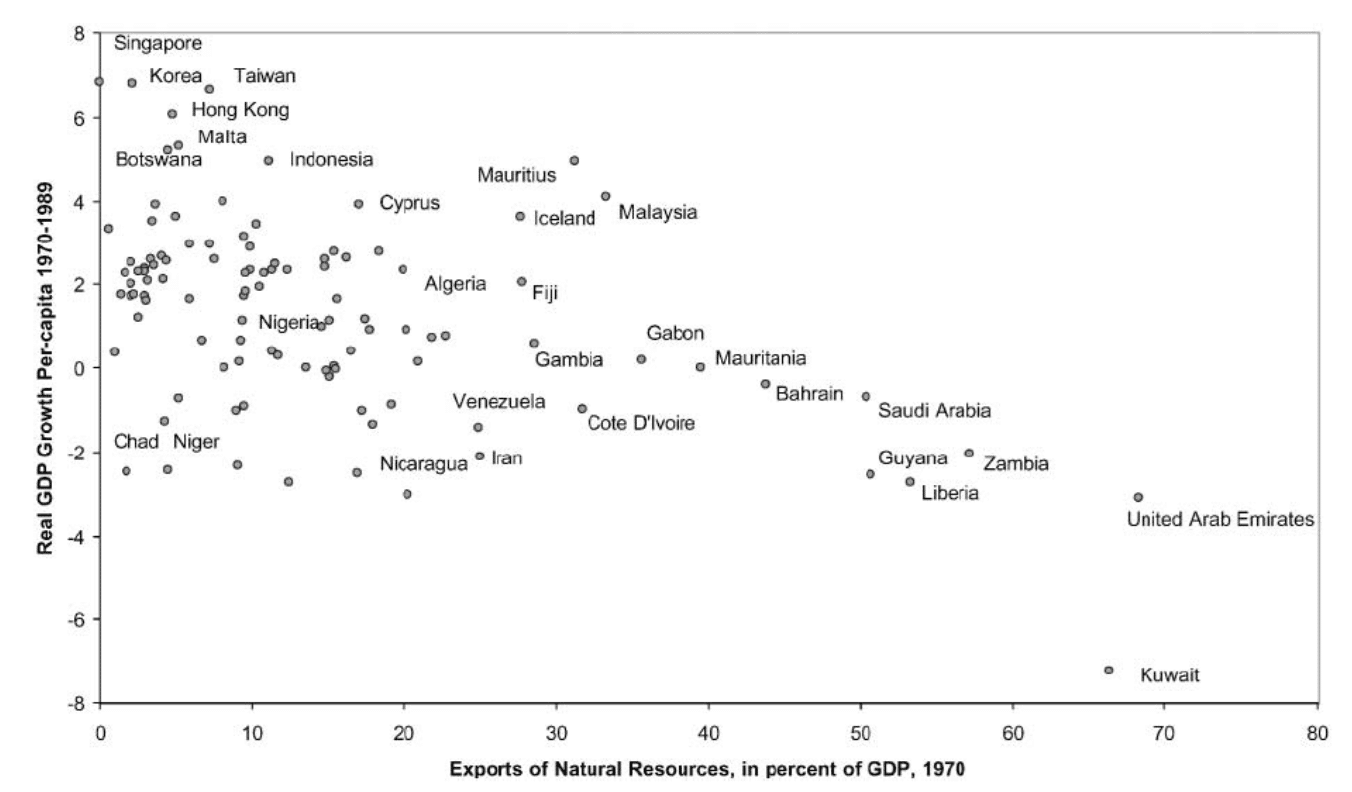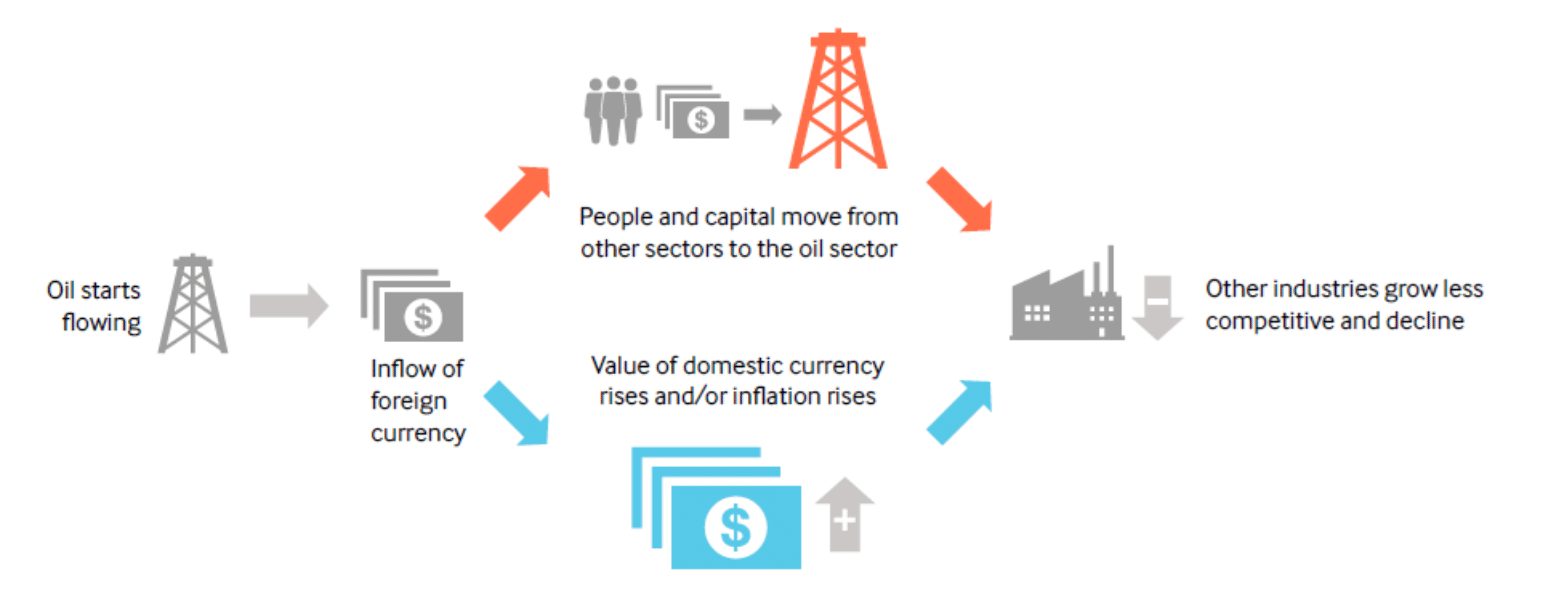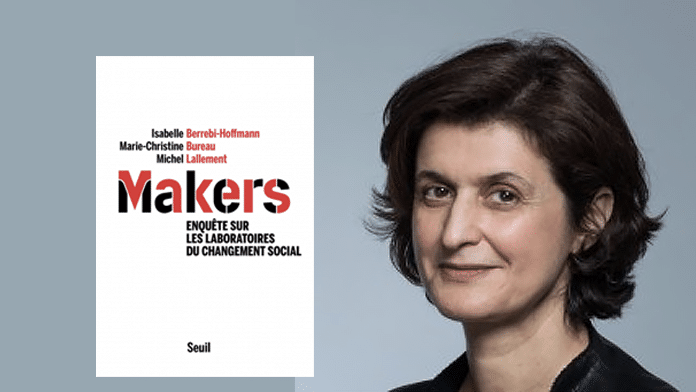Francesco Callegaro est philosophe. Originaire d’Italie, il s’est formé en France où il a soutenu une thèse sur l’autonomie sous la direction de Vincent Descombes. Il a ensuite rejoint le LIER-FYT, laboratoire de l’EHESS qui cherche à relancer l’ambition de la sociologie, par un croisement fécond avec la philosophie et l’histoire, la linguistique et le droit. Il a participé à ce travail collectif en publiant La science politique des modernes. Durkheim, la sociologie et le projet d’autonomie, puis en dirigeant le numéro de la revue Incidence Le sens du socialisme. Depuis 2016, il a quitté la France pour l’Argentine. Il enseigne philosophie, sociologie et histoire conceptuelle à l’Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Buenos Aires. Milo Lévy-Bruhl est doctorant en philosophie politique à l’EHESS. Sa recherche porte sur le socialisme français et la question juive. En croisant philosophie, sociologie et psychanalyse, ils confrontent dans cet échange en deux parties le populisme de Chantal Mouffe et Laclau au socialisme qu’ils repensent à nouveaux frais et à la situation politique actuelle en Argentine et en Europe. Deuxième partie. Entretien en collaboration avec Hémisphère gauche.
Milo Lévy-Bruhl – Si je résume votre critique de Chantal Mouffe, elle consiste à dire que son populisme de gauche ne sort pas du cadre du libéralisme. Il n’en serait qu’une variante égalitaire. C’est du même coup vers le socialisme qu’il faudrait se diriger. Le socialisme ne part pas de l’individu, comme le libéralisme, et pas non plus de la nation ou de l’Etat, comme le conservatisme, plus ou moins réactionnaire. Il part de la société, ce qui veut dire aussi des acteurs et des groupes qui la composent. C’est ce que dit son nom. Mais qu’en est-il alors du peuple ?
Francesco Callegaro – La rencontre entre la société et le peuple s’est faite à la suite d’une « heureuse équivoque ». C’est l’expression qu’utilise Comte dans son Discours sur l’ensemble du positivisme, écrit en 48. Surtout en français, nous dit-il, « le mot peuple rappelle sans cesse que les prolétaires ne forment point une véritable classe mais constituent la masse sociale d’où émanent les diverses classes spéciales[1]». Ici, dans la sociologie naissante, le terme « peuple », comme l’a souligné à juste titre Bruno Karsenti, a pris une signification irréductible au sens hérité de la politique du droit naturel.[2]Si le peuple en tant que masse sociale n’a rien en commun avec le sujet politico-juridique du libéralisme, c’est qu’il n’en partage pas les traits constitutifs.Loin d’être le produit d’une abstraction qui rend tous les sujets homogènes, il se caractérise au contraire par son hétérogénéité interne. Surtout, ce peuple n’est pas universel, je veux dire qu’il n’inclut pas tous les individus : l’immense majorité, pour reprendre une expression que l’on retrouve souvent sous la plume de Saint-Simon et de Marx, comme de Durkheim et Mauss, pour être immense, n’est pas moins une partie. Ce n’est pas tous. C’est ce qui déplace la question du pouvoir : la démocratie n’est plus la souveraineté du peuple-tous, sur le plan de la représentation, c’est le gouvernement du peuple-partie, en dessous, à travers et au-delà de la représentation, l’autogouvernement de la masse sociale d’où émanent diverses classes spéciales. De ce point de vue, la véritable réactivation de la démocratie a été une répercussion du socialisme. C’est un fait historique attesté, même si l’on tend à l’oublier.
MLB – Cette définition de Comte, est-ce la définition sociologique du peuple ?
F.C. – Non, je n’irai pas jusque-là. Je dis seulement qu’au niveau historique, au niveau philologique, au sens de Gramsci, il y a une tradition alternative à la tradition libérale prédominante dans laquelle le peuple n’est qu’une construction politico-juridique, incluant tous les individus, donc aussi l’oligarchie à laquelle devrait s’opposer le peuple de gauche. Dans cette tradition alternative, le peuple a préservé son référent réel, sans être pour autant réductible à cette autre figure de l’homogène qui hante la pensée de Schmitt, la nation ethnique. C’est un peuple lié au travail, qu’on ne peut comprendre que si on y introduit la division qui rend possible la coopération : il y a ici un sens distinctif du lien social qui tient à la répartition et à la coordination des tâches en vue d’une œuvre commune. On en a fait une affaire de plans bureaucratiques, alors qu’il s’agit d’un mode de la solidarité, comme l’a d’ailleurs montré Durkheim. Cela dit, il faudrait suivre plus loin le destin de ce peuple, inséparable du destin d’une démocratie se situant en deçà et au-delà de la scène représentative. Le fait que cette tradition ait persisté dans le langage commun ne suffit pas à en démontrer la consistance.
MLB – Comment reprendre alors cette tradition ? Il en va de la possibilité de défier le dispositif libéral avec un populisme qui serait cette fois-ci solidaire d’un peuple réel.
F.C. – On a besoin sur ce point d’une reprise sociologique. Car si le socialisme a réinventé la politique moderne, en logeant le savoir au cœur de la politique, il reste, malgré tout, une idéologie. C’est inexact de le réduire à un cri de douleur, à une série de plaintes et de demandes. Mais l’exigence d’un retour à l’action lui est aussi inhérente, ce qui veut dire qu’il s’expose aux risques d’une pensée pressée. La sociologie suppose un effort supérieur de distanciation, d’où sa proximité avec la philosophie. C’est la marque de sa distinction par rapport au socialisme. Pourtant, depuis cette distance, elle préserve un lien avec la source de son regard sur la réalité. De ce fait, la sociologie opère une rupture singulière vis-à-vis du sens commun. J’y faisais allusion la dernière fois, en parlant de retour au réel des rapports. C’est ce qu’a très bien décrit Bruno Karsenti dans l’introduction de son livre, D’une philosophie à l’autre[3]. Contrairement aux sciences naturelles qui se débarrassent des concepts ordinaires, la sociologie ne rompt avec le langage commun que pour en retrouver le noyau de vérité. Elle doit parler comme nous, en quelque sorte. C’est donc de son travail que l’on peut attendre une récupération du peuple. C’est elle qui devrait nous dire ce qui s’y cache, encore aujourd’hui, si l’on sort des fictions juridico-rhétoriques.
MLB – Si je reprends la tâche conceptuelle que Durkheim a placée au fondement de toute enquête sociologique, le premier problème à résoudre concernerait la définition du critère d’appartenance. Si ce n’est pas tous et chacun, comme dans la théorie libérale, il y a bien un principe qui doit faire le partage entre nous et eux.
F.C. – C’est le problème qu’ont essayé de résoudre Laclau et Mouffe. Le terme de critère fait penser à des propriétés objectives qu’on pourrait établir abstraction faite de la relation que les sujets établissent avec la classification qui en résulte. Ce que Mouffe appelle anti-essentialisme revient à refuser la possibilité de classifications objectives de ce genre. Laclau et Mouffe ont pourtant oublié un trait singulier de ces sujets qu’ils cherchent à ne pas enfermer dans des classifications : c’est que les sujets se classifient eux-mêmes et parfois avec une satisfaction étonnante. On peut être tout à fait fier de faire partie du peuple, je veux dire de cette masse hétérogène qui soutient la société, le revendiquer et même y ordonner sa vie. C’est tout à fait sensible en Argentine. Cette appartenance y est d’abord liée au travail et à la lutte pour la participation et la justice.
« Le socialisme doit partir des mouvements sociaux et de leurs créations »
MLB – On pourrait alors chercher le peuple là où se donnent à voir des réponses aux logiques sociales qui produisent de l’injustice. Celles et ceux dont les conditions de vie sont prises dans les dynamiques sociales qui créent des injustices reconnaissables comme telles par la société, voilà le peuple.
F.C. – C’est une bonne hypothèse, à condition de préciser un point : l’analyse réflexive de la société, dont la sociologie est le corrélat, est précédée par le travail que font déjà les groupes présents dans la société pour dénoncer les injustices subies et surtout pour y remédier. On met trop l’accent sur les plaintes, on oublie qu’il y a un au-delà de la demande. Le désir de justice ne s’épuise pas dans la demande de réparation. Si vous reprenez le chapitre de Mauss sur le socialisme, ce qu’il souligne, en contrepartie de la perception du social, c’est l’extraordinaire créativité des masses. Mauss y met un accent à lui, mais les faits qu’il avance sont parlants : syndicats, mutuelles, coopératives, etc. Autrement dit, le socialisme doit partir des mouvements sociaux et de leurs créations, pour autant qu’ils sont le fruit de masses plus ou moins organisées. C’est dans cette activité que se produisent les réponses qu’il faudrait ensuite savoir synthétiser. On est très loin de la « chaîne d’équivalence » de Laclau et Mouffe.
MLB – Le peuple de gauche serait ainsi le lieu où l’on cherche à remédier activement aux injustices. Peut-on dire qu’il s’agit de l’endroit où l’on produit de la solidarité ?
F.C. – Durkheim avait très exactement cette position. A ses yeux, les classes populaires jouissaient, du point de vue sociologique, d’un privilège certain, en ce qu’elles représentaient la voie d’accès à l’endroit de la société où s’élabore une idée plus élevée de justice, en réponse à des situations d’injustice. C’est bien de production de solidarité qu’il s’agit, en effet. Car quoi qu’on en dise, le concept de solidarité est indissociable d’une référence à la justice. Il ne s’agit pas d’un concept purement fonctionnel : l’interdépendance ne produit une forme spécifique de solidarité que parce que la coopération subvertit les relations d’exploitation inhérentes au capitalisme. Durkheim était sur ce point sur la même ligne de Marx. Il voyait la classe ouvrière comme le point le plus exposé d’une logique économique affectant la société dans son ensemble et du même coup le foyer d’une politique ayant à embrasser l’ensemble des sphères, du fait même que le capital, ce fait social totalisant, tendait à pénétrer partout. Pour rejoindre notre présent, il faudrait alors reprendre et même développer les analyses d’auteurs qui, comme Karl Polanyi, ont déployé une perspective sociologique analogue, pour écrire l’histoire du capitalisme au XXème siècle. C’est ce que fait mon collègue d’ici, le sociologue Alexandre Roig, en croisant Mauss et Polanyi avec l’Ecole régulationniste.
« Ce qui manque au socialisme c’est une organisation, des intellectuels, pas les aspirations socialistes »
MLB – Qu’en est-il dès lors de la politique, dans ce cadre aussi social que total?
F.C. – L’adoption d’un regard à la fois socialiste et sociologique suppose un élargissement de la politique, Mauss y a insisté à plusieurs reprises. Dans cette perspective, le peuple se configure en effet comme la partie du tout où le tout commence à se penser en tant que tel, dans la solidarité qui l’innerve et doit l’innerver, à travers toutes les sphères d’interaction, bien avant que l’État n’intervienne. Il s’agit de la partie de la société dans laquelle surgit la politique, au sens non pas de cet affairement autour du pouvoir auquel se réfèrent les politistes qui ont lu Max Weber, mais bien en ce sens ancien, situé sur le bord de la modernité libérale, qu’évoque Mauss dans la dernière phrase de son Essai sur le don: l’« art suprême » en quoi consiste la « direction consciente » de la « vie en commun »[4]. C’est « la politique au sens socratique ». Cet art est démocratique lorsqu’il est pris en charge par la pluralité de groupes hétérogènes qui composent la masse sociale, se faisant peuple du fait même d’assumer une telle charge à un degré significatif. Telle est la définition du peuple et de la démocratie qu’on a perdu de vue suite à la glaciation politique des trente dernières années. Personne n’en parle, ni au Parti Socialiste, ni même à la France Insoumise.
MLB – Comment expliquez-vous cette glaciation ?
F.C. – Il faudrait l’expliquer sociologiquement. Cyril Lemieux a amorcé une recherche sur le socialisme en tant que tendance historique et sur les classes populaires comme le lieu, dans la société, où la conscience de la société commence à émerger. Il faudrait lui demander ce qu’une approche en termes pragmatiques, sensible aux classifications spontanées des acteurs auxquelles je faisais allusion tout à l’heure, permet de mettre en évidence quant à la persistance du peuple. L’hypothèse qu’on partage, c’est qu’il ne faut pas chercher le socialisme là où l’on croit le trouver, c’est-à-dire dans les discours et programmes des partis. Pour autant, le fait qu’ils ne rendent pas visible le peuple et même qu’ils tendent à l’occulter ne veut pas dire que le socialisme soit absent. Dans les pratiques et les discours, il y a des revendications de justice sociale, de démocratie réelle, des agencements surtout, où l’on peut identifier des traces significatives – mais il faudrait faire des enquêtes sérieuses pour le démontrer – du socialisme tel qu’on vient de le définir.
MLB – Le socialisme et son peuple sont donc absents sur le plan de l’expression explicite, politique et théorique, pas dans la réalité.
F.C. – Ce qui manque, c’est une organisation, des intellectuels, pas les aspirations socialistes. Aspirations, pas au sens de rêveries, mais d’engagements et d’actions, de pratiques concrètes, voire d’institutions. C’est la symbolisation théorique qui manque, ce qui laisse la place libre à une capture par des discours et des programmes non socialistes. La sociologie est très en deçà de la tâche que lui avaient fixée ses fondateurs, du moins en France. Il y a des sociologues militants qui en sont venus à envisager leur fonction comme consistant à donner une voix aux sans-voix. C’est tout de même extraordinaire. On dirait qu’ils vivent dans un bocal à poissons. Alors que si l’on prend la peine d’écouter les discours des acteurs, on est fort susceptible d’y entendre quelque chose de ces traces dont on parlait.
MLB – Vous ne considérez pas que le populisme de gauche répond à cette attente de symbolisation ?
F.C. – Non, je crois même qu’il s’agit d’un symptôme assez frappant de la rencontre ratée entre les intellectuels et le peuple. Chantal Mouffe indique toute une série de phénomènes qui démontrent l’existence d’une réaction à la Réaction, qu’on voit bien dans la montée de l’extrême-droite. Ce sont ces éléments dispersés qu’elle a cherché à réunir sous l’étiquette de « populisme de gauche ». Elle aurait mieux fait, je crois, de revenir aux sources. Le populisme de gauche, c’est le socialisme. Mais il faut en tirer les conséquences : au peuple, il faut lui redonner sa consistance, c’est la condition de sa puissance, y compris en matière d’égalité de droits. Alors même qu’elle vient de passer quatre ans d’une rare brutalité, l’Argentine le démontre : la résistance singulière à la destruction néo-libérale y remonte à la présence de masses organisées qui se savent peuple et agissent en conséquence. Et je vous fait remarquer que le mouvement féministe n’y est pas exclu. C’est dire à quel point l’opposition à l’oligarchie, lorsqu’on la prend au sérieux comme procédant d’un sujet collectif en action, peut être inclusive.
MLB – La référence au peuple n’écrase pas les différences.
F.C. – Si je me réfère à l’expérience argentine, on voit bien qu’il y a des tensions, mais elles dynamisent le travail de la politique. Il faut dégager des entrecroisements, mettre à jour les joints, resserrer les nœuds de la volonté générale, ce qui suppose un retour sur soi des uns et des autres. L’un de ces joints est bien le travail, c’est-à-dire aussi bien le fait de l’exploitation que celui de la coopération. C’est ce qui a été condensé, pour revenir au féminisme, dans la grève internationale des femmes du mouvement 8M. La connexion peut aller si loin que Veronica Gago, sociologue et militante du collectif Ni Una Menos, a pu soutenir que le mouvement féministe, tel du moins qu’il se pratique en Argentine, recèle la possibilité de penser l’émergence d’un peuple effectif au-delà du peuple abstrait du populisme, par quoi elle entend faire référence à Laclau et Mouffe[5].
MLB – Etes-vous en train de dire que la réalité politique de l’Argentine ne correspond pas au populisme qu’envisage Mouffe ? C’est pourtant pour la rendre pensable que Laclau a élaboré sa théorie.
F.C. – C’est tout le paradoxe. Laclau a fait un énorme effort intellectuel pour arracher la réalité politique de l’Argentine à la marginalité anomique à laquelle la destinait la science politique officielle, figée dans l’opposition entre démocratie et autoritarisme.Il a souvent rappelé cette inscription politique de sa pensée, ce qui est tout à son honneur. On l’oublie trop souvent lorsqu’on transpose les catégories qu’il a forgées à d’autres contextes. Il n’en reste pas moins qu’à partir de La raison populiste, Laclau a accusé une dérive qui, en l’éloignant du terrain social-historique, l’a conduit à la théorie politique. Pour sauver le populisme, il a essayé de lui donner une sorte de dignité ontologique, ce qui est une autre manière de le perdre. On ne saurait saisir le nœud vital du populisme effectif en s’orientant avec le schéma qu’il a mis en place dans son dernier ouvrage. Ce qu’on appelle ici « mouvement national-populaire » s’en écarte d’abord par ce seul trait, que le peuple n’y est pas perçu comme l’objet d’une construction discursive, suspendue à l’identification au signifiant du leader. C’est un sujet collectif de premier plan. Il a la consistance palpable de la masse sociale hétérogène dont parlait Comte.
« Le populisme latino-américain est organisé autour de trois pôles : le parti, les mouvements sociaux et les intellectuels »
MLB – C’est un populisme avec le peuple réel.
F.C. – C’est tout l’intérêt de ce mouvement. Loin d’être le résultat d’une construction discursive, il est toujours supposé dans tous les discours. Même l’analyse de la place nodale du leader serait donc à reprendre, car il n’apparaît pas comme cet objet d’identification qui condense en lui-même le peuple, ne serait-ce que parce qu’il en est plutôt l’interlocuteur. Le leader s’adresse au peuple, à la masse sociale en action, il ne le fait pas exister comme sujet politique. Cette relation repose sur une organisation qui la rend possible. Avant les revendications, c’est l’organisation qui marque l’originalité de ce qu’on nomme « populisme latino-américain », du moins pour ce que j’en vois en Argentine. Le peuple y figure, dans l’hétérogénéité qui le compose, comme le pôle d’une configuration complexe qui a comme contrepoint l’État en sa fonction de gouvernement, d’où la centralité du leader, mais aussi tous ceux qui portent la parole d’une multiplicité d’organisations sociales et politiques. Cette configuration inclut aussi l’Université, et plus généralement tous les lieux de production du savoir où travaillent les intellectuels qui ne cessent d’intervenir dans le processus de formation de la volonté générale. Bien loin de représenter une anomalie politique, fruit d’un débordement, c’est en matière d’organisation que ce mouvement a plus d’une leçon à nous donner.
MLB – Vous savez que ça m’intéresse. Concrètement, ça se passe comment ?
F.C. – L’image à laquelle on reste figé, ce sont les rassemblements océaniques où le leader s’adresse à une immense masse en fête. C’est très impressionnant, tout à fait décisif pour une compréhension adéquate du phénomène, mais aussi trompeur. Car l’essentiel se déroule dans les coulisses du quotidien. Il suffit d’ailleurs d’observer de plus près cette masse sociale pour s’apercevoir qu’elle n’a rien d’une multitude. On y distingue toute sorte d’organisations qui travaillent au jour le jour, de façon disséminée, pour faire vivre la politique. Il faudrait donc remettre en mouvement l’image arrêtée et suivre plutôt le processus, celui dont Laclau et Mouffe ont cherché à rendre compte par leur schéma logique, mais qui le dépasse très largement. Pour ne donner qu’un seul exemple, j’ai assisté l’autre jour à une réunion des équipes techniques du « Frente de todos », la nouvelle alliance du champ national-populaire. J’ai été frappé d’y rencontrer des centaines de personnes, travailleurs, représentants des mouvements sociaux, chercheurs, étudiants, figures politiques, etc., réunis dans les amphithéâtres de la Faculté de médecine pour débattre de l’ensemble des sujets de l’actualité : État, démocratie, éducation, sécurité, justice sociale, économie populaire, etc. Chaque intervention faisait valoir une expérience, une lutte, un savoir, un projet… Je ne sais pas quel sera le destin des synthèses qui ont été rédigées à la fin, mais le processus collectif me paraît en lui-même significatif. Comme ils partagent un même engagement et qu’il y a une organisation solide à l’arrière-plan, aucun des trois pôles – le Parti, les mouvements sociaux et les intellectuels – ne m’a semblé prendre le pas sur l’autre.
MLB – Pourquoi selon vous ce processus n’a pas lieu en Europe ?
F.C. – C’est une bonne question. L’un des obstacles de fond, il me semble, c’est la contradiction apparemment insurmontable entre parti et mouvement. On le voit bien à la profusion de mouvements qui ne veulent pas être des partis, alors qu’ils manient les rouages du pouvoir, comme le M5S en Italie. Prenons l’exemple de la déclaration de Mélenchon aux gilets jaunes : je ne veux pas les récupérer, je veux être récupéré. A quoi ils ont répondu : surtout pas. Ça fait penser à la lettre d’amur de Lacan : je te demande de me refuser ce que je t’offre, parce que ce n’est pas ça. C’est ce mur qu’il faudrait abattre. Car on est bien dans l’embarras : le parti ne veut pas récupérer un mouvement qui ne veut pas se greffer à un parti. Le résultat, c’est une sorte de perte entropique de puissance. Le parti sans le mouvement se vide d’expérience, en se décrochant du social, alors que le mouvement sans le parti, s’il n’est pas aveugle, il ne voit pas non plus très loin. En dernière instance, la responsabilité de cette impuissance incombe aux partis, parce qu’ils sont incapables de mettre en place une organisation vivante qui préserve la tension avec les mouvements sociaux, tout en s’en nourrissant. Cette incapacité, c’est la catastrophe des partis socialistes européens depuis plus de trente ans. Mais c’est la forme-parti même qui est à repenser, ce qui veut dire aussi le sens et la fonction de la représentation.
MLB – Alors que la spécificité d’un parti socialiste ce serait précisément ce branchement sur la société.
F.C. – Oui, il faudrait avoir un enracinement dans la société – vous sentez bien quelle dérive peut s’ouvrir si on entend par là la « société civile », le « marché » – et en particulier là où les nouvelles formes de solidarité sont en train d’émerger. Mais afin que les désirs puissent porter à conséquence, je parle des désirs qui s’expriment, au-delà de la demande, sur le plan des actes, la médiation des sciences sociales me paraît tout aussi indispensable. Et c’est là qu’on rencontre un second obstacle. En Europe, à gauche en particulier, c’est devenu un lieu commun de penser que le savoir, s’il fait une différence, c’est surtout en négatif. On a une sorte de terreur de l’autorité du savoir. Toute médiation savante est perçue d’emblée comme une médiation experte qui nous dessaisie de la vérité de l’expérience. C’est surtout à ce niveau qu’une rupture s’est consommée, par rapport à ce sens inédit de la politique dont le socialisme a été le porteur, selon l’analyse de Mauss. On soupçonne, parfois à juste titre, que la sociologie n’exprime pas le sens du social et même qu’elle l’étouffe.
MLB – Est-ce qu’il y a de la place pour une figure qui ne soit pas celle de l’expert ?
F.C. – Je poserais la question autrement. Est-ce qu’on peut se passer de médiations ? On ne peut pas, tout d’abord parce que l’idée d’expérience immédiate est un leurre : le langage est déjà médiation. Dans notre modernité, il a même atteint un degré de sophistication scientifique sans précédent. C’est dire que lorsqu’on croit en rester à l’auto-compréhension immédiate, on ne fait que reproduire les médiations hégémoniques. Ensuite et surtout parce que ce qui se présente sur l’autre front, le front néo-libéral, n’est pas une construction discursive, c’est un agencement très verrouillé. L’idéologie a sans doute un noyau fantasmatique, autrement elle n’attraperait pas le sujet, mais elle repose aussi sur des élaborations théoriques qui se matérialisent dans des dispositifs tout à fait opératoires. Bref, on manipule du savoir sans le savoir. Et c’est bien souvent un savoir expert : psychologie, économie, droit, etc.
MLB – Est-ce que la sociologie s’en écarte ?
F.C. – Le style de pensée sociologique se distingue, bien sûr, de l’intervention experte délivrant des informations quantifiées prêtes à l’emploi. En raison de son inscription sociale, elle se caractérise par un effort de problématisation qui vise à ouvrir l’horizon du pensable, à chaque fois que l’idéologie libérale tend à le fermer en occultant le réel des rapports. Comme l’avait déjà fait remarquer Mauss, le sociologue doit être à l’affut des « mouvements nouveaux des sociétés », car c’est là que se produisent les perturbations du sens commun libéral, du fait que la politique s’y réactive au plus près des problèmes qu’on doit affronter.
MLB – Doit-on s’en tenir dès lors à une articulation de ce qui émerge dans les mouvements sociaux ?
F.C. – Non, au contraire, il faut les accompagner avec un savoir qui les excède. On ne peut pas faire l’économie de l’économie, si je puis dire. Dégager les tendances du capitalisme, d’un point de vue décentré par rapport au discours de l’économie orthodoxe, reste une tâche incontournable. Il en va de même pour les métamorphoses de l’État et du droit. Pense-t-on pouvoir réaliser une réforme constitutionnelle sans aucune forme de médiation savante ? Bref, il nous faut retrouver la voie de la critique radicale, ce qui suppose pas mal de savoir, si on ne veut pas tomber dans les pièges du dispositif libéral. D’où le besoin, il me semble, de mettre en place quelque chose d’analogue à la circulation entre les trois pôles qui innerve la vitalité politique du dit populisme argentin.
MLB – Cette modalité d’organisation collective du travail politique et intellectuel, c’est donc ça le populisme argentin ?
F.C. – Je crois bien, oui. Mais pour en en tirer les enseignements, encore faudrait-il vouloir changer la société, surtout ces « institutions secondes », comme les appelait Castoriadis, qui sont l’État et le marché. Est-ce que c’est vraiment le cas en Europe ? On a plutôt l’impression qu’on attend. Qu’est-ce qu’on attend ? Je ne sais pas, mais on attend. L’extrême droite a pris les devants parce qu’elle n’attend pas. On revient au problème de toute à l’heure : ce qui manque, ce sont moins les aspirations socialistes que leur élaboration tout à fait explicite, un travail situé à la frontière de la politique et de l’intellectualité. C’est le grand problème de notre situation : la réaction à la Réaction – le socialisme – est intellectuellement et politiquement désarmée…
« Tous les nœuds du discours doivent être refaits, depuis la société jusqu’au peuple et au leader, en passant par les groupes, le conflit, la représentation, la démocratie, etc. »
MLB – N’êtes-vous pas en train de dire que ce qu’il nous manque est bien une stratégie hégémonique socialiste ?
F.C. – À condition de garder à l’esprit les critiques formulées jusqu’ici, je serais d’accord, en effet. Dans leur ouvrage de 1985[6], Laclau et Mouffe ont eu le mérite de nommer le problème et d’indiquer une issue possible. A une époque où l’on commençait déjà à le laisser tomber, ils n’ont pas cédé sur le mot, « socialisme », et sur le besoin de mettre en place une nouvelle hégémonie, susceptible d’articuler les demandes de la pluralité de groupes au centre des nouveaux mouvements sociaux. Celle-ci reste la tâche actuelle de la gauche. Mais vous voyez bien ce qu’il faut repenser pour freiner la dérive libérale qui l’affecte depuis trente ans. Tous les nœuds du discours doivent être refaits, depuis la société jusqu’au peuple et au leader, en passant par les groupes, le conflit, la représentation, la démocratie, etc. C’est sur ce point que la médiation sociologique m’apparaît décisive. La relance de la sociologie et des sciences sociales est une partie essentielle d’une nouvelle « stratégie socialiste ».
MLB – Je ne voudrais pas qu’on achève cet entretien sans avoir parlé du clivage gauche-droite. Vous avez préféré utiliser les trois idéologies modernes – libéralisme, conservatisme, socialisme – et vous avez développé ce qu’est la modalité spécifiquement socialiste d’organisation de la politique, qui repose sur une compréhension sociologique du réel. Les socialistes partent des mouvements sociaux et les éclairent grâce aux sciences sociales, au nom d’idéaux. Partir du réel pour faire triompher des idéaux, c’est bien ça la gauche socialiste.
F.C. – Je suis d’accord avec vous, mais il faudrait préciser alors le niveau de réalité auquel on situe le clivage gauche-droite. Gauche et droite de quoi ? De quel corps ? Il faut, ici encore, déborder le politique, selon l’expression que Dumont a repris de Mauss. On ne peut pas comprendre le socialisme si l’on cherche la gauche dans le Parlement, on risque même de le confondre avec le libéralisme. Le corps qu’il faut prendre en considération, c’est le corps social. La métaphore organique est très utile à ce propos : elle nous rappelle que la main gauche, comme l’a montré Robert Hertz, c’est la main soumise, donc la main des insoumis. Hors métaphore, c’est à l’intérieur de la société qu’on doit trouver la droite et la gauche comme deux manières incompatibles d’envisager la politique et pas seulement comme deux partis ou deux courants politiques.
« c’est surtout l’État social qu’il nous faut repenser, avec le degré requis de radicalité»
MLB- Quels sont alors les idéaux sociaux de la gauche ?
F.C. – Il faudrait arriver à répondre en saisissant quelque chose qui précède et dépasse le langage abstrait du droit, autrement on retombe dans les apories de la « souveraineté du peuple » et de l’« égalité ». L’idée de « solidarité » est un bon exemple de ce débordement du politique, d’autant plus significatif qu’elle préserve un lien étroit avec le droit, via la référence centrale à la justice. A cet égard, il me semble que c’est surtout l’État social qu’il nous faut repenser, avec le degré requis de radicalité. Vous connaissez tout le travail qui a été fait par la sociologie française sur cette question, mais aussi en Allemagne avec des figures comme Hermann Heller. Le livre de Mauss sur la nation était en fait une tentative de repenser la « République sociale ». C’est resté en chemin, contrairement à ce que laissent entendre les analyses qui réduisent cette anticipation sociologique à une préfiguration de ce qu’a été le Welfare State. Raison de plus pour s’y pencher de nouveau, alors que cette construction juridique est en crise.
MLB – Mais qu’est-ce donc qu’un idéal, s’il doit excéder les formules juridiques ?
F.C. –Pour répondre, nous avons besoin d’une approche croisant sociologie et psychanalyse. Les idéaux sont en effet des objets sociaux de désir. Il faudrait donner à « désir » son sens psychanalytique. Lacan l’a défini très exactement comme le reste de la demande. Est-il dès lors destiné, ce désir en excès, a être attrapé par les fantasmes de l’idéologie ? N’y a-t-il pas aussi une autre satisfaction, sur le plan de l’action et d’une action sociale ? Il faudrait revenir à Freud. La plateforme épistémologique qu’on esquisse depuis tout à l’heure, la plateforme de la critique radicale, n’est pas complète sans la psychanalyse.
MLB – Sur ce point vous rejoignez Laclau.
F.C. – Oui, mais seulement dans la mesure où il est passé à côté de Psychologie des masses. Présent dans l’ouverture de La raison populiste, Freud y est réduit à un penseur oscillant entre la foule et le peuple. Aux prises avec les limitations inhérentes à la théorie politique, Laclau n’a pas vu que Freud a cherché à penser aussi et peut-être surtout la structure libidinale de la société. Même Lacan est resté assez silencieux sur ce point pourtant si décisif. C’est l’objet de mon travail actuel que d’amener à jour cette structure, où se cache une politique de la psychanalyse qui se ne réduirait pas aux querelles d’École. On compte sur les doigts d’une main les analystes qui ont entrevu cette dimension de la pensée de Freud. Colette Soler[7]a écrit à ce sujet, mais c’est peu par rapport à la tâche qui nous incombe. Il en va de la possibilité de saisir l’inconscient du peuple. Sans ce socle, on ne peut pas comprendre la source des dynamiques sociales dont résulte l’existence même d’une gauche socialiste. On ne comprend pas non plus les impasses subjectives du libéralisme, car on ne mesure pas son incidence sur les affects.
MLB – On revient au sujet évoqué lors de notre premier entretien, le grand sommeil, l’apathie.
F.C. – En effet. Qu’est-ce qu’est l’apathie et comment on en sort ? Avec un discours sur l’égalité de droit ? Non. L’apathie, c’est un état du sujet, un sujet sans pathos. Il faut bien plus que la doxa libérale pour lui redonner quelque passion. Il faudrait d’ailleurs associer à chaque pôle du trièdre idéologique un affect spécifique. Quel est l’affect sous-jacent au libéralisme ? Si l’on s’en tient aux classiques, à Hobbes, il faudrait répondre la peur, voire la terreur. L’expérience sociale récente prouve qu’il s’agit aussi d’autre chose. Si l’on reprend ces pathologies qu’ont étudié les psychanalystes, les « pathologies du vide », au premier chef la dépression, on voit bien que la peur s’accompagne aussi d’autre chose, lorsqu’on ne se réfère plus au rapport à l’État, mais à la société civile qu’il engendre : l’envers de l’inquiétude de Locke, l’envers du seul désir envisagé par l’économie politique, l’envers de la poussée pour la conservation de la vie et l’accumulation des biens, c’est un dégout pour la vie même. C’est la mélancolie, comme on disait avant la médicalisation des affects. La biopolitique libérale fait circuler quand même quelque chose qui est de l’ordre de la pulsion de mort. Sur ce point, je crois que Freud a touché au plus profond : pour fixer un au-delà du principe mortifère du plaisir, il faut un objet au désir inconscient qui maintienne le sujet sous tension.
MLB – Vous décrivez une dynamique des affects qui échappe à la logique du discours.
F.C. – Le discours est décisif, mais en tant qu’il se greffe sur des corps. Il faut avoir du même coup des instruments – psychanalytiques – pour capter ces déplacements d’affects qui ne sont pas de l’ordre de la construction discursive. Le discours ne produit rien à lui seul, il ne permet que de faire émerger, comme il arrive en analyse. C’est un premier élément pour repenser ce que suppose la mise en place d’une nouvelle hégémonie socialiste, si elle doit être autre chose qu’un artifice rhétorique. Une fois de plus, elle suppose une plongée au milieu de la société. Car n’oublions pas que la société, comme le disait Mauss, c’est avant tout une affaire de corps et de réactions des corps, du fait même d’être constituée par des idées.
« C’est la tâche du grand législateur que de rendre possible le passage à l’acte du peuple »
MLB – Le leader de gauche doit alors être à la société ce que le psychanalyste est au sujet ?
F.C. – Ce dialogue entre politique et psychanalyse, on avait essayé de le nouer au milieu des années 60. Je pense au grand livre de Habermas, Connaissance et intérêt. Si l’on excepte les travaux de Castoriadis, c’est un programme qui est resté en gros sans suite. Il faut du même coup tout reprendre. En ayant en tête les failles de la théorie populiste de Laclau, j’ai récemment fait un premier essai, dans un article sur Rousseau et Durkheim consacré à la figure du législateur, l’être d’exception qui rend possible l’émergence du sujet collectif de la politique, le peuple[8]. Freud y est présent entre les lignes, mais il manque une prise en compte sérieuse de Psychologie des masses. A part un article saisissant de Karsenti[9], je n’ai pas trouvé à ce propos beaucoup de soutien.
MLB – C’est étrange d’associer la figure du législateur au nom de Durkheim. On croit souvent que sa sociologie repose sur l’exclusion du grand homme de la scène de l’histoire.
F.C. – On imagine mal qu’un sociologue qui a réussi à socialiser le suicide, acte individuel s’il en est, ait rencontré des difficultés à rendre compte de la signification sociale d’un chef politique. Durkheim l’a si peu occulté que dans les Formes élémentaires il en a esquissé le profil, jusqu’à en faire presque la théorie. En un mot, un individu qui rêve d’occuper la place du grand législateur ne peut y arriver que dans la mesure où il se fait la métonymie du groupe. Il doit savoir amener à l’expression les désirs qui s’y travaillent, notamment dans ces phases de crises que marquait, aux yeux de Durkheim, un degré élevé d’effervescence. Nous y sommes, presque. En ce sens, il ne peut être un leader démocrate que s’il porte la voix du peuple, tel que nous l’avons défini plus haut, ce qui suppose qu’il sache se brancher sur la société et ses groupes, en apportant des lumières autant qu’il en reçoit, là où il est question de solidarité. Mauss a repris cette conception. Dans son livre sur la nation, il dit du grand législateur qu’il exprime la « notion absurde » aussi bien que l’« illusion fondée » que l’« homme peut changer arbitrairement les sociétés ». Il y a toute la tension entre science et politique, sociologie et socialisme, dans cette phrase.
MLB – Est-ce aussi votre idée du législateur ?
F.C. – En profitant de la rigueur logique qui caractérise la réflexion juridico-politique moderne sur les conditions du contrat social, aussi bien que des brèches ouvertes par Rousseau, l’inquiet, dans la dogmatique libérale, j’ai essayé de faire du législateur le point logique et réel sans lequel l’idée d’une démocratie effective ne saurait se soutenir. La volonté générale d’un peuple agissant comme le sujet collectif de la politique ne se conçoit comme pouvant être consacrée par des lois que si elle émerge du fond de l’histoire d’une société déjà faite. C’est la tâche du grand législateur que de rendre possible le passage à l’acte du peuple. On n’a pas du tout besoin de penser qu’il s’agit d’un individu, et encore moins d’un homme, je veux dire d’un sujet marqué par ce que les analystes décryptent au titre de la jouissance phallique. Comme l’a montré Stefania Ferrando, en prolongeant les recherches de Luisa Muraro, c’est même sur le sens et la portée de l’autorité symbolique que le féminisme a laissé une trace singulière dans la pratique et la pensée politiques. C’est donc la fonction symbolique qui compte.
MLB – Cette figure exceptionnelle, hors normes, fait craindre le despotisme, l’autoritarisme. Le régime représentatif s’est érigé contre ce danger, d’où le primat de la « rule of law ». C’est le reproche qu’on adresse d’ailleurs aux populismes latino-américains que de mettre en danger la République, l’État de droit.
F.C. – Le spectre de la soumission de tous à la volonté d’un seul procède d’une inversion exacte du législateur : c’est son ombre, plus que sa figure. Si l’on suit le raisonnement de Rousseau, tel qu’il a été repris par Durkheim et Mauss, il faut dire, au contraire, que ce personnage d’exception ne s’élève à une sorte de souveraineté singulière, extra legem, que parce qu’il est subordonné aux idéaux de la société. Ce n’est pas lui qui détient les clés de la volonté générale, il ne fait qu’en rendre possible l’émergence sur le plan du discours qui prépare l’adoption d’une loi. Il ne peut pas ne pas être subordonné à la société, s’il entend remplir ce rôle. C’est une relation où le primat est détenu, en fait et en droit, par la société. Si l’on se reporte à l’Argentine, on voit bien que le leader répond à une attente collective. C’est ce que la théorie du populisme de Laclau et Chantal Mouffe ne laisse même pas soupçonner.
MLB – Qu’est-ce que vous voulez dire ?
F.C. – Je veux dire que le schéma logique composé à partir de la pluralité de demandes, de la chaîne d’équivalence et du point d’identification ne permet pas de comprendre ce qui se passe dans cette rencontre étonnante entre le leader et le peuple à laquelle je faisais allusion plus haut. Ce qu’on attend, lors de ces rassemblements océaniques, c’est en effet un discours, mais au sens de la rhétorique classique : la place à part du leader se marque par une capacité sans égal d’articuler la parole et l’action, dans une synthèse permettant d’avoir tout à la fois une vision claire de la situation et de ce qu’elle exige, compte tenu de l’histoire de la société. Mauss en a fait un portrait très juste, au moment de souligner l’originalité de l’art politique. Le politique se signale, comme il le dit, par « son habileté à manier les formules, à trouver les rythmes et les harmonies nécessaires, les unanimités et à sentir les avis contraires »[10]. C’est ça un leader, pas un signifiant, mais un sujet qui parle et qui s’en sort d’ailleurs assez bien avec la parole pour dévoiler et recomposer, dans un seul discours, l’hétérogénéité du peuple, afin que la volonté soit en effet générale, ce qui est bien la condition pour qu’on passe à l’acte. Mais il faudrait préciser, bien sûr, car je m’imagine que cette description ne suffit pas à éloigner le spectre d’un plébiscite écrasant les droits de la minorité. Il faudrait développer, à ce propos, une autre conception du conflit, irréductible aux négociations pragmatiques dont parle Mouffe. La démocratie véritable est inséparable du vote à la majorité, comme l’a souvent souligné Castoriadis, ce qui veut dire aussi qu’elle suppose le conflit permanent avec la minorité. Il ne s’agit pas de nier les garanties constitutionnelles.
« En politique, on ne commande pas, d’ailleurs, on persuade. Et pour être capable de persuader, il faut d’abord savoir écouter et entendre. »
MLB – Le point clef de cette conception sociologique du chef, c’est donc son auto-compréhension comme dépendant de la société.
F.C. – Exactement. C’est la différence que fait le gouvernement, comme l’a si bien expliqué, encore une fois, Giuseppe Duso. Ce renversement est capital, si l’on veut comprendre les conditions de constitution d’un leader qui ne serait pas un despote. Le chef est un être de gouvernement, ce qui veut dire qu’il oriente et coordonne l’activité d’une pluralité de groupes hétérogènes dont la composition échappe à sa décision, car elle en est la condition. Ce n’est pas le point d’accumulation du pouvoir, déplacé depuis le parlement jusqu’à l’exécutif. La logique du gouvernement exige autre chose que l’accumulation du pouvoir de commander. En politique, on ne commande pas, d’ailleurs, on persuade. Et pour être capable de persuader, il faut d’abord savoir écouter et entendre. C’est tout l’art de la rhétorique. Il faut savoir saisir là où pointent les tendances, là où émergent les aspirations, afin que la puissance sociale s’exprime sur le plan politique.
MLB – Il me semble qu’il faudrait pénétrer davantage dans cette « ombre qui accompagne le législateur » dont vous avez parlé, pour comprendre ce qui arrive aujourd’hui. N’est-ce pas ce type de leader autoritaire qui caractérise le populisme de droite ?
F.C. – Oui, vous avez raison, il ne faut pas oublier « l’ombre du législateur ». Quant au populisme de droite, cette expression me paraît occulter ce dont il s’agit : on fait comme si le problème était sa conception du peuple, alors qu’il s’agit de sa conception de la nation. Le fait manifeste est une recrudescence du nationalisme. Karsenti et Lemieux ont eu raison de lever ce voile, car il nous empêche de prendre les mesures de ce qui nous arrive. Ne sachant pas penser la nation pour son propre compte, la gauche se trouve dans l’impasse : elle ne sait pas comment contrer l’attaque, au moment même où le renvoi à l’Europe paraît avaliser la pire compromission avec le néo-libéralisme.
MLB – Karsenti et Lemieux font référence à Mauss précisément sur ce point. Ils essayent de sauver la nation du nationalisme.
F.C. – Ils ont bien raison, car l’approche sociologique nous ouvre une perspective inédite sur la nation. En prenant ses distances du fétichisme nationaliste, Mauss a investi la nation de ce sens du social qui fait le propre du socialisme. Alors même que ses attentes ont été déçues par la montée du fascisme, l’essentiel de son message n’a pas perdu sa pertinence : il ne peut y avoir de nation insoumise, je veux dire de gauche, que si l’on travaille activement à la constitution de cette réalité de niveau supérieur, à cette fédération que Mauss appelait « Internation ». On peut y reconnaître un autre nom de l’Europe sociale qui peine aujourd’hui à émerger. L’alternative à cet internationalisme socialiste n’est pas la démocratie libérale, c’est la rechute dans le nationalisme souverainiste qu’on pense mal en l’appelant « populisme de droite ».
MLB – Vous parlez de « fascisme ». On entend quotidiennement crier à son retour…
F.C. – C’est une insulte libératrice, plus qu’une description satisfaisante. C’est souvent excessif, surtout lorsqu’on finit par embrasser, en raison de l’effet de miroir induit par la représentation, l’ensemble d’une société. On se croit entourés par une populace xénophobe, prête au pire. Cela dit, le rapprochement permet de cerner ce qui est à l’œuvre aujourd’hui.
MLB – À quoi pensez-vous ?
F.C. – À ce qu’a mis en évidence Georges Bataille, à l’époque où il a essayé de penser la communauté, ou plus exactement le « mouvement communionel », en croisant la sociologie de Durkheim et Mauss avec la psychanalyse de Freud. Lors d’une séance du Collège de sociologie, il a esquissé une définition du « pouvoir » qui, en excédant le langage du droit, me semble aller au cœur du phénomène sur lequel il nous faut de nouveau réfléchir. Le pouvoir prend forme, selon Bataille, lorsqu’un individu cherche à capter la puissance sociale dégagée par un mouvement d’ensemble, pour la freiner en la mettant au service de la conservation.
MLB – Cela ne suffit pas à cerner le fascisme.
F.C. – Vous avez raison, Bataille a ajouté d’ailleurs un autre trait, décisif : la « réunion institutionnelle de la force sacrée et de la puissance militaire en une seule personne »[11]. Or, à cet égard, il me semble que si l’on est bien en présence, à l’extrême droite nationaliste, de la formation d’un pouvoir qui cherche à capter la puissance au bénéfice de la conservation, de soi et des institutions, nous n’en sommes pourtant pas au pro patria mori. Il y a des signes inquiétants, c’est vrai, je pense notamment à la manipulation politique de la religion chrétienne, allant tout à fait à l’encontre de la lutte pour la libération qui marque, ici en Argentine, la signification politique de la théologie. L’accumulation du sacré ne me semble pourtant pas aller dans le sens de la guerre, à moins qu’on ne veuille penser sous ce chef la violence exercée sur les migrants. Car c’est surtout cette violence qui, en Europe, fait parler d’un fascisme renaissant. Tout ce qui compte, c’est de savoir intercepter ces signes, pour organiser la réponse.
MLB – C’est donc encore une fois une question d’organisation.
F.C. – Tout à fait. Il ne s’agit pas d’attendre l’homme providentiel. Dans la perspective que nous avons esquissée, la place centrale de la fonction de gouvernement que nous avons nommé « grand législateur » ne se rend intelligible que sur le fond de l’organisation préalable du mouvement d’ensemble, de cette puissance sociale que le pouvoir pas encore tout à fait fasciste à la fois capte et freine, alors qu’il s’agit, pour nous, d’en rendre possible la pleine expression, pour qu’elle puisse transformer la réalité instituée. On peut conclure sur ce point, car le terme d’« organisation » résume à lui seul la relation à distance entre socialisme et populisme. Il n’y en a pas d’autres en effet qui condense mieux ce qu’a été et voulu être le socialisme : au-delà de la phase critique, il devait y avoir une phase organisée. Organisation toujours déjà en cours d’ailleurs, à quelque degré, s’il est vrai qu’il s’agissait et qu’il s’agit de mesurer et régler les rapports entre idéaux et pratiques, futur et présent. La créativité des masses dont parle Mauss en a été le témoignage : toutes les inventions de la classe ouvrière n’avaient qu’une visée, produire en acte une nouvelle organisation. Mais c’est vrai aussi du féminisme comme de l’écologie. Et c’est bien ce que j’observe en Argentine, lorsque je suis ce processus politique qu’on résume en parlant de populisme. Des masses sociales hétérogènes aussi créatives qu’organisées. Nous avons esquissé tout à l’heure en quoi consiste cette organisation. C’est ce mode d’organisation qui me semble révolutionnaire, si vous voulez, et qu’il faudrait chercher à reprendre. S’il est vrai qu’historiquement le populisme de gauche, c’est le socialisme, le socialisme d’aujourd’hui ne peut à son tour retrouver son esprit qu’en étant bien plus populiste que ce qu’il n’est.
[1]A. Comte, Discours sur l’ensemble du positivisme, Paris, Librairie scientifique-industrielle, 1848.
[2]B. Karsenti, Politique de l’esprit. Auguste Comte et la naissance de la science sociale, Paris, Hermann, 2006.
[3]B. Karsenti, D’une philosophie à l’autre, Paris, Gallimard, 2013.
[4]M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris,1925.
[5]V. Gago, La potencia feminista, Buenos Aires, Tinta Limon, 2019.
[6]E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Towards a radical democratic politics, London, Verso, 1985.
[7]C. Soler, Qu’est-ce qui fait lien ?, Paris, Éditions du Champ lacanien, 2012.
[8]F. Callegaro « Le législateur et l’inconscient du peuple. Rousseau avec Durkheim », Etica & Politica/Ethics & Politics, XX(2), “‘Civil’ Religion : an uneasiness of the Moderns ?”, 2018, p. 211-2443
[9]B. Karsenti, « Identification et reconnaissance. Remarques freudiennes. » L’injustice sociale. Quelles voies pour la critique(2013): 149-166.
[10]M. Mauss, « Division concrète de la sociologie », in Essais de sociologie, Paris, Minuit, 1968.
[11]D. Hollier, Le Collège de sociologie(1937-1939), Paris, Folio Essais, 1995.