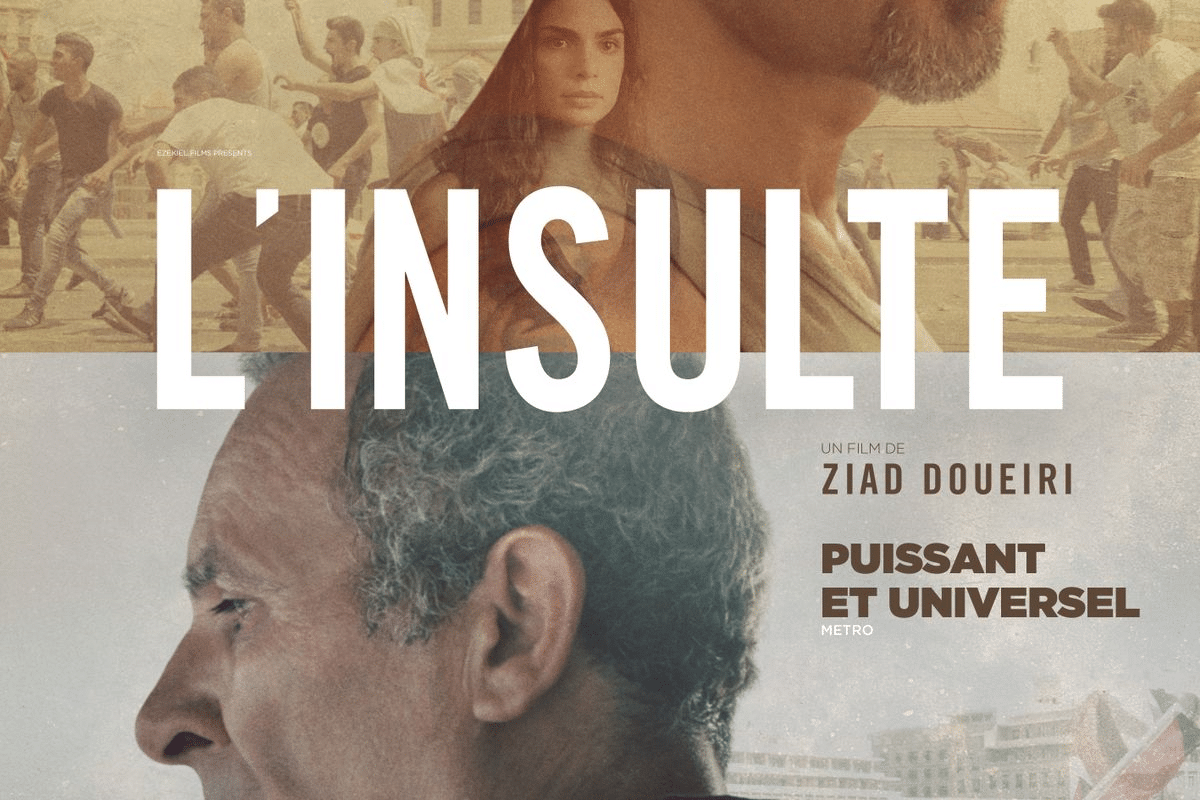Pouvoir exsangue, institutions engluées dans des divisions politiques et confessionnelles exacerbées par le conflit syrien, élections remises aux calendes grecques, crise économique parmi les plus violentes de l’Histoire avec une inflation à quatre chiffres : le Liban traverse ses heures les plus sombres depuis la guerre civile (1975-1990). Pourtant, au milieu du chaos souffle un vent d’espoir. Après l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, une mobilisation collective sans précédent, soutenue par la diaspora et les organisations non gouvernementales (ONG), a permis de réparer une grande partie des dégâts causés dans les quartiers les plus impactés. Une reconstruction « par le bas », sans la moindre aide publique, qui a donné des idées au monde intellectuel pour bâtir une société plus juste. Un reportage de Nicolas Guillon.
C’est leur 11 septembre. Mais un 11 septembre qui serait intervenu dans la foulée d’un 24 octobre 1929 et dans un contexte pandémique. « Le 4 août 2020 a été l’explosion ultime venue clore une série », explique Alexis Abdallah, de l’ONG Live Love Beirut 1. Comme un Jugement dernier s’abattant sur ce Liban miné par ses sempiternelles luttes confessionnelles et une corruption politique à la limite de l’imaginable qui l’a plongé dans l’une des plus importantes crises économiques que l’on ait vues depuis deux siècles, au point de mettre son existence en péril. Car, comme le rappelle Fadlallah Dagher, le doyen de l’Académie libanaise des beaux-arts (Alba) 2, « le Liban est une idée plus qu’une réalité ».
Lorsque ce jeudi noir, à 18h08 heure locale, presque cent ans jour pour jour après le tracé officiel par la puissance mandataire française des frontières de l’Etat du Grand Liban, se produit dans le port de Beyrouth l’une des plus importantes explosions non-nucléaires de l’Histoire 3, le pays, reconfiné depuis quelques jours suite à une résurgence de cas de Covid-19, traverse une terrible récession. Durant le seul mois de juillet, la livre libanaise a perdu deux tiers de sa valeur et c’est tout un pays qui est en train de basculer dans la pauvreté. Alexis pointe une tour luxueuse en premier rideau du blast : « Tout le monde a été impacté, les plus pauvres comme les plus aisés, car comment voulez-vous réparer des dégâts lorsque votre argent est inaccessible ? »
En déambulant dans les rues pentues de la colline d’Achrafieh sur laquelle l’onde de choc s’est propagée, le jeune homme raconte l’indescriptible : « la forte chaleur ressentie, le souffle qui vous envoie dans la pièce d’à-côté, la déflagration que vous entendez de façon sourde ». Et puis, en sortant de chez soi, les premières images du désastre : les immeubles sans ouvertures voire sans façade, dont bon nombre menacent de s’effondrer, les habitants qui n’ont plus que leur voiture pour abri, les médecins de l’hôpital Geitaoui qui traitent les blessés dans la rue à la lumière de leur smartphone, les jeunes accourus pour balayer les innombrables débris, les livreurs qui, dans une ville pétrifiée, mettent spontanément leurs deux-roues à la disposition des secours : « Trois cents mobylettes ont sauvé trois cents vies », résume Alexis. À l’écoute de ce récit apocalyptique, le bilan officiel faisant état de 215 morts et 6 500 blessés apparaît presque miraculeux.
Pourtant, s’il ne persistait quelques stigmates du traumatisme, ici une structure métallique maintenant un édifice debout, là une bâche recouvrant un échafaudage, difficile, trois ans plus tard, de s’imaginer l’ampleur de la catastrophe. En effet, à Mar Mikhael comme à Gemmayzé, secteurs entièrement dévastés par l’explosion, la vie semble avoir repris son cours, même si en soirée le faible nombre de fenêtres éclairées trahit un certain exode. « Welcome to Lebanon ! », lance de sa voix tonitruante Charbel aux clients franchissant le seuil du restaurant Le Chef, une institution de la rue Gouraud, qui a survécu à la guerre civile. Ici s’entassent joyeusement, dans une salle ne dépassant pas les vingt-cinq couverts, familles du quartier, expatriés et touristes en recherche d’authenticité. Comme l’indique le nom du lieu, chez Le Chef on parle français, bien que la devise de la maison s’affiche en anglais au comptoir : « A generous hand in a broken land ». Une formule en parfaite adéquation avec l’esprit et l’énergie qui ont prévalu dans la ville depuis la « nuit du 4 août ».
Macron et l’espoir déçu
Certes, faute de puissance publique, la reconstruction du port n’a toujours pas débuté et l’enquête piétine. Présent sur zone dès le 6 août 2020, Emmanuel Macron avait pourtant suscité un grand espoir parmi la population. Mais depuis, rien, si ce n’est un jeu dangereux comme l’écrivait, le 3 avril dernier, Anthony Samrani, dans le quotidien libanais L’Orient-Le Jour : « Emmanuel Macron a mené ici une politique parfois incohérente, souvent illisible. (…) Près de trois ans plus tard, aucune réforme n’a été mise en œuvre, le Liban continue de se déliter et rien ne permet de penser que la situation va s’améliorer à court et moyen terme. » En arrière-plan, une élection présidentielle qui n’en finit pas d’être reportée et pour laquelle Paris soutient la candidature de Sleiman Frangié 4. « Mais comment Emmanuel Macron, qui appelait encore en décembre dernier les Libanais à « changer de leadership » et à « dégager les responsables politiques qui bloquent les réformes », a pu se retrouver dans la situation de celui qui doit « vendre » le candidat du Hezbollah aux Saoudiens ? », s’interroge l’éditorialiste.
De fait, Le Liban est aujourd’hui coincé entre deux veto. Mais la nature ayant horreur du vide, la société civile n’a pas tardé à remplir la case laissée vacante par le pouvoir. Engagés depuis octobre 2019 dans un mouvement de manifestation ayant conduit à la chute du gouvernement, les activistes étaient sur le pied de guerre, les ONG déjà à l’œuvre sur le terrain et les universitaires au chevet de leur ville martyrisée ; alors la mobilisation collective fut instantanée pour réparer ce qui pouvait l’être sans nécessiter une intervention d’en haut. « Les gens étaient dépassés par l’ampleur des dégâts, il fallait dans un premier temps répondre aux besoins urgents, explique Bachir Moujaes, architecte, enseignant à l’Alba et alors habitant d’Achrafieh. Il faut bien comprendre que sitôt la sidération passée on est confronté à l’ingérable : il n’y a plus de compteurs d’électricité, de réservoirs d’eau. » À l’initiative de l’Ordre des ingénieurs et architectes de Beyrouth 5, un état des lieux est immédiatement engagé. La zone impactée est divisée en cinquante-deux super îlots et autant d’équipes sont constituées qui vont œuvrer durant deux mois sur la seule base du volontariat. Considéré comme le « Monsieur Patrimoine » de Beyrouth, Fadlallah Dagher appelle le Service des Antiquités pour offrir les services de son agence, puisqu’il s’avère que la pierre a davantage souffert que le béton. C’est l’acte de naissance de l’association Beirut Heritage Initiative (BHI) 6, dont le logo apparaît aujourd’hui sur de nombreux panneaux de chantier : « Toutes les bonnes volontés se sont retrouvées et nous nous sommes réparti le travail. Nous avons établi des cartes, un plan d’actions. Ce fut un moment de grâce. »
Puis très vite vient le temps de travaux. Les ONG parent à la première urgence, remettent compteurs et réservoirs en état de marche : il faut encourager les habitants qui le peuvent à revenir au plus vite chez eux et permettre à ceux qui ont refusé de quitter les lieux de revivre le plus rapidement possible dans des conditions décentes. Les donations affluent : sommes consistantes mais également modestes. À sa création en 2012, Live Love Beirut se limitait à une équipe de quatre personnes ; elles sont désormais plus de cinquante à travailler pour elle. « Suite à l’explosion, nous avons commencé par monter des opérations de l’ordre de 3 000 USD (ndlr, 2 738 EUR), aujourd’hui certaines atteignent 2,5 millions USD (ndlr, 2,28 millions EUR) », annonce fièrement Alexis Abdallah. Les opérations en question s’organisent par cluster, c’est-à-dire par groupe de quatre, cinq, six, voire une dizaine de bâtiments, comme dans celle qu’Alexis nous fait visiter. Concrètement, une fois les dégâts inventoriés, un partenariat est engagé avec les propriétaires, langue est prise avec le gouverneur de la ville, l’ONG sollicitée débloque les fonds et les appels d’offres aux entreprises sont lancés. Là encore, étape après étape, chacun apporte son écot : un cabinet d’avocats se met en disponibilité pour rédiger les contrats, des entreprises acceptent de travailler à marge réduite sans pour autant transiger sur la qualité – une gageure au Liban où l’exception a toujours fait office de règle. Dans la continuité de l’état de grâce, une confiance s’est installée. « Nous avions le budget pour rénover douze bâtiments, finalement nous avons pu en faire vingt-deux », s’étonne encore Fadlallah Dagher. Du côté de Live Love Beirut, le bilan des rénovations dressé en mars dernier est spectaculaire : 385 appartements, 45 immeubles patrimoniaux, 55 magasins pour un total de plus d’un millier de bénéficiaires. On serait tenté de vanter pour la énième fois la résilience du peuple libanais mais celui-ci ne veut plus entendre ce mot qui semble servir de prétexte à toujours alourdir un peu plus son fardeau. La résilience ne saurait être durable.
« Nous avons surtout le sentiment d’avoir inventé un processus nouveau parce que les grandes opérations de reconstruction sont généralement dirigées par la puissance publique ou déléguées à une société privée d’aménagement, comme cela fut le cas pour le centre-ville de Beyrouth après la guerre civile », précise l’architecte franco-libanais Jad Tabet, président de l’Ordre au moment du recensement des dégâts 7. Deux modèles bien évidemment inadaptés au Liban tant que la vacance du pouvoir perdurera et qu’un équilibre économique et financier n’aura pas été recouvré. Mais c’est peut-être, paradoxalement, une chance pour Beyrouth qui, en l’absence d’institutions fonctionnant démocratiquement, est parvenue à imaginer un autre mode de faire, non plus top down mais bottom up, c’est-à-dire partant de la base, une méthode, qui correspond finalement assez bien à ce pays si singulier. Un adage libanais ne dit-il pas : « Si tu as compris le Liban c’est qu’on te l’a mal expliqué ».
Centre-ville fantôme
Car force est de constater qu’il fait meilleur se promener dans les quartiers bordant le port, même après l’explosion, même sur des trottoirs étroits et défoncés, au milieu de la jungle des voitures et de l’odeur des ordures, que dans les rues gentrifiées du downtown, certaines aujourd’hui barrées de rouleaux de barbelés pour protéger quelque dignitaire n’ayant pas la conscience tranquille. Depuis les manifestations de 2019, il est, en effet, impossible d’accéder à la place de l’Étoile où trône la tour de l’Horloge. Autour, un centre-ville fantôme que la crise a vidé de ses occupants privilégiés. Le grand œuvre de Rafiq Hariri, assassiné en ces lieux-mêmes, ne ressemble plus qu’à un décor de cinéma dont même les enfants de réfugiés ont disparu. Pour une fois qu’un projet ne reste pas au fond d’un tiroir, celui-ci apparaît aujourd’hui totalement anachronique. Ce qui se voulait être un centre du monde, avec ses malls luxueux, est devenu une impasse, illustration d’un libéralisme poussé au bout de sa logique, qui, à force de mensonge et d’immoralité, en vient à nier toute humanité.
Avec ses cafés tous plus accueillants les uns que les autres, ses souks alimentaires et ses ateliers d’artiste, la vitalité sociale et créative des quartiers de Gemmayzié et Mar Mikhael offre un contraste saisissant, dont les enseignements à tirer dépassent le contexte libanais. En contrepoint des habituelles démarches capitalistes aboutissant bien souvent à la confiscation de la vie par le béton, s’épanouit ici une urbanité organique et inclusive qui commence au seuil de son domicile et s’étend jusqu’à la rue, pour donner la priorité aux liens. Après l’apocalypse, l’arbre a repoussé. Cet « urbanisme du possible », comme l’a joliment défini Bachir Moujaes, apparaît dès lors comme un motif d’espérance dans les cas les plus désespérés. L’architecte mène avec ses étudiants des travaux sur cet urbanisme « tactique » qui s’affranchit de la planification. En parallèle de l’action sur le terrain, cinq des sept écoles d’architecture du pays ont planché sur les grands principes qui pourraient demain présider à la construction d’un écosystème pour une ville plus juste, tant sur le plan spatial que social. Un travail qui a abouti à la publication d’un document référence : la « Déclaration de Beyrouth » 8. Selon Mona Fawaz, de l’Université américaine de Beyrouth (AUB) 9, cette régénération hors portage politique de sa capitale offrirait deux opportunités au Liban : « d’une part l’invention d’un nouveau modèle économique, plus redistributif et moins spéculatif, d’autre part le dépassement des confessions par le vivre-ensemble ».
Mona Fawaz était de la liste « indépendante, non confessionnelle et paritaire » Beirut Madinati (ndlr, en arabe, Beyrouth est ma ville) qui osa défier les partis traditionnels lors des élections municipales de 2016. Beirut Madinati récolta 30 % des suffrages mais… aucun siège au conseil, la loi attribuant la totalité de la représentation à la liste arrivée en tête du suffrage. Qui plus est, au Liban, on ne vote pas dans son lieu de résidence mais dans la commune de ses racines familiales, ce qui fait qu’à peine 200 000 personnes ont leur mot à dire sur la gestion d’une ville qui compte deux millions d’habitants. « Cette situation traduit bien le divorce qui existe entre le pays légal et le pays réel, développe sa collègue et colistière Mona Harb. Cela fait plus de vingt ans que nous travaillons à la construction d’une ville plus juste, qui rejaillirait bien entendu sur l’ensemble du pays. Nous nous battons contre les projets les plus insensés, nous faisons du bruit. Depuis les relevés post-explosion, nous sommes en possession d’une importante somme de données, nous savons précisément quelle propriété appartient à quel propriétaire (la moitié des immeubles du front de mer au seul clan Hariri). Il serait parfaitement envisageable d’instaurer une taxe sur les plus-values immobilières pour financer un autre projet de société. C’est très frustrant parce que nous sommes prêts et qu’il y a actuellement, de par la faiblesse du pouvoir, une fenêtre pour agir, pour insuffler une dynamique nouvelle. » Fadlallah Dagher mise, lui, sur le fait inéluctable que « les vieux chefs de guerre qui ont installé un esprit tribal au sein de l’Etat finiront par disparaître ».
Le 13 avril 1986, le poète libanais Antoine Boulad écrivait ces lignes dans L’Orient-Le jour : « Un pays vole en éclats lorsque sa capitale est atteinte. Une capitale se désintègre lorsque son centre est détruit. Ces deux cercles concentriques qui font une nation, les hommes politiques de demain n’auront dansé que sur leurs débris. Ainsi, il n’y aura plus de politique au Liban. J’ai peine à croire qu’il y aura des hommes. » 10 Trente-sept ans plus tard, constatons que l’oracle s’est trompé sur au moins un point.
Remerciements à Ariella Masboungi, Grand Prix de l’urbanisme 2016, pour son aide précieuse dans la construction de ce reportage.
Notes :
2. Alba: Université De Balamand – Académie Libanaise Des Beaux-Arts
3. Selon des spécialistes de l’Université de Sheffield, au Royaume-Uni, l’explosion du port de Beyrouth aurait atteint 1/10ème de la puissance de la bombe atomique ayant détruit Hiroshima.
4. Entre Riyad et Paris, le fossé se creuse, article de Mounir Rabih in L’Orient-Le Jour, 20 mars 2023.
6. https ://beirutheritageinitiative.com
7. Beyrouth, un processus innovant de reconstruction, Jad Tabet et Ariella Masboungi : entretien croisé in revue Urbanisme, novembre 2021.
8. Déclaration urbaine de Beyrouth – FRAN FINAL.pdf (oea.org.lb)
10. Les franges incendiées du ciel, Antoine Boulad in Le goût du Liban, p. 89-91, texte choisis par Georgia Makhlouf, coll. Le petit mercure, Editions Mercure de France, août 2021.