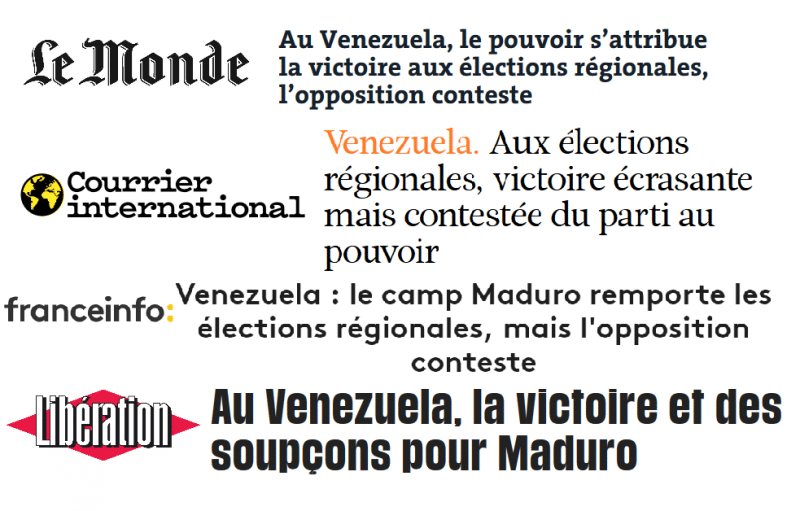Depuis l’invasion de l’Ukraine, plusieurs « États voyous », hier honnis, retrouvent les bonnes grâces de Washington. Tout à leur volonté de sanctionner la Russie, les États-Unis ont été contraints de se rapprocher de plusieurs de leurs adversaires géopolitiques, notamment l’Iran et le Venezuela, exportateurs majeurs de pétrole. Sous le joug d’un quasi-embargo financier depuis plusieurs années, le Venezuela a particulièrement souffert des sanctions imposées par Washington, qui pourraient bientôt être levées. Si la population en a fait les frais, si l’économie vénézuélienne en est sortie été dévastée, le gouvernement, lui, n’a pas été ébranlé par les sanctions. Nous avons rencontré Temir Porras, qui fut vice-ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Hugo Chávez, puis directeur de cabinet de Nicolas Maduro, avant de démissionner. Il revient pour Le Vent Se Lève sur l’impact des sanctions américaines sur le Venezuela, la récente convalescence de l’économie du pays, et les perspectives politiques qui se dessinent. Entretien par Vincent Ortiz, retranscription Agathe Contet.
Le Vent Se Lève – La situation économique du Venezuela s’améliore. Comme vous le notez dans un article pour le Washington Post, l’inflation est passée sous la barre des 10 % mensuels, tandis que le taux de croissance pour l’année 2021 est extrêmement élevé. Pensez-vous que cela soit lié aux mesures de libéralisation des taux de changes mis en place depuis 2018 par le gouvernement de Nicolas Maduro – notamment les facilités accordées à la convertibilité avec le dollar ?
Temir Porras – Il s’agit d’un facteur fondamental. L’économie vénézuélienne est historiquement liée à la production pétrolière. Depuis le milieu des années 70, cette production est essentiellement sous contrôle étatique – la société nationale pétrolière PDVSA joue un rôle central, accentué depuis l’élection de Hugo Chávez. La PDVSA peut, dans certaines zones où une technologie particulière est nécessaire, s’associer avec des partenaires privés, mais à condition qu’elle demeure majoritaire. Des sociétés d’économie mixte peuvent être établies, mais la société vénézuélienne doit être propriétaire d’au moins 50 % des actions, avec un monopole sur la commercialisation. L’État possède donc de fait un contrôle sur l’exploration, la production et la commercialisation du pétrole.
L’industrie pétrolière occupe plus de 90% des exportations, et c’est la principale source de revenus en monnaie dure, en dollars. Celui-ci, dans une économie périphérique comme le Venezuela, joue un rôle fondamental, y compris dans l’économie non pétrolière. Même si les revenus de la vente du pétrole ne représentent qu’une fraction du PIB, cette composante est capitale car l’économie vénézuélienne est incapable de produire tous les biens et les services qu’elle consomme et dépend fortement du reste du monde pour les technologies qu’elle utilise. De plus la monnaie vénézuélienne n’est pas librement convertible ; elle n’est pas demandée sur les marchés internationaux – où elle n’a pas de valeur en soi -, il faut donc passer par le dollar pour commercer. Les habitants des pays du Nord n’ont pas toujours conscience de la différence fondamentale entre une économie périphérique – dépendante du dollar – et une économie du centre.
[NDLR : Pour une analyse des difficultés structurelles rencontrées par les économies extractivistes dépendantes du dollar, lire sur LVLS l’article d’Andrés Arauz : « Triage monétaire : comment la pandémie révèle les fractures Nord-Sud » et celui de Pablo Rotelli : « Richesse des terres et pauvreté des nations : l’éternelle malédiction des ressources en Amérique latine »]
L’État joue donc un rôle central dans l’obtention de ces devises : c’est lui, et non le secteur privé, qui procure les dollars dont le pays a besoin. Et c’est un arbitrage d’État qui décide de l’allocation de ces devises à tel ou tel secteur. C’est dans ce contexte que le système de contrôle de changes a pu être justifié.
Depuis plusieurs années, la PDVSA est frappée par des sanctions américaines. Si l’on est rigoureux, il ne s’agit pas de sanctions au sens du droit international, mais des mesures unilatérales coercitives imposées par un État tiers. Ce ne sont pas des sanctions des Nations unies ou du Conseil de sécurité, ce sont des mesures prises par le gouvernement des États-Unis à l’encontre de la PDVSA, qui l’empêchent de commercer avec eux – bien que les États-Unis étaient longtemps été la principale destination du pétrole vénézuélien.
La stratégie américaine a consisté à mettre en place un sabotage économique visant à générer un changement de régime.
Les sanctions visent également à empêcher la PDVSA d’utiliser le dollar : c’est là où le problème de l’extraterritorialité du droit commence. Le dollar est la monnaie des États-Unis mais aussi celle du commerce international. À partir du moment où une société est empêchée d’utiliser le dollar, toutes les banques vont fermer ses comptes, par crainte d’être en violation de la législation américaine. En effet, même si elles ne sont pas américaines, ces banques opèrent en dollar, et sont donc passibles de sanctions si elles permettent à une société sous sanctions de posséder un compte. N’importe quelle banque du monde occidental – et même non occidental – est obligée d’opérer en dollars, donc une mesure législative interne aux États-Unis affecte des tiers en dehors des États-Unis.
[NDLR : Le Vent Se Lève organisait en janvier une conférence à Assas dédiée à l’extra-territorialité du droit américain avec Frédéric Pierucchi, Juliette Alibert et Jean-Baptiste Souffron : « Le droit américain, une arme de guerre économique ? »]
Donc dès lors qu’une société est frappée de sanctions, elle ne peut plus utiliser le dollar et elle n’a plus de compte bancaire. La PDVSA peut bien tenter d’exporter son pétrole malgré tout, mais dans quelle monnaie serait-elle payée ? Cette source de devises étant tarie, toute l’économie vénézuélienne à son tour se voit privée de dollars, donc dans l’incapacité de fonctionner.
De son côté, l’État vénézuélien, frappé lui aussi de sanctions, ne peut plus se financer. Il pourrait émettre de la dette dans sa propre monnaie, mais cette monnaie n’a pas de pouvoir d’achat international – raison pour laquelle les pays périphériques ont tendance à émettre de la dette en dollars, ce qui n’est plus possible au Venezuela. L’État se voit privé de ses revenus pétroliers, de la possibilité de s’endetter et de financer son déficit public. Il commence alors à financer sa dépense par de la création monétaire… ce qui, dans une économie coupée du monde, produit très rapidement des effets hyper-inflationnistes. C’est la descente aux enfers.
L’État a donc reculé, contraint, permettant au secteur privé – lequel échappe aux sanctions – d’opérer grâce à la dollarisation de l’économie. Dans un contexte d’hyperinflation, le principal problème est que l’on ne sait pas combien les choses vont coûter demain : il est impossible de programmer, planifier, calculer une structure de prix, un coûts, un retour sur investissement, etc. Le secteur privé a donc mécaniquement gagné en importance, l’État étant empêché de jouer le rôle qui était historiquement le sien.
La stabilisation de l’économie a donc à voir avec une meilleure circulation du dollar. Une fois que le dollar commence à circuler, cela a pour premier effet la stabilisation de la hausse des prix : le secteur privé peut en effet à nouveau importer des denrées, ce qui engendre une baisse drastique des niveaux de pénurie. Cela permet de réactiver de larges secteurs de l’économie, ainsi que le commerce, dans un pays qui était à l’arrêt.
La croissance économique se calculant sur l’année précédente, l’année 2021 était la première année durant laquelle l’économie a pu fonctionner d’une façon à peu près normale après des années de chute libre. D’où cette croissance entre 7 et 8,5%. Il faut tout de même prendre en compte le fait que l’économie vénézuélienne n’est qu’une fraction de ce qu’elle était il y a une décennie. Certains calculs estiment que la destruction du PIB du Venezuela est supérieure à 75% – que les trois quarts de l’économie ont disparu en cinq ans ! Par conséquent, n’importe quel redémarrage de l’économie est immédiatement sensible dans les indicateurs macro-économiques.
Dernier point : l’industrie pétrolière a recommencé à fonctionner. Le secteur privé a accru son rôle dans l’exportation du pétrole et sa commercialisation (la PDVSA étant sanctionnée, elle ne pouvait passer des contrats avec des tiers, qui se seraient eux-même exposés aux sanctions des États-Unis). Un mécanisme a été trouvé : la société pétrolière vénézuélienne vend son pétrole à des privés locaux qui eux-mêmes le commercialisent sur le marché et le monétisent. Une partie des produits de la vente revient dans l’économie nationale.
LVSL – Comment comprendre la stratégie de l’administration Biden ? Les sanctions n’ont pas été levées. D’un autre côté, l’État vénézuélien parvient à les contourner assez ouvertement en passant par le secteur privé, via ce mécanisme que vous venez de décrire. Pensez-vous que Joe Biden hérite de la stratégie de pression maximale qui était celle de Donald Trump visant à imposer un changement de gouvernement au Venezuela ? Ou estimez-vous qu’il a adouci son approche, tout en maintenant des sanctions pour donner des gages à son électorat de Miami ?
[NDLR : Miami concentre les citoyens américains issus du sous-continent, généralement hostiles à Cuba et au Venezuela]
TP – Revenons à l’origine de ces sanctions. C’est l’administration Obama qui, la première, a bâti les bases légales des sanctions. C’est Barack Obama, en 2015, qui décrète que le Venezuela est une menace extraordinaire et laisse le champ ouvert à l’adoption de sanctions.
C’est ensuite l’administration Trump qui impose le régime de sanctions tel qu’on le connaît aujourd’hui. La stratégie américaine vise, par le biais d’un approfondissement de la crise économique au Venezuela et d’une pression politique constante, à créer une sorte de cocktail interne de pénurie et d’insatisfaction. Du sabotage économique qui vise à générer un changement de régime, en somme. C’est toute l’histoire de Juan Guaido, qui a désigné un gouvernement par intérim alors reconnu par les États-Unis.
[NDLR : Pour une analyse de la stratégie américaine visant à faire tomber le gouvernement de Nicolas Maduro via les partisans de Juan Guaido, lire sur LVSL notre entretien avec Christophe Ventura : « Le Venezuela révèle les fracture de l’ordre mondial »]
Imaginer que la pression économique suffise à générer un changement de régime relève cependant de la gageure. Lorsqu’on effectue un sabotage économique, la destruction économique est certaine – les États-Unis ont pu détruire les trois quarts de l’économie vénézuélienne ! Les conséquence politique sont bien moins prévisibles. Les États-Unis ont pensé que les Vénézuéliens allaient réagir comme des rats de laboratoire et mécaniquement se tourner contre leur gouvernement.
Il ne faudrait cependant pas négliger, à côté de l’establishment diplomatique du Parti démocrate, extrêmement impérialiste, l’existence d’une aile progressiste très forte
C’est plutôt l’effet inverse qui s’est produit. Même les Vénézuéliens qui n’étaient pas particulièrement anti-impérialistes, exposés à une telle situation, ont adopté des réflexes de ce type. Les sanctions ont donc jeté une partie de la population dans les bras du gouvernement. Par ailleurs, l’armée n’a pas eu le comportement que les États-Unis souhaitaient ; elle n’a pas rallié l’appel au coup d’État de Guaido.
Les États-Unis prévoyaient que tout cela aurait un effet très rapide. En 2019, croyant que la transition est au coin de la rue, ils prennent une somme de dispositions qui ont encore aujourd’hui des conséquences majeures, notamment la confiscation des actifs de l’État vénézuélien aux États-Unis et la reconnaissance du gouvernement parallèle auto-proclamé de Juan Guaido. Aujourd’hui, la situation est étrange : une partie de l’opposition, qui n’a pas de pouvoir, a le contrôle sur des actifs de la nation qui sont à l’étranger !
De plus, en 2017, le Venezuela a fait défaut sur sa dette qui était essentiellement en dollars et détenue par des investisseurs américains. Lorsque les créanciers cherchent à récupérer ou à attaquer en justice l’État vénézuélien parce qu’il est mauvais payeur, ils se retrouvent à attaquer l’allié des États-Unis, puisqu’aux yeux du droit américain c’est le gouvernement légitime !
Les sanctions ont débouché sur une situation absurde. À quoi servent-elles ? Si l’objectif était de mener un changement de régime en quelques semaines, pourquoi la population vénézuélienne doit-elle en pâtir plusieurs années plus tard ? Les stratégies de contournement de l’État vénézuélien ne résolvent pas un problème majeur : il ne peut toujours pas émettre de dette, et donc ne peut pas se financer.
Le tout dans le contexte de la pandémie : en Europe, les gouvernements ont réagi par l’émission massive de dette. C’est la doctrine du quoi qu’il en coûte, qui vise à remplacer les revenus autrefois produits par l’économie par des revenus de substitution. Cela donne l’impression que, dans un pays du Nord, il suffit d’avoir de la volonté politique pour agir sur l’économie par simple décision du législateur. Dans un pays comme le Venezuela, il a fallu traverser deux années de pandémie sans revenus pétroliers et sans la possibilité d’émettre de la dette !
Le Fonds monétaire international (FMI), qui avait débloqué une enveloppe modeste de 100 milliards de dollars pour le reste du monde, répondait au Venezuela que, ne sachant pas qui est le président du pays, il ne pouvait accéder à sa demande. Par conséquent le Venezuela n’a même pas eu accès au financement international d’urgence et a dû faire face à la pandémie sans argent ! Les conséquences de cette politique agressive et totalement inutile sont là.
Quid de l’administration Biden ? Elle ne parle pas de changement de régime, et n’a pas de politique active de confrontation entretenue par des hauts fonctionnaires, comme c’était le cas avec Trump. Dans le même temps – comme souvent avec les démocrates – on se demande s’il y a bien une politique étrangère. Qui est en charge du dossier vénézuélien ? Tout cela est extrêmement diffus. L’administration Biden, par cette sorte d’indéfinition, donne beaucoup moins d’importance aux Vénézuéliens.
Dans ses priorités politiques étrangères elle est obsédée par sa confrontation avec la Russie, grand dossier géopolitique. Sans doute les Vénézuéliens sont-ils traités comme un « sous-produit » des Russes, non comme une priorité centrale. Il faut ajouter à cela le chantage permanent de la Floride, qui est un État avec une sociologie électorale très particulière : c’est la terre de l’immigration riche, la capitale du capitalisme latino-américain avec une base cubaine et vénézuélienne très forte. Le poids de ces populations est tel, qu’avec leur vision du communisme qui leur est tout à fait propre – pour certains, le communisme commence avec Joe Biden ! -, ils exercent un chantage permanent dans la politique américaine vis-à-vis de Cuba.
La politique cubaine n’a pas évolué à cause du lobby en Floride qui considère que la punition de Cuba, même si elle ne produit aucun effet politique, doit rester une politique. Ils raisonnent autant comme Américains que comme Cubains : quitte à ne pas pouvoir renverser les autorités cubaines, il faut au moins que le pays soit puni. Il se produit peu ou prou la même chose avec le Venezuela.
Il ne faudrait cependant pas négliger, à côté de l’establishment diplomatique du Parti démocrate, extrêmement impérialiste, l’existence d’une aile progressiste très forte. Sans en faire un sujet phare, cette composante du Parti démocrate est un facteur de modération de l’administration Biden.
Il faut garder à l’esprit que les banques vénézuéliennes sont exclues du système financier international. Les devises ne peuvent tout simplement pas entrer dans la pays via le système bancaire. La dollarisation… se fait essentiellement via du cash. Le secteur privé qui monétise le pétrole à l’étranger ramène une partie du produit en cash.
Malgré tout, les sanctions restent en place. Dans cet environnement d’indéfinition et de statu quo, le gouvernement de Maduro déploie sa stratégie indépendamment de ce qui se passe aux États-Unis. Les Vénézuéliens ont décidé de vivre sans attendre une hypothétique levée des sanctions. D’où cette ouverture au secteur privé – qui n’est pas facile à « vendre » politiquement pour un mouvement politique qui s’est construit autour d’un imaginaire anti-capitaliste. Le secteur privé national a également compris qu’il en allait de sa survie. Le contexte des sanctions alimente une sorte de réflexe « patriotique » de survie dans lequel les tensions internes finissent par s’estomper devant la nécessité de subsister. Aujourd’hui le secteur privé est beaucoup moins hostile aux autorités, qui sont celles qui peuvent lui permettre de fonctionner et même lui offrir des perspectives dont il n’aurait pas pu rêver il y a quelques années. C’est dans ce contexte de pragmatisme généralisé que ces réponses se mettent en place.
LVSL – La dollarisation de facto est extrêmement forte – les Vénézuéliens échangent des bolivars contre des dollars dès qu’ils le peuvent, jugés plus stables et indicateurs de valeurs économiques réelles. Une institutionnalisation ou un approfondissement de ce processus est-il à l’ordre du jour ? Si les relations se normalisent avec les États-Unis, un mécanisme de currency board, voire une dollarisation intégrale comme c’est le cas en Équateur, sont-ils envisageables ?
[NDLR : Le Vent Se Lève avait organisé une conférence en février 2019 à l’École normale supérieure avec Guillaume Long, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Équateur, dédiée à l’analyse des conséquences de la dollarisation sur ce pays : « Le dollar instaure une relation asymétrique entre l’Équateur et les États-Unis »]
TP – Je vois plusieurs obstacles. Le premier est politique. L’adoption du dollar aurait une charge symbolique très forte. Le gouvernement, même s’il a déjà opéré un virage économique, risque de toucher un symbole et rompre l’équilibre précaire au sein du chavisme.
En termes économiques, il faut garder à l’esprit que le secteur privé demeure partiellement paralysé. Certaines entités privées vénézuéliennes peuvent avoir accès au système économique international et opérer en dehors du Venezuela – des Vénézuéliens basés à Miami ont accès au système bancaire américain, et peuvent importer des produits vénézuéliens. Mais les Vénézuéliens qui ont un compte dans une banque vénézuélienne ne peuvent pas faire de virement ou en recevoir dans des banques vénézuéliennes ! Le Venezuela est coupé du système financier international, les banques vénézuéliennes, même privées, ne sont pas connectées par les systèmes de paiement comme SWIFT.
Les devises ne peuvent tout simplement pas entrer dans la pays via le système bancaire. Aujourd’hui, la dollarisation… se fait essentiellement via du cash. Le secteur privé qui monétise le pétrole à l’étranger rapporte une partie du produit en cash.
Une partie des transactions dans l’économie vénézuélienne se produit en dehors du Venezuela : un supermarché, par exemple peut vous offrir la possibilité de payer aux États-Unis. C’est le cas pour beaucoup de Vénézuéliens de la classe moyenne ou aisés, titulaires d’un compte aux États-Unis. C’est une transaction en dollars mais qui ne touche pas territorialement la juridiction vénézuélienne. Ces exemples-là établissent la précarité de la dollarisation en cours !
On peut ouvrir un compte en dollar dans une banque vénézuélienne, si on a l’argent en cash et qu’on le dépose littéralement au guichet. Ces dollars, une fois déposés, sont plutôt utilisés comme réserve de valeur, puisqu’il n’y a pas de transaction en dollars bancarisée au sein de l’économie vénézuélienne. Les banques privées vénézuéliennes ne sont pas non plus autorisées à prêter en dollar. Elles ne peuvent pas faire de crédit à la consommation. Cela pose de sévères limitations pour que le Venezuela adopte une dollarisation complète.
Dernière chose : les transitions vers la dollarisation de l’économie comme en Équateur se sont faites en négociation avec le Trésor américain. L’adoption d’une monnaie étrangère nécessite une entente bilatérale. Ce n’est pas possible dans le cas actuel.
LVSL – Le rapprochement de Nicolas Maduro avec le bloc Chine-Russie a fait l’objet d’un commentaire médiatique fourni. Est-ce que ce rapprochement est d’un quelconque secours pour le gouvernement face à ces sanctions américaines – compte tenu de l’hégémonie du dollar et de l’exclusion du Venezuela des marchés internationaux ?
TP- La proximité avec la Chine et la Russie a sans doute constitué un recours. Dans le cas de la Chine, cela s’est produit bien en amont des sanctions. Les Chinois, contrairement aux Russes, ont des politiques d’exportation de leur capital, par des programmes de coopérations financières. Cela a permis au Venezuela d’avoir accès à une source de financement alternative au marché de capitaux occidentaux. Les fonds mobilisés par la Chine dans le cadre d’accords bilatéraux étaient, dans la première décennie du XXIe siècle, au moins égaux en volume au montant que le Venezuela avait levé sur les marchés internationaux en émettant de la dette obligataire.
Dans le cas russe, la coopération est essentiellement centrée sur deux secteurs. D’abord le secteur de défense : l’équipement militaire vénézuélien a adopté à partir de 2006 du matériel russe. Dans le secteur pétrolier ensuite : les sociétés pétrolières russes, pour des raisons géopolitiques, ont témoigné de l’intérêt à l’égard de l’exploitation du pétrole au Venezuela.
Mais il y a des limites. Concernant la stabilité vénézuélienne, d’abord. Le rôle alternatif que peuvent jouer les Chinois n’est possible que dans la mesure où l’économie vénézuélienne est stable. Les Chinois ont une vision géopolitique différente de celle des Américains. Ils sont porteurs d’un récit plus modeste, qui possède un réel attrait pour les pays du Sud ; mais d’un autre côté, ils sont mus par des intérêts essentiellement économico-commerciaux. Ils n’ont aucune d’ambition d’exportation de civilisation ou de valeurs. Or, l’économie vénézuélienne était dans un état désastreux, et il est difficile de prêter à une économie en chute libre. Les Chinois n’ont pas jeté une bouée de sauvetage économico-financière au Venezuela.
En revanche, une fois que la situation a été stabilisée, avec aujourd’hui une croissance économique et la possibilité d’avoir davantage de visibilité sur des projets de nature économique, on a assisté à un regain d’intérêt des Chinois pour des projets d’investissement. Il n’empêche : les banques chinoises ne sont pas immunisées face aux sanctions américaines. Et beaucoup ne vont pas risquer leurs opérations dans le reste du monde pour le Venezuela. Il faut également garder à l’esprit que l’économie chinoise, si elle est la première économie du monde par certains aspects, n’est pas une économie ouverte et libéralisée. En conséquence, le yuan ne remplit pas le rôle du dollar, ce n’est pas une monnaie internationale utilisée dans les échanges – ou alors pour du commerce bilatéral avec un pays comme la Russie… mais cela nécessite une très grande complémentarité entre les deux économies, qui fasse que les opérations puissent se faire par compensation ou par règlement en monnaie locale. Enfin le Venezuela est situé en Occident, et certains fondamentaux économiques sont incontournables. L’importation depuis Miami reviendra toujours moins chère que depuis la Chine.
La Chine est donc une alternative, mais celle-ci nécessite une économie stable et implique de surmonter de nombreux obstacles.
LVSL – On assiste à une nouvelle vague de gouvernements progressistes en Amérique latine : Pedro Castillo au Pérou, Xiomara Castro au Honduras, Gabriel Boric au Chili… Les sondages augurent des résultants prometteurs pour Gustavo Petro en Colombie et Lula au Brésil. Cela permettra-t-il au Venezuela de revenir au coeur de l’intégration régionale, comme c’était le cas sous Hugo Chávez ? Ou du fait de l’émergence d’une gauche moins critique à l’égard des États-Unis, le Venezuela risque-t-il de demeuré un pays diplomatiquement marginalisé, même au sein de la gauche ? Au Chili, Gabriel Boric a après tout nommé une ministre des Affaires étrangères qui tient un discours hostile à Cuba et au Venezuela…
[NDLR : Pour une analyse du gouvernement nommé par Gabriel Boric, lire sur LVSL l’article de Julian Calfuquir et Jim Delémont : « Victoire de Boric : le Chili va-t-il “enterrer le néolibéralisme” ? »]
C’est une bonne nouvelle pour les pays qui ont connu ces victoires. Il y a bien, cependant une réelle question qui se pose quant au rapport d’une partie de la gauche au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua, les pays « problématiques » pour l’Occident. Plusieurs éléments à prendre en compte, et d’abord, la vision propre de ces mouvements : sont-ils eux-mêmes anti-impérialistes ? Dans le cas chilien, la gauche semble bien plus intéressée par des réformes internes, qui ont trait à des problématiques proprement chiliennes – ou mondiales comme celles concernant la place des femmes, l’éducation publique, le financement des retraites – que par des questions géopolitiques. Peut-être, du fait des caractéristiques de la société chilienne et de son intégration à l’économie mondiale, de valeurs partagées avec les sociétés occidentales, y a-t-il une perception du Venezuela par une grille de lecture autre que celle de l’anti-impérialisme. Dans tous les cas, il n’y a pas de solidarité automatique entre les gouvernements de gauche, voire une hostilité exprimée d’une manière sans doute excessive des plus modérés aux plus radicaux.
L’élection d’un gouvernement progressiste dans la région accroit bien sûr les possibilités qu’il y ait une politique moins hostile que celle que pouvait mettre en pratique le Groupe de Lima. Mais, répondant aux injonctions de la droite ou de la presse, le gouvernement chilien fait le choix d’exprimer des opinions hostiles vis-à-vis du Venezuela et de Cuba, ce qui est moins coûteux que de susciter une polémique. Sans doute, également, des leçons ont-elles été tirées de ce qui est arrivé à Podemos en Espagne – qui était continuellement sommé de démontrer qu’il ne recevait pas de financement du Venezuela.
En définitive, on ne peut que se réjouir de l’élection de divers gouvernements de gauche dans la région. Mais on peut regretter qu’une partie de cette gauche soit mal préparée à faire face à des polémiques internes liées au Venezuela, et ne contribue pas de façon plus active à une approche rationnelle de la question vénézuélienne.