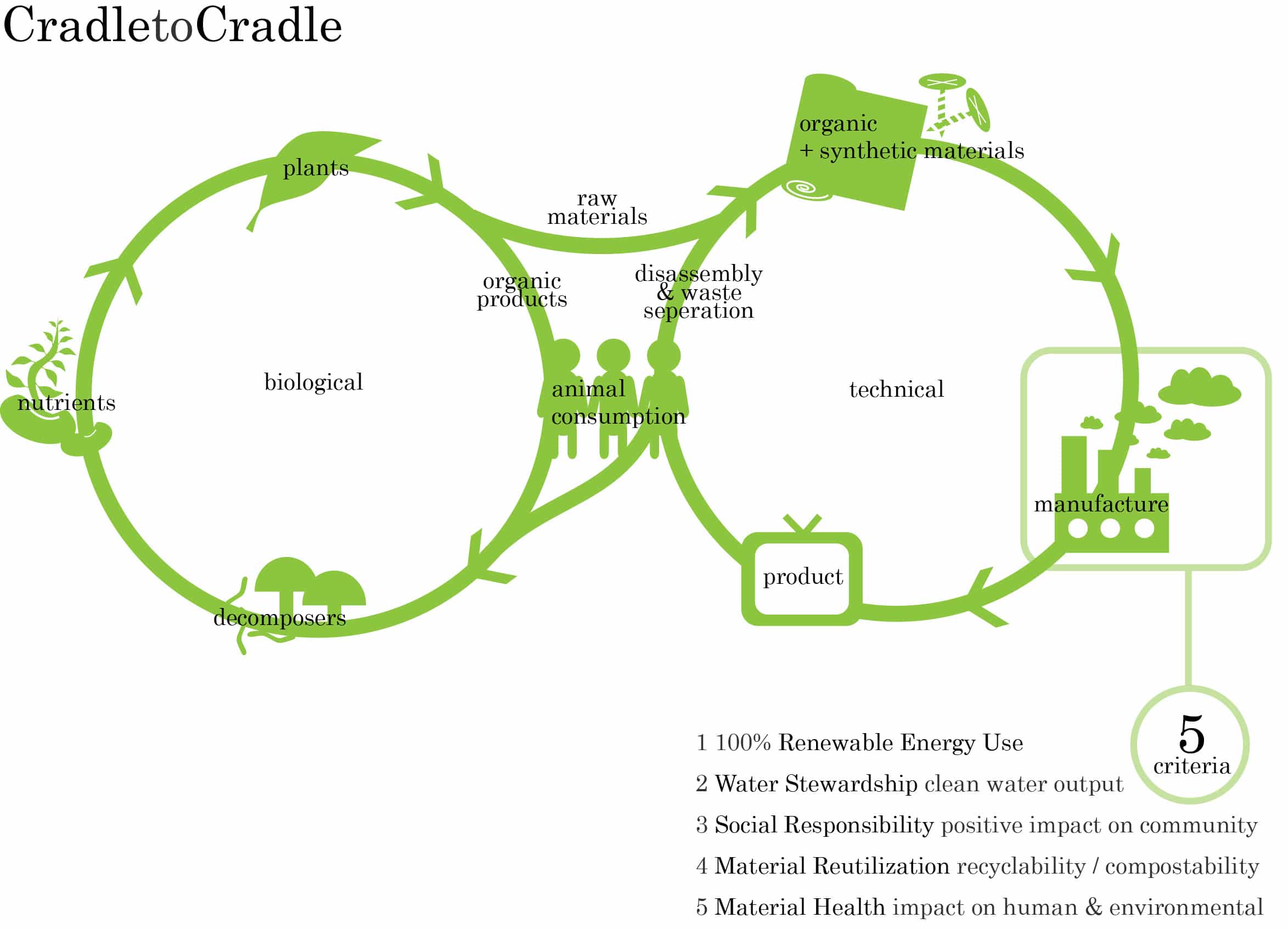Rompre avec l’extractivisme est un défi sur lequel butent la plupart des gouvernements « progressistes » des pays d’Amérique latine, spécialisés depuis des décennies dans l’exploitation d’une poignée de matières premières. Les candidats qui promettent une sortie de ce modèle maintiennent généralement le statu quo une fois élus. Trahison ? Dans cet article, le chercheur Matthieu le Quang analyse les contraintes structurelles, d’ordre économique aussi bien que géopolitique, qui expliquent la pérennité du système extractiviste en Équateur. Docteur en sciences politiques, il est l’auteur de nombreux articles portant notamment sur le modèle de développement équatorien. En 2021, il contribue à l’ouvrage collectif dirigé par Franck Gaudichaud et Thomas Posado, Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018), publié aux Presses Universitaires de Rennes.
Ndlr : à propos de la même thématique, lire sur LVSL l’article de Pablo Rotelli « Richesse des terres et pauvreté des nations : l’éternelle malédiction des ressources naturelles en Amérique latine ».
Les activités extractivistes et leurs désastreuses conséquences sur les populations locales ne sont pas une nouveauté en Équateur : historiquement, ce pays dépend de l’exploitation et de l’exportation de ses ressources naturelles (café, cacao, banane, pétrole). Toutefois, l’arrivée au pouvoir de Rafael Correa et de la Révolution Citoyenne, en janvier 2007, a mis au centre de l’agenda politique la nécessité de faire évoluer ce modèle de développement pour rompre avec cette dépendance.
Le continent latino-américain connaîtrait une certaine reprimarisation de ses économies. Ce serait une des conséquences du « consensus des commodities » qui repositionnerait les économies latino-américaines dans leur rôle classique de fournisseurs de matières premières au reste du monde, principalement à la Chine ces dernières années
Pour cela, il a fallu changer la Constitution : approuvée en 2008, elle donne un rôle prépondérant à l’État non seulement dans la récupération de la régulation et la planification des politiques publiques, mais aussi dans la nationalisation des ressources stratégiques dont font partie le pétrole et les mines. Le plus innovant dans la Constitution a été d’inclure un nouveau concept encore en construction – et donc en dispute politique : le bien vivre. Dans cet article, nous analyserons ce concept selon trois courants1 : un premier culturaliste et indigéniste, un deuxième écologiste et post-développementaliste, enfin un dernier éco-marxiste et étatiste. Cette « utopie mobilisatrice » a occasionné des conflits autour du modèle de développement. L’un des débats en Équateur porte sur le type de transition socio-écologique nécessaire pour passer d’une économie extractiviste exportatrice de matières premières à une société fondée sur le bien vivre.
L’extractivisme a été caractérisé comme un modèle de développement fondé sur l’extraction et l’exportation de matières premières, que celles-ci proviennent des secteurs traditionnels d’exploitation minière et de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon, argent, or, etc.) ou des produits agricoles et forestiers cultivés en monoculture (palme africaine, soja, canne à sucre, etc.). Ces activités appartiennent au secteur primaire de l’économie et ne créent pas de valeurs ajoutées. Le continent latino-américain connaîtrait une certaine reprimarisation de ses économies. Ce serait une des conséquences du « consensus des commodities2 » qui repositionnerait les économies latino-américaines dans leur rôle classique de fournisseurs de matières premières au reste du monde, principalement à la Chine ces dernières années. Toutefois, Hans-Jurgen Burchardt nous avertit qu’il est difficile pour le moment de définir l’extractivisme comme un modèle de développement car « ce concept contient de grandes imprécisions, tant du point de vue empirique que méthodologique et analytique3 ». Ces généralisations continentales ne permettent pas d’analyser les complexités des processus nationaux.
C’est pour cette raison que nous nous proposons d’analyser les débats autour de l’extractivisme en Équateur à partir des interprétations du bien vivre et des tensions qui ont émergé lors de la transition post-néolibérale. Nous reprendrons en premier lieu les controverses qui agitent les trois courants du bien vivre, en particulier celle qui entoure le postextractivisme. Nous reviendrons ensuite sur les limites tant internes (néo-développementisme) qu’externes (géopolitique) que connaît la Révolution Citoyenne pour changer de modèle de développement, limites que nous expliciterons en conclusion à travers l’exemple de l’Initiative Yasuni-ITT.
Le post-extractivisme : tensions dans les débats autour du bien vivre
Tous les auteurs et acteurs socio-politiques4 sont d’accord sur le fait que les origines du bien vivre se trouvent dans les traditions culturelles indigènes. Pourtant, selon Armando Muyolema, il existe une transculturation du concept de sumak kawsay qui n’existe dans aucun dictionnaire de quechua ou de quichua5. Selon lui, il ne s’agit pas d’une catégorie épistémologique ancestrale (comme par exemple celle de Pachamama) mais d’une construction qui s’alimente des luttes écologiques dans un monde en crise et des styles de vie des communautés indigènes.
Cela peut être corroboré par les travaux de Philipp Altmann6 : celui-ci retrace le concept de sumak kawsay dans les discours du mouvement indigène. Il n’apparait pas avant le changement de millénaire et les publications, avec l’aide de la coopération allemande, de certains intellectuels et militants aymaras en Bolivie et kichwas en Équateur. Toutefois, selon Altmann, il faut attendre octobre 2003 et la publication d’un texte7 du peuple Sarayaku pour voir apparaitre ce concept dans les discours du mouvement indigène équatorien. Selon cet auteur, il s’agit d’une « attaque discursive » d’une organisation amazonienne contre la stratégie nationale de la Confédération Nationale des Indigènes d’Équateur (CONAIE). L’objectif est de réorienter celle-ci vers les campagnes et la périphérie, alors qu’elle est de plus en plus concentrée à Quito, à cause des mobilisations sociales et de la participation politique du mouvement indigène dans les années 1990 et début des années 2000. Avec la création de l’Université Interculturelle Amawtay Wasi en 2004, la CONAIE intègre le sumak kawsay dans son discours et ses textes. Mais ce concept ne surgit dans les débats politiques nationaux qu’avec l’arrivée de Rafael Correa au pouvoir et l’installation de l’Assemblée constituante.
Pour résumer, le sumak kawsay n’est pas une catégorie épistémologique ancestrale et n’apparait pas dans les discours des organisations indigènes avant les années 2000, et tient ses origines dans l’existence d’une forme de vie des sociétés indigènes précoloniales « basée sur une organisation communautaire, une forme de vie sauvage et rurale, et une culture traditionnelle, empirico-naturelle et magico-religieuse8 ». Mais cette recréation, reconstruction ou « tradition réinventée9 » s’est alimentée de luttes contemporaines surtout écologistes et anti-néolibérales.
Depuis, les textes sur le bien vivre sont nombreux. Certains auteurs remettent en question des valeurs caractérisant la modernité, principalement la notion de développement avec sa vision économiciste et homogène des sociétés, le concept de progrès qui compromet la sauvegarde de l’environnement, et la vision utilitariste de la nature qui en découle. Ils insistent sur la crise de civilisation que traverse le monde, crise liée au système capitaliste. C’est ainsi que le bien vivre, s’intégrant dans les débats sur la relation entre société et environnement, s’oppose à l’imaginaire moderne de contrôle rationnel du monde naturel. Le développement est vu comme une utopie irréalisable à cause des limites naturelles de la planète, porteur d’une distribution sociale limitée qui génère des inégalités, et d’une relation réduite entre croissance et bien-être. Face à lui, le bien vivre propose d’aller vers la démarchandisation des espaces nécessaires à la reproduction de la vie, à celle des biens communs et publics. Le but : aider à améliorer les relations humaines, libérer du temps pour profiter d’autres activités comme la participation politique, les relations familiales, les loisirs – tout ce qui participe des relations communautaires et sociétales.
Ainsi, les principaux traits communs aux trois courants du bien vivre sont les suivants : la dimension communautaire de la vie ; l’être humain en tant qu’être social ; le dépassement de la domination de la nature par les êtres humains et par conséquent la reconnaissance de droits à la nature (intégrés dans la Constitution équatorienne de 2008) ; la nécessité de repenser les structures de l’État pour le transformer en un État plurinational et interculturel ; la transition vers une société postextractiviste ; et la revendication de la souveraineté sur le territoire national qui n’est pas incompatible avec une volonté d’intégration régionale (cette caractéristique est moins présente dans le courant culturaliste et indigéniste). De cette base commune, toutefois, différents courants n’ont pas manqué de naître.
Les différences entre les courants du bien vivre
Les courants du bien vivre sont incarnés par une diversité d’auteurs et d’acteurs socio-politiques venus d’horizons variés et nourrissant des intérêts différents, ce qui explique les multiples interprétations et débats autour de ce concept. Nous allons ici insister sur les différences conceptuelles de ces courants.
Le premier ministre bolivien García Linera critique la position « écologiste » : « les critiques de l’extractivisme confondent système technique avec mode de production, et à partir de cette confusion associent extractivisme avec capitalisme ; oubliant qu’il existe des sociétés non extractivistes totalement capitalistes
Les auteurs du courant « culturaliste et indigéniste » (comme Carlos Viteri, Luis Macas, Nina Pacari) insistent sur les éléments spirituels – comme la Pachamama – de la pensée indigène du sumak kawsay. Ils utilisent cette expression originelle plutôt que celle de bien vivre car ils considèrent que cette dernière « a été dépouillée de la dimension spirituelle qu’a le Sumak Kawsay, assaisonnée par ailleurs d’apports occidentaux qui n’ont rien à voir avec les cultures ancestrales10 ». Ils reprennent également la principale revendication de la CONAIE : celle d’un État plurinational qui donnerait une autonomie économique et politique aux peuples et nationalités indigènes, ainsi que des droits collectifs. Les « culturalistes » exaltent la filiation du sumak kawsay aux peuples indigènes – et en particulier andins11 –, ils se concentrent sur l’opposition entre le monde occidental et ces peuples. Selon eux, le système capitaliste étant une création de l’Occident, le dépassement de la crise actuelle dépendrait de l’abandon de cette matrice culturelle.
Les auteurs du courant « écologiste et post-développementaliste » (Alberto Acosta, Eduardo Gudynas ou Esperanza Martínez) ont trouvé dans le bien vivre une « plateforme politique12 » qui pourrait réunir des alternatives au développement. Selon eux, le bien vivre « se constitue comme un collage post-moderne de conceptions indigènes, paysannes, syndicalistes, coopératives, solidaristes, féministes, pacifistes, écologistes, socialistes, théologico-libérationnistes, décolonialistes13… » Leur critique insiste sur le caractère prédateur du système capitaliste : une exploitation démesurée de la nature qui n’entraîne pas l’amélioration des conditions de vie de la population, reprenant ainsi le concept de « malédiction des ressources naturelles » ou le « paradoxe de l’abondance14 ». La question de la destruction de la nature, l’impératif d’inverser cette tendance, la critique des promesses manquées du développement et la non-viabilité écologique de sa concrétisation occupent le premier plan de leurs préoccupations. Ainsi, les « écologistes » voient dans le bien vivre une opportunité pour construire une alternative au développement15.
Quant aux auteurs du courant « éco-marxiste et étatiste », ils ont pour particularité d’avoir occupé des postes politiques au sein des gouvernements équatorien et bolivien (comme René Ramírez ou Álvaro García Linera). La priorité de ces intellectuels inspirés par le socialisme est la satisfaction des besoins matériels de base de toute la population, ce qui peut s’expliquer, en partie, par le fait qu’ils ont développé leur pensée sur le bien vivre depuis l’État et l’expérience de la gestion publique. Toutefois, ils ne laissent de côté ni la critique du productivisme et du consumérisme liée au système capitaliste, ni le respect des droits de la nature. Ils focalisent leurs critiques non pas sur le monde occidental mais sur le système politique, social et économique qui régit le monde : le capitalisme. Ainsi, ils insistent sur la transformation de la structure socio-économique marquée par les fortes inégalités sociales et « la subsomption réelle du système intégral de la vie naturelle de la planète au capital16 » pour aller vers un post-capitalisme à travers une planification participative, qui pourrait s’appeler « socialisme communautaire du Vivre Bien17 », « socialisme du Sumak Kawsay » ou « biosocialisme républicain18 ».
Les débats autour du postextractivisme
Une des différences les plus importantes qui oppose les courants du bien vivre porte sur la question de l’exploitation des ressources naturelles et le postextractivisme : ce débat sur le changement du modèle d’accumulation est en effet un important point de dispute.
Les « culturalistes » et les « écologistes » s’opposent à l’élargissement de tout type d’extractivisme, sans défendre la fermeture des zones déjà en exploitation. Leur proposition est de sortir du modèle d’accumulation actuel en mettant en œuvre l’économie sociale et solidaire. Les « culturalistes », liés aux mobilisations indigènes, revendiquant la mise en place d’un véritable État plurinational et son corollaire en cas d’activités extractivistes sur leurs territoires : la consultation préalable et informée.
Les auteurs du courant « écologiste » se concentrent en revanche avant tout sur la dénonciation de l’extractivisme. Selon eux, aussi bien l’insertion des pays du Sud dans un capitalisme mondial que la quête d’un « développement » ont entraîné une exploitation démesurée de la nature. Les racines de la crise de civilisation observée en Occident et dans le monde ne se trouvent ni dans la culture (« culturalistes »), ni dans la structure (« éco-marxistes ») mais dans l’extractivisme.
L’extraction de matières premières, héritage de la colonisation, s’est prolongée après les indépendances des pays latino-américains. L’arrivée au pouvoir de gouvernements progressistes, dans la première décennie du XXIème siècle, a voulu rompre avec cette dimension coloniale des activités d’extraction. Toutefois, selon les auteurs du courant « écologiste », ces gouvernements progressistes se situent à l’origine du « néoextractivisme19 », qui reproduit des dynamiques propres à l’extractivisme, comme celle d’une insertion internationale subordonnée et fonctionnelle à la globalisation du capitalisme transnational, en y ajoutant un rôle plus actif de l’État dans l’entreprise extractiviste ainsi qu’une plus importante et plus profonde distribution de la rente générée. En plus de ne pas changer les structures économiques et productives, le néoextractivisme, au nom du développement, permet la dégradation de la nature et l’exercice de pratiques politiques autoritaires qui portent atteinte principalement aux droits humains des peuples vivant dans les zones d’extraction.
Au contraire des deux autres courants, les « éco-marxistes » ne voient pas dans l’abondance en ressources naturelles une malédiction, mais plutôt un moyen pour passer à une société postextractiviste. Leur approche systémique anticapitaliste leur permet d’aller au-delà de la revendication d’un postextractivisme vu comme une fin en soi (comme cela pourrait être le cas des « écologistes »). Ils le voient plutôt comme un moyen de changer les structures socio-économiques de la société. En effet, sortir de la dépendance à l’exploitation des ressources naturelles ne signifie pas nécessairement entrer dans une société post-capitaliste. Dans l’immédiat, ils considèrent donc impossible d’arrêter toute exploitation de ressources naturelles. La contradiction de ces pays est évidente : ils ont besoin de l’extractivisme pour financer leur transition vers une société postextractiviste qui mettrait fin à leur dépendance de l’extractivisme.
Cette position est très critiquée par les auteurs du courant « écologiste ». Gudynas accuse le courant « éco-marxiste » de ne pas « comprendre les contradictions essentielles entre bien vivre et extractivisme. […] ils se sont approprié un concept, en le dépouillant de ses contenus originaux, pour qu’il puisse servir d’étiquette à des propositions conventionnelles très connues. Il n’est pas acceptable qu’ils s’emparent d’un terme qu’ils n’ont pas créé, et qu’ils le fassent pour aller dans une direction contraire à son intentionnalité originelle20. »
García Linera critique cette position : « les critiques de l’extractivisme confondent système technique avec mode de production, et à partir de cette confusion associent extractivisme avec capitalisme ; oubliant qu’il existe des sociétés non extractivistes, les industrielles, totalement capitalistes 21! » Selon lui, « le social est un composant du métabolisme naturel » donc les relations humains-nature font partie d’un « certain mode de production social22 ». La division internationale du travail dans laquelle s’insère la Bolivie ou l’Équateur fait partie de la construction historique et coloniale du capitalisme et il est impossible de changer ce système dans un seul pays, il faut créer un mouvement international. Ce qui prime est donc de mettre en place les conditions pour « satisfaire les besoins de la population, générer de la richesse et la distribuer avec justice ; et à partir de là, créer une nouvelle base matérielle non extractiviste qui préserve et élargit les bénéfices des travailleurs23 ». Et cela sans laisser de côté la diminution des impacts nocifs sur la nature.
Post-néolibéralisme et extractivisme dans l’Équateur de la Révolution Citoyenne
Les expériences progressistes en Amérique Latine ont traduit une volonté de prendre des mesures contre le néolibéralisme, et surtout de dépasser le modèle de libéralisation extrême des marchés imposé par le Consensus de Washington à partir des années 1980. Cette perspective a ouvert un champ conflictuel complexe autour de la transition post-néolibérale, en particulier en Équateur où cette dispute s’est cristallisée autour de la transformation de la matrice productive d’une économie largement dépendante des exportations de matières premières.
Dans ce qui suit, nous allons nous concentrer uniquement sur le thème de l’extractivisme. Avant toute chose, il nous faut constater que le gouvernement équatorien n’a pas réussi pour le moment à changer sa matrice productive. L’économie équatorienne dépend encore beaucoup de l’exploitation et de l’exportation de ses ressources naturelles, et donc de son secteur primaire.
Retour de l’État et enjeux de la transition socio-écologique
La Constitution de 2008 marque le retour de l’État et de ses capacités à réguler l’économie et les marchés, et à redistribuer la richesse sociale24. La récupération des capacités régulatrices de l’État va au-delà de la simple opposition « plus d’État, moins de marché ». La Constitution prône un équilibre entre État, marché et société dans la responsabilité collective d’étendre les bénéfices du développement national à de larges secteurs de la population.
Le gouvernement équatorien a mis en place des mesures visant à accroître la part des revenus de l’État provenant des rentes de ces ressources, principalement la rente pétrolière (….) Mais l’extension de l’extractivisme, liée notamment à l’accroissement de la superficie du territoire d’exploitation minière à grande échelle (…) entraîne une augmentation des conflits socio-environnementaux en Équateur.
En Équateur, il existe une tension, présente aussi dans la Constitution25, entre développement économique, extension des droits sociaux et protection de l’environnement. Comment peut-on défendre les droits de la nature et lutter contre sa dégradation (une des conséquences de l’exploitation des ressources naturelles) et, en même temps, chercher le bien-être de la population, l’éradication de la pauvreté et l’élargissement des droits sociaux à l’ensemble de la population ?
La question fondamentale consiste alors à concilier les exigences environnementales avec la croissance économique nécessaire pour transformer le pays et fournir des services publics de base à toute la population. Il ne s’agit pas d’opposer le court terme au long terme mais de les penser simultanément afin de développer le temps nécessaire à la transition, pour que l’Équateur ne dépende plus de l’exploitation et de l’exportation de ses ressources naturelles. Que ce soit pour la transition ou pour la lutte contre la pauvreté, l’État équatorien a besoin de ressources financières dont il ne dispose pas, objectifs rendus encore plus difficiles dans une économie dollarisée. Pour parvenir à ses fins, une des caractéristiques du retour de l’État en Équateur a été de récupérer ses capacités de planification, fondamentale pour la transition socio-écologique vers une société postextractiviste.
Pour cela, la Révolution Citoyenne a mis en œuvre des plans de développement. Le Plan national pour le Bien Vivre 2009-201326 se trouve à la base de la planification de la Révolution Citoyenne et pose clairement les objectifs à long terme : dans les deux prochaines décennies, le pays doit passer à une société post-pétrolière et transiter vers une économie de services centrée sur la connaissance et vers le développement de l’industrie nationale dans le cadre d’une politique de substitution sélective des importations. Le Plan national pour le Bien Vivre 2013-201727 renforçait cette vision en ayant comme objectifs principaux le changement de la matrice productive et l’éradication de l’extrême pauvreté. Ces deux plans reprennent l’affirmation de la nécessité des ressources financières de l’extractivisme pour sortir de l’extractivisme. En cela, le courant éco-marxiste du bien vivre, mené par l’ancien ministre de la planification René Ramirez, se rapproche en partie du pôle développementiste, prédominant au sein du gouvernement, qui a privilégié l’exploitation des ressources naturelles pour financer l’expansion des droits sociaux et la réactivation des forces productives.
En ce qui concerne l’extractivisme, le retour de l’État s’est caractérisé par l’interdiction constitutionnelle de privatiser les ressources stratégiques du pays. Cela a permis au gouvernement de mettre en place des mesures visant à accroître la part des revenus de l’État provenant des rentes de ces ressources, principalement la rente pétrolière. La gestion nationale de ces excédents a fixé certaines conditions – notamment fiscales – d’exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères. Le gouvernement équatorien a donc dû renégocier les contrats avec différentes entreprises multinationales pétrolières ce qui, dans un contexte de prix élevés des commodities, lui a permis d’augmenter les marges de participation étatique dans les revenus et royalties. Cette stratégie a permis à l’État équatorien d’avoir un peu plus d’autonomie par rapport au pouvoir global et surtout de financer le développement national avec des capitaux propres28.
Même si cette renégociation des contrats ne s’est pas faite sans résistance de la part de certaines transnationales comme nous le verrons par la suite, d’autres conflits liés à l’État caractérisent le néoextractivisme en Équateur. Dans son étude sur la politique minière de la Révolution Citoyenne, Andrea Carrión nous dit que « le nationalisme étatique sur les ressources naturelles se construit en opposition aux conflits socio-environnementaux et inclut l’usage des ressources publiques pour rendre possible les projets à grande échelle29 ». Selon Carrión, les réformes à caractère nationaliste (nationalisation des ressources naturelles, plus grande participation de l’État dans les royalties, respect des normes environnementales et du droit du travail nationaux, etc.) permettent l’expansion globale du capital transnational à travers la concession de territoires pour l’exploration et l’exploitation minières.
Cette expansion territoriale entraîne une augmentation des conflits socio-environnementaux en Équateur. L’extension de l’extractivisme, liée notamment à l’accroissement de la superficie du territoire d’exploitation minière à grande échelle, a pour conséquence la fragmentation spatiale, la création d’économies enclavées générant peu d’emplois, la désintégration et parfois le déplacement de communautés indigènes et rurales. Ces conflits se traduisent par différentes revendications : la sauvegarde du territoire comme lieu de vie, culturel ou de subsistance économique ; la protection de l’environnement et de l’eau contre les pollutions des activités extractivistes ; la défense de modes de vie ; la redistribution de la rente générée par ces activités30.
Ces conflits posent aussi la question de la participation politique et sociale des populations locales et de la société civile pour débattre des modèles de développement de leur territoire ou des projets extractivistes. Un des débats entre les organisations sociales et le gouvernement de Correa a porté sur les mécanismes de participation, en particulier le caractère contraignant de la consultation préalable et informée. Quoique le président Correa ait défendu l’inclusion de mécanismes de participation et de consultation, il leur a ôté leur pouvoir contraignant envers l’État car selon lui, des populations locales ne peuvent décider du bien-être de toute la nation.
Cette dispute sur le caractère contraignant de la consultation préalable est aussi une « dispute sur le sens du concept de développement [qui] confronte et sépare le bien commun de l’État-nation de celui des groupes de population dans des localités spécifiques31 ». Elle pose aussi la question de la mise en œuvre de l’État plurinational reconnu dans la Constitution. La manière dont a été résolue la question de la plurinationalité par le gouvernement équatorien n’a pas satisfait les organisations indigènes et a abouti à divers conflits, en particulier au sujet des demandes autonomistes de celles-ci liées à des disputes autour des ressources naturelles sur leurs territoires. Ces organisations questionnent la centralité d’un type d’État qui se rapprocherait de la matrice national-populaire32 historiquement liée à l’expansion développementiste en Amérique latine.
Les difficultés de la Révolution Citoyenne pour changer la matrice productive
Après la récupération des capacités régulatrices de l’État, le plus grand défi de la transition post-néolibérale a été le changement de la matrice productive. La dispute entre divers acteurs politiques et sociaux s’articulait autour de la construction d’un régime d’accumulation qui romprait à la fois avec l’orthodoxie fiscale des années 1990, la dépendance à l’extractivisme, et les schémas classiques de compréhension du développement. La dispute interne au gouvernement a tracé une frontière entre tenants du courant éco-marxiste du bien vivre33 et ceux du développementisme post-néolibéral. Le financement du changement de la matrice productive représente le dilemme le plus important, dont la résolution a confirmé l’importance des revenus provenant des hydrocarbures. Principal problème : même si l’investissement dans l’éducation supérieure et dans le domaine de la science et des technologies se retrouve parmi les plus élevés de la région, les bases de la transformation de la structure productive du pays ne sont pas clairement posées et le secteur industriel n’a pas été dynamisé. Même si la réappropriation étatique des excédents pétroliers a pu élever la marge de souveraineté nationale, elle n’a pas permis de remettre en question la place de l’Équateur dans la division internationale du travail comme fournisseur de matières premières.
L’insertion des pays latino-américains dans la division internationale du travail, conséquence de la colonisation européenne, fait de ces territoires des fournisseurs en ressources naturelles (minerais et produits agricoles). Cette position périphérique constitue un obstacle important au moment d’engager une transition vers un post-extractivisme, elle génère une dépendance aux marchés centraux et à la fluctuation des prix des commodities conditionnés par la demande mondiale et autres spéculations financières.
Les théoriciens de la dépendance, dans les années 1950 et 1960, avaient déjà analysé ces échanges économiques et commerciaux inégaux. Réunis au sein de la Commission Economique pour l’Amérique Latine (CEPAL), ils expliquaient les problèmes de l’Amérique Latine par le fait que ces pays périphériques exportaient des biens primaires vers le centre dont les prix sont plus bas que les biens avec valeur ajoutée qu’ils importaient depuis le centre34. Á ces inégalités économiques, les auteurs venant de l’économie écologique ont ajouté les inégalités environnementales35. Selon María Cristina Vallejo, « bien que, dans les années récentes, le boom des prix internationaux des commodities parait avoir déréglé cette relation d’échange inégale, plusieurs pays du sud maintiennent des inégalités structurales dans leurs conditions d’échange économique36 ». Selon elle, c’est le cas de l’Équateur qui doit « réaliser un plus grand effort environnemental en extrayant de grandes quantités de ressources naturelles pour les destiner à l’exportation37 » c’est-à-dire qu’il doit exporter plus de tonnes qu’il n’en importe pour réaliser des échanges commerciaux dans les termes économiques du marché global.
Dès lors, sortir de cette dépendance devient d’autant plus difficile au cours d’une période de hausse des prix des commodities, surtout lorsque le gouvernement affiche pour but l’éradication de la pauvreté, ce qui répond à des objectifs de court terme qui à leur tout découlent d’une certaine stratégie afin de rester au pouvoir. À cette difficulté s’ajoute une économie équatorienne dollarisée depuis 2000 et dépendante des flux d’argent entrant, l’équilibre de la balance des paiements étant fondamentale dans une économie sans monnaie propre. Le pragmatisme éthique (lutte contre la pauvreté), économique (la nécessité de disposer de devises) et politique (réélection) a éloigné la Révolution Citoyenne de son compromis à plus long terme qui était le changement de la matrice productive.
L’intégration subordonnée des pays latino-américains au marché global comme fournisseurs de matières premières amène une autre conséquence géopolitique : la domination de ces pays par des règles commerciales néolibérales. Cette domination passe, entre autres, par la signature de Traités bilatéraux d’investissement (TBI)38. Depuis l’approbation de la Constitution, le gouvernement équatorien avait pour objectif de dénoncer ces TBI. Pour cela, il a mis en place, en mai 2013, une Commission pour l’Audit Intégral Citoyen des Traités de Protection Réciproque des Investissements et du Système d’Arbitrage international en Matière d’Investissement (CAITISA), en prenant exemple sur la commission citoyenne qui avait permis l’audit de la dette et sa dénonciation en 200839.
Ndlr : sur les tribunaux d’arbitrage, lire sur LVSL l’article de Vincent Arpoulet : « Les traités bilatéraux d’investissements, entraves à la souveraineté des États : l’exemple équatorien »
Pour résumer, les TBI protègent les investissements des firmes étrangères face aux changements éventuels des lois nationales, à travers des dispositions qui limitent l’action étatique face aux possibilités d’administrer et de contrôler l’investissement étranger en fonction de ses intérêts légitimes et souverains. Par exemple, si l’État équatorien décide de renforcer les normes sociales ou environnementales, les transnationales peuvent dénoncer l’État au sein du système d’arbitrage international dont le principal tribunal, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), appartient à la Banque Mondiale.
Il est difficile de changer de modèle d’accumulation dans un seul pays sans prendre en compte les enjeux géopolitiques et les rapports de force internationaux
En Équateur, la grande majorité des TBI a été signée entre 1992 et 2002, à l’apogée du néolibéralisme. En raison de l’économie extractiviste de l’Équateur, les plus gros investissements étrangers se font dans ce secteur. Sur les 28 demandes internationales dont a fait l’objet l’État équatorien, 57% viennent d’entreprises pétrolières, 18% du secteur de l’énergie électrique et 11% du secteur minier, c’est-à-dire que l’extractivisme est responsable de plus des deux tiers des demandes internationales40. Ces investissements étrangers, en plus de ne pas avoir apporté au développement économique et social national et local, ont affecté la vie communautaire, le régime foncier, la sécurité alimentaire et ont généré des déplacements et des conflits dans les zones où se sont effectués ces investissements.
Une partie des demandes vient d’entreprises pétrolières qui n’ont pas accepté les renégociations de contrats en 2009-2010 et dont les contrats n’ont pas été reconduits. Elles estiment que l’État équatorien a changé les règles juridiques et fiscales – ce que les TBI interdisent. Le système juridique des échanges commerciaux internationaux qui favorise le libre-échange et surtout les investissements des firmes transnationales représente donc un obstacle contre tout changement qui irait contre ces règles, par le risque de coût économique pour l’Etat.
Conclusion
Nous avons analysé les disputes autour du modèle de développement de l’Équateur de la Révolution Citoyenne et les tensions qu’elles ont générées dans un pays dont les modèles d’accumulation et d’insertion internationale dépendent de l’exploitation des ressources naturelles. Un symbole des limites tant internes qu’externes pour changer de modèle de développement est l’Initiative Yasuní-ITT. Cette politique publique ambitieuse, présentée en juin 2007 par le président Correa, consistait à laisser sous terre 20% des réserves de pétrole du pays, situées dans le parc national Yasuní, en échange d’une contribution financière internationale équivalent à la moitié de ce que l’État équatorien aurait pu gagner avec l’exploitation41. Cette politique entrait en résonance avec les postulats du bien vivre et les plans gouvernementaux tendant à une transition écosociale postextractiviste en Équateur car elle illustrait la nécessité de ne pas exploiter les ressources naturelles dans n’importe quel endroit, en particulier les aires protégées et les zones de mégabiodiversité. La priorité n’était pas l’obtention de ressources financières à court terme mais de conserver ses richesses naturelles pour ne pas hypothéquer le futur.
Dans un autre article, nous avions montré que sa trajectoire politique oscillait entre une construction conceptuelle proche de l’écosocialisme, alternative post-capitaliste, et une stratégie d’insertion internationale à mi-chemin entre écosocialisme et capitalisme vert, idéologie dominante dans les négociations internationales autour du changement climatique42. Une des grandes contradictions de l’Initiative Yasuní-ITT est que sa construction conceptuelle a été confiée à des écologistes proches de l’écosocialisme ou de l’économie écologiste (tels Fander Falconi ou Carlos Larrea) alors que la conduite de la commission en charge des négociations internationales a été attribuée à des acteurs (Roque Sevilla et Ivonne Baki) en étroite adéquation avec le capitalisme vert. Cette contradiction idéologique était une stratégie pour s’adapter à la géopolitique des négociations sur le réchauffement climatique, un discours trop radical ayant pu faire fuir les possibles contributeurs.
Avec l’Initiative Yasuní-ITT, le gouvernement équatorien a mis au défi le système capitaliste néolibéral à travers la volonté de laisser sous terre la base de cette société thermo-industrielle : le pétrole. Il a mis le doigt sur la dépendance du système envers cette ressource pétrolière puisque une des raisons pour ne pas contribuer au fidéicommis était celui de la possible reproductibilité de cette politique dans d’autres pays, ce qui était perçu comme un danger pour la stabilité du capitalisme mondial puisque l’expansion de ce dernier est basée sur l’exploitation du pétrole, et en plus d’un pétrole à bas prix.
Toutefois, le problème pour l’Équateur est qu’une fois décidés son cadre légal et ses objectifs, le gouvernement devient dépendant des autres pays, notamment les pays riches du Nord, afin d’obtenir les contributions internationales souhaitées et nécessaires pour le budget de l’État équatorien. Cette politique publique est tombée dans les ornières du capitalisme vert au moment où ont commencé les négociations internationales, et ce d’autant plus facilement que certains acteurs gouvernementaux équatoriens étaient proches de cette idéologie. Lorsque l’Initiative Yasuní-ITT est entrée dans le cadre des négociations internationales, elle a commencé à échapper au gouvernement équatorien qui ne se trouvait pas dans une position géopolitique lui permettant de remettre en question la géopolitique internationale et le cadre des négociations sur le changement climatique.
La fin de l’initiative en août 2013, sous la pression des lobbys pétroliers (présents au sein du gouvernement), est un bon indicateur des arguments développementistes et des antiextractivistes. Le président Correa a soutenu que la lutte contre la pauvreté et les besoins en services publics de la population équatorienne ne pouvaient pas attendre la bonne volonté des contributeurs internationaux. Ainsi, les ressources financières de l’exploitation des champs ITT devraient servir pour améliorer les conditions de vie de la population et aider au changement de la matrice productive. Cette décision a généré une vague de protestations et de mobilisation de secteurs qui soutenaient la thèse reliant la non-exploitation avec le bien vivre : protection de la biodiversité, respect des peuples indigènes en isolement volontaire, lutte contre les dégradations sociales, écologiques et culturelles dans les zones d’exploitation, entre autres. Ces mobilisations n’ont toutefois pas rempli leur objectif qui était d’appeler à un référendum afin de décider de l’exploitation ou non de l’ITT.
Le cas de l’Équateur nous montre que la dichotomie entre écologie et redistribution ou entre « pachamamisme vs extractivisme43 » est simpliste et que le changement de la matrice productive pour passer à une société basée sur le bien vivre est plus complexe. La dispute politique est présente à plusieurs échelles spatiales, du local à l’international. Si les conflits liés à l’extractivisme sont locaux et assez isolés les uns des autres ce qui complique des rapports de force avec l’État central, la conflictualité socio-politique liée au bien vivre est un problème national car celle-ci se porte sur les différentes visions autour du modèle de développement ou le caractère plurinational de l’État équatorien. De plus, il est difficile de changer de modèle d’accumulation dans un seul pays sans prendre en compte les enjeux géopolitiques et les rapports de force internationaux. L’hégémonie idéologique néolibérale s’exprime dans une certaine vision de la société et du progrès mais aussi marque des contraintes politiques et commerciales pour les États qu’il est difficile d’affronter pour un pays comme l’Équateur sans certaines alliances régionales et internationales.
Notes :
1 Voir Le Quang Matthieu et Vercoutère Tamia, Ecosocialismo y Buen Vivir. Diálogo entre dos alternativas al capitalismo, Quito, Instituto de Altos Estudios Nacionales, 2013 ; Hidalgo-Capitán, Antonio Luis et Ana Patricia Cubillo-Guevara, « Seis debates abiertos sobre el sumak kawsay », Iconos, n°48, 2014, p. 25-40.
2 Svampa, Maristella, « “Consenso de los Commodities” y lenguajes de valoración en América Latina », Nueva Sociedad, n° 244, 2013, p. 30-46. Svampa utilise la définition suivante de commodities : « des produits de fabrication, disponibilité et demande mondiale, qui ont une gamme de prix internationale et ne demandent pas de technologie avancée pour leur fabrication et traitement » (p.31).
3 Burchardt Hans-Jurgen, « Logros y contradicciones del extractivismo: bases para una fundamentación empírica y analítica », Nueva Sociedad, février 2014, E-book, p.4.
4 Pour approfondir cette partie, voir Le Quang Matthieu, « Le Bien Vivre, une alternative au développement en Équateur ? », Revue du MAUSS permanente, mis en ligne le 4 octobre 2016. [http://www.journaldumauss.net/?Le-Bien-Vivre-une-alternative-au]
5 Muyolema Armando, « Las poéticas del Sumak Kawsay en un horizonte global », in François Houtart et Brigit Daiber (comp.), Un paradigma poscapitalista: el Bien Común de la Humanidad, Panamá, Ruth Casa Editorial, Panamá, 2012, p. 353.
6 Altmann Philipp, « El Sumak Kawsay en el discurso del movimiento indígena ecuatoriano », INDIANA, n°30, 2013, p. 283-299.
7 Ce texte est intitulé “Sarayaku Sumak Kawsayta Ñawpakma Katina Killka / El libro de la vida de Sarayaku para defender nuestro futuro”.
8 Hidalgo-Capitán Antonio Luis, El Buen Vivir. La (re)creación del pensamiento del PYDLOS, Cuenca, PYDLOS Ediciones, 2012, p. 18.
9 Viola Recasens Andreu, « Discursos “pachamamistas” versus políticas desarrollistas: el debate sobre el sumak kawsay en los Andes », Iconos, n° 48, 2014, p. 64.
10 Hidalgo-Capitán, op. cit., p. 48.
11 Voir Macas Luis, « Sumak kawsay. La vida en plenitud », América Latina en Movimiento, vol. 34, n° 452, 2010, p. 14-16. Choquehuanca Céspedes David, « Hacia la reconstrucción del Vivir Bien », América Latina en Movimiento, vol. 34, n° 452, 2010, p. 8-13.
12 Gudynas Eduardo, « Buen Vivir: sobre secuestros, domesticaciones, rescates y alternativas », in Atawallpa Oviedo Freire (comp.), Bifurcación del Buen Vivir y el Sumak Kawsay, Quito, Ed. Yachay, 2014, p. 23-45.
13 Hidalgo-Capitán, Op. cit., p. 49.
14 Acosta Alberto, « Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición », in Miriam Lang et Dunia Mokrani (Comps.), Más allá del desarrollo (Grupo permanente de trabajo sobre alternativas al desarrollo), Quito, Fundación Rosa Luxemburgo/Abya Yala, 2011, p. 83-118.
15 Lang Miriam et Mokrani Dunia (Comps.), Op. cit. ; Acosta Alberto, « Solo imaginando otros mundos, se cambiará este », in Ivonne Farah et Luciano Vasapollo (coords.), Vivir bien: ¿paradigma no capitalista?, La Paz, CIDES-UMSA, 2010, p. 189-208.
16 García Linera Álvaro, Socialismo comunitario. Un horizonte de época, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2015, p. 11.
17 Ibidem.
18 Ramírez Gallegos René, « Socialismo del sumak kawsay o biosocialismo republicano », in Los nuevos retos de América Latina. Socialismo y Sumak Kawsay, Quito, Senplades/IAEN, 2010, p. 55-76.
19 Gudynas Eduardo, « Si eres tan progresista, ¿por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas », Ecuador Debate,n°79, 2010, p. 61-82; Acosta Alberto, Op. cit., 2011; VV.AA., Extractivismo, Política y Sociedad, Quito, CAAP/CLAES, 2009.
20 Gudynas Eduardo, Op. cit., 2014, p. 36.
21 García Linera Álvaro, Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012, p.107.
22 Ibidem, p. 98.
23 Ibidem, p. 108.
24 Ramírez Gallegos Franklin, « Political Change, State Autonomy, and Post-Neoliberalism in Ecuador, 2007–2012 », Latin American Perspectives, vol. 43, n°1, 2016, p. 143-158 ; Ramírez Gallegos Franklin, « Reconfiguraciones estatales en Ecuador », in Mabel Thwaites Rey (Ed.), El Estado en América Latina: continuidades y rupturas, Santiago de Chile, CLACSO/ASDI/Editorial ARCIS, 2012, p. 341-375.
25 Voir Le Quang, Matthieu et Ramírez Gallegos Franklin, « Introduction », Cahiers des Amériques Latines, 2016/3, n° 83, p. 17-32.
26 Voir Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 : [http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir.pdf]
27 Voir Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 : [http://www.buenvivir.gob.ec/69]
28 Il faut noter que, contrairement à d’autres pays latino-américains, les programmes sociaux ne sont pas financés par les revenus de la rente pétrolière car la Constitution de 2008 interdit l’utilisation de revenus non permanents (les revenus du pétrole dépendant de la fluctuation des prix au niveau international sont considérés comme des revenus non permanents) pour financer des coûts permanents. Par exemple il est possible de financer la construction d’infrastructures (écoles, hôpitaux, routes, etc.) avec la rente pétrolière mais pas les salaires des fonctionnaires (professeurs, médecins, etc.).
29 Carrión Andrea, « Extractivismo minero y estrategia de desarrollo : entre el nacionalismo de los recursos y los conflictos socioterritoriales », in Matthieu Le Quang (Ed.), La Revolución Ciudadana en escala de grises: avances, continuidades y dilemas, Quito, Instituto de Altos Estudios Nacional, Collection Pensamiento Radical, 2016, p. 182.
30 Pour une analyse et une classification plus approfondies de ces conflits socio-environnementaux, voir Bebbington Anthony et Humphreys Bebbington Denise, « Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú », Íconos, n°35, 2009, p. 117-128.
31 Carrión Andrea, Op. Cit., p. 194.
32 Stefanoni Pablo, « Comparación del futuro de la democracia entre Venezuela, Bolivia y Ecuador », in Anja Dargatz et Moira Zuazo (Ed.), Democracias en transformación. ¿Qué hay de Nuevo en los nuevos Estados andinos?, La Paz, FES- ILDIS, 2012, p. 205-250.
33 Même s’ils ne sont pas contre l’exploitation des ressources naturelles, ils ne sont pas pour l’exploitation dans n’importe quels lieux, notamment ceux où se trouve une mégabiodiversité. Comme nous le verrons, le courant éco-marxiste s’est opposé à l’exploitation de l’ITT dans le parc national Yasuní alors que les tenants du développementisme post-néolibéral ne s’y sont pas opposés.
34 Prebisch Raul, El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas, Santiago de Chile, CEPAL, 1949.
35 Martínez Alier Joan et Roca Jusmet Jordi, Economia ecologica y politica ambiental, México, Fondo de Cultura Económica, 3ème édition, 2013.
36 Vallejo María Cristina, « Reflexiones sobre los límites del desarrollo en el marco del Sexto Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente, FLACSO-Sede Ecuador », in María Cristina Vallejo et Mateo Aguado Caso, Reflexiones sobre los límites del desarrollo. Memorias del Sexto Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente, Quito, FLACSO/Senplades, 2014, p. 18.
37 Ibidem, p. 20.
38 Les TBI sont des instruments juridiques internationaux signés entre deux États ayant pour objet de protéger réciproquement des investissements au niveau international. L’objet de la protection est l’investissement privé d’une personne ou une entreprise d’un pays dans un autre pays.
39 Le rapport de cette commission a été rendu public en mai 2017. Pour télécharger le résumé du rapport de cette commission : [www.caitisa.org]. Les informations qui suivent viennent de ce rapport intitulé : « Auditoria integral ciudadana de los tratados de protección recíproca de inversiones y del sistema de arbitraje en materia de inversiones en Ecuador ».
40 Au total, les demandes des investisseurs contre l’État équatorien ont été de 21,2 milliards de dollars desquels 1498 millions de dollars ont déjà été déboursés (1342 millions d’amendes, notamment pour Oxy et Chevron et 156 millions pour les arbitres et buffets d’avocats internationaux spécialisés dans ce genre de procès). Les demandes en cours s’élèvent à 13,4 milliards de dollars ce qui représente 52% du Budget de l’Etat de 2017.
41 Voir Le Quang Matthieu, Laissons le pétrole sous terre ! L’Initiative Yasuní-ITT en Equateur, Paris, Omniscience, 2012.
42 Le Quang Matthieu, « La trajectoire politique de l’initiative Yasuní-ITT en Équateur : entre capitalisme vert et écosocialisme. », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 2016, n°130, p. 105-121.
43 Boron Atilio, Pachamamismo vs extractivismo, Quito, Colección Luna de sol, 2013.