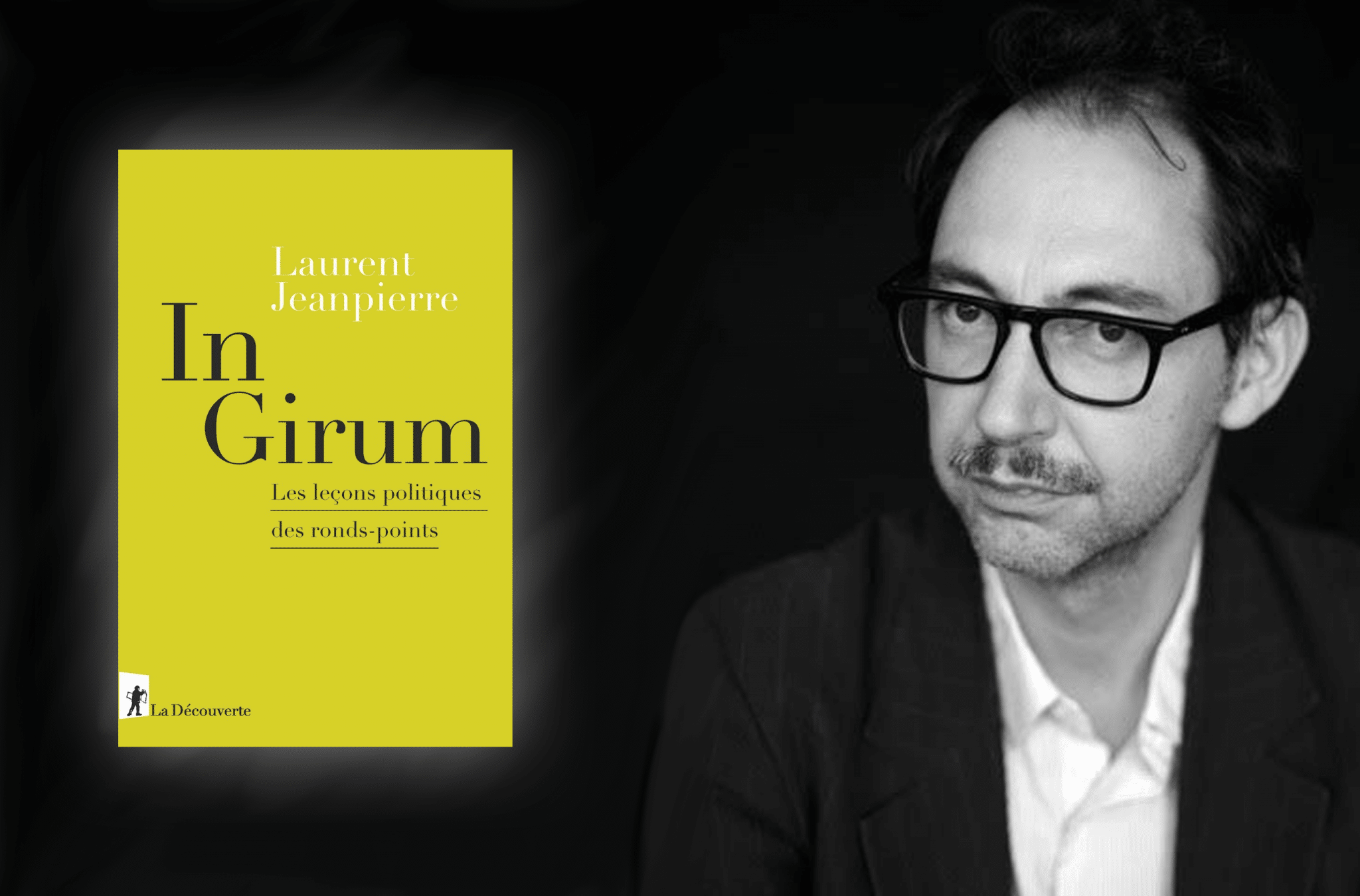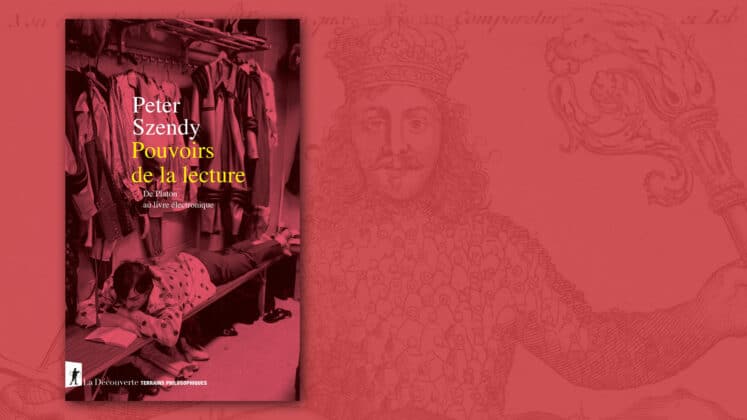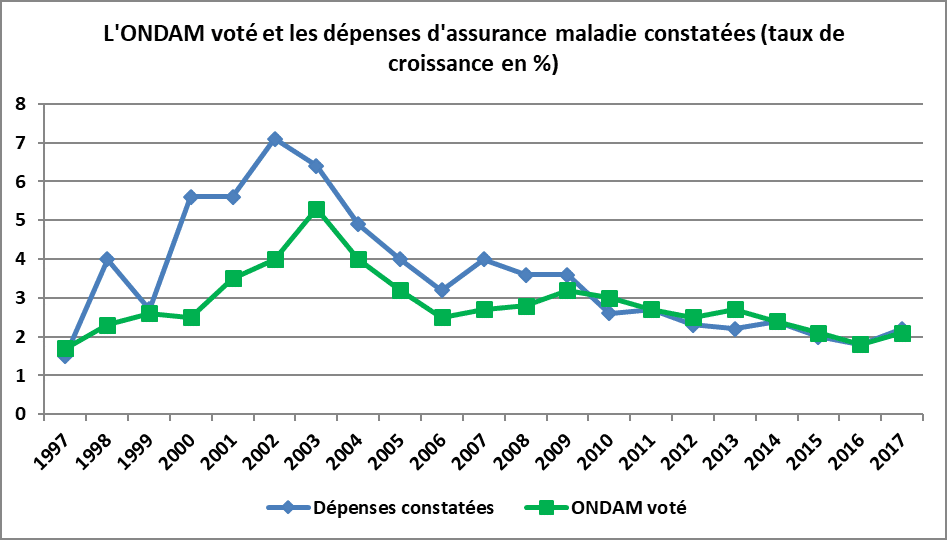En 2019, tandis que révoltes et insurrections ont grondé à travers le monde (France, Haïti, Liban, Équateur, Chili, Irak…), le premier réflexe a consisté à interroger les causes de ce soulèvement généralisé. Par-delà les divergences nationales, ce sont en effet les inégalités économiques et sociales ainsi que la confiscation de la souveraineté populaire qui se sont révélées être au cœur des mobilisations. Mais à l’examen des raisons a symétriquement répondu l’heure du « bilan », qui voulait, comme à chaque fois, mettre les luttes au passé, faire résonner la redoutable logique du « Et après ? » et reconduire vers les routes de la servitude et de la résignation. Un certain ton qu’il est urgent de combattre, en proposant une véritable politique du présent, capable d’interrompre le cours de l’histoire et d’opposer au « à quoi bon ? » le pouvoir de l’action.
La tyrannie du « Et après ? »
Les réflexions interrogeant la postérité des soulèvements contemporains ne se sont pas fait attendre. Elles n’en demeuraient pas moins investies, pour la plupart, d’un postulat fondamental : l’événement était clos, désormais terminé. À l’embrasement médiatique et politique succédait l’analyse froide et rigoureuse ; derrière un souci de « compréhension », le discours venait pourtant camoufler le visage de la réaction. On reprochait la violence des manifestants, on pointait l’absence de débouchés institutionnels et l’impossibilité de désigner des représentants, on soulignait la proportion moindre des insurgés au regard de la population moyenne, on affirmait l’essoufflement des mouvements mais l’on saluait les « avancées » octroyées par un pouvoir en place, qui avait « entendu son peuple », on invitait enfin au retour à l’ordre. Et c’est bien ce dernier qui couve en secret la question « Et après ? ». En faisant jouer le soulèvement selon ses propres règles, elle emprisonne la contestation et prétend pointer ses « contradictions ». Révolte adolescente incapable de se « structurer », elle ne serait que puissance de négation, sans affirmation. Preuve en est, lorsqu’on l’invitait à comparaître au tribunal de l’opinion et de la raison, elle était piégée dans une impasse : si elle se refusait à venir, elle était coupable et désavouait « le dialogue » ; si elle acceptait, ses demandes étaient jugées « floues » ou « trop radicales ». Pis encore cependant, en se pliant aux règles du jeu, elle se compromettait et oubliait sa nature : celle qui exige, non le désordre, mais la sortie de cet ordre-ci – de l’ordre, qui toujours demande « Et après ? ».
« C’est bien l’ordre que couve en secret la question « Et après ? ». En faisant jouer le soulèvement selon ses propres règles, elle emprisonne la contestation et prétend pointer ses contradictions. »
Mais comment alors éviter l’impasse – ou plus exactement, ce qui nous est présenté comme une impasse ? En récusant précisément la fuite en avant, qui offre au futur seul le privilège du jugement. « Même si toutes ces révoltes n’aboutissent pas à une victoire des contestataires, que changent-elles dans l’histoire ? » pouvait-on, par exemple, lire dans la presse [2]. Manière subtile de reconnaître les « secousses » provoquées par les vagues de soulèvements, tout en admettant leurs défaites – ou renvoyant, au mieux, leurs effets à des éléments sédimentés qui « un jour » peut-être se concrétiseront. Un bilan toujours démobilisateur, qui renvoie les insurgés à leur incomplétude et les place immédiatement sous le signe du « manque », de même qu’il contraint les plus farouches enthousiastes à l’attentisme : « Tu verras que les choses vont changer. » ; « La politique, c’est aussi le temps long » ; « Les effets sont invisibles, mais ils seront là. » Parier sur l’avenir, la tentation est toujours grande ; mais derrière l’horizon radieux s’abrite un cadre d’intelligibilité auquel il s’agit désormais de faire l’effort de résister car il prive la réflexion d’un espace précieux. Interroger pleinement les « soulèvements » impose d’admettre une autre grammaire temporelle qui diffère de celle qui règne partout en maître. Un pas de côté qui exige de dénaturaliser l’ordre des temps dont avons hérité, depuis l’affirmation du régime moderne d’historicité [3], tout entier pensé sur le modèle de la linéarité. En d’autres termes, admettre qu’il est possible de penser autrement l’articulation entre passé, présent et futur : ces trois « temps » pouvant se succéder sur le modèle traditionnel « avant / pendant / après », mais aussi – et surtout – se superposer au profit d’un présent agissant synthétisant, au moment de l’action, le passé des luttes inachevées, le présent d’un cri de révolte et le futur déjà anticipé d’un ordre juste.
« En s’arrachant aux lois du temps, l’insurrection instaure une suspension, devrait-on dire une respiration. Elle mérite alors d’être considérée à la lueur de son seul passage, venant lézarder l’oppressante précipitation de la modernité. »
Renouer avec une pensée et une politique du présent, c’est accepter de considérer l’insurrection, non du point de vue du devenir, mais selon les modalités du « surgissement » et de « l’événement ». C’est aussi conjuguer une dynamique de prévisibilité – il y a en effet des conditions matérielles et objectives aux « révoltes », qu’une analyse sociologique peut explorer – et un « sursaut » imprévisible, qui porte en lui, le geste politique par excellence : celui capable d’interrompre le cours du monde. En s’arrachant aux lois du temps, l’insurrection instaure une suspension, devrait-on dire une respiration.

Elle mérite alors d’être considérée à la lueur de son seul passage, à l’image de la passante baudelairienne, un éclair… puis la nuit, qui appartient à ce même registre de la circonstance, venant lézarder l’oppressante précipitation de la modernité. Face à l’événement, la seule attitude qui vaille est celle qui ne s’empresse pas d’exiger des preuves et des explications, mais celle qui reconnaît son caractère politique, entreprend de répondre à son appel et enfin de lui rendre justice. Car demander « Et après ? », c’est déjà perpétuer une injustice : celle de la mise au passé et de l’oubli, qui voudrait tourner la page, sans entendre ce « nouveau-né qui crie dans les couches sales de l’époque » [4] et sans comprendre que ce sont ceux pour qui « le rapport au futur s’est refermé » [5] qui voient alors le jour. Celle aussi qui dissout la singularité du présent et ne jure que par les systèmes explicatifs. Quand se glisse parmi les insurgés l’accusation « c’est la faute du système », on n’imagine pas combien, ils touchent à une réalité plus profonde encore que la simple dénonciation d’une oligarchisation croissante des sociétés. Ils savent que l’ordre déteste le droit à l’existence, qui vient bousculer ses catégories.
« Lorsque Marx invite à considérer la Commune, d’abord selon « son existence même », il esquisse les prémices de cette politique du présent, qui au-delà de son souci de justice, est aussi une lutte contre les prophètes de la défaite anticipée et de l’alternative avortée. »
Et lorsque Marx invite à considérer la Commune, d’abord selon « son existence même » [5], il esquisse les prémices de cette politique du présent, qui au-delà de son souci de justice, est aussi une lutte contre les prophètes de la défaite anticipée et de l’alternative avortée. Un combat qu’il faut encore aujourd’hui mener pour empêcher qu’aux soulèvements succèdent l’amer sentiment du « retour au même » et l’impossibilité d’agir pour « changer l’histoire ».
L’insurrection contre l’histoire
Comment agir, en effet, face au scandale de la répétition ? Walter Benjamin, dans ses fulgurantes « Thèses sur le concept d’histoire » (1940), offre une réponse en esquissant les contours d’un marxisme hétérodoxe, capable de s’émanciper de la tradition hégélienne, ayant précipité le dix-neuvième siècle dans la « marche de l’Histoire ». Loin de s’enfermer dans des spéculations philosophiques, c’est face à la brutalité de l’époque – victoire du nazisme, échec de la social-démocratie allemande, signature du pacte germano-soviétique en 1939, perçu comme le mariage entre le fascisme et le communisme – que le théoricien de l’École de Francfort délivre dans l’urgence « le texte le plus important de la théorie révolutionnaire depuis les célèbres Thèses sur Feuerbach (1845) » [6], selon Michael Löwy, avant de se suicider à Port-Bou en 1940, pour échapper à la police allemande.

En 2019, ses intuitions demeurent intemporelles et témoignent de ce même paradoxe : tandis que l’histoire se présente comme moteur, comme progrès, comme accomplissement, la voici qui, suivant si bien son cours, délaisse les hommes, dépassés par le torrent de son immense machinerie. Tout en se poursuivant, elle répète inlassablement la même logique ; sa force révolutionnaire se mue en force conservatrice. Et si Marx affirmait que « les révolutions sont les locomotives de l’histoire », Benjamin soutient désormais qu’elles sont devenues « le frein d’urgence » pour stopper ce train sans conducteur.
« Face à l’histoire « En Marche », qui n’est plus qu’une illusion pour justifier l’éternel retour de la domination, Walter Benjamin oppose la radicalité du geste insurrectionnel. Il écrit : « Les classes révolutionnaires, au moment de l’action, ont conscience de faire éclater le continuum de l’histoire. »
Face à l’histoire « En Marche », qui n’est plus qu’une illusion pour justifier l’éternel retour de la domination, comme en atteste plus lourdement encore l’heureuse postérité partisane de l’expression, Benjamin oppose ainsi la radicalité du geste insurrectionnel. Il écrit : « Les classes révolutionnaires, au moment de l’action, ont conscience de faire éclater le continuum de l’histoire. La Grande Révolution introduisit un nouveau calendrier. (…) Au soir du premier jour de combat [de la révolution de Juillet], on vit en plusieurs endroits de Paris, au même moment et sans concertation, des gens tirer sur les horloges. » [7] Au jour de la première mobilisation des Gilets Jaunes, on déclara aussi Acte I. Sur les places occupées, on retrouvait des inscriptions sur les sols, An Zéro. Une manifestation alternative du temps qui « sort » de l’histoire : « the time is out of joint, le temps est hors de ses gonds » [8] dira Derrida, citant l’Hamlet de Shakespeare. Au cœur de cette échappée, ce qui se joue, c’est à chaque fois le possible – possible qui n’a rien d’un utopique avenir, mais qui s’inscrit dans la chair du présent – Présent, qui n’a rien de l’étroit présentisme auquel nous devrions être aujourd’hui bornés. S’insurger contre l’histoire, c’est alors reprendre son droit et son pouvoir d’agir ; c’est affirmer avec la clairvoyance de Benjamin que « la politique prime désormais l’histoire » et qu’il s’agit de renverser le cadeau empoisonné de la modernité.
« Changer l’histoire, ce n’est donc plus changer son cours, mais changer profondément notre rapport à cette dernière afin qu’elle cesse d’être un registre d’accusations, une locomotive infernale, ou un horizon apocalyptique. »
Changer l’histoire, ce n’est donc plus changer son cours, mais changer profondément notre rapport à cette dernière afin qu’elle cesse d’être un registre d’accusations (il faudrait « apprendre des erreurs du passé »), une locomotive infernale (il faudrait « aller de l’avant », sans qu’on sache jamais ce qu’il y a devant), ou un horizon apocalyptique (il n’y aurait plus rien à faire, puisque « nous courrons à notre perte »). Aussi différents ses visages puissent-ils paraître, ils relèvent tous de cette conception linéaire de l’histoire, où rien ne peut véritablement venir s’interposer. Or penser l’histoire, c’est précisément penser la latitude d’action qu’il est permis à l’homme d’espérer. Actuellement, force est de constater l’étroitesse des rives qui nous est imposée et la nécessité de reconquérir le lieu du présent, ou plus exactement de l’ « à-présent » pour reprendre Benjamin. « Ainsi, pour Robespierre, la Rome antique était un passé chargé d’ « à-présent », qu’il arrachait au continuum de l’histoire. La Révolution française se comprenait comme une seconde Rome » [9] n’hésite pas à affirmer le théoricien de Francfort, réunissant ainsi deux exigences : celle d’agir, maintenant, au temps de l’aujourd’hui et celle de ne pas abandonner les soulèvements « passés », qu’aucun « Et après ? » ne sera parvenu à dissoudre dans l’oubli.

Une fraternité des morts et des vivants s’installe avec Benjamin, entourant l’engagement révolutionnaire d’une responsabilité plus grande encore que celle du seul homme qui dit non. Il s’agit de dire ce « nous » d’à travers le temps, pour se donner le courage de la lutte. Impossible alors de trahir ceux qui nous ont précédés et de baisser les armes. Pas de posture révérencieuse cependant, ou pire mimétique, car notre unique chance est celle de vivre « stratégiquement » au présent. Dérober au « no future » l’énergie de sa révolte ; substituer à sa négativité absolue l’espoir rédempteur d’une autre révolution. Et si l’invocation de « l’espoir » paraît bien anachronique, en ces temps où sévissent les prophètes du vide contemporain, il faut rappeler que ce dernier n’a cessé d’être étouffé sous les coups répétés de leurs « Et après ? » et qu’il ne pourra être retrouvé qu’à condition de changer de matrice historique, au cœur de laquelle l’utopie pourra se manifester comme « un espoir vécu sur le mode de l’aujourd’hui » [10].
La lutte des histoires
Mais alors l’histoire joue-t-elle avec ou contre nous ? Pour répondre, il faut échapper au choix binaire : l’histoire est d’abord contre nous, avant d’être avec nous. C’est à partir de cette « conscience historique » que doit se réinventer l’engagement politique – et, in extenso, l’engagement révolutionnaire. Plutôt qu’une « lutte des classes », proposition est faite de parler de « lutte des histoires » pour caractériser l’affrontement qui se cristallise lors des vagues d’insurrections.
« En défiant « l’histoire de la conservation », les insurgés ouvriraient une brèche à « l’histoire de l’émancipation ». Cette dernière n’étant pas un continuum, mais le produit d’interruptions répétées, qui rejouent, à chaque fois, la possibilité d’un basculement. Elle aurait son temps, sa mémoire, son mouvement et sa fonction propre : elle écrirait au cœur du réel l’alternative. »
En défiant « l’histoire de la conservation », les insurgés ouvriraient une brèche à « l’histoire de l’émancipation ». Cette dernière n’étant pas un continuum, mais le produit d’interruptions répétées, qui rejouent, à chaque fois, la possibilité d’un basculement. Elle aurait son temps, sa mémoire, son mouvement et sa fonction propre : elle écrirait au cœur du réel l’alternative. Et pour les plus sceptiques, qui demanderait encore avec une inquiétude toute légitime « Mais concrètement ? », il convient de leur rappeler que notre premier défi n’est pas celui de suggérer des « suites » aux mobilisations mais de combattre la résignation. À mesure que faiblira le sentiment de dépossession, grandira le potentiel d’invention. Chaque soulèvement est alors d’abord le lieu d’une rencontre ; chaque appel pour « en être » est la possibilité de faire l’expérience d’un autre monde. « Un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci », insistait déjà Paul Éluard. Et ce n’est ainsi pas un hasard, si lorsqu’on échange avec les insurgés, il se tisse d’abord une parole pour dire l’intensité d’un vécu partagé, avant celle qui veut préciser un horizon programmatique. Aussi insuffisant cela puisse-t-il paraître pour certains, quand le contemporain a choisi les biens plutôt que les liens [11], la force de se réunir et de se parler est déjà subversive.
Au mouvement du « faire » répond celui du « raconter » ; car la lutte des histoires est aussi une lutte des récits, des « grands » comme des « petits », qui ne se contentent pas d’être de simples auxiliaires de l’action. Dire c’est faire exister, mais c’est surtout résister au silence. Une parole qui trouve naissance au cœur même de la mobilisation, et qui, contrairement à ce que l’on croit, ne s’évanouit jamais après. Elle se transforme pour rejoindre l’espace littéraire, qui préserve une mémoire vivante. Dans toutes les traces écrites se lit la possibilité de la conjonction des temps : passé simple devenu présent, conjurant la distance entre les siècles.

Lorsqu’Éric Vuillard « raconte » le 14 Juillet, il fait bien davantage que dépouiller des archives, il leur redonne vie. Alors que les preneurs de la Bastille s’essaient à attraper un bout de papier, tendu par un garde de la prison, en traversant une planche suspendue aussi du vide, la voix du narrateur revient : « C’est que depuis des siècles on l’attendait ce petit mot, un mot d’excuse peut-être, qui nous soufflerait que tout est fini, qu’on allait enfin partager, que ç’avait été une mauvaise blague, l’Histoire, qu’on y reviendrait plus, qu’à présent, on pouvait sortir tranquillement des tableaux de Le Nain et des chansons à boire, que c’en était terminé des salaires de misères, du mépris. » [12]
« C’est que depuis des siècles on l’attendait ce petit mot, un mot d’excuse peut-être, qui nous soufflerait que tout est fini, qu’on allait enfin partager, que ç’avait été une mauvaise blague, l’Histoire, qu’on y reviendrait plus, qu’à présent, on pouvait sortir tranquillement des tableaux de Le Nain et des chansons à boire, que c’en était terminé des salaires de misères, du mépris. »
Difficile de nier le pouvoir d’entraînement de telles lignes, qui participent doublement du mouvement de l’histoire : à la fois comme « souvenir » d’un soulèvement et comme « étincelle » capable d’allumer un autre brasier. En redonnant une place ainsi qu’une effectivité aux récits et en maintenant l’exigence d’une parole qu’on oserait dire « prophétique », il devient possible de reconquérir une marge de manœuvre, une marge de « discours » capable de faire taire l’insupportable langue, qui à force de ressasser ses vérités est parvenue à les rendre réelles.
Aux enfants de la « fin de l’histoire » sont alors dédiées tout particulièrement ces réflexions. Car il est une génération à laquelle on répète depuis qu’elle est en âge de penser, qu’elle est née au cœur d’une époque terminale et qui pour « commencer » à parler doit sans cesse se justifier. Commencer par dire que « c’était la fin », mais que finalement « ce n’est pas la fin ». Un vieux sortilège, qui sévit déjà depuis les années 1950 comme en témoigne Derrida, lorsqu’il raconte qu’il a lui-aussi été nourri par ce « pain d’apocalypse » [13]. Il serait trop long d’interroger en profondeur la persistance de ce discours de la fin ; à défaut, il est utile de mettre en garde contre le piège qu’il nous tend. Car en le perpétuant, même pour s’y opposer, nous entretenons son influence. Nous admettons implicitement qu’il avait « raison » et qu’une énergie historique s’était effondrée.
« Désormais, il faudrait brandir « la fin de la fin ». […] En formulant ainsi nos revendications, nous nous condamnons, insidieusement, à la répétition. En reprenant le même schéma que celui de nos adversaires, nous nous rendons tributaires de leur logiciel historique. »
Nous acceptons aussi le rapport de force, « l’histoire de la conservation » aurait triomphé et désormais tels de valeureux chevaliers, il faudrait brandir « la fin de la fin ». Si je partage le combat qui sous-tend cet étendard – à savoir, celui de rendre aux sujets historiques la puissance d’agir et de transformer l’ordre existant –, il me paraît qu’en formulant ainsi nos revendications, nous nous condamnons, insidieusement, à la répétition. En reprenant le même schéma que celui de nos adversaires, nous nous rendons tributaires de leur logiciel historique. Nous poursuivons la course en avant, nous prenons le risque qu’après « la fin », la pièce « recommence », comme un mauvais drame dans un théâtre de boulevard, et qu’en dépit du changement d’acteurs, le décor demeure identique.

Or, ce dont nous avons besoin, c’est d’un sursaut de la pensée pour s’arracher aux grilles qui l’emprisonnent, d’un pouvoir d’invention pratique et théorique pour lutter contre la perpétuation des injustices, d’une voix qui aura compris l’avertissement de Benjamin – « Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe » –, d’un corps qui osera l’aventure.
« Prends garde c’est l’instant où se rompent les digues
C’est l’instant échappé aux processions du temps
Où l’on joue une aurore contre une naissance. »
Paul Éluard, « L’aventure », Les Mains Libres, 1937.
[1] W. Benjamin, « Thèse XV », « Sur le concept d’histoire », in : Oeuvres, Tome III, Paris, Gallimard, p. 440.
[2] « Liban, Chili, Hong-Kong, Soudan… Pourquoi le monde est-il en train de se soulever ? », France Info, 27 octobre 2019.
[3] Voir à ce sujet les travaux de F. Hartog, Temps, histoire, régimes d’historicité, Paris, Points, 2003 (préface de 2012).
[4] W. Benjamin, « Expérience et pauvreté » (1933), in: Po&sie , n° 51, tr. fr. P. Beck, B. Stiegler, p.73.
[5] L. Jeanpierre, In Girum, Les leçons politiques des ronds-points, La Découverte, Paris, 2019, p.181.
[5] K. Marx, La guerre civile en France (La Commune de Paris), 1871, p.55. [éd. numérique]
[6] M. Löwy, « Pessimisme révolutionnaire. Le marxisme romantique de Walter Benjamin », Cités, vol.74, 2018, p.99.
[7] W. Benjamin, « Thèse XV », « Sur le concept d’histoire », in : Oeuvres, Tome III, Paris, Gallimard, p. 440.
[8] J. Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993, p.42.
[9] W. Benjamin, « Thèse XIV », « Sur le concept d’histoire », in : Oeuvres, Tome III, Paris, Gallimard, p. 439.
[10] S. Moses, L’Ange de l’Histoire. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Paris, Le Seuil, 1992, p.145.
[11] Expression empruntée à F. Ruffin, Il est où le bonheur, Paris, Les liens qui libèrent, 2019.
[12] E. Vuillard, 14 juillet, Paris, Actes Sud, 2016, p.163.
[13] J. Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993, p.37.