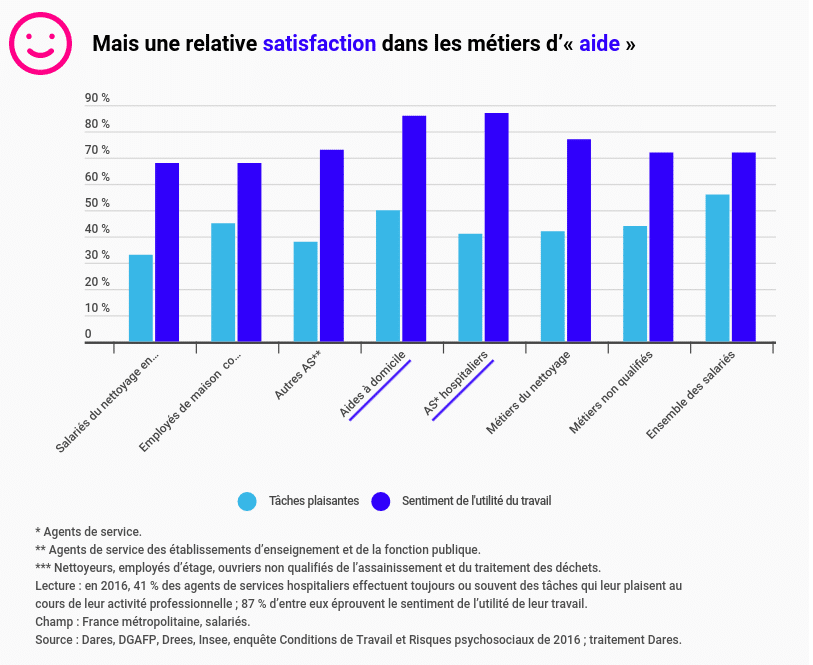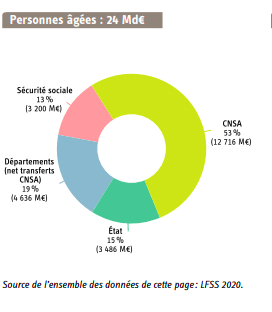À l’été 1830, face à la menace d’un retour à l’Ancien-Régime par le Roi Charles X, le peuple de Paris se révolte et renverse définitivement la dynastie des Bourbons. Si l’action du peuple parisien est saluée par le nouveau pouvoir, ces évènements raniment aussi la peur de voir l’apparition d’un nouveau cycle de révolutions populaires comme ce fut le cas dans le chapitre exceptionnel que représente la dynamique révolutionnaire parisienne de 1789 à 1795. Durant ces 6 années qui vont de la prise de la Bastille en juillet 1789 jusqu’aux insurrections contre la vie chère lors du printemps 1795, Paris est le théâtre de plusieurs révolutions populaires qui s’attaquent directement aux lieux de pouvoir dans un but politique. C’est ce processus social de la journée révolutionnaire qu’Antoine Boulant, historien spécialiste de la Révolution française et de l’Empire, dissèque dans son dernier ouvrage La journée révolutionnaire, le peuple à l’assaut du pouvoir (1789-1795) paru aux éditions Passés Composés. À travers une analyse approfondie des différentes étapes, des acteurs et aboutissements de ces journées, ce livre permet de mieux appréhender une page cruciale de notre histoire contemporaine, toujours source d’inspiration pour l’imaginaire politique français et international. Entretien réalisé par Xavier Vest.
LVSL – Pour décrire la dynamique révolutionnaire parisienne (1789-1795), le baron Paul Charles Thiébault, témoin des événements, compare Paris à un « sol volcanique dont les torrents de feu s’échappaient à la moindre secousse ». Ces secousses politiques sont-elles apparues de façon spontanée dans la vie politique parisienne à partir de 1789 ou trouve-t-on des préludes de contestation révolutionnaire et populaire sous l’Ancien régime durant les longs règnes de Louis XIV et de Louis XV ou dans les premières années de règne de Louis XVI ?
Antoine Boulant – En effet, Paris et la France n’ont pas attendu la Révolution pour connaître des mouvements populaires… Les révoltes antifiscales, notamment, furent très fréquentes sous l’Ancien Régime dans les campagnes. La capitale elle-même connut plusieurs révoltes, des troubles de 1588 contre les troupes d’Henri III aux séditions de 1788 dirigées contre les réformes du Garde des Sceaux Lamoignon de Basville, en passant par les barricades élevées en 1648 pour protester contre l’arrestation du conseiller Broussel.
LVSL – Votre ouvrage n’est pas écrit chronologiquement mais de façon analytique vis-à-vis du processus politique et social qu’est la journée révolutionnaire pour aboutir à la description d’une mécanique commune. Vous vous basez néanmoins sur huit journées révolutionnaires avec certaines célèbres comme la prise de la Bastille, le 10 août 1792 et d’autres moins connues comme le 20 juin 1792 ou les journées d’avril et de mai 1795. Néanmoins, vous n’englobez pas d’autres événements comme la fusillade du Champ de Mars, les massacres de septembre ou encore plus tard la conjuration des égaux ou les coups d’État qui animent le Directoire (1795-1799). Quelle définition donner de la journée révolutionnaire ?
A. B. – Les insurrections de la période 1789-1795 sont de nature très différente des révoltes d’Ancien Régime. Conduites au nom de la souveraineté du peuple, elles avaient pour objet d’attaquer directement les détenteurs du pouvoir (le roi, les députés) dans le lieu même de leur résidence (le château de Versailles et le palais des Tuileries, la prison de la Bastille étant un cas à part) pour en obtenir par la contrainte des mesures à caractère politique, économique ou social. L’une ou l’autre de ces dimensions manque dans les événements que vous citez : ainsi, le pouvoir en tant que tel ne fut pas attaqué lors de l’affaire du Champ de Mars, et les coups d’État du Directoire n’eurent aucune dimension populaire.
LVSL – En 1781, l’écrivain Louis-Sébastien Mercier publie Le Tableau de Paris, ouvrage dans lequel il se livre à une description générale du Paris pré-révolutionnaire et aussi de la pauvreté qui règne dans certains faubourgs à l’est de la capitale. Retrouve-t-on plus tard les indigents dont Mercier dresse le portrait comme la base sociale principale à l’œuvre dans les journées révolutionnaires qui animent la vie politique de Paris ?

A. B. – La question de la composition socio-professionnelle des insurgés est évidemment essentielle. Comme l’ont démontré plusieurs historiens, notamment Georges Rudé ou Albert Soboul, il y avait en réalité très peu de véritables pauvres parmi les foules qui attaquèrent Versailles ou les Tuileries. L’immense majorité des insurgés étaient des membres de la petite et moyenne bourgeoisie, essentiellement des artisans, des commerçants, des apprentis et des employés, donc des individus possédant un domicile et un travail, souvent alphabétisés et bénéficiant de réseaux professionnels, amicaux et familiaux.
LVSL – Dans Les Origines de la France contemporaine, l’historien conservateur Hippolyte Taine critique souvent de façon violente une foule révolutionnaire manipulable peuplée de bandits ivres. Quel rôle a véritablement eu la rumeur dans le processus révolutionnaire? La journée révolutionnaire est-elle un acte spontané obéissant à une logique horizontale ou est-elle préparée et encadrée par des personnalités fortes ?
A. B. – Les « fausses nouvelles » existaient déjà sous la Révolution (et même bien avant) et ont joué un rôle important dans le déclenchement des journées, même si celles-ci eurent évidemment des causes objectives, économiques et politiques. La seule journée véritablement spontanée fut la prise de la Bastille, qui se décida en quelques heures puisqu’il s’agissait de trouver rapidement de la poudre pour les fusils qui venaient d’être saisis aux Invalides. Toutes les autres journées furent plus ou moins préparées et anticipées, en particulier la prise des Tuileries le 10 août 1792. Les membres de la municipalité, les orateurs des clubs, les journalistes et certains meneurs de quartier jouèrent un rôle essentiel pour mobiliser les foules.
LVSL – La prise de la Bastille apparaît souvent pour l’opinion publique française et internationale comme le symbole de la journée révolutionnaire. N’y a-t-il pas une mythification de cet événement et notamment de sa symbolique ? À l’inverse, la journée du 10 août 1792, qui voit la prise des Tuileries par les sections parisiennes et les fédérés puis la chute de la monarchie, peut-elle apparaître comme l’acmé de cette dynamique révolutionnaire et la forme la plus paroxystique de la journée révolutionnaire ?

A. B. – C’est tout à fait juste en effet. La prise de la Bastille étant la première des journées révolutionnaires, elle frappa d’étonnement les contemporains, et jusque dans certains pays étrangers. Ses conséquences furent importantes, mais sans commune mesure avec celles des journées d’octobre 1789 (qui obligèrent le roi à s’installer dans la capitale et le contraignirent à reconnaître l’abolition des privilèges et la Déclaration des droits de l’homme) et celle du 10 août 1792, qui entraîna la fin de la monarchie (qui devait cependant être rétablie en 1814). Cette dernière journée fut également la mieux préparée et, malheureusement, la plus meurtrière, avec des combats et des massacres qui firent environ un millier de morts.
LVSL – Le bilan humain du 10 août 1792 est en effet particulièrement élevé avec des centaines de morts des deux côtés. Cette violence se retrouve-t-elle aussi à ce niveau dans les autres journées ? Choque-t-elle le peuple de Paris ?
A. B. – Toutes les journées n’ont pas occasionné de victimes. La prise de la Bastille fit une centaine de morts, tandis que les journées d’octobre 1789 et l’insurrection du 20 mai 1795 entraînèrent le massacre de quelques individus. En revanche, les quatre autres journées ne firent aucune victime. Certaines d’entre elles peuvent d’ailleurs être assimilées à de grosses manifestations plutôt qu’à de véritables insurrections, comme la journée du 5 septembre 1793 qui vit des centaines de manifestants envahir sans violence la salle des séances de la Convention.
LVSL – Le journaliste Antoine Rivarol écrit à propos de ces journées : « La défection de l’armée n’est point une des causes de la Révolution, elle est la Révolution elle-même. » Certaines journées ont-elles réussi grâce à une faible volonté de défendre les institutions gouvernementales ?
A. B. – On peut même dire qu’elles ont presque toutes réussi grâce à cela… Outre que Louis XVI ne se décida jamais à ordonner de faire tirer sur la foule, les troupes se sont toujours révélées insuffisamment nombreuses, mal commandées et peu motivées. Beaucoup d’officiers n’avaient aucune expérience des insurrections populaires en milieu urbain et ne savaient comment réagir face aux émeutiers. Beaucoup de gardes nationaux ou de gendarmes partageaient les revendications des insurgés et refusaient de tirer, comme on le vit notamment lors de la prise des Tuileries.
LVSL – À l’été 1793, avec le soutien passif ou actif des députés montagnards, les sections parisiennes renversent les principaux députés girondins qui sont vus par les sans-culottes comme trop passifs face à l’ennemi intérieur et extérieur. Dans les mois qui suivent, les jacobins parviennent-ils à contenir le pouvoir populaire et à éviter de nouvelles journées révolutionnaires ?
A. B. – En révolution, les radicaux sont souvent dépassés par des individus encore plus radicaux qu’eux… Les Montagnards durent ainsi subir la journée du 5 septembre 1793 et accorder aux sans-culottes certaines mesures politiques qu’ils ne souhaitaient pas forcément eux-mêmes. Jusqu’à la chute de Robespierre, ils réussirent cependant à échapper à une nouvelle journée. Lorsque les hébertistes tentèrent d’organiser une insurrection en mars 1794, ils furent aussitôt arrêtés, jugés et exécutés. La Convention thermidorienne, c’est-à-dire modérée, ne put cependant éviter deux nouvelles journées en avril et mai 1795, dont l’une se solda par le massacre d’un député.
LVSL – Après l’échec des journées révolutionnaires d’avril et mai 1795, le député René Levasseur déclare que le mouvement populaire parisien « a donné sa démission ». Comment le pouvoir met-il fin définitivement au pouvoir de la rue ?

A. B. – La journée du 20 mai 1795 fut suivie par le désarmement du faubourg Saint-Antoine : la Convention décida de frapper un grand coup et ordonna que l’armée cerne le faubourg Saint-Antoine, menaçant ses habitants de couper leurs approvisionnements et obligeant les sans-culottes à restituer les piques et les fusils qu’ils avaient amassés depuis les débuts de la Révolution. Il y eut bien une nouvelle insurrection en octobre, mais elle fut conduite par les sections bourgeoises de l’ouest de Paris, et on ne peut donc la qualifier de « journée révolutionnaire » proprement dite…