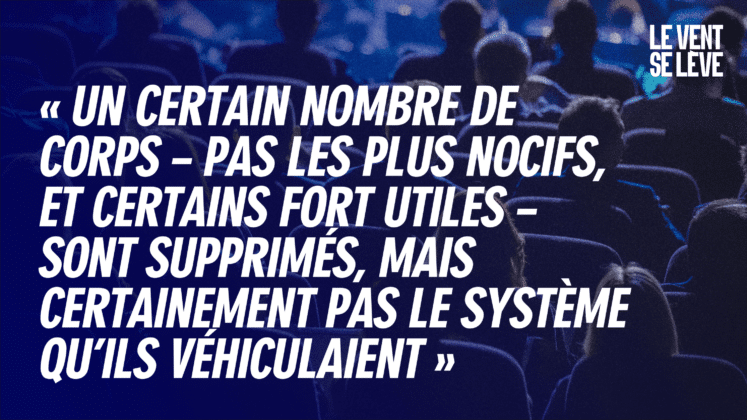Le journaliste américain, Thomas Frank, dont les travaux Pourquoi les pauvres votent à droite et Pourquoi les riches votent à gauche continuent de faire autorité, revient avec un nouvel ouvrage intitulé, non sans ironie, Le populisme, voilà l’ennemi ! (Agone, 2021). Un mot d’ordre en réalité propre à l’anti-populisme qui sature les discours des élites, brandissant l’arme de la raison face aux passions populaires. On aurait cependant tort de croire ce phénomène propre au XXIème siècle : l’histoire érudite que retrace Thomas Frank démontre, au contraire, en quoi l’anti-populisme traverse la scène politique américaine depuis la fondation du Parti du Peuple (People’s Party) en 1892 et manifeste un anti-démocratisme qui n’ose pas dire son nom. À rebours de l’opinion commune, Thomas Frank soutient alors que la solution au malaise contemporain peut être « populiste » – à condition de renouer avec l’espoir dont il était initialement porteur et de démentir l’idée contre-révolutionnaire qui voudrait que la politique ne soit pas l’affaire de tous. Les lignes qui suivent sont extraites du chapitre VIII, « Blâmons maintenant les ignares ».
La longue controverse sur le populisme que j’ai retracée dans ce livre est, pour partie, une affaire d’image et de rhétorique. Mais elle met aussi en jeu une question de fond : comment les libéraux doivent-ils concevoir leur rapport au pays qu’ils veulent rénover et aux gens qu’ils souhaitent diriger ? Un modèle libéral – le paradigme élitiste – admire l’expertise et compte sur les professionnels surdiplômés pour prendre les bonnes décisions en notre nom. L’autre – le modèle populiste – compte sur les gens ordinaires en tant qu’ultimes dépositaires du génie démocratique.
Pendant de nombreuses années, le Parti démocrate a suivi le modèle populiste : c’était là tout le sens du libéralisme pour nombre de ses dirigeants. Mais à partir des années 1970, la mission a commencé à évoluer. Au fil d’innombrables débats internes au parti, les démocrates en sont venus à se voir non plus comme la voix des travailleurs mais comme une sorte de rassemblement des doctes et des vertueux.
L’ironie de la chose, c’est qu’ils sont parvenus à cette conception au moment même où le populisme, en tant qu’hostilité généralisée à l’establishment, était en train de gagner tout le pays. De Madison Avenue aux ondes de la radio musicale de leurs mornes petites villes, les Américains de tout acabit se voyaient en rebelles vent debout contre les règles, la tradition et l’autorité. Même les conservateurs posaient en insurgés. Le seul groupe qui semblait avoir du mal à se faire à ce nouveau climat était le Parti démocrate.
C’est ainsi que nous arrivons enfin à la synthèse désastreuse à laquelle les nombreux fils contradictoires de ce livre nous ont menés : tandis que les conservateurs se sont mis à claironner leur soulèvement, les libéraux se sont retournés contre lui. Ils sont devenus anti-populistes.
La faction dominante du Parti démocrate a décidé qu’elle ne voulait pas participer à la moindre critique systématique des grandes firmes, des monopoles ni de l’industrie de la finance. Elle a renâclé à construire ou à soutenir tout mouvement de masse. L’idée de rassembler une coalition de travailleurs s’est mise à lui inspirer un profond dégoût.
Mépriser l’idéologie et les passions, soutenir que nos problèmes étaient de nature technique – voilà en bref ce à quoi ne tarderait pas à se résumer la philosophie démocrate. La bonne réponse à l’offensive de classe de la droite, ont commencé à se dire les démocrates, est d’arrêter de se réclamer eux-mêmes de la tradition populiste et de dépasser totalement l’idéologie.
Mépriser l’idéologie et les passions, soutenir que nos problèmes étaient de nature technique – voilà en bref ce à quoi ne tarderait pas à se résumer la philosophie démocrate.
Si on la rapporte aux succès électoraux des démocrates à l’époque du New Deal, on doit bien constater que cette stratégie n’a pas été particulièrement gagnante. Cependant, aucun de leurs nombreux revers au fil des ans n’a conduit leurs maîtres à penser à revenir sur la décision de devenir le parti de l’élite en col blanc. Au contraire, les démocrates ont employé tout le pouvoir dont ils disposaient pour soutenir le secteur des banques d’investissement et conclure des accords commerciaux conçus non pour développer l’industrie américaine mais pour la siphonner. Mis en cause par des électeurs qui faisaient les frais de ces politiques, les démocrates sortaient des économistes et des politologues de leur manche pour expliquer aux travailleurs que tout ce qui leur arrivait n’était que l’effet de la fatalité, du progrès économique lui-même. La situation ne devait pas être changée. Elle devait être acceptée et supportée.
Le mot même de « populisme » a été frappé d’anathème par les penseurs du parti. En 1992, dans un livre largement célébré, l’apprenti pontife Mickey Kaus conseillait aux démocrates d’abandonner la cause traditionnelle de l’égalité économique et de résister à ceux qu’il qualifiait de « populistes libéraux » : les démocrates doivent cesser d’écouter les syndicats, disait-il, et afficher clairement leur rupture avec le « sous-prolétariat » noir1. Les déclarations de ce genre étaient banales dans les publications du Democratic Leadership Council (DLC), où les populistes étaient définis comme ceux qui « résistent aux changements induits par la Nouvelle économie » et regrettent vainement « les jours glorieux » où les Américains avaient « des emplois stables dans des grandes entreprises »2.
La référence aux « grandes entreprises » n’était pas sans intérêt, mais sur le fond, l’argumentaire était toujours le même. Pour les démocrates, les populistes étaient des gens qui refusaient bêtement l’avenir, pleurant sur leurs bien-aimés trimardeurs quand tout le monde voyait bien que les seuls qui comptaient désormais étaient les professionnels en col blanc, soit la « classe de la connaissance », pour employer la formule co-inventée par le politologue William Galston. Ce que le dynamisme innovant de cette classe représentait, c’était le pouvoir de l’enseignement supérieur et la façon dont « des millions d’Américains étaient en train de rejoindre les rangs de la classe moyenne supérieure et des possédants », déclarait en 1998 un manifeste du DLC co-écrit par Galston3. Les Américains devenaient intelligents, les Américains devenaient riches. Par conséquent, le Parti démocrate devait devenir le parti des gens riches et intelligents, des « électeurs haut de gamme plus instruits » qui voulaient des plans épargne retraite privés mais étaient un peu moins emballés par les écoles publiques. Dans l’une de ses nombreuses dénonciations du populisme, Al From, figure incontournable du Parti démocrate, psalmodiait : « Sous l’ère industrielle, la classe ouvrière dominait le corps électoral. Mais le nouveau corps électoral de l’ère de l’information est de plus en plus dominé par les électeurs des classes moyenne et moyenne supérieure qui vivent en périphérie des grandes villes, travaillent dans la nouvelle économie, sont culturellement tolérants et ont des opinions politiques modérées4. »
Cette post-idéologie n’a pas tardé à devenir le sens commun de la faction dominante du parti. Ayant laissé le New Deal derrière eux, les démocrates se réinventaient en leaders d’une ère d’innovation et de flexibilité, d’abondance et de sophistication, de banquiers d’investissement et de milliardaires des nouvelles technologies. Quand leur tour est venu d’occuper le pouvoir en 2008, ces leaders d’un nouveau style ont refusé de démembrer les banques de Wall Street. Ils ont élaboré une forme d’assurance maladie nationale qui, étonnamment, ne causait aucun tort à Big Pharma ni aux assurances privées. Rayonnants d’exubérance futurible, les cadres de la Silicon Valley avaient envahi la Maison-Blanche de Barack Obama et squattaient l’organisation de la campagne présidentielle de celle qui devait lui succéder, Hillary Clinton, pour faire entrer la nation dans un nouvel âge d’or de cyber-transformation.
Jusqu’au bout, ce fantasme post-idéologique de la classe de l’information a continué à marcher d’un pas tranquille et le port fier. Un mois avant l’élection de 2016, le président Obama a accueilli sur la pelouse Sud de la Maison-Blanche (le South Lawn) une déclinaison du fameux festival de l’innovation texan, South by South West, rebaptisé pour l’occasion « South by South Lawn ». Sous un parfait ciel d’octobre, des stars hollywoodiennes croisaient des climatologues devant un public choisi (au terme d’un processus de candidature fondé sur le mérite) qui pouvait contempler des œuvres d’art conceptuel colorées et écouter parler de solutions créatives à la pauvreté ou aux maladies. Et sur ce ton de simplicité bonhomme qu’on lui connaît, le président disait sa confiance de nous voir surmonter le réchauffement climatique mondial « parce qu’il se trouve que nous sommes le secteur économique et entrepreneurial le plus innovant et dynamique au monde ». C’était le dernier moment de suprême assurance du libéralisme de consensus, une performance si impeccable qu’une fan journaliste n’a pu s’empêcher de surnommer Obama notre « commandant-en-cool »5.
Quelques mois après ce merveilleux après-midi, la campagne présidentielle démocrate qui comptait tranquillement installer Hillary Clinton dans le fauteuil d’Obama était l’illustration parfaite de cette imperturbable suffisance. Si l’objectif ultime de la politique moderne était l’« affinité entre les élites » (comme Edward Shils l’avait dit en 1956), alors les démocrates ont sans doute atteint le nirvana cet automne-là. La campagne de Clinton ne se contentait pas de promettre le consensus, ouvrant sa table aux représentants de Wall Street, de la Silicon Valley et de l’appareil national de sécurité, elle était en elle-même un acte de consensus. Toutes les orthodoxies avaient leur place. Pour une fois, la candidate démocrate a levé et dépensé plus de fonds pour sa campagne que son rival républicain. Dans les villes universitaires du pays et les périphéries huppées de la classe de la connaissance, elle était acclamée comme l’incarnation de l’inévitable.
Comme en 1936, l’« affinité entre les élites » englobait les économistes de profession, dont 370 représentants ont signé une lettre ouverte invitant à ne pas voter pour Donald Trump. Elle a aussi entraîné la presse, les journalistes ayant pris le parti de Clinton par une forme de solidarité de classe de la connaissance. Elle a écrasé Trump dans la course aux soutiens des titres de presse, cinquante-sept des plus grands journaux du pays se rangeant derrière Clinton contre deux seulement derrière Trump ; et 96 % de l’argent donné par les journalistes pendant la campagne présidentielle est allé à Clinton . Presque tous les sondages commandés par les médias affirmaient que Clinton l’emporterait facilement. En octobre 2016, le New York Times a rapporté qu’elle concentrait sa campagne dans les États républicains afin d’élargir sa victoire certaine contre le raciste Trump6.
Puis, le 8 novembre, l’impensable s’est produit. L’imposteur milliardaire a réussi à remporter une grande partie des États du Midwest industriel en déclin, et avec eux la présidence. Abasourdie par le désastre, l’Amérique en col blanc a sombré dans une « peur de la démocratie » pareille à celles que j’ai décrites dans ce livre. Une fois de plus, le populisme était identifié comme le coupable : c’était l’esprit politique maléfique qui avait permis Trump et qui hantait les cauchemars des nantis. Le fait que Trump n’ait nullement, en réalité, recueilli la majorité des suffrages n’a pas du tout ralenti ce récit irrésistible ; que son populisme ait été une totale imposture ne comptait pas davantage : pour les bien instruits et les bien lotis, cette vieille rengaine familière de l’anti-populisme est devenue le nouvel hymne fédérateur de notre temps.
Une fois de plus, le populisme était identifié comme le coupable : c’était l’esprit politique maléfique qui avait permis Trump et qui hantait les cauchemars des nantis.
Lawrence Goodwyn, le grand historien des soulèvements démocratiques de masse, a écrit que, pour construire un mouvement comme le Parti du peuple des années 1890 ou le mouvement syndical des années 1930, il fallait « être en rapport avec les gens tels qu’ils sont dans la société, autrement dit, dans un état que des observateurs avertis modernes ont tendance à considérer comme un état de “conscience insuffisante”7». Cette idée est si importante pour Goodwyn qu’il la reformule quelques pages plus loin : une condition essentielle d’un mouvement démocratique de masse est « d’accepter la conscience humaine au point où elle en est8».
Goodwyn mettait aussi en garde contre une politique de la « vertu individuelle », cette tendance à « célébrer la pureté » de notre supposé radicalisme. Si l’on veut démocratiser la structure économique du pays, affirmait-il, cela demande de la « patience idéologique9 », une suspension du jugement moral à l’égard des Américains ordinaires. Alors seulement pourra-t-on commencer à bâtir un mouvement puissant, prometteur et susceptible de changer définitivement la société10.
Si démocratiser la structure économique du pays ne vous intéresse pas, en revanche, le modèle de la vertu individuelle pourrait bien être ce qu’il vous faut. Les citoyens ordinaires y sont traités par le jugement et l’épuration, par l’annulation et le blâme. Il ne s’agit pas de construction mais de pureté, de moralité sans tache. Son opération favorite est la soustraction, sa forme rhétorique de prédilection la dénonciation et son objectif de maintenir la cohorte des vertueux dans l’étroite orbite du plus vertueux de tous les vertueux.
Ce qui a submergé d’immenses secteurs du libéralisme américain après le désastre du 8 novembre 2016 est le contraire de la « patience idéologique » de Goodwyn. C’est le blâme à son paroxysme, une fureur de faire savoir aux électeurs de Trump quel genre de personnes insuffisantes et même parfaitement nulles elles étaient. La tendance élitiste qui n’a cessé de progresser chez les libéraux depuis des décennies s’est élancée vers son bruyant couronnement chicanier.
Là où le populisme est optimiste à l’égard des électeurs ordinaires, la variété de libéralisme que j’ai à l’esprit les regarde avec un mélange de soupçon et de dégoût. Elle rêve non de syndiquer l’humanité mais de la policer. C’est un geyser de remontrances prêt à jaillir contre tout adolescent ayant commis un geste d’appropriation culturelle, contre le choix inopportun d’un rôle par tel acteur, contre un discours public dont les idées ne plaisent pas, contre le déchargement illégal d’ordures ménagères, contre la technique d’élagage inappropriée repérée dans une banlieue voisine. Son objectif typique n’est pas, comme le populisme, de reprendre le contrôle des banques et des monopoles mais de monter une organisation à but non lucratif, de séduire les banques et les monopoles pour obtenir des financements puis… de blâmer le monde entier pour ses péchés.
Les populistes rêvaient autrefois de ce qu’ils appelaient une « société coopérative », mais c’est aujourd’hui une société vindicative qui inspire le rénovateur, une utopie du blâme où le tribunal siège jour et nuit et où les vertueux ne cessent de rendre les jugements les plus sévères sur leurs inférieurs économiques et moraux. […]
Là où le populisme est optimiste à l’égard des électeurs ordinaires, la variété de libéralisme que j’ai à l’esprit les regarde avec un mélange de soupçon et de dégoût. Elle rêve non de syndiquer l’humanité mais de la policer.
C’est une génération de libéraux centristes qui désespèrent collectivement de la démocratie elle-même. Après avoir tourné le dos à la question ouvrière, qui constitue traditionnellement le cœur de la problématique des partis de gauche, les démocrates ont regardé les bras croisés la démagogie de droite s’enraciner et prospérer. Puis, le peuple ayant fini par assimiler le torrent de propagande pseudo-populiste qui s’abat sur lui depuis cinquante ans, les démocrates se sont retournés contre l’idée même de « peuple »11.
L’Amérique s’est fondée sur l’expression « Nous le peuple ». Pourtant Galston nous demande de surmonter notre obsession de la souveraineté populaire. Comme il l’écrit dans Anti-Pluralism, sa charge de 2018 contre le populisme, « nous devrions mettre de côté cette conviction étroite et suffisante : il existe des alternatives viables au peuple comme source de légitimité12 ».
Assurément. Dans les pages de ce livre, nous avons vu des anti-populistes expliquer qu’ils méritent de régner parce qu’ils sont mieux qualifiés, ou plus riches, ou plus rationnels, ou plus durs à la tâche. La culture contemporaine du blâme moral perpétuel correspond parfaitement à cette manière de penser : elle ne fait que reproduire le vieux fantasme élitiste.
Si l’establishment libéral est anti-populiste, ce n’est pas seulement parce qu’il n’aime pas Trump – qui n’est lui-même en rien un populiste authentique – mais parce que ce libéralisme est presque en tout point le contraire du populisme. Son ambition politique n’est pas de rassembler les gens dans un mouvement rénovateur mais de les blâmer, de les couvrir de honte et de leur apprendre à s’en remettre à leurs supérieurs. Il ne cherche pas à punir Wall Street ou la Silicon Valley – de fait, cette même bande qui réprimande, annule et blackliste, a été incapable de trouver le moyen de punir les banquiers d’élite après la crise financière mondiale en 2009. Ce libéralisme-là désire fusionner avec ces institutions du privilège privé, enrôler leur pouvoir dans sa croisade pour son idée du « bien ». Les districts libéraux prospères de l’Amérique sont devenus des utopies du blâme car c’est par le blâme que ce type de concentration du pouvoir économique se rapporte aux citoyens ordinaires. Ce n’est pas « l’autoritarisme de la classe ouvrière », c’est l’autoritarisme de la classe de la connaissance. Les gens au sommet, nous dit ce type de libéralisme, ils ont plus que vous parce qu’ils méritent d’avoir plus que vous : ces belles personnes vous dominent parce qu’elles sont meilleures que vous.
La différence la plus constante entre le populisme et son contraire est peut-être une différence d’humeur. Le populisme était et demeure incurablement optimiste – sur les gens, sur les possibilités politiques, sur la vie et sur l’Amérique en général.
L’anti-populisme ne parle que de désespoir. Il porte un regard plein d’amertume sur les humains ordinaires. Son aspiration à la rédemption de l’humanité est nulle. Sa vision du bien commun est sombre. Son humeur sinistre nous donne des livres qui portent des titres comme Défense de l’élitisme ou Contre la démocratie.
Le comble du sinistre est atteint quand l’anti-populisme envisage le changement climatique. Je pense à un texte largement commenté, paru dans le New York Times en décembre 2018, quelque deux ans après que l’élection de Donald Trump eut mis en lambeaux la vision du monde bien ordonnée de la classe de la connaissance. Cet article ne constitue pas en lui-même une déclaration politique mais le professeur de philosophie qui l’a écrit, Todd May, est un militant anti-Trump bien connu dans l’université où il enseigne. Cette publication à la page des tribunes du New York Times, la vitrine ultime de l’opinion libérale, m’est apparue comme un acte politique : le verdict définitif de l’élite démoralisée sur une population entêtée qui refuse de tenir compte de ses avertissements, se repaît de mensonges et s’obstine à préférer des démagogues ridicules à des experts responsables.
Le sujet de May est l’extinction de l’humanité : doit-elle arriver ou pas ? Le professeur formule son acte d’accusation du genre humain avec une certaine délicatesse, mais il est impossible de ne pas voir où il veut en venir. Nous sommes une espèce dangereuse, attaque-t-il, « causant une souffrance inimaginable à un grand nombre des animaux qui habitent » la Terre. Il cite le changement climatique et l’élevage industriel comme les pires de nos offenses et déclare que, « si l’histoire s’arrêtait là, ce ne serait pas une tragédie. L’élimination de l’espèce humaine serait une bonne chose, point ».
Mais il y a d’autres considérations à prendre en compte, admet le professeur. Les gens font parfois des choses louables. Par ailleurs, il serait cruel « d’exiger des êtres humains qu’ils mettent fin à leurs jours ». Pour finir, la solution de May est de ne pas choisir : « Il est fort possible que l’extinction de l’humanité soit une bonne chose pour le monde, et néanmoins, une tragédie. »
Ce type de pessimisme cérébral, cette aspiration à peine voilée à la mort de l’espèce, est une attitude qu’on rencontre partout ces temps-ci dans les cercles libéraux éclairés – voir toute la littérature sur l’« anthropocène ». C’est l’envers inévitable de la politique moralisatrice que j’ai décrite dans ce chapitre : le salaire de nos péchés, la récompense de notre incorrigible stupidité.
Chaque fois que j’ai affaire à des sentiments de ce genre dans cet abattoir de l’idéalisme qu’est Washington, mon esprit me ramène à ma bonne vieille ville de Chicago, un lieu bruyant, rouillé et âpre dont personne n’est jamais nostalgique mais où j’aime me rappeler comment les Américains ordinaires vivaient leur vie, la tête au travail, au jeu, et à la réussite, peut-être, un jour.
Je pense à Carl Sandburg, le « poète du peuple » du XXème siècle, un homme qui ne voyait pas de contradiction entre vie humaine et péché humain. Et je pense à son « Chicago », le plus grand de tous les poèmes populistes, qui reconnaît la vulgarité de la ville, tous ses péchés sordides : « On me dit que tu es méchante » ; « On me dit que tu es véreuse » ; « On me dit que tu es brutale » – toutes choses aussi vraies aujourd’hui qu’en 1914.
Mais « Chicago » n’est pas un hymne qui blâme. C’est une répudiation du blâme. C’est un chant sur l’amour de la vie malgré tout, l’amour de la vie des gens, même au milieu de toute cette horreur industrialisée éreintante :
Sous la fumée, de la poussière plein la bouche, riant de ses dents blanches,
Sous le poids terrible du destin riant comme rit le jeune homme,
Riant même comme rit le boxeur ignorant qui n’a jamais perdu un combat,
Crânant et riant d’avoir sous son poignet le pouls, et sous ses côtes le cœur du peuple,
Riant !
[1] Mickey Kaus, The End of Equality, Basic Books/A New Republic Book, New York, 1992, p. 173.
[2] Robert D. Atkinson, « Who Will Lead in the New Economy ? », Blueprint, 2 juin 2000.
[3] William A. Galston et Elaine C. Kamarck, « Five Realities That Will Shape 21st Century Politics », Blueprint, automne 1998.
[4] Al From, « Building a New Progressive Majority », Blueprint, 24 janvier 2001.
[5] Le festival « SXSL » a eu lieu le 3 octobre 2016 et on trouve une description du processus de sélection du public ainsi que la formule « commandant-en-cool » in Erin Coulehan, « Commander in Cool », Salon, 26 septembre 2016.
[6] Sur l’opposition des journalistes à Trump, lire Jim Rutenberg, « Trump Is Testing the Norms of Objectivity in Journalism », New York Times, 7 août 2016 ; David Mindich, « For Journalists Covering Trump, a Murrow Moment », Columbia Journalism Review, 15 juillet 2016. Sur leur financement de la campagne de Clinton : Dave Levinthal et Michael Beckel, « Journalists Shower Hillary Clinton with Campaign Cash », Columbia Journalism Review, 17 octobre 2016. Sur la campagne de Clinton dans les États républicains, Matt Flegenheimer et Jonathan Martin, « Showing Confidence, Hillary Clinton Pushes into Republican Strongholds », New York Times, 17 octobre 2016. Lire également Nate Silver, « There Really Was a Liberal Media Bubble », FiveThirtYeight.com, 10 mars 2017.
[7] Lire Lawrence Goodwyn, « Organizing Democracy : The Limits of Theory and Practice », Democracy, 1981, vol. 1, no 1, p. 51 – souligné par Goodwyn.
[8] Ibid., p. 59.
[9] Wesley Hogan, Many Minds…, op. cit.
[10] Lawrence Goodwyn, resp. The Populist Moment… (op. cit., p. 292) et « Organizing Democracy » (art. cité).
[11] Lire David Adler, « Centrists Are the Most Hostile to Democracy, Not Extremists », New York Times, 23 mai 2018.
[12] William Galston, Anti-Pluralism…, op. cit., p. 22 – Galston ne souscrit expressément à aucune de ces « alternatives viables ».