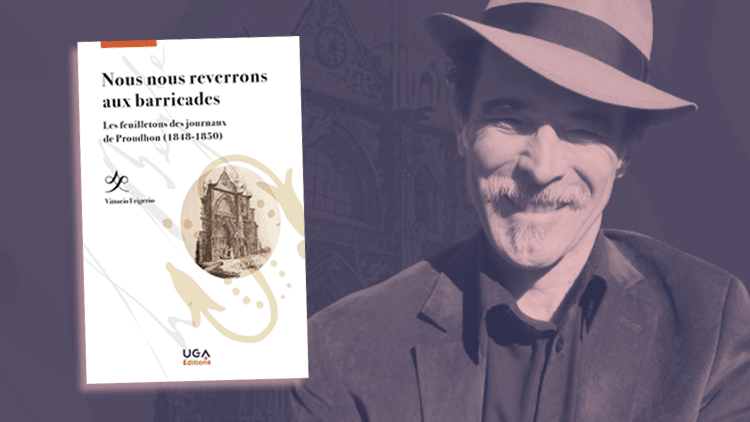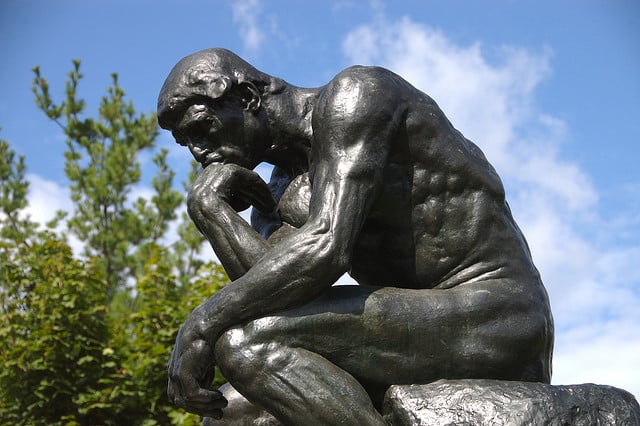Si l’imaginaire révolutionnaire doit beaucoup à la littérature, celle-ci, on l’oublie souvent, n’a pas toujours eu bonne presse parmi les pionniers du mouvement socialiste. Vittorio Frigerio, professeur émérite de littérature française à l’Université Dalhousie (Halifax, Canada), consacre un essai (Nous nous reverrons aux barricades, Éditions UGA, 2021) aux rapports qu’entretenait la presse proudhonienne avec le roman. C’est l’occasion de revenir avec lui sur les relations entre socialisme et création littéraire, mais aussi sur l’appel à Proudhon qu’on voit resurgir chez plusieurs intellectuels contemporains.
LVSL – Vous vous êtes intéressé aux roman-feuilletons publiés dans les journaux proudhoniens, pourquoi ? Ce genre d’écrits, précurseur de nos séries actuelles et plutôt délégitimé pour le caractère industriel de sa production, détonne un peu dans la presse socialiste…
Vittorio Frigerio – Le milieu du dix-neuvième siècle est l’âge d’or du développement du roman, tel qu’on le comprend encore de nos jours. Mais c’est également le moment où ce genre qui est en passe de devenir dominant dans le panorama culturel commence à se scinder. Ainsi, l’opposition entre littérature haut de gamme et littérature populaire apparaît et se théorise de plus en plus systématiquement . Cette scission, qui verra au bout du compte la construction d’un canon relativement réduit de grands écrivains, opposé à une masse d’écrivaillons estimés de seconde zone, ne s’est toutefois pas opérée rapidement, ni sans hésitations et retours en arrière. Le coup d’envoi de ce processus de sacralisation et de démonisation conjointes s’identifie généralement avec la publication de l’article de Sainte-Beuve « De la littérature industrielle » dans La Revue des deux mondes en 1839. Mais la fatwa du critique, si vous me passez l’anachronisme, qu’on considère souvent comme une condamnation de la littérature commerciale, abrutissante, destinée à la grande masse, est en fait une excommunication en bonne et due forme du romantisme en général.
Sainte-Beuve, à l’instar d’autres critiques plus ou moins conservateurs de l’époque comme Alfred Nettement, mettait joyeusement dans le même sac Dumas, Hugo, Balzac, Sue et Sand, tous uniformément jugés coupables de mauvais goût et de prostituer leur talent à la masse ignorante. Or, le feuilleton, qu’on associe maintenant exclusivement avec la soi-disant paralittérature, était justement à ses débuts la forme privilégiée de prépublication pour tous les auteurs, indépendamment de leur statut. La grande presse, dont le règne commence à cette époque, s’arrache les auteurs les plus suivis. Les journaux s’achètent tout autant, si ce n’est plus, pour le roman-feuilleton que pour la politique. Certains romanciers finiront par acquérir une présence massive et en détrôneront d’autres. L’anecdote qui narre la fureur de Balzac est à cet égard symptomatique. Elle prend forme lorsque la publication de son roman Les paysans dans le journal La Presse est interrompue pour faire de la place à La Reine Margot de Dumas, davantage prisé des lecteurs. Le lecteur est roi et on ne peut pas vouloir se lancer dans le monde de la presse à ce moment sans tenir compte du formidable attrait du feuilleton pour le public. Proudhon avait beau être idéalement sur la même longueur d’onde que Sainte-Beuve, il comprenait tout à fait l’importance de la présence du feuilleton sur les pages de son journal, ne serait-ce que pour des raisons commerciales. Il lui fallut donc trouver des auteurs aussi compétitifs que possible. Proudhon, malgré le peu d’intérêt qu’il portait personnellement à tout ce qui n’était pas économie ou politique, était conscient de la nécessité pour son mouvement (souvent accusé de philistinisme) d’élaborer également une position culturelle.
LVSL – Comment ces romans produits par ou pour la presse socialiste se configurent-ils ? Sont-ils ouvertement ou indirectement militants ? En quoi se singularisent-ils par rapport à la production courante de feuilletons historiques dans la presse du milieu du XIXe siècle ?
V. F. – Le choix des feuilletons du Peuple dépend sans doute bien davantage de l’offre et de la disponibilité des auteurs que d’une stratégie délibérée très clairement définie. Le journal annonce à plusieurs reprises de futurs feuilletons qui ne paraîtront pas – y compris notamment, chose intéressante, des traductions de Dickens. Il fait également miroiter à ses lecteurs un feuilleton d’Eugène Sue qui ne se matérialisera pas non plus, le romancier ayant certainement déjà suffisamment de pain sur la planche avec ses nombreux autres contrats, sans parler de ses ambitions électorales. Le Peuple finira ainsi par publier un certain nombre d’auteurs pour la plupart débutants, d’origine provinciale, ainsi qu’on peut le voir par les thèmes de certains de ces textes. Leur militantisme n’est pas toujours immédiatement évident et dans bien des cas les feuilletons ne se distinguent pas si nettement que ça de la production moyenne du temps. Il y a une exception notable, toutefois : le roman Le Mont Saint-Michel, texte signé A.-C. Blouet, qui traite de l’insurrection républicaine de 1832. J’y consacre une analyse détaillée dans mon livre en raison à la fois de sa nature de roman « historique » (narrant une histoire vieille de vingt ans, effacée de la mémoire historique officielle) et de sa fonction d’anticipation et d’encouragement des révolutions encore à venir.
LVSL – En quoi ce roman se distingue-t-il ? Qu’annonce-t-il de la manière dont s’élabore l’imaginaire des barricades en cette première moitié du XIXe siècle ?
V. F. – Ce roman se distingue surtout et principalement par son sujet. Narrer l’histoire de la barricade Saint-Merry en 1848 n’allait pas encore nécessairement de soi. Il y a des souvenirs qui ne s’évoquent pas impunément. Il faut se rappeler que le premier roman consacré à cet épisode, Le Cloître Saint-Méry, de Marius Rey-Dussueil, paru quelques mois à peine après les événements. Il servit de base à Victor Hugo pour la scène de la barricade dans Les Misérables et fut immédiatement saisi et condamné à la lacération. L’insurrection fait très vite l’objet d’une damnatio memoriae. Blouet profite de l’assouplissement relatif des contrôles et de la censure pour exhumer son souvenir et tenter de lui redonner une place centrale dans la généalogie révolutionnaire française, mais aussi et surtout pour en faire un exemplum. Ses personnages traversent toutes les révolutions : 1830, 1832, 1848, et se tiennent prêts pour celle qu’ils estiment devoir suivre incessamment. En même temps, écrivant son roman au jour le jour, au fur et à mesure de sa publication, Blouet a – on voudrait dire instinctivement – recours à des schémas typiques du roman populaire de l’époque qui lui permettent de mettre en scène le social en l’ancrant dans une intrigue privée. C’est dans l’analyse de la rencontre, toujours problématique, de ces deux niveaux de la narration qu’on peut essayer de formuler quelques remarques intéressantes sur les rapports entre littérature et politique, potentiellement pertinentes au-delà de ce moment historique particulier.
LVSL – Plus largement, c’est toute la littérature et la plupart des écrivains qui semblent faire les frais de la méfiance de Proudhon et des proudhoniens. Comment l’expliquer ? Anti-intellectualisme ? Méfiance platonicienne à l’égard de la fable ? Mépris du métier d’écrivain ?
V. F. – Proudhon, littérairement parlant, est conservateur dans l’âme. Son idéal esthétique – le théâtre de l’époque classique – n’est tel que parce qu’il correspond au rôle qu’il aimerait voir jouer à la culture dans la société : un rôle d’appui à l’idéologie, pédagogique, secondaire dans tous les sens du terme. Les enthousiasmes romantiques – qu’il juge excessifs, déplacés, inauthentiques et moralement discutables – le répugnent profondément. D’où son hostilité profonde envers Victor Hugo et Alexandre Dumas, les deux plumes les plus en vue du mouvement, qu’il ne cesse d’attaquer dans les termes les plus violents.
Pour Proudhon, le romantisme est le symptôme de la décadence profonde de la société dans laquelle il vit. Il est par conséquent une cible nécessaire, au même titre que ses adversaires politiques directs. D’ailleurs, les deux peuvent se confondre, comme lors des élections de 1848, qui voient et Hugo et Dumas en lice, les deux sur des positions modérées, prônant un « républicanisme social » très critique envers le « républicanisme révolutionnaire » de Proudhon et des siens. On peut en effet deviner chez lui une forme de méfiance profonde et instinctive envers les écrivains en général, quelle que soit leur orientation, considérés comme des exhibitionnistes, ne cherchant que la réclame, exclusivement soucieux de leurs profits. L’écrivain qui bâcle son travail et exige des rétributions énormes serait alors l’opposé de l’ouvrier vertueux, qui travaille selon conscience et qui est exploité par son patron. De fait, Proudhon ne semble pas capable de distinguer la profession d’écrivain du système de la presse et de l’édition au mécanisme commercial. Ou du moins, il les considère indissociables et également dignes de dédain.
LVSL – De rares écrivains trouvent pourtant grâce aux yeux de Proudhon, notamment Eugène Sue, initiateur du roman sociale (Le Juif errant, 1844-45) qui représente une sorte d’exception. On est en revanche frappé par la vive animosité qu’il nourrit envers Victor Hugo, lequel fut effectivement proche de tous les pouvoirs jusqu’à 1848. Mais ce dernier, à l’époque, n’avait pas encore publié Les Misérables… Sait-on si Proudhon avait lu cette fresque de 1862, parue trois ans avant sa mort et s’il s’est ravisé à cette occasion ?
V. F. – Proudhon a une admiration certaine, mais tout de même relative, pour Sue. Après tout, Sue est un fouriériste et sa chapelle n’est donc pas la même que celle de Proudhon. Il lui reconnaît toutefois la capacité de faire passer des messages importants auprès du peuple des lecteurs, comme en particulier justement sa critique des Jésuites dans Le Juif errant.
Le fossé entre Hugo et Proudhon, en revanche, était impossible à combler. L’antipathie du philosophe pour le romancier était tellement profonde qu’il aurait fallu rien de moins qu’un retournement complet de Hugo, un mea culpa en règle et un reniement de toute son œuvre pour contenter Proudhon. La publication des Misérables, roman imprégné de ce mysticisme particulier qui caractérise l’ensemble des écrits de Hugo, ne devait par conséquent pas changer cela. En fait, le jugement de Proudhon peut paraître encore plus surprenant quand on pense aux attaques fielleuses auxquelles ce roman épique a dû faire face de la part de critiques conservateurs. Mais il montre au moins sans confusion possible son attitude invariable chaque fois qu’il est question de Hugo et de sa production, et mérite une citation complète. Dans une lettre de 1861, il affirme en effet : « J’ai lu cela. C’est d’un bout à l’autre faux, outré, illogique, dénué de vraisemblance, dépourvu de sensibilité et de vrai sens moral ; des vulgarités, des turpitudes, des balourdises sur lesquelles l’auteur a étendu un style pourpre ; au total, un empoisonnement pour le public. Ces réclames monstres me donnent de la colère, et j’ai presque envie de me faire critique ». Il l’a fait, d’ailleurs, dans ses journaux notamment, mais toujours en marge d’autres activités jugées plus importantes.
LVSL – Les décennies passant, le mouvement anarchiste – qui reconnaît en Proudhon l’un de ses précurseurs – verra-t-il évoluer sa position à l’égard de la littérature ? Quels auteurs ou quels groupes portent l’anarchisme littéraire ou romanesque au tournant du XXe siècle ?
V. F. – Le rapport entre le mouvement anarchiste et le monde littéraire demeurera compliqué, mais aussi extrêmement fructueux et cela de manières parfois surprenantes. On a pris l’habitude d’associer assez étroitement anarchisme et symbolisme en raison de nombreux croisements entre les deux mouvements dans la dernière décennie du dix-neuvième siècle et cela n’est pas entièrement faux. Il y a eu en effet une forte présence de sympathisants libertaires parmi les écrivains qui ont publié dans les innombrables petites revues à tendance symboliste qui ont marqué par leur vivacité le panorama culturel de cette décennie très agitée, qui est aussi celle de la « période des attentats » qui a fini par faire s’identifier, dans l’esprit de l’opinion publique, anarchisme et terrorisme. Mais ce n’est pas un voisinage à surévaluer.
La littérature des anarchistes va bien au-delà de la simple expérience symboliste, limitée dans le temps et portée par de jeunes écrivains qui ont pour la plupart déserté le mouvement lorsque la répression de l’état s’est abattue sur les militants. Les Temps Nouveaux, le journal de Jean Grave, publiait un important « Supplément littéraire ». Le Père Peinard d’Émile Pouget offrait à ses lecteurs des feuilletons dans un argot désopilant. Pratiquement tous les journaux anarchistes faisaient, peu ou prou, une place à la création littéraire. La mouvance individualiste et pacifiste se montrait plus accueillante pour les écrivains, dont plusieurs, tels Han Ryner, Manuel Devaldès, ou encore Gérard de Lacaze-Duthiers, étaient des habitués de journaux comme L’Insurgé, La Patrie humaine ou L’Unique.
Mais il ne faut pas oublier d’autres romanciers plus ou moins en vue qui ont aussi porté haut leur identité anarchiste tout en restant plus intégrés dans le milieu littéraire que ceux qui publiaient principalement dans la presse. Pensons notamment à Louise Michel, très prolifique, à Georges Darien, ou encore à Octave Mirbeau. Mais il y en a tant d’autres encore, dont beaucoup qui mériteraient d’être redécouverts…
LVSL – Malgré cet assouplissement, cet affect anti-romanesque ou antilittéraire ne resurgit-il pas encore au XXe siècle ? Je pense au PCF des années 1930 (celui des cellules d’entreprise, des cadres exclusivement ouvriers et du « réalisme socialiste »), qui tiendra Aragon éloigné de son comité central jusqu’à l’après-guerre en dépit des efforts de l’écrivain ?
V. F. – La question de l’utilité de la littérature, de son rôle dans le mouvement d’émancipation du peuple, ne cesse en effet d’être débattue :
Au sein du mouvement anarchiste, les plus obstinément négatifs sont souvent les scientistes, qui jugent que les poursuites littéraires ne sont au fond qu’un petit jeu inutile et souvent irrationnel, une perte de temps qui empêche les gens de se concentrer sur l’action révolutionnaire.
L’anti-intellectualisme, parfois sous-entendu, parfois flagrant, demeure une constante dans bien des milieux de la gauche révolutionnaire et ce ne seront pas, malgré toute la bonne volonté des gens qui y ont adhéré, des mouvements comme celui de la « littérature populiste » ou de la « littérature prolétarienne » qui changeront quoi que ce soit fondamentalement à la chose.
Les surréalistes, tiraillés entre leurs pulsions libertaires originelles et la volonté de s’intégrer à un grand mouvement révolutionnaire en courtisant le PCF, offrent clairement un exemple typique des dangers qu’il peut y avoir pour des écrivains à vouloir s’identifier trop étroitement avec un parti.
Mais il ne s’agit pas là d’un problème uniquement limité aux confins de l’hexagone. Pour ne faire qu’un exemple, l’expérience des Futuristes en Russie et en Italie, au service de régimes guère identiques, si ce n’est pour leur vitalisme révolutionnaire initial, recèle d’autres leçons du même ordre.
LVSL – Ce qui se joue dans ce durable malentendu, n’est-ce pas une harmonisation impossible entre la dynamique de tout programme militant et celle de l’œuvre littéraire elle-même face à une finalité espérée – quelle qu’elle soit ? Au fond, la littérature finit toujours par s’autoriser à insulter l’avenir (ou tous les avenirs possibles), tandis qu’il est capital pour le récit militant d’interpeller l’avenir dans un certain sens.
V. F. – Il est sans doute tentant de conclure que politique et littérature, en dépit de leurs nombreux croisements, parlent deux langages au fond très différents, qui ne sont pas simplement superposables. Chacun des deux domaines recherche une primauté qui se veut exclusive. Dans la pratique, toute tentative de les faire convivre se révèle problématique et farcie de contradictions. Les critiques portées contre les romans « engagés » dès les premières dérives sociales du romantisme – donc notamment avec les romans-feuilletons d’Eugène Sue et consorts – ont toujours souligné le côté artificiel de créations qui veulent atteindre en même temps deux buts : valeur littéraire objective et critique sociale constructive.
En ce qui concerne Proudhon, pour revenir à lui, ce qui devait primer était le sujet, la forme ne l’intéressait pas outre mesure. La littérature devait avoir une valeur de projet ou de dénonciation et tant que ce rôle était rempli, c’était l’essentiel. Mais encore fallait-il que le sujet fût exprimé de manière univoque, claire, pour qu’il soit impossible au lecteur de se méprendre sur le fond du message. C’est sans doute à ce niveau-là que se situe la contradiction de base entre politique et littérature, que nul n’est parvenu encore à résoudre : le conflit entre l’univocité idéologique et la multiplicité de voix que véhicule quoi qu’on veuille la littérature, parfois en dépit de tous les efforts des écrivains pour la bâillonner.
LVSL – Aujourd’hui, quelle serait l’actualité des positions proudhoniennes en matière de littérature ? Une figure de l’édition comme Michel Onfray, qui se réclame volontiers « proudhonien » ou « socialiste libertaire », a pu exprimer certaines préventions qu’on pourrait qualifier de moralisantes à l’encontre d’écrivains comme Sade ou Sartre…
V. F. – Proudhon a été plus ou moins récupéré au fil du temps par des gens aux positions finalement les plus diverses. C’était le propre de sa philosophie d’avoir un assez grand nombre de facettes pour que certains de ses aspects puissent plaire aux compagnons de route les moins probables. Il y a même eu une courte renaissance du proudhonisme sous l’égide du « Cercle Proudhon » au début des années dix, qui a essayé de tisser des liens entre syndicalistes et militants de l’Action Française, et ensuite sous le régime de Vichy, fort bien vue par les autorités. S’il faut en croire les jugements parus dans les feuilles libertaires dans l’entre-deux-siècles, les croisements idéologiques n’étaient pas faits pour effrayer les militants anarchistes. Dans Les Temps Nouveaux, Jean Grave n’hésitait pas à offrir à ses lecteurs des extraits d’ouvrages d’auteurs on ne peut plus réactionnaires, tel Édouard Drumont, tant que les cibles indiquées dans ces fragments étaient les mêmes que celles qui attiraient les foudres anarchistes. Un pamphlétaire profondément catholique et conservateur comme Léon Bloy jouissait d’une excellente réputation parmi les anarchistes, qui pouvaient aussi compter bon nombre de plumes acérées dans leurs rangs et se reconnaissaient sans doute volontiers dans le style intransigeant de cet auteur, si ce n’est dans ses envolées mystiques.
Le désir de faire la morale aux autres n’est pas l’exclusivité de l’un ou de l’autre extrême de l’éventail politique, et on peut se donner parfois des compagnons de route inhabituels. Preuve en soit justement l’admiration réciproque étalée publiquement sur les écrans entre ce proudhonien moderne que se veut Michel Onfray et Éric Zemmour, dont les prises de position ne devraient cependant pas enthousiasmer les progressistes… Mais tel est apparemment le destin des rencontres entre la littérature et la politique.