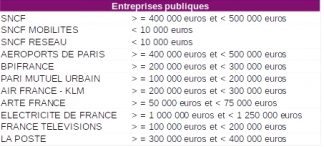La communauté humanitaire internationale s’est réunie en 2016 pour résoudre les problèmes de sous-financement qui existent depuis de nombreuses années. Plusieurs réformes structurelles du système ont été évoquées, qui ont connu des succès divers et mitigés. Une chose est cependant restée absente des débats : un examen minutieux de l’aspect non-lucratif du travail humanitaire.
Le système humanitaire international est en crise de sous-financement
Le système humanitaire d’urgence est en crise. En effet, entre 2005 et 2017, le nombre de crises nécessitant une réponse humanitaire internationale a presque doublé (de 16 à 30). La durée moyenne de chaque crise a aussi beaucoup augmenté [1]. Notamment à cause du réchauffement climatique, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. Les conflits armés se multiplient et/ou ne trouvent pas de fin. En 2020, l’ONU cherche ainsi à venir en aide à plus de 167 millions de personnes.
La conséquence de tout cela est que l’aide humanitaire coûte, chaque année, de plus en plus cher. En 2007, l’ONU estimait qu’il faudrait 5 milliards de dollars pour mettre en œuvre ses programmes humanitaires internationaux. Pour 2020, elle estimait qu’il faudrait désormais trouver 28,8 milliards[2], tandis que les plans se chiffrent déjà à plus de 30 milliards[3].
Si la tendance continue, on estime que l’appel prévisionnel de l’ONU pourrait atteindre 50 milliards pour l’année 2030[4]. De son côté, le financement humanitaire public n’a pas suffisamment augmenté : seulement 59% des besoins humanitaires ont été couverts en 2019.
Il y a donc un déficit du financement humanitaire, estimé en 2016 à environ 15 milliards de dollars. Ce déficit signifie que des millions de personnes ne peuvent pas du tout être aidées dans le cadre des besoins évalués par l’ONU. Elles ne reçoivent pas assez d’aides alimentaires, d’abris pour se protéger ou d’argent pour survivre.
Le Sommet humanitaire mondial devait résoudre ce problème
Notamment pour répondre à ce problème, l’ancien Secrétaire général des Nations unies avait convié en 2016 un Sommet humanitaire mondial à Istanbul. Pendant quelques jours, la quasi-totalité de la communauté humanitaire mondiale s’y était réunie. Les acteurs humanitaires (pays donateurs, agences des Nations unies, ONGs) se sont engagés à effectuer dix réformes structurelles du système humanitaire, devant être terminées en 2020.
Un bon exemple de ces réformes est la localisation, qui consiste à augmenter le rôle joué par les acteurs locaux dans la réponse humanitaire, pour entraîner des économies d’échelle (les acteurs locaux étant moins coûteux); ou encore l’augmentation de programmes basés sur des transferts monétaires, qui pourrait amener à la réduction du nombre de personnels humanitaires nécessaires sur chaque crise en réduisant le nombre de projets nécessaires.
Ces réformes ont pour le moment eu des succès très mitigés et hétéroclites. Il faudrait donc appeler à renouveler leur calendrier jusqu’en 2030, mais ce n’est pas le sujet de l’article.
Le principe de non-lucrativité n’a pas été abordé
Un élément essentiel n’a pas été abordé pendant le Sommet humanitaire mondial, et est absent de toutes les discussions.
Si le système humanitaire est censé être caractérisé notamment par son aspect non-lucratif, ce principe n’a jamais eu de standards internationaux. Les différents acteurs humanitaires ont donc des pratiques très différentes en la matière.
Formaliser le principe de non-lucrativité au niveau international pourrait-il résorber la crise de sous-financement ?
Il n’est pas question que ce principe affirme que les personnes travaillant dans l’humanitaire devraient être pauvres. Tout le monde a le droit de pouvoir épargner ou de subvenir aux besoins de sa famille. Dans des sociétés capitalistes, il serait trop facile d’avoir des exigences démesurées vis-à-vis des personnes qui décident de s’engager.
Ce secteur est déjà suffisamment difficile et dangereux[5] pour ne pas lui faire porter toute la responsabilité de l’avarice des pays développés. En effet, les 15 milliards manquants ne constituent même pas 0,01% du PIB mondial.
Cependant, le principe de non-lucrativité devrait permettre de pouvoir combattre les excès. Y a-t-il des excès dans les agences humanitaires des Nations unies ?
Présentation du système des Nations unies
9 agences de l’ONU* [voir fin de l’article pour la liste complète] jouent un rôle prépondérant dans le système humanitaire. Elles sont à ce titre membres du Comité permanent interorganisation (institution coordonnant les plus grandes agences de l’aide humanitaire internationale).
Prises ensemble, elles emploient plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde. Ces personnels ne sont pas tous logés à la même enseigne, et sont divisés en deux grands types : professionnels et généraux.
Les fonctionnaires généraux s’occupent des tâches administratives. Ils ont des contrats basés sur le principe de flemming : leurs conditions d’emploi sont les meilleures que l’on puisse trouver dans leur localité.
Les salaires des professionnels n’obéissent pas du tout aux même règles. Le principe du noblemaire postule que le fonctionnariat international doit être capable de recruter notamment les fonctionnaires les mieux payés au monde[6].
Les professionnels jouissent donc de salaires fixés en référence à ceux des fonctionnaires fédéraux des États-Unis. Et ce, quelle que soit leur nationalité, ou les coûts réels auxquels ils font face dans leur vie. Ils sont même plus élevés, puisque la tradition veut que les fonctionnaires internationaux soient mieux payés que les fonctionnaires nationaux (pour la raison qu’ils ne travaillent pas dans leur propre pays)[7].
Ainsi, les fonctionnaires professionnels internationaux disposent tous d’un salaire de base équivalent (equal work, equal pay). Cependant, ce principe d’égalité est problématique dans un monde d’inégalités économiques, où certains pays ont un coût de la vie bien plus élevé que d’autres.
Y compris lorsqu’ils vivent dans des pays à revenus intermédiaires ou faibles, plus de la moitié des professionnels gagnent près de 10 000 dollars par mois.
En plus de leur salaire de base, les fonctionnaires professionnels touchent une somme supplémentaire dite d’ajustement de poste. C’est une somme additionnelle, pouvant constituer de 11% à 106% du salaire de base, indexée sur le coût de la vie de leur zone d’affectation[8]. Cet ajustement de poste est tout de même de l’ordre de 35% du salaire de base au Bangladesh, et 45% en Afghanistan.
Y compris lorsqu’ils sont déployés dans des pays à revenus faibles ou moyens, et qu’ils ne payent pas de loyers, les professionnels gagnent donc presque tous au minimum 5 000 dollars net par mois. Plus de la moitié gagne près de 10 000 dollars net par mois, ou plus (jusque 14 364 dollars net mensuels au Niger, par exemple).
Les principes éthiques des Nations unies sont peu éthiques
Depuis le jugement de 1987 de l’Organisation internationale du travail, le principe de noblemaire a fait jurisprudence pour devenir un principe coutumier de droit international. Il est donc obligatoire pour toutes les organisations appartenant au système des Nations unies[9]. Selon le jugement, il ne serait pas une façon de privilégier le fonctionnariat international, mais une manière d’y attirer les plus qualifiés.
Ce principe peut paraître légitime à certains. De toute évidence, il repose sur une logique incitative purement économique: celle de l’homo economicus. Comme tous les principes ayant trait à des questions de justice sociale, il peut aussi ne pas être compris. Par exemple, cela présupposerait-il que les personnes travaillant pour des ONGs (généralement moins bien payées) seraient moins compétentes que les personnels des Nations unies ?
De plus, la logique purement économique du principe de noblemaire peut rebuter les personnes attirées par l’altruisme humanitaire. Ayant effectué un stage dans une agence humanitaire de l’ONU, c’est ce qui m’est arrivé. Je n’étais pas le seul stagiaire à subir cette désillusion.
On voit bien ici les limites d’un raisonnement purement économique – ou économiciste – lorsqu’il est appliqué au domaine humanitaire. L’homo humanitarus n’est pas seulement un homo economicus. Comme dans certaines autres professions, il se doit d’attacher plus d’importance aux gratifications morales, symboliques et sociales.
Les citoyens ne sont pas toujours au courant de cet état de fait, notamment lorsqu’ils font des dons au PAM ou à l’UNICEF. Romuald Sciorra, spécialiste de l’ONU, admet dans son dernier livre qu’il est regrettable que certains personnels onusiens aient une mentalité assez éloignée des préoccupations humanitaires. Il relève aussi que leur travail est probablement loin d’être toujours absolument indispensable[10].
Dans un contexte humanitaire, le principe de non-lucrativité équitable devrait remplacer ou guider le principe de noblemaire. Ce dernier entre en contradiction directe avec le principe éthique de non-lucrativité, souvent associé au domaine humanitaire.
Discuter d’un tel changement de principe serait un grand défi pour les Nations unies, et pourrait permettre d’économiser au moins 650 millions de dollars par an (comme nous le verrons plus loin).
Formaliser le principe de non-lucrativité pour combattre les excès
Dans la situation actuelle de pénurie générale, il semble qu’il est temps de changer de principe.
Prises ensemble, les agences humanitaires de l’ONU membres du Comité Permanent Inter-Organisations emploient près de 18 000 professionnels (en prenant en compte les 820 professionnels d’OCHA, et ceux d’UNOPS). Parmi ceux-ci, plus de 10 000 sont au moins au niveau P-4, jouissant ainsi des plus hauts salaires de l’ONU (à près de 10 000 dollars nets par mois, ou plus) [11]. Une baisse mesurée des salaires des professionnels permettrait donc de faire des économies d’échelle importantes.
Dans toutes ces agences, environ 4 600 employés proviennent des Etats-Unis, d’Europe du Nord, ou d’autres pays où le coût de la vie est notoirement élevé (Suisse, Luxembourg, Corée, Japon, Israël…)[12]. Cela ne fait pas de distinction entre les différentes catégories de personnel, et comprend donc une partie importante d’employés généraux. Notamment puisque les sièges des organisations sont à Genève et New York.
Le reste des professionnels n’a aucune raison de toucher des salaires basés sur la norme américaine. De plus, si les personnels de l’ONU basés à New York ou à Genève acceptaient d’avoir des salaires moins élevés que ceux des cadres supérieurs du public, au nom de principes humanitaires, des économies substantielles pourraient être réalisées.
Des mathématiques de base montrent qu’une baisse moyenne de 3 000 dollars par mois sur les salaires de 18 000 professionnels engendrerait des économies de 650 millions de dollars par an. Cette somme correspond à quasiment une année entière d’aide humanitaire au Tchad, pays en crise profonde (l’appel de l’ONU pour 2020 y demande 672 millions de dollars)[13]. Un effort plus important que 3 000 dollars par mois, qui reste a priori possible, pourrait avoir plus d’impact.
Discuter et organiser un changement de principe
Le principe de non-lucrativité équitable ne plaide pas pour la pauvreté des travailleurs humanitaires. D’ailleurs, certaines caractéristiques propres au métier humanitaire peuvent y expliquer des salaires plus élevés que la moyenne, comme par exemple la dangerosité. Simplement, ce principe doit permettre de combattre les excès de rémunération.
Discuter de la possibilité d’un tel changement de principe et en identifier les modalités pratiques d’application serait un grand défi pour l’Organisation des Nations unies. Cela pourrait également montrer la voie à d’autres organismes non-lucratifs (par exemple certaines ONGs américaines) qui peuvent aussi parfois pratiquer des salaires très élevés.
Un Sommet organisé par le Secrétaire Général ou Sous-secrétaire Général de l’ONU aux affaires humanitaires pourrait, par exemple, permettre de discuter de ce changement. Les économies d’au moins 650 millions de dollars pourraient par exemple être allouées aux différents fonds humanitaires communs gérés par OCHA au niveau de chaque pays.
Le principe de non-lucrativité équitable ne suffirait pas à lui seul à anéantir le sous-financement de l’aide humanitaire, loin de là. Au même titre que les autres réformes identifiées lors du Sommet humanitaire mondial de 2016, il peut le réduire.
On voit tout de même son importance lorsque certains acteurs, probablement peu optimistes, pensent que tous les engagements issus de la Grande Négociation n’aboutiraient qu’à 1 milliard d’économies par an[14].
Ce type de changement pourrait entraîner un effet de levier, favorisant l’augmentation nécessaire des financements humanitaires internationaux.
Pour une renaissance de l’idéologie humanitaire
Le grand public apparaît souvent méfiant vis-à-vis des organismes humanitaires, émettant des doutes quant à la destination réelle des dons qu’il pourrait consentir. De plus, la majorité des citoyens ne connaissent pas l’ONU et ses objectifs. Combien ignorent le nom du Secrétaire Général, ou ce que sont les Objectifs de Développement Durable ?
Formaliser le principe de non-lucrativité pourrait renouveler la légitimité du secteur. Cela pourrait aussi dans le même temps motiver le public à consentir plus d’efforts pour aider les plus pauvres à travers les organismes internationaux ou non-gouvernementaux. Cet effet levier, qu’il est impossible de mesurer précisément, ne devrait pas être sous-estimé.
L’ONU apparaît aujourd’hui affaiblie, minée par les nationalistes. Souvent mal perçue pour son caractère inaccessible et son inefficacité à résoudre les conflits. Divers scandales ne font qu’aggraver cela: non-rémunération des stagiaires, crimes de casques bleus… A sa création, elle représentait pourtant l’idéal de coopération universelle et d’abolition de la misère.
Faire renaître cette flamme pourrait encourager plus d’efforts et d’engagements pour réduire les souffrances humaines. D’autres voies identifiées par Romuald Sciorra dans son dernier livre (référence en fin d’article) sont encore plus importantes. Par exemple, l’idée de mettre les institutions financières internationales sous le contrôle du Conseil Economique et Social de l’ONU.
Dans un monde marqué par les futurs risques climatiques, les défis se multiplieront et le monde humanitaire pourrait les relever notamment en recréant un lien de confiance avec les citoyens.
* Programme alimentaire mondial (PAM, ou WFP)
Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)
Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO)
Organisation internationale des migrations (OIM)
Haut commissariat aux réfugiés (HCR)
Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP)
Fondation des Nations unies pour l’habitat (UN Habitat)
Le PAM, le HCR et l’UNICEF sont de loin les plus grandes.
[1] Global Humanitarian Overview 2019, OCHA
[2] Global Humanitarian Overview 2020, OCHA
[3] https://fts.unocha.org/appeals/overview/2020/plans
[4] Too important to fail – addressing the humanitarian financing gap, High-Level Panel on Humanitarian Financing Report to the Secretary General, January 2016
[5] Professional Humanitarianism and Violence against Aid Workers, Abby Stoddard, 3 janvier 2020
[6] United Nations website : Compensation and Classification Section, UN salaries
[7] Judgment No. 825, International Labour Organization (ILO), 5 juin 1987
[8] Consolidated Post Adjustment Circular, ICSC/CIRC/PAC/541, 15 janvier 2020
[9] Judgment No. 986, International Labour Organization (ILO), 1989
[10] Qui veut la mort de l’ONU ? Romuald Sciorra, novembre 2018
[11] https://www.unsystem.org/content/hr-category
[12] https://www.unsystem.org/content/hr-nationality
[13] Plan de Réponse Humanitaire pour la République Centrafricaine, OCHA, décembre 2019
[14] http://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2016/05/24/grand-bargain-big-deal