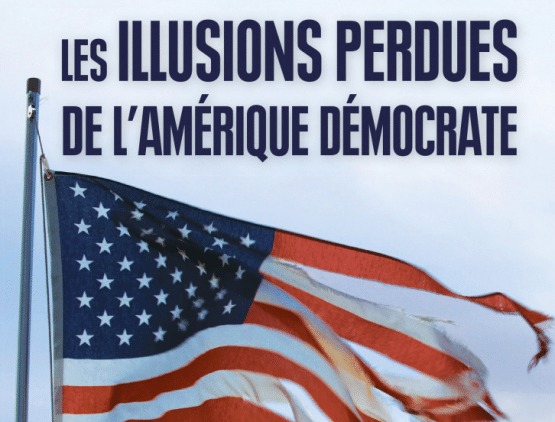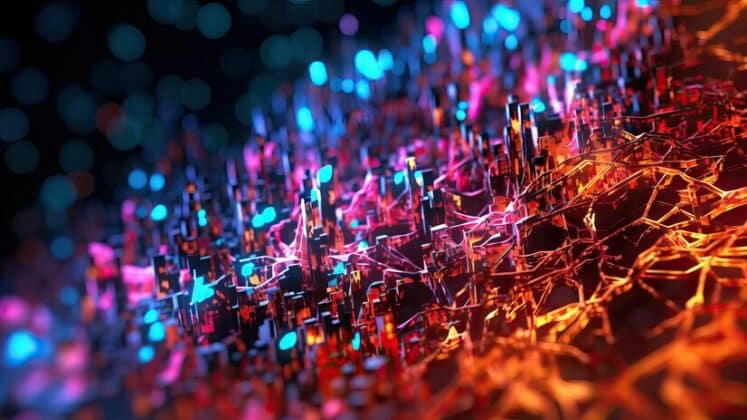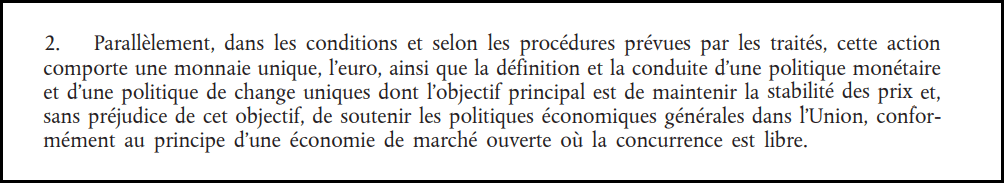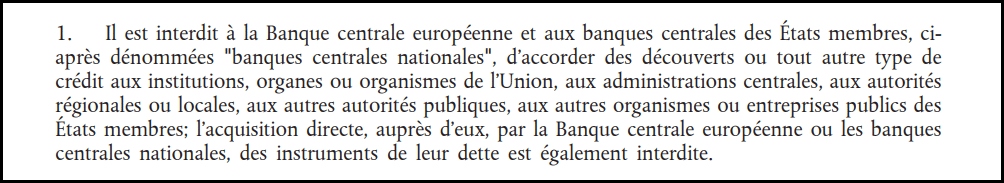Les Frères d’Italie, parti d’extrême-droite dirigé par Giorgia Meloni, sont en bonne voie pour remporter les élections italiennes ce dimanche. Il bénéficie de la complaisance des médias et de l’échec du centre-gauche à proposer une solution permettant au pays d’échapper à la stagnation. Article de David Broder, publié par Jacobin, traduit par Jean-Yves Cotté et édité par William Bouchardon.
Selon les sondages, la coalition dite de « centre droit », du moins d’après les médias italiens, frôle les 50% d’intentions de vote pour le scrutin de ce dimanche. Dès lors, elle est quasiment assurée d’obtenir une large majorité au Parlement. Toutefois, force est de constater que parler de « centre droit » est un doux euphémisme. Tant Fratelli d’Italia (Frères d’Italie), le parti postfasciste de Giorgia Meloni qui est la force principale de cette alliance (crédité d’environ 24 % dans les sondages), que la Lega (Ligue) de Matteo Salvini (créditée de 14 %) font cause commune en promettant d’énormes réductions d’impôts tout en déversant une propagande haineuse visant, entre autres, les immigrants, les « lobbies » LGBTQ et « le remplacement ethnique en cours ».
Fratelli d‘Italia n’est pas assuré d’arriver en tête. Dans les sondages, il est au coude-à-coude avec le Parti démocrate (centre-gauche). Toutefois, les projections en sièges de ce dernier sont bien moins fiables faute d’alliés de poids. Le Parti démocrate affirme qu’il poursuivra la politique menée par le gouvernement technocratique transpartisan de Mario Draghi, constitué en février dernier pour mettre en œuvre le plan de relance européen et dissout suite à la démission de ce dernier durant l’été. La majorité de Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, s’appuyait également sur Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Lega, et l’éclectique Mouvement cinq étoiles ; ayant perdu le soutien de ceux-ci en juillet dernier, le Parti démocrate est désormais isolé.
Sur l’histoire des gouvernements technocratiques en Italie et leur caractère antidémocratique, lire sur LVSL l’article de Paolo Gerbaudo « Italie : le gouvernement technocratique de Draghi est une insulte à la démocratie »
Cette situation est à l’origine d’une illusion d’optique typique de la vie politique italienne, où les représentants de la droite affirment combattre une gauche soi-disant hégémonique, alors même qu’il n’y a plus de gauche à proprement parler en Italie. Le gouvernement Draghi était le dernier avatar d’une longue série de grandes coalitions et de « gouvernements techniques » qui se sont succédé ces dernières décennies, soutenus notamment par le Parti démocrate, farouche garant de la stabilité institutionnelle. Mais, compte tenu du substrat intrinsèquement néolibéral et décliniste de la vie politique italienne, la campagne de 2022 se joue une fois encore entre ce centre gauche néolibéral et managérial et les partis d’extrême-droite qui affirment vouloir mettre un terme à « une décennie de gouvernements de gauche ».
Au milieu des turbulences actuelles que connaît le système des partis, le fait de ne pas appartenir au gouvernement Draghi a assurément aidé Fratelli d’Italia à ratisser à droite. Le parti n’était crédité que de 4 % en 2018, et à peu près la moitié de ceux qui lui apportent désormais leur soutien sont d’anciens électeurs de la Lega, qui a elle-même connu un essor en 2018-2019, lorsque Matteo Salvini était ministre de l’Intérieur. Cependant, le fait que la Lega ait rejoint les autres grands partis pour soutenir Draghi depuis février 2021 a permis à Meloni de se poser en seule opposante. Durant un an et demi, elle a ainsi mis l’accent sur son approche « constructive », hostile à la « gauche au pouvoir » mais pas à Draghi lui-même. Par ailleurs, Fratelli d’Italia n’a eu de cesse de souligner sa fidélité à l’Union européenne et à l’OTAN et d’appuyer les fournitures d’armes à l’Ukraine, pour témoigner de son atlantisme. Autant de moyens de rassurer l’oligarchie que ses intérêts ne seront pas menacés.
Fratelli d’Italia n’a eu de cesse de souligner sa fidélité à l’Union européenne et à l’OTAN et d’appuyer les fournitures d’armes à l’Ukraine, afin de rassurer l’oligarchie que ses intérêts ne seront pas menacés.
Quant au centre-droit, une fraction de celui-ci était mécontente à la fin du gouvernement Draghi. Au début de la campagne, le Parti démocrate a cajolé des personnalités comme Renato Brunetta, un allié de longue date de Berlusconi, qui a fini par quitter Forza Italia (parti de Berlusconi, membre de l’alliance des droites). Un peu à la façon des Démocrates américains à la recherche de Républicains « modérés », anti-Trump, certains au centre-gauche n’ont pas renoncé à l’idée de trouver des interlocuteurs à droite, quitte à se tourner vers des personnalités (notamment Berlusconi) qui, par le passé, représentaient le « mal » auquel un vote « du moindre mal » devait faire barrage. Le seul problème est qu’avec le temps, le mal ne cesse d’empirer.
Les fantômes du passé n’ont pas refait surface
Nombre de médias italiens ne font aucun effort pour « diaboliser » Meloni. « Peut-on arrêter de faire référence au passé ne serait-ce que pendant deux mois ? » a même demandé le journaliste Paolo Mieli au début de la campagne. Quoi qu’en dise Mieli, personne n’avait prétendu que Fratelli d’Italia projetait une « marche sur Rome » pour célébrer le centenaire de l’arrivée au pouvoir de Benito Mussolini en octobre 1922. En réalité, Enrico Letta lui-même, leader du Parti démocrate, entretient depuis quelques années des relations cordiales avec Meloni. Néanmoins, il y a manifestement quelque chose d’inhabituel à ce que qu’une aspirante Première ministre ait besoin d’insister sur le fait que les « nostalgiques » de son parti – un euphémisme pour désigner les dirigeants du parti qui affichent les symboles et les oriflammes de la république de Salo qui a collaboré avec les nazis – sont des « traîtres à la cause ».
Le fait que Mieli, ancien étudiant de Renzo de Felice (célèbre biographe de Mussolini) et l’auteur de nombreux livres sur l’Italie du vingtième siècle, appelle à arrêter de faire référence au passé est significatif. Sa demande a été reprise par des pans entiers des médias nationaux, qui font souvent preuve d’une étonnante amnésie, y compris sur l’histoire récente. Fratelli d’Italia, héritier du Movimento Sociale Italiano (MSI – Mouvement social italien) néofasciste créé en 1946, nie régulièrement en bloc les assertions de racisme et d’éloge du fascisme de ses dirigeants, ainsi que leurs liens avec d’autres groupes militants, arguant que tout cela n’est que « calomnies ». Ces démentis sont repris en chœur par les journalistes des quotidiens de droite qui soulignent que puisque le « fascisme n’est pas de retour » – et il ne l’est pas effectivement pas de manière littérale – la question n’a pas lieu d’être.
Des indices montrent toutefois que le passé de certains candidats revient les hanter, même si cela ne concerne pas l’aile postfasciste de la politique italienne. Raffaele La Regina, candidat du Parti démocrate dans la région méridionale de Basilicate, a dû retirer sa candidature après que la révélation de propos datant de 2020 où il remettait en question le droit d’Israël à exister. De grands quotidiens comme Il Corriere et La Repubblica ont alors, assez bizarrement, fait remarquer que les anciennes déclarations des politiciens postées sur les médias sociaux sont désormais utilisées à des fins électorales. Toutefois, les anciennes allégations répétées de Meloni selon lesquelles l’« usurier » George Soros, un milliardaire juif d’origine hongroise, « finance un plan de substitution ethnique des Européens » n’ont pas été évoquées durant la campagne actuelle.
La vraie menace que représente Fratelli d’Italia, si le parti venait à accéder au pouvoir, est bien moins un « retour au fascisme » que l’érosion des normes démocratiques et de l’Etat de droit.
La vraie menace que représente Fratelli d’Italia, si le parti venait à accéder au pouvoir, est bien moins un « retour au fascisme » que l’érosion des normes démocratiques et de l’Etat de droit. Les campagnes calomnieuses officielles contre les opposants et les minorités similaires à celles pratiquées en Pologne et en Hongrie, pourraient également se multiplier. Plus encore que la Hongrie, la droite polonaise du PiS sert en effet de modèle au parti de Meloni, d’autant que celle-ci semble avoir retrouvé une certaine légitimité au sein des cercles dirigeants de l’Union européenne depuis l’invasion russe de l’Ukraine. De plus, si Meloni a par le passé encensé Vladimir Poutine, elle adhère davantage aux positions atlantistes que la Lega, bien que son parti soit plus proche de la Conservative Action Political Conference (CPAC) et de l’aile trumpiste du Parti républicain que de l’administration démocrate actuellement au pouvoir à Washington.
Ainsi, il n’y aucune chance que Meloni ne cherche à sortir de l’euro ou de l’Union européenne, pourtant à l’origine de la stagnation économique de l’Italie depuis deux décennies. En revanche, un gouvernement dirigé par Meloni risque d’infliger des dommages durables de deux façons. D’une part en appelant à un blocus naval contre les bateaux de migrants, un acte démagogique non seulement illégal mais aussi à même de tuer des milliers d’êtres humains. D’autre part en proposant différents projets de réécriture de la Constitution italienne pour y inclure des articles vagues et fourre-tout pour lutter contre les critiques de la gauche, par exemple en criminalisant l’« apologie du communisme » ou du « totalitarisme islamique ». Derrière ce renversement du caractère antifasciste (rarement appliqué) de la Constitution actuelle se cache le projet de transformer l’Italie en une république présidentielle, en remplaçant le système parlementaire actuel par un exécutif tout-puissant.
Une campagne qui n’aborde aucun sujet de fond
Compte tenu de l’avance de Meloni dans les sondages, sa campagne se veut plutôt discrète, presque entièrement consacrée à répondre à la gauche qui l’accuse de ses liens avec le fascisme. Elle a notamment réalisé une vidéo sur le sujet à destination de la presse internationale – une déclaration face caméra, sans questions de journalistes – dans laquelle elle affirme que le fascisme appartient à « l’histoire ancienne » et où elle dénonce les « lois antijuives de 1938 » et la « dictature ». Le choix des termes, moins critiques du passé que ceux adoptés en son temps par Gianfranco Fini, leader historique du MSI (ancêtre des Fratelli) dans les années 1990-2000, vise de toute évidence à éviter de condamner la tradition néo-fasciste proprement dite. Meloni insiste d’ailleurs sur le fait que la gauche invoque l’histoire faute de trouver quoi que ce soit à dire sur son programme de gouvernement.
Le fait qu’aucune force politique majeure n’ait abordé la question de l’appartenance à la zone euro dans la campagne témoigne du caractère superficiel de la campagne conduite depuis cet été.
Sur ce dernier point, il est malheureusement difficile de lui donner tort. En réalité, les deux camps principaux, à savoir le bloc centriste du Parti Démocrate et l’alliance des droites, manquent cruellement de propositions concrètes pour les cinq prochaines années. La recherche par le Parti démocrate des voix centristes en grande partie imaginaires (et la multitude des petits partis néolibéraux qui affirment représenter ce « troisième pôle ») est également un épiphénomène de ce problème. Alors que Fratelli d’Italia rassemble l’électorat de droite sous un nouveau leadership, le centre-gauche semble paralysé, uniquement capable de se retrancher derrière la défense d’un modèle économique qui a conduit la croissance italienne à stagner depuis la fin des années 1990, tout en ayant recours à des subventions temporaires et à des mesures d’allègement pour en atténuer les répercussions. Le fait qu’aucune force politique majeure n’ait abordé la question de l’appartenance à la zone euro dans la campagne témoigne du caractère superficiel de la campagne conduite depuis cet été. Le cercle vicieux de faibles niveaux d’investissements, de modestes gains de productivité, de creusement de la dette publique, et de taux d’emploi structurellement bas a donc toutes les chances de continuer à frapper l’Italie.
En matière économique, les propositions de Meloni et de ses alliés sont tout aussi inadaptées que celles de leurs adversaires centristes. Le « centre-droit » promet notamment une réduction générale de la fiscalité et de la bureaucratie, tout en promettant de taxer davantage les entreprises non-européennes, censées être responsables à elles seules de l’évasion fiscale phénoménale dont est victime l’Italie. La proposition de Fratelli d’Italia pour stimuler l’emploi – des réductions d’impôts pour les entreprises (italiennes) qui créent des emplois – n’est qu’un pansement sur la jambe de bois des faiblesses économiques structurelles. En parallèle, Meloni souhaite remettre en question les allocations versées aux demandeurs d’emploi. Au sein de la coalition de droite, la proposition de la Lega d’un taux d’imposition uniforme de 15% – quitte à creuser un trou de 80 milliards d’euros dans les comptes publics – est tellement extravagante qu’on se demande pourquoi le parti ne propose pas d’aller encore plus loin en proposant un taux de 10% ou de 5%. La candidature, sur les listes de Fratelli d’Italia, de Giulio Tremonti, ministre des Finances à plusieurs reprises sous l’ère Berlusconi, témoigne sans la moindre ambiguïté de l’absence d’alternative en matière de politique économique.
À la gauche du Parti démocrate, certaines forces politiques tentent d’imposer la politique sociale dans la campagne. L’une, quoique plutôt chimérique, est le Mouvement cinq étoiles, dirigé par Giuseppe Conte : après avoir été au début de la dernière législature un fragile allié de la Lega de Salvini, il a fait de la défense de l’allocation aux demandeurs d’emploi déposée en 2019 (improprement appelée « revenu citoyen ») sa politique phare. Etant donné le départ de Luigi Di Maio, ancien dirigeant du parti, et ses alliances à géométrie variable (avec la Lega, puis avec le Parti Démocrate, avant de soutenir le gouvernement technocratique de Draghi, qui incarnait tout ce que les 5 Étoiles ont toujours dénoncé, ndlr) il obtiendra probablement autour de 10%, bien loin des 32% de 2018. Une partie des forces de la gauche et des écologistes s’est alliée au Parti démocrate (avec notamment la candidature du défenseur des ouvriers agricoles Aboubakar Soumahoro, d’origine ivoirienne) et soutient donc le cap néolibéral de ce parti. Enfin, une gauche indépendante de toute alliance se présente sous la bannière de l’Unione Popolare (Union populaire), emmenée par l’ancien maire de Naples Luigi de Magistris. Créée au dernier moment – les élections étant initialement prévues pour le printemps prochain – cette liste a peu de chances d’obtenir des élus au Parlement.
La période actuelle, à travers la percée des Fratelli, est réellement porteuse de nouveaux dangers : de nombreux dirigeants de ce parti sont non seulement des adeptes déclarés des théories du complot de l’alt-right mais également des défenseurs de criminels de guerre fascistes.
Ainsi, si la vie politique italienne est marquée par une profonde polarisation rhétorique avec des affrontements verbaux permanents et par la récurrence du symbolisme historique, aucune réelle alternative ne semble vraiment émerger. En réalité, le malaise économique est plus chronique que réductible à une période de crise en particulier : l’estime des citoyens à l’égard des partis est en baisse depuis plus de trente ans, et les choses ne sont pas près de changer. Cependant, la période actuelle, à travers la percée des Fratelli, est réellement porteuse de nouveaux dangers : de nombreux dirigeants de ce parti sont non seulement des adeptes déclarés des théories du complot de l’alt-right mais également des défenseurs de criminels de guerre fascistes. En diffusant récemment une vidéo d’une femme qui prétend s’être fait violer par un immigrant, Meloni nous révèle beaucoup de choses sur sa vraie personnalité. L’espoir de ne pas la voir accéder au pouvoir paraît bien mince.