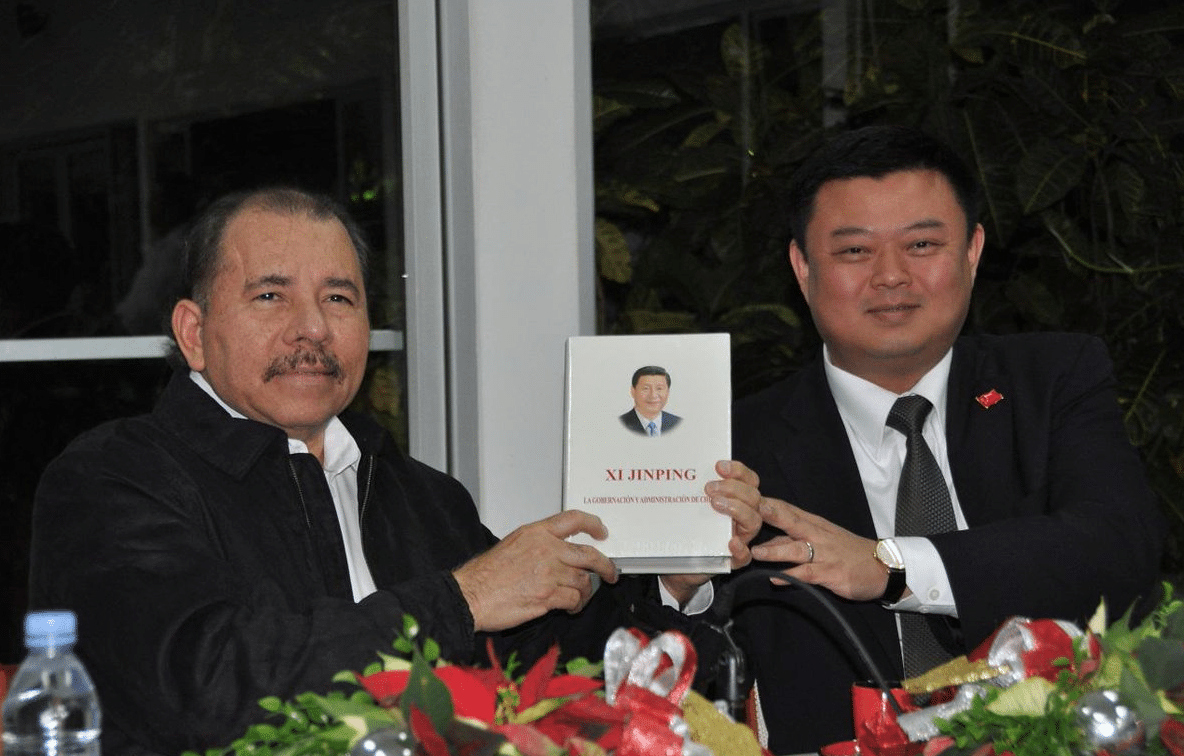Jeudi 21 avril 2016, gare de Vénissieux. Prochaine arrivée : le premier train direct en provenance de Chine. Transportant des marchandises, il aura mis seulement seize jours pour franchir les six pays [1] et 11 500 km qui séparent Wuhan, située dans la province du Hubei dans le centre de la Chine, de Lyon. Alors que 164 convois en provenance de Wuhan ont desservi l’Europe depuis 2015, cette ligne prévoit deux trains par semaine.
Voici l’exemple concret du gigantesque projet de « Nouvelle route de la soie » qu’a officiellement lancé la Chine en 2013. Son but : la connecter directement à toutes les zones et pays nécessaires à son intérêt national et à son développement économique.
La première puissance mondiale organise et équipe son espace régional proche et lointain
La Chine ambitionne la création de véritables corridors économiques qui la connectent à ses partenaires commerciaux européens (pour le volet terrestre), arabes et africains (pour le volet maritime). En contrôlant ainsi ces nouvelles voies de communication, elle parviendra par là même à échapper à l’influence d’autres puissances qui pourraient vouloir la contrer, tels les États-Unis.
Ses moyens : la construction et la maîtrise de nombreuses infrastructures, qu’elles soient de transport (routes, voies ferrées, aéroports, ports), de réseaux énergétiques (gazoduc, oléoduc, électricité), dans tous les pays traversés par les flux commerciaux et humains en direction et vers la Chine.
Et l’argent est là : la nouvelle Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) créée en 2015 sur impulsion chinoise est clairement destinée à financer ce projet. Elle est dotée de plus de 100 milliards de dollars et devrait en allouer en rythme de croisière plus de 15 milliards chaque année (3,5 milliards l’ont été en 2017). À cela, il faut ajouter d’autres fonds, dont le Silk Road Company Ltd doté de 40 milliards de dollars et ceux qui pourraient être mobilisés par la Nouvelle Banque de Développement des BRICS. En 2017, l’agence de notation Fitch Ratings a ainsi évalué à plus de 900 milliards de dollars le nombre de projets prévus ou en cours.
Son volet terrestre : la « grande marche » vers les capitales européennes
La route terrestre partirait de la ville de Xi’An, également située dans la province du Hubei et rejoindrait l’Europe jusqu’en Belgique, à travers un réseau de plus de 13 000 kilomètres de routes, autoroutes et voies ferrées. Sur le seul plan ferroviaire, trois axes principaux sont prévus : Shenyang dans le Liaoning à Leipzig (en passant par la Russie), Yiwu également dans le Liaoning à Madrid et Chengdu dans le Sichuan à Duisbourg (en passant par l’Asie centrale). Illustration de cette importance stratégique de l’Europe du Nord : le géant chinois du commerce en ligne Alibaba vient d’annoncer mi-novembre la création d’un centre ou hub logistique européen à Liège – plus de 380 000 m2 – afin de se confronter directement à son concurrent américain Amazon.
Ce volet terrestre serait complété par des corridors économiques [2], tel celui acté en avril 2015 entre la Chine et le Pakistan. La Chine a ainsi promis plus de 46 milliards de dollars – 17% du PIB pakistanais… – pour construire un axe allant de l’Ouest chinois (de Kashgar dans la province du Xinjiang) au port de Gwadar [3] au Pakistan où la Chine construit un port en eau profondes. Exemple de projet en travaux : l’autoroute Karachi-Lahore-Peshawar de presque 400 km financée par la Chine.
Le président chinois Xi a aussi annoncé vouloir accompagner le volet terrestre par une « Route aérienne de la soie », pont aérien commercial aérien entre Zhengzhou, située dans le Henan, avec une liaison aérienne avec le Luxembourg, qui a concerné plus de 150 000 tonnes de fret en 2017.
Son volet maritime : cap sur Venise et Athènes en passant par le canal de Suez
La route maritime s’inscrit, quant à elle, dans la stratégie du « collier des perles » des années 1990 et 2000 [4] qu’elle poursuit et développe. La Chine se fonde ainsi sur sept « perles » [5] qui partent de la Chine du Sud, contournent la péninsule indochinoise, traversent le détroit de Malacca et longent l’océan Indien jusqu’à l’entrée du détroit d’Ormuz. Elle a ainsi modernisé ou créé de nombreuses infrastructures, notamment des ports en eau profonde – adaptés à des navires de grande taille [6] et [7].
Sur cette assise solide, la Chine souhaite désormais compléter sa route de la soie jusqu’à l’Europe. Il ne reste plus que quelques perles à aligner. Prochaine étape : la première base militaire chinoise à l’étranger a été construite à Djibouti en 2017 [8]. En Grèce, le port d’Athènes qu’est le Pirée a été racheté par l’armateur chinois Cosco [9] au début de l’année 2016 [10] et devrait doubler l’activité du port d’ici la mi-2019.
Enfin, le port d’arrivée de la nouvelle route de la soie serait Venise. La destination est particulièrement symbolique pour les Chinois : revenir à la ville de départ de Marco Polo, 800 ans après son voyage à la découverte de l’Orient !
Vers une alternative ou une concurrence de la route de la soie chinoise ?
L’importance stratégique de ce nouveau projet de routes commerciales n’a pas échappé aux États-Unis puisque le 17 novembre 2018, au dernier sommet de l’APEC (qui réunit les pays asiatiques et du continent américain), le vice-Président Mike Pence a affirmé que la puissance états-unienne ne soutiendrait pas « une route à sens unique » et a dénoncé l’opacité et l’importance de l’endettement qu’implique un tel projet. En effet, depuis 2013, d’importantes fragilités du projet chinois sont apparues.
Ainsi, dans une note d’octobre 2018, la direction générale du Trésor français se montrait vigilante, en pointant du doigt que ces investissements massifs « pourraient entraîner les États concernés dans des dérives d’endettement insoutenables ». D’autres signaux faibles de cette rébellion sont apparus dans des pays pivots : après le Premier ministre de la Malaisie qui a dénoncé un « néocolonialisme chinois » en août 2018 et reporté plusieurs grands projets d’infrastructure portés par Pékin – dont une ligne à grande vitesse devant relier le pays à Singapour, le Pakistan a annoncé souhaiter renégocier les conditions du « corridor économique » impulsé par Pékin sur son territoire.
Les États-Unis, le Japon et l’Inde vont probablement s’engouffrer dans ce mécontentement. Ainsi, dès 2015, face à la BAII, Shinzo Abe a annoncé que son pays était prêt à investir 100 milliards d’euros pour soutenir le développement d’infrastructures en Asie – soit le capital total de la BAII) et l’Inde a lancé une contre-offensive diplomatique : la blue diplomacy dans l’océan indien aux Seychelles, à l’île Maurice et au Sri Lanka. Pour preuve, en février 2018, ces trois pays, aux côtés de l’Australie, travaillaient à une alternative à la route de la soie chinoise et ce, pour promouvoir une stratégie dite « indo-pacifique » libre et ouverte. Les jeux sont ouverts !
[1] Le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l’Allemagne
[2] Outre le corridor Chine – Pakistan, le corridor Chine – Singapour. Le but étant de créer une ligne à grande vitesse Kunming – Singapour. A cet effet la Chine a signé un accord de coopération avec la Thaïlande en 2014 pour construire une voie ferrée de 867 km (sa construction doit débuter en 2016).
[3] Ce port stratégique est en face du détroit d’Ormuz et à une cinquantaine de kilomètres de la frontière iranienne.
[4] Raffermissement des liens diplomatiques et investissements importants pour le développement de ports commerciaux et de zones supports pour la marine chinoise (Merguy et Sittwe en Birmanie, Chittatong au Bangladesh, Hambantota au Sri-Lana, Gwadar au Pakistan). Outre l’approvisionnement énergétique chinois qui était sa priorité, la Chine « encerclait » ainsi dans l’Océan indien son rival régional qu’est l’Inde. Exemple : installation d’une base d’écoute et d’interception sur l’Île Coco (Birmanie).
[5] L’île de Hainan (Chine), l’île Woody (Paracels – territoires contestés mais sous domination chinoise), Sihanoukville (Cambodge), Mergui et Sittwe (Birmanie), Chittatong (Bangladesh), Hambantota (Sri-Lanka – depuis 2007) et Gwadar au Pakistan.
[6] Tels les cargos, les porte-conteneurs, les navires pétroliers et minéraliers.
[7] Extension de l’aéroport de Malé aux Maldives, aérodrome de l’Île Woody dans les Paracels,
[8] La France, les Etats-Unis et le Japon (depuis 2011)
[9] Il détient désormais 51% de la société du port du Pirée, et 67% d’ici 2020 s’il respecte ses engagements.
[10] Pour 368,5 millions d’euros.
© President of Russia