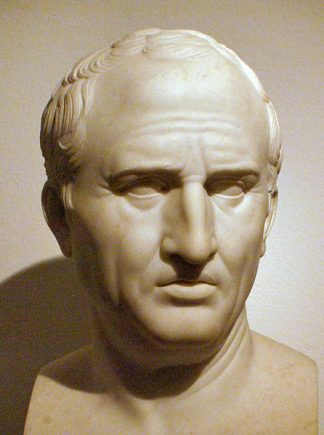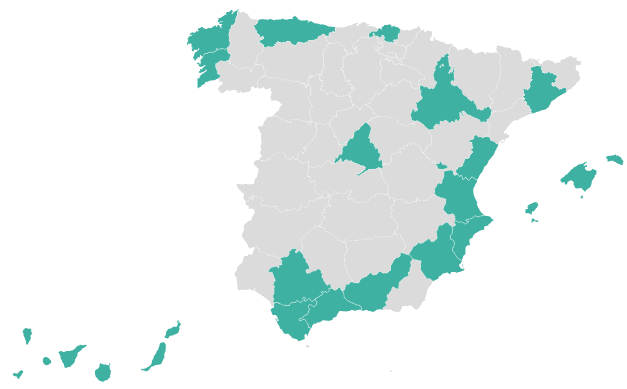Passé à deux doigts de la nomination en 2016, Bernie Sanders abordait les primaires de 2020 en position de force. À quatre jours du Super Tuesday, les sondages lui promettaient une victoire décisive. Pourtant, c’est Joe Biden qui, en remportant une série d’États dans de très larges proportions, s’est rapidement constitué une avance insurmontable. Comment expliquer cet échec ? La campagne de Bernie Sanders était-elle trop « à gauche », pas assez « populiste » ou bien l’appareil démocrate est-il trop puissant pour être renversé? Autrement dit, la défaite s’explique-t-elle par des erreurs stratégiques ou par le contexte structurel de cette élection ?
S’il a gagné la bataille des idées, Sanders n’a pas réussi à convaincre les électeurs démocrates que celles-ci pouvaient triompher à l’échelle nationale. Or, battre Donald Trump constitue leur priorité absolue. Malgré ses faiblesses manifestes, Joe Biden leur est apparu comme un choix moins risqué.
« L’argent contre les gens »
Les électeurs démocrates étaient-ils mal informés ? Pour répondre à cette première question, il est utile d’observer les trois principaux leviers dont dispose une campagne pour diffuser son message :
- L’engagement direct : les meetings de campagne et l’action des militants qui réalisent du porte-à-porte, appels téléphoniques, envoient des SMS etc. ;
- Les médias payants (publicité à la télévision et sur internet, campagne sur les réseaux sociaux, brochures dans les boîtes aux lettres, affiches…) qui sont très peu régulés aux États-Unis ;
- Les médias gratuits (participation dans des émissions du candidat et de ses porte-paroles, plus la couverture médiatique sans la présence du candidat en plateau). Aux États-Unis, il n’y a pas de décompte du temps de parole ni de règle de parité.
En termes d’engagement direct, Bernie Sanders bénéficiait d’un avantage indéniable. Il a tenu le plus grand nombre de meetings, rassemblé les plus grandes foules et disposait de la plus large organisation militante observée depuis des années. Cette dernière a téléphoné à tous les électeurs de l’Iowa, frappé aux portes de tous les démocrates du New Hampshire, et délivré des millions d’appels téléphoniques, SMS et centaines de milliers de porte-à-porte en Californie et au Nevada. [1]
Deuxièmes et troisièmes sur cet aspect, les campagnes de Warren et Buttigieg avaient également établi un maillage important dans les deux premiers États, avec des résultats remarqués pour Buttigieg et décevants pour Warren.
À l’inverse, Joe Biden n’avait aucune infrastructure de terrain digne de ce nom. Il a cependant bénéficié indirectement de l’auto-organisation d’une partie de la base électorale démocrate. Depuis 2017, le mouvement « indivisible » inspiré des tactiques du Tea Party s’est mobilisé pour défendre la réforme de la santé Obamacare et s’opposer aux politiques de Trump les plus brutales dans une forme de résistance spontanée. Si cette base électorale issue des zones périphériques n’est pas dédiée à un candidat particulier, elle a contribué à l’augmentation de la participation en faveur de Biden dans les jours qui ont précédé le Super Tuesday. [2] Dire que Biden n’avait aucune force militante est donc inexact, bien qu’elle se soit manifestée sans son intervention et dans des proportions moins importantes.
Avec cette primaire, l’organisation de terrain montre tout de même ses limites. Un porte-à-porte de vingt minutes s’avère souvent insuffisant pour changer définitivement l’opinion d’une personne qui entend quotidiennement dans les médias le point de vue inverse et reste influencée par son milieu. À ce titre, l’analyse effectuée par la journaliste et militante pro-Sanders Megan Day, qui a conduit des centaines de porte-à-porte, est éclairante. Si son expérience démontre le peu d’information et de temps dont disposent les électeurs pour se forger une opinion, elle tend à valider l’hypothèse d’un électorat désinformé ou peu informé. Des choses aussi évidentes que le fait que Sanders défendait un système de santé universel, gratuit et public, et que Biden y était férocement opposé n’avaient pas atteint de nombreux électeurs. [3]
En clair, si Sanders bénéficiait d’un avantage certain sur le terrain militant, il n’était pas suffisant pour contrebalancer les deux autres leviers que sont les médias payants et gratuits.

Sanders a récolté près de 190 millions de dollars, soit plus du double de Joe Biden et davantage que tous les autres candidats à l’exception des milliardaires Tom Steyer (250 millions de dollars) et Mike Bloomberg (1 milliard). Mais ces sommes ne servent pas seulement à diffuser de la publicité ciblée : il faut aussi payer l’infrastructure de la campagne.
Avec l’argent des Super Pacs, c’est l’inverse. Or, Sanders fut le seul candidat majeur à refuser l’aide de ces entités privées, et à subir les attaques de certaines d’entre elles pourtant non affiliées à un candidat. Des millions de dollars furent ainsi dépensés par divers lobbies hostiles, alors que les candidatures de Biden, Buttigieg et Warren furent maintenues en vie par leurs Super Pacs respectifs après la primaire du New Hampshire. [4]
Si l’on compare l’argent dont disposait Sanders pour diffuser des spots publicitaires susceptibles de convaincre les électeurs avec le total des dépenses réalisées dans ce domaine par ses multiples adversaires et Super Pacs indépendants, le socialiste accuse un déficit conséquent – contrairement à 2016 ou il avait pu faire jeu égal avec Clinton.
Mais c’est encore le troisième levier, celui des médias “gratuits”, qui lui aura fait le plus défaut.
Le rôle problématique des médias démocrates
Aux États-Unis, les médias sont de plus en plus structurés selon leurs cœurs de cible. Pour la presse écrite, le New York Times et le Washington Post sont les titres de références des démocrates, tandis que CNN et MSNBC jouent ce rôle dans l’audiovisuel.
Suite à l’élection de Donald Trump, ils ont recruté une pléthore d’anciens cadres des services de renseignements et d’ex-stratèges républicains qui s’étaient illustrés comme Never trumpers en appelant à voter Hillary Clinton. Qu’ils tiennent des colonnes quotidiennes dans la presse ou monopolisent les plateaux télé, leur parole s’ajoute à celle des anciens cadres de la campagne de Clinton et membre de l’administration Obama pour produire une information particulièrement éditorialisée.
L’opposition médiatique à Donald Trump s’est davantage axée sur la forme que le fond, traitant en priorité les questions de politique étrangère et de protocole, promouvant des théories conspirationnistes de type RussiaGate et se nourrissant des nombreux scandales qui ont touché la Maison-Blanche. Inversement, ils ont dépensé très peu d’énergie à couvrir la politique intérieure de Trump. [5]
Leur discours a ainsi produit trois effets dominants : faire apparaître Donald Trump comme la cause principale des problèmes du pays (et non un symptôme), porter une critique de droite à son encontre, et marteler le fait que seul un candidat de centre droit serait capable de le battre.
Dans ce cadre, la candidature Sanders ne pouvait qu’être mal accueillie. CNN comparera sa campagne au Coronavirus, MSNBC à l’Allemagne nazie. Selon une enquête sociologique, les téléspectateurs de cette chaine avaient une opinion moins favorable du sénateur socialiste que ceux de Fox News. Le Washington Post est allé jusqu’à écrire que Sanders était aussi dangereux que Donald Trump pour le climat. CNN a monté une polémique la veille d’un débat télévisé pour repeindre le socialiste en sexiste avec le concours d’Elizabeth Warren, ce que le journaliste Matt Taibbi a décrit comme la pire tentative d’assassinat politique de l’histoire moderne. Quant au Times, les douze membres de son service politique ont classé Sanders en dernière position des candidats susceptibles d’obtenir le soutien officiel du prestigieux journal.

Lorsque la primaire a atteint une phase critique, les fameux Never Trumpers et anciens membres de la campagne Clinton ont ressassé l’idée que Sanders allait offrir un second mandat au président sortant, nombre d’entre eux allant jusqu’à refuser publiquement de voter pour lui contre Trump, en matraquant l’idée que seul un candidat modéré comme Hillary Clinton pouvait gagner.
Les services de renseignements américains l’ont également accusé d’être une marionnette de Poutine, en diffusant de fuites anonymes “révélées” par le Washington Post et amplifiées par les chaines d’informations continues. [6]
Or, ce sont les électeurs âgés de 45 ans et plus qui ont été le plus exposés à ce discours, ceux qui avaient été nourris pendant trois ans au RussiaGate et ont voté dans les plus larges proportions. Faut-il s’étonner qu’ils aient plébiscité Biden malgré leurs préférences pour le programme de Sanders ?
Lors des deux derniers jours précédant le Super Tuesday, Biden bénéficiera d’une couverture médiatique extrêmement large et positive, dont la valeur sera estimée à 72 millions de dollars. Plus de dix fois le montant publicitaire dépensé par Sanders dans le même laps de temps, alors que ce dernier recevait une couverture faible et extrêmement négative.
Sanders était-il condamné à subir ce désavantage ? Pas nécessairement. Il aurait pu se rendre plus souvent sur les plateaux, en particulier chez MSNBC, au lieu d’adopter une stratégie de contournement des médias. De même, il aurait pu orienter leur discours en lançant ses propres polémiques. Avant l’Iowa, sa campagne avait réussi à imposer un cycle médiatique centré sur le fait que Biden avait, par le passé, systématiquement cherché à réduire la sécurité sociale dont dépend une majorité des seniors qui constituent son électorat. Mais cette tactique offensive n’a pas été poursuivie plus avant.
Bernie 2020, une candidature trop à gauche ?
Si Sanders a musclé son programme depuis 2016, les enquêtes d’opinion montrent que ses propositions phares restent majoritaires non seulement auprès des électeurs démocrates, mais de l’ensemble du pays. En particulier, près de 90 % des Américains sont d’accord avec sa critique du rôle de l’argent en politique et 70 % sont favorables à un impôt sur la fortune. Ses propositions de légalisation du cannabis, de hausse du salaire minimum et de New Deal vert reçoivent toutes une majorité d’opinions favorables.
Même lorsqu’elle est formulée de manière négative, la nationalisation de l’assurance maladie a systématiquement reçu l’adhésion d’au moins 60 % des électeurs à la primaire, soit plus du double des suffrages obtenus par Sanders. D’autres enquêtes d’opinion vont dans ce sens. Une étude de l’institut Data for Progress a montré que l’étiquette socialiste n’avait pas d’impact négatif sur les chances de victoire de Bernie Sanders face à Trump, contrairement au qualificatif « démocrate ». Au Texas, une large majorité d’électeurs démocrates a indiqué préférer le socialisme au capitalisme.
Si la polémique lancée par CBS en diffusant les propos que Sanders avait tenus sur Fidel Castro dans les années 80 a été utilisée pour alerter sur le fait qu’il ne pourrait pas gagner la Floride, les fameux « latinos d’origine cubaine » de Floride ont voté en majorité pour Sanders à la primaire.
La présence de Warren le forçait à défendre son aile gauche, mais il a été débordé par divers candidats sur les questions de réformes institutionnelles et de contrôle des armes à feu. Sa campagne aurait cessé de solliciter l’aide d’Alexandria Ocasio-Cortez suite à ses propos en faveur des immigrants, jugés trop radicaux par l’équipe Sanders. [7]
À l’inverse, le sénateur du Vermont a cherché à étendre son électorat vers la droite, notamment en participant à deux émissions sur Fox News et en donnant une interview à Joe Rogan, le youtubeur le plus populaire du pays – qui, s’il se définit comme apartisan, accorde souvent des entretiens à des personnalités très marquées à droite.
En clair, le positionnement idéologique de Bernie Sanders ne semblait pas représenter un obstacle en vue de la présidentielle. Mais la perception qu’il en constituerait un explique certainement le ralliement des électeurs derrière Biden. Son erreur fut-elle de tenir un discours d’élection présidentielle lors d’une primaire, et de parler aux Américains dans leur ensemble plutôt que de cibler les électeurs démocrates ?
Une campagne trop populiste ?
En 2020, Bernie Sanders pouvait poursuivre le mouvement « populiste » entamé en 2016 ou rentrer dans le rang pour incarner le nouveau visage du parti démocrate.
Cette seconde voie aurait impliqué de rejoindre officiellement le parti au lieu de maintenir son statut d’indépendant, de cesser de critiquer « l’establishment » et de jouer le jeu des alliances et des compromis tout en ouvrant ses équipes aux anciens conseillers de Clinton et Obama.
Mais le programme de Sanders remet en cause les structures du parti et s’attaque aux industries qui le financent. Les innombrables conseillers qui gravitent autour n’auraient pu être intégrés dans son équipe, et encore moins dans sa future administration, sans entrer en conflit avec son programme. Pour ces centaines de personnes, Sanders représentait une menace existentielle.[8]
Quelle que soit la bonne volonté affichée par le sénateur, cette option risquait de tourner court, comme l’a démontré Elizabeth Warren. En dépit de ses mains tendues à l’establishment, y compris en recrutant d’anciens dirigeants de la campagne d’Hillary Clinton, Warren a été sévèrement attaquée par l’appareil et boudée par les cadres du parti. Les fameux vétérans de la campagne Clinton l’ont orienté vers une stratégie désastreuse. Quant aux médias, ils lui ont réservé un traitement parfois aussi hostile qu’à Bernie Sanders. En clair, le capital ne cède pas aux flatteries, il ne répond qu’au rapport de force.
Sachant cela, l’alternative consistait à poursuivre sa stratégie « populiste » et «insurrectionnelle ». Pour avoir toutes les chances de fonctionner, elle devait être menée avec détermination. Or, dès 2016, Sanders a refusé la rupture. Il a fait activement campagne pour Hillary Clinton, puis suivi la stratégie d’opposition des dirigeants démocrates, attendant patiemment que les tentatives d’abrogation de l’Obamacare menées par Trump échouent avant de proposer sa propre réforme « Medicare for All ». En bon soldat, il a embrassé la stratégie du RussiaGate et soutenu la tentative de destitution maladroite de Donald Trump. Contrairement à Alexandria Ocasio-Cortez, il n’a jamais critiqué un cadre du parti publiquement.[9]
Lorsque Obama a imposé Tom Perez contre son allié Keith Ellison à la tête du DNC, Bernie n’a pas protesté. Pourtant, Perez était connu pour son opposition viscérale à Sanders.[10]
Dès le début des primaires, il a affirmé qu’il ferait campagne pour le vainqueur, quel qu’il soit, au lieu d’agiter la menace d’une candidature dissidente aux élections générales ou d’un soutien minimaliste qui risquerait de pousser sa base électorale vers l’abstention. Il s’est ainsi privé d’un levier important pour dissuader les attaques de l’establishment. Ses adversaires ont pu le qualifier de sexiste, de corrompu et dénoncer sa volonté de détruire le parti en toute impunité.
Pour plusieurs journalistes indépendants, cette timidité explique le manque d’enthousiasme suscité auprès des jeunes, qui l’ont considéré comme un démocrate de plus et se sont peu mobilisés. [11]
Cependant, une stratégie confrontationnelle semblait risquée. L’électorat démocrate reste attaché à son parti, et l’élection de Donald Trump a changé ses priorités. Sanders lui-même considère que battre Trump est plus important que de gagner l’élection, contrairement à une part de l’aile droite démocrate. Il a donc refusé d’attaquer directement ses adversaires et accepté de jouer l’unité, tout en conservant son statut d’indépendant et sa rhétorique anti-establishment.
Ce faisant, il a pu heurter des pans entiers de l’électorat démocrate qui s’identifient fortement au parti, sans pour autant mettre en difficulté l’establishment.
I've got news for the Republican establishment. I've got news for the Democratic establishment. They can't stop us.
— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 22, 2020
Se situer entre le « tout populiste » et le « tout démocrate » restait probablement le meilleur choix. Mais encore fallait-il l’exécuter avec agilité. Si la stratégie retenue par Sanders semblait fonctionner jusqu’à la primaire de Caroline du Sud, après le come-back de Biden et la consolidation de l’establishment, le socialiste a été incapable de pivoter efficacement et a payé cher ses erreurs initiales.
Les erreurs propres à la personnalité de Bernie Sanders
En 2018, Bernie Sanders a effectué une tournée dans le deep south à la rencontre de la « communauté » noire et de ses représentants afin de préparer 2020. Malheureusement, cet effort fut contre-productif, comme le rapportera un article du New York Times mettant en cause les choix sémantiques malheureux de Sanders et son manque de sensibilité. Surtout, il s’est montré incapable de mentionner son engagement pour le mouvement des droits civiques et son arrestation par la police lors d’une action non violente.

Comme l’a expliqué le journaliste Anand Giridharadas lors d’un long portrait en couverture du magazine Time, Sanders pèche par excès de matérialisme. Parler de sa personne n’est pas dans ses habitudes. Or, dans le jeu politique américain, cette capacité à démonter et susciter de l’empathie reste cruciale. Son autre problème restera son inaptitude à s’attirer des soutiens de poids. À l’exception d’Alexandria Ocasio-Cortez, venue d’elle même, Sanders est apparu isolé.
À l’inverse, Biden a bénéficié de nombreux ralliements à l’impact déterminant. Le soutien du baron Jim Clyburn lui a offert près d’un tiers des votes de Caroline du Sud. De même, l’écrasante majorité des électeurs de Buttigieg et Klobuchar a voté Biden pour le Super Tuesday, provoquant une cascade de ralliements supplémentaires dans les jours suivants.[12]
Sanders aurait pu répondre à Biden coup par coup s’il avait lui aussi récolté des soutiens importants. Quelqu’un comme Clyburn, financé par les lobbys pharmaceutiques, était probablement hors de portée. Mais suite à sa victoire écrasante au Nevada, Sanders disposait d’une courte fenêtre de tir. Chuck Schumer (président du groupe démocrate au Sénat) et Nancy Pelosi (président de la chambre des représentants du Congrès) avaient publiquement déclaré qu’une victoire de Sanders ne présentait pas de risque pour le parti, sans pour autant se ranger derrière lui.
Beto O’Rourke constituait une cible plus aisée, tant cette étoile texane s’était inspirée de Sanders pour sa campagne sénatoriale de 2018 et avait recruté des vétérans de son équipe de 2016. Quant aux candidats Tom Steyer et Andrew Yang, le fait qu’ils n’aient pas de carrière politique à défendre et étaient idéologiquement proches du sénateur socialiste en faisaient des alliés évidents. Si leur poids politique restait faible, leur ralliement aurait permis de casser le récit médiatique.
Elizabeth Warren, enfin, restera le gros point noir des primaires. Non seulement son maintient jusqu’au Super Tuesday aura divisé le vote progressiste, mais elle aura également empêché l’union des institutions de la gauche américaine derrière Sanders. D’innombrables syndicats, élus, organisations militantes, médias, journalistes, activistes et personnalités influentes seront restés neutres jusqu’au Super Tuesday. Pendant que les néolibéraux se ralliaient derrière Biden, les institutions progressistes sont majoritairement restées spectatrices ou divisés. Enfin, Warren a livré d’innombrables attaques d’une rare violence contre Sanders, au point de décourager une part de son électorat de se reporter sur Bernie. Mais en ce qui la concerne, il semble que Sanders ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour la rallier. [13]
La principale faute de Sanders fut-elle d’avoir été trop conciliant ?
En janvier 2020, un soutien de Sanders, Zephyr Teachout, publie une colonne très détaillée dans le Guardian, intitulé « Joe Biden a un problème de corruption ». David Sirota, conseiller stratégique de Sanders, diffusera cet article massivement. Devant l’indignation de Biden, Sanders s’excusera publiquement au lieu de saisir l’opportunité pour imposer ce thème majeur dans la campagne. [14]
Par la suite, les différents conseillers de Sanders vont le supplier d’attaquer Biden sur son bilan, et de formuler des arguments clairs pour expliquer en quoi le vice-président serait un candidat catastrophique à opposer à Trump. Bernie Sanders a refusé de rentrer dans ce jeu, prétextant qu’il était un « ami » des Biden. Enfin, lorsqu’un journaliste lui a demandé si Joe Biden pouvait battre Trump, Sanders a répondu positivement, détruisant ainsi son principal argument électoral. [15]
Pour des raisons personnelles que le journaliste Matt Taibbi a très bien explicité, Sanders n’était pas capable de confronter Biden de manière décisive, malgré les innombrables opportunités qui se sont présentées. Mais au-delà des errements stratégiques, Bernie Sanders pouvait-il s’imposer dans ce contexte électoral particulier ?
L’électorat démocrate de 2020, plus à droite qu’en 2016 ?
Deux électorats clés ont fait défaut à Bernie Sanders : les Afro-Américains de plus de 45 ans et les habitants des banlieues aisées. Or, ces deux groupes ont massivement voté à la primaire.
Comme le révèle une enquête de The Intercept, les Noirs du Sud des États-Unis ont majoritairement voté pour Biden en connaissance de cause. Bien qu’ils préfèrent le programme de Bernie Sanders, ils ne font pas confiance aux électeurs blancs aisés pour élire un « socialiste » à la Maison-Blanche. [16]
Quant aux zones périurbaines aisées, leur vote s’explique d’abord par la stratégie du parti démocrate, explicité par Chuck Schumer en 2016 : « pour chaque électeur que nous perdons dans la classe ouvrière de l’ouest de la Pennsylvanie, nous en gagnerons trois dans les banlieues aisées de Philadelphie, et ce modèle peut se répliquer à travers tout le pays ». Si une telle stratégie a coûté la Maison-Blanche en 2016, elle a permis de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants du Congrès en 2018. Outre le positionnement politique du parti, ce succès s’explique par la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Médias et Parti démocrate ont matraqué l’idée que le milliardaire représentait un danger existentiel, en l’attaquant quasi exclusivement sur la forme. Ils ont alimenté le feuilleton conspirationniste du RussiaGate avant de lancer une procédure de destitution bâclée, qui n’a produit aucun résultat probant, mais permettait d’éviter toute autocritique de fond aux cadres du parti.
Les électeurs les plus âgés et idéologiquement modérés, qui sont aussi le cœur de cible des médias de masse, semblent avoir adhéré à cette logique. Puisque Trump est la source de tous les problèmes, et que le parti démocrate est la solution, pourquoi prendre le risque d’élire un « socialiste » ?
Quelques appels téléphoniques de Barack Obama en arrière-plan auront suffi à rallier le parti derrière Biden, et par voie de conséquence, la majorité de son électorat. Les électeurs qui avaient pour priorité d’améliorer leurs conditions d’existence ont voté Sanders, les autres ont préféré Joe Biden par vote utile.
Cette élection aura signé le retour des vieilles recettes que 2016 semblait avoir discrédité : médias traditionnels, l’argent investi en spots télévisés et le poids des instances du parti auront triomphé des nouvelles techniques militantes, des campagnes ciblées à l’aide des réseaux sociaux et des médias alternatifs. Malgré ses faiblesses, Joe Biden reste le vice-président du plus populaire président démocrate depuis Kennedy, ce qui en faisait un adversaire bien plus redoutable qu’Hillary Clinton.
Quel futur pour la gauche américaine ?
En pleine crise de coronavirus, la défaite de Bernie Sanders laisse un gout amer.
La catastrophe sanitaire, économique et sociale qui tétanise le pays démontre la pertinence de son programme, tandis que l’ampleur des crédits débloqués par la FED et le Congrès prouvent que son projet était finançable. [17] Théoriquement, cette crise devrait placer la gauche américaine en position de force en vue des échéances futures.
D’abord, seuls les plus de 65 ans ont voté massivement pour Joe Biden. Sanders a remporté de très loin le vote des moins de 30 ans, et confortablement celui des moins de 45 ans. Cette génération de millenials, qui a connu le 11 septembre et la crise des subprimes reste durablement ancrée à gauche. Et dans quatre ans, une jeunesse marquée à son tour par une crise profonde viendra grossir les rangs du mouvement progressiste.
Ensuite, Bernie Sanders a remporté le vote latino, seul électorat en forte expansion démographique, dans des proportions écrasantes. Il s’agit d’un immense vivier de voix qui ne demande qu’à être « organisé ». Reste à savoir si Sanders et son mouvement auront la capacité de poursuivre le travail et de saisir cette opportunité…
Sources :
- Lire ce long article de Ryan Grim, en particulier pour les détails sur l’organisation militante de Sanders https://theintercept.com/2020/01/03/bernie-sanders-democratic-party-2020-presidential-election/
- Lire à ce propos Ryan Grim, “We’ve got people”, chapitre 19 et surtout Ryan Grim via reddit ici.
- https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/3/16/21165201/bernie-sanders-joe-biden-2020-election-meagan-day
- Elizabeth Warren recevra un chèque de 14 millions de dollars de la part d’une richissime donatrice californienne pour former un Super Pac une semaine avant le Super Tuesday. L’argent sera utilisé pour tapisser le Texas, la Californie et le Massachusetts de spots télévisés anti-Bernie. https://theintercept.com/2020/03/20/karla-jurvetson-elizabeth-warrens-persist-super-pac/
- À ce propos, lire https://lvsl.fr/pourquoi-le-parti-democrate-renonce-a-sopposer-frontalement-a-donald-trump/
- Aaron Maté “The Russiagate playbook can’t stop Sanders“
- Ce point reste très discuté, lire : https://www.huffpost.com/entry/alexandria-ocasio-cortez-bernie-sanders-campaign-rallies_n_5e6ade51c5b6bd8156f44356
- New York Times : Democratic Party leaders willing to risk party damage to stop Sanders. https://www.nytimes.com/2020/02/27/us/politics/democratic-superdelegates.html
- https://theintercept.com/2020/04/01/watch-our-new-weekly-video-commentary-and-interview-program-system-update-debuts-today/
- À lire absolument pour comprendre le rôle d’Obama dans la prise de pouvoir au DNC et ses conséquences : https://prospect.org/politics/tom-perez-should-resign-dnc/
- Lire Glenn Greenwald ici et Chris Hedges ici et là.
- Lire sur LVSL le récit du come-back de Biden
- Lire à ce propos l’analyse de Current Affairs sur les causes de la défaite de Sanders
- Lire la réflexion de David Sirota sur cet épisode dans Jacobinmag, et l‘article du NYT qui le commente
- How things fell appart for Sanders, NYT
- À lire pour comprendre les problèmes de Sanders auprès des Afro-Américains : https://theintercept.com/2020/03/10/mississippi-sanders-biden-black-voters/
- Lire sur LVSL : les USA face au Coronavirus