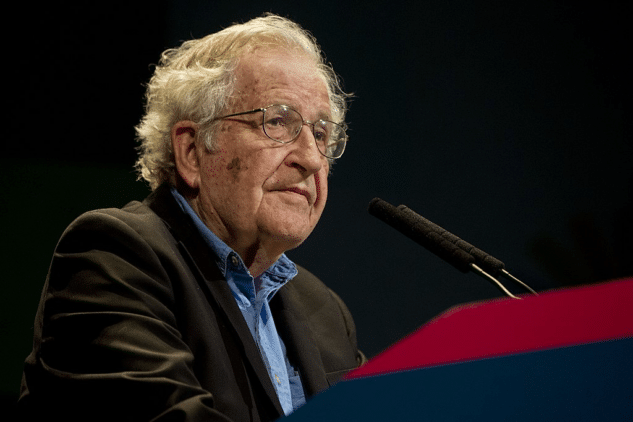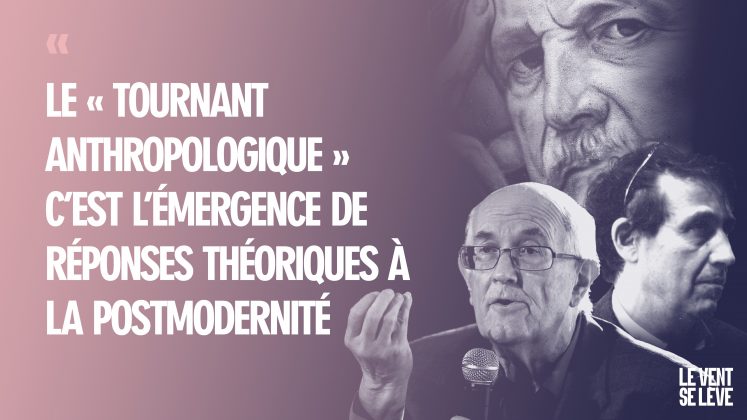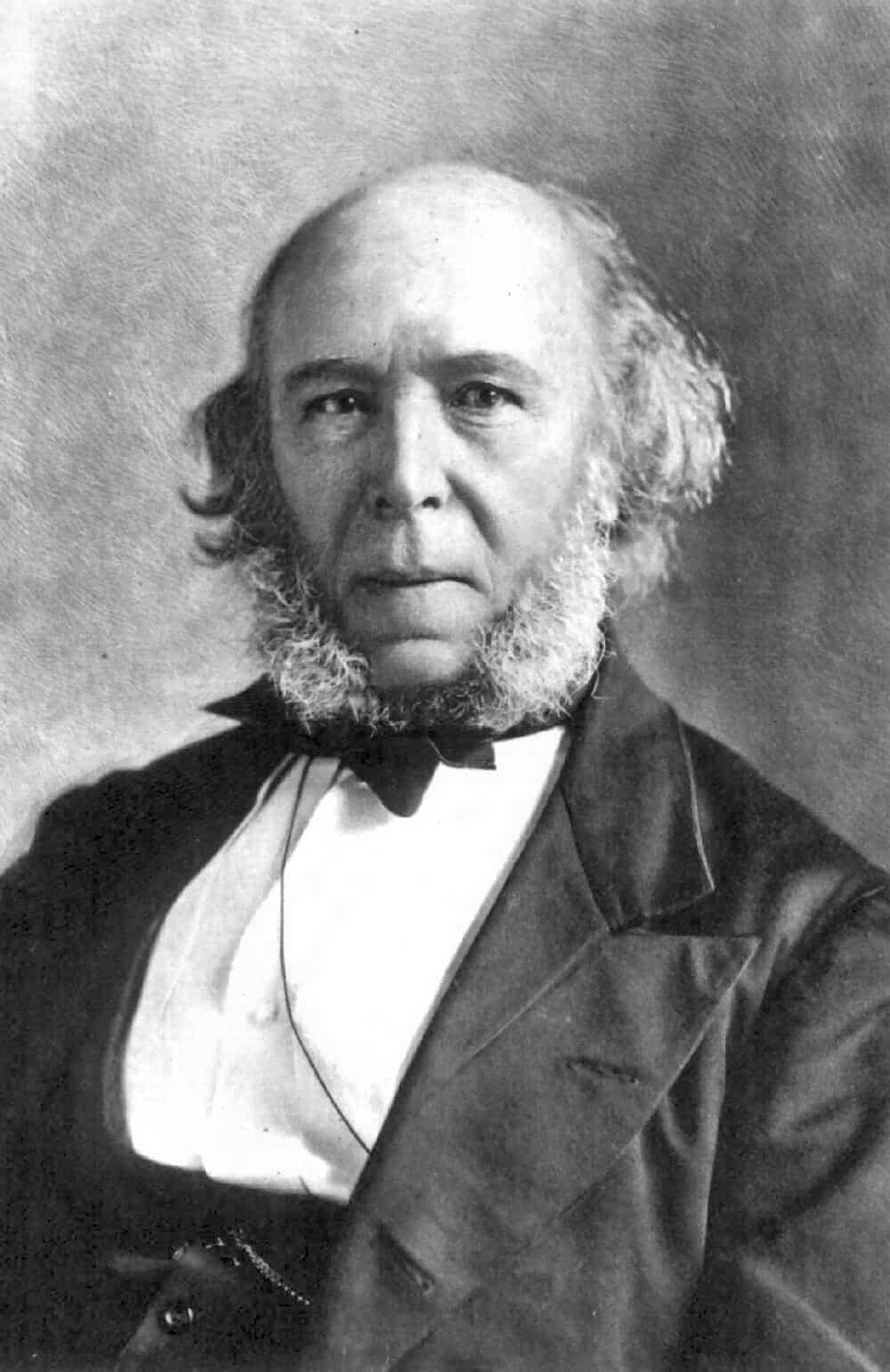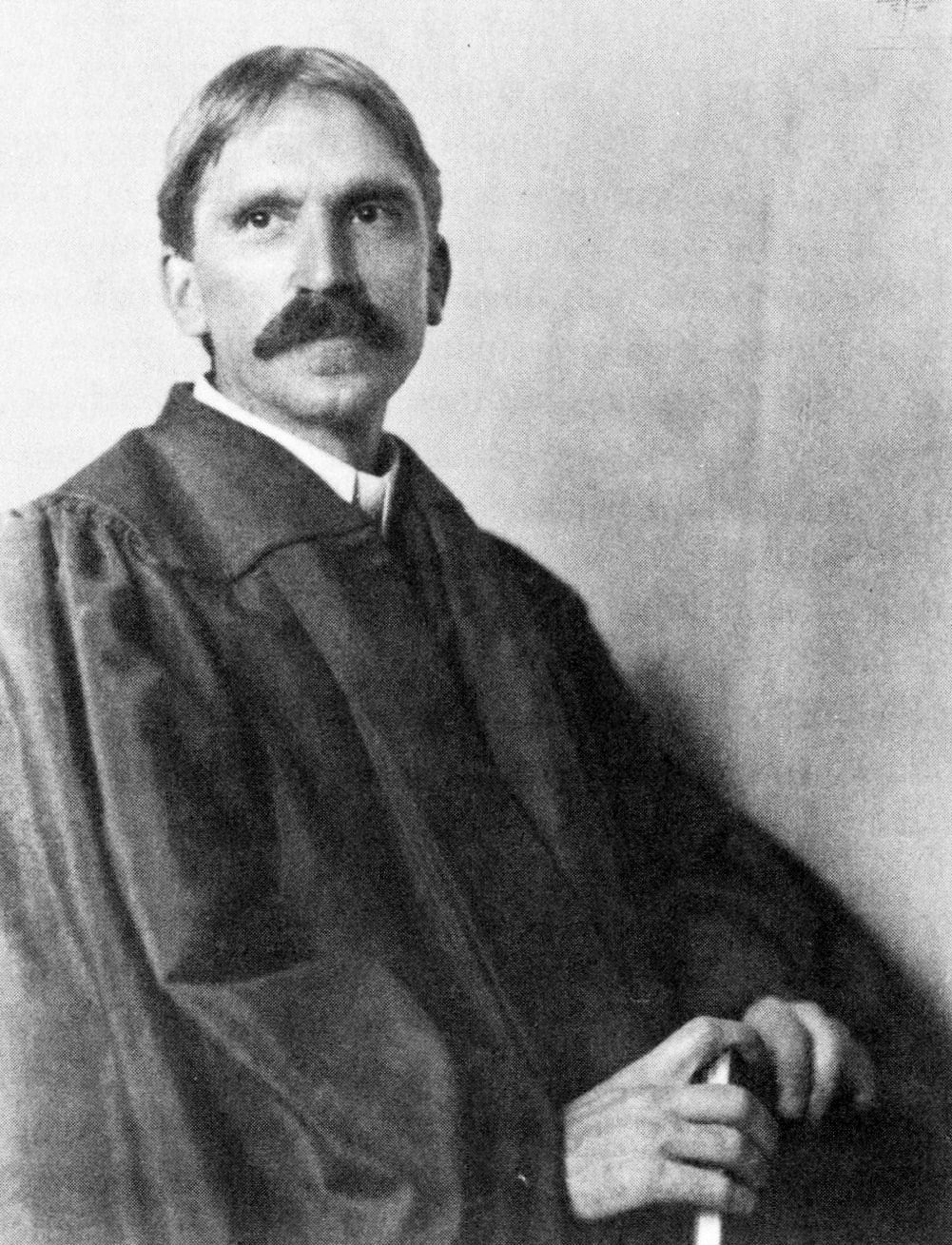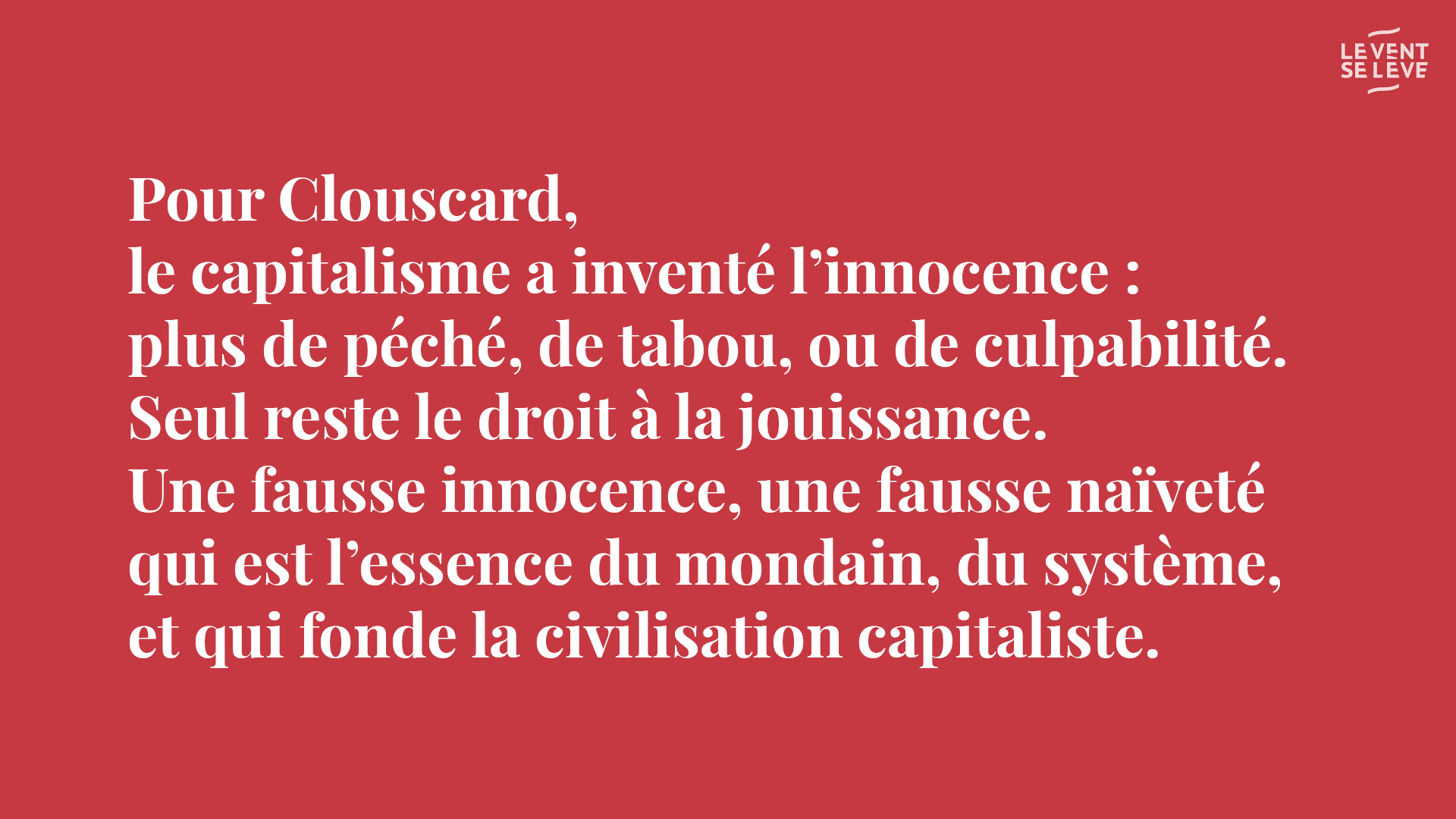L’un des textes essentiels du linguiste Noam Chomsky, La responsabilité des intellectuels (1967), vient de paraître aux éditions Agone. Enrichi d’une préface de l’auteur et d’une partie complémentaire (2017), cet inédit en français, traduit par Laure Mistral, est rédigé pendant la guerre du Viêt Nam. Il dénonce notamment l’impérialisme américain, à travers une critique des intellectuels qui n’ont pas hésité à soutenir et à justifier la politique anticommuniste des États-Unis. Toutefois, plus qu’une pièce de circonstance, c’est aussi l’occasion pour Noam Chomsky de diagnostiquer la mise au pas progressive des intellectuels, qui n’ont guère plus d’intérêts à la « transformation radicale de la société ». Au contraire, c’est désormais l’adaptation à l’ordre existant qui légitime la parole des nouveaux savants-experts, dont les discours se confondent avec la langue du pouvoir. Extraits.
Qu’est-ce qu’un intellectuel ?
Extrait de la préface (2017)
C’est lors de l’affaire Dreyfus qu’est apparu le concept d’« intellectuel », au sens contemporain du terme, et qui renvoie à des catégories devenues aujourd’hui des classiques. La figure de proue des dreyfusards, Émile Zola, fut condamné à un an de prison pour l’infamie d’avoir demandé justice pour le colonel Alfred Dreyfus accusé à tort de trahison. Zola dut même s’enfuir en Angleterre pour échapper à une nouvelle sanction, et il subit les foudres des « Immortels » de l’Académie française. C’est que les dreyfusards étaient de véritables « forcenés en coulisses », coupables d’« une des plus ridicules excentricités de notre temps », selon les termes de l’académicien Ferdinand Brunetière : « La prétention d’élever des écrivains, des savants, des professeurs et des philologues au rang de surhommes », qui osent « qualifier nos généraux d’idiots, nos institutions d’absurdes et nos traditions de malsaines ». Ils prétendaient s’immiscer dans des affaires judicieusement laissées aux « experts », aux « hommes responsables », aux « intellectuels technocrates et politiques » – selon la terminologie du discours libéral contemporain.
Alors, quelle est la responsabilité des intellectuels ? Ils ont toujours le choix entre deux rôles. Dans les États ennemis des États-Unis, c’est être commissaires du peuple ou dissidents. Dans les États clients des États-Unis, il peut se révéler d’une difficulté écrasante. Au pays, c’est être des « experts responsables » ou des « forcenés en coulisses ».
Et puis, il y a toujours le choix de suivre le bon conseil de [Dwight] Macdonald : « C’est une grande chose que d’arriver à voir ce qu’on a sous le nez » – et d’avoir la simple honnêteté de dire les choses telles qu’elles sont.
Extrait de la Partie I. De la responsabilité des intellectuels (1967)
En 1945, Dwight Macdonald publia dans Politics une série d’articles sur la responsabilité des populations et, plus précisément, sur celle des intellectuels. Je les ai lus quand j’étais étudiant, dans les années d’après-guerre, et j’ai eu l’occasion de les relire vingt ans plus tard. Ils me semblaient n’avoir rien perdu de leur puissance ni de leur force de persuasion. Macdonald s’intéresse à la culpabilité de la guerre. Il pose la question suivante : dans quelle mesure les peuples allemand ou japonais étaient-ils responsables des atrocités commises par leurs gouvernements ? Et, à bon droit, il nous renvoie la question : dans quelle mesure les peuples britannique ou américain sont-ils responsables des odieux bombardements terroristes de civils, une technique de guerre développée par les démocraties occidentales qui atteignit son summum avec Hiroshima et Nagasaki, certainement un des crimes les plus abominables de l’histoire. Pour un étudiant de premier cycle en 1945-1946 – pour quiconque dont la conscience politique et morale s’était forgée face aux horreurs des années 1930 : la guerre en Éthiopie, les purges soviétiques, l’« incident du pont de Lugou »1, la guerre civile espagnole ou les atrocités nazies, la réaction de l’Occident à ces événements et sa complicité active dans certains cas –, ces questions se posaient avec une force et une intensité particulières.
La démocratie occidentale offre le loisir, les infrastructures et la formation nécessaires pour rechercher la vérité qui se cache derrière le voile de distorsion et d’altération, d’idéologie et d’intérêt de classe à travers lequel les événements de l’histoire en cours nous sont présentés.
Concernant la responsabilité des intellectuels, il y a d’autres questions, tout aussi dérangeantes. Les intellectuels sont en position de dénoncer les mensonges des gouvernements, d’analyser les actes à partir de leurs causes, de leurs motivations, et des intentions, souvent occultes, de leurs auteurs. Dans le monde occidental, du moins, ils ont le pouvoir qui découle de la liberté politique, de l’accès à l’information et de la liberté d’expression. À cette minorité privilégiée, la démocratie occidentale offre le loisir, les infrastructures et la formation nécessaires pour rechercher la vérité qui se cache derrière le voile de distorsion et d’altération, d’idéologie et d’intérêt de classe à travers lequel les événements de l’histoire en cours nous sont présentés. Étant donné les privilèges uniques dont jouissent les intellectuels, leurs responsabilités sont bien plus étendues que ce que Macdonald appelle la « responsabilité de la population ».
Les questions posées par Macdonald sont aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut difficilement éviter de se demander dans quelle mesure le peuple américain est responsable de l’impitoyable attaque américaine contre la population rurale, pratiquement sans défense, du Viêt Nam – une autre atrocité de ce que les Asiatiques appellent l’« Ère Vasco da Gama »2 de l’histoire mondiale. Quant à ceux d’entre nous qui sont restés silencieux et apathiques alors que cette catastrophe prenait lentement forme au fil des ans, dans quelle page de l’histoire trouveront-ils leur place ? Seuls les plus indifférents peuvent faire la sourde oreille à ces questions. J’y reviendrai plus tard, après quelques remarques rapides sur la responsabilité des intellectuels et la manière dont ils l’ont assumée au milieu des années 1960.
Les intellectuels face à la guerre du Viêt Nam
Revenons toutefois à la guerre du Viêt Nam et à la réaction qu’elle a suscitée chez les intellectuels américains. Une des caractéristiques frappantes du débat sur la politique de l’Asie du Sud-Est dans les années 1960, c’est la distinction communément établie entre, d’une part la « critique responsable » et, d’autre part la critique « sentimentale », « à fleur de peau » ou « hystérique ». Il est particulièrement instructif d’étudier les termes dans lesquels cette distinction est établie. Apparemment, on reconnaît les « critiques hystériques » à leur refus irrationnel d’accepter un axiome politique fondamental, à savoir que les États-Unis ont le droit d’étendre leur pouvoir et leur contrôle dans les seules limites du possible. Une critique responsable ne remet pas en cause ce postulat, et elle estimera éventuellement que nous ne pouvons sans doute pas « nous en tirer » à un moment et en un lieu donnés.
C’est ce genre de distinction qu’un Irving Kristol semble avoir à l’esprit quand il analyse la contestation de la politique vietnamienne. Il oppose les critiques responsables comme le Times, le sénateur Fulbright et Walter Lippmann au « mouvement des teach-in »3. « Contrairement aux contestataires des universités, souligne-t-il, M. Lippmann ne s’engage pas dans des spéculations présomptueuses sur “ce que le peuple vietnamien veut vraiment” [visiblement, il s’en moque], ni dans une exégèse légaliste pour savoir si, ou dans quelle mesure, il y a “agression” ou “révolution” au Sud-Viêt Nam. Il adopte le point de vue de la realpolitik. Et il va apparemment jusqu’à envisager la possibilité d’une guerre nucléaire contre la Chine dans des circonstances extrêmes. »
Voilà qui est digne d’éloges, contrairement aux discours des « idéologues inconséquents » du mouvement des teach-in qui, au nom d’un « “anti-impérialisme” sobre et vertueux » et autres absurdités, se lancent dans des « diatribes contre “la structure du pouvoir” » et s’abaissent même, parfois, au point de lire « des articles et des comptes rendus de la presse étrangère sur la présence américaine au Viêt Nam ». De plus, ces sales types sont souvent des psychologues, des mathématiciens, des chimistes ou des philosophes – tout comme, d’ailleurs, ceux qui protestent le plus en Union soviétique sont dans l’ensemble des physiciens, des écrivains et autres personnes éloignées de l’exercice du pouvoir –, et non des citoyens bien introduits à Washington, qui naturellement ont tout à fait conscience que, « s’ils avaient une nouvelle idée géniale sur le Viêt Nam, ils trouveraient aussitôt une oreille attentive » auprès du gouvernement.
[…]
Il pourrait être utile d’étudier de près les « nouvelles idées géniales sur le Viêt Nam » auxquelles Washington a « aussitôt prêté une oreille attentive ». L’U.S. Government Printing Office est une mine d’informations sur le haut degré de moralité et de discernement de ces avis d’experts. On peut lire dans une de ses publications une communication du professeur David N. Rowe, directeur des études supérieures en relations internationales à Yale University, devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Le professeur Rowe a proposé que les États-Unis achètent tous les excédents de blé canadien et australien afin de provoquer une famine massive en Chine. Selon ses mots : « Attention, il ne s’agit pas d’en faire une arme dont le peuple chinois aurait à pâtir. De fait, ce sera le cas, mais c’est secondaire. Ce sera avant tout une arme contre un gouvernement autoritaire, qui ne pourra maintenir la stabilité du pays face à une famine généralisée. »
On ne trouvera pas trace chez le professeur Rowe de ce moralisme sentimental qui pourrait appeler une comparaison avec, par exemple, l’Ostpolitik de l’Allemagne hitlérienne4. Il ne craint pas non plus les répercussions de telles mesures sur d’autres pays asiatiques comme le Japon. Sa « très longue fréquentation des questions japonaises » lui permet d’affirmer que « les Japonais sont avant tout des gens qui respectent le pouvoir et la fermeté ». Par conséquent, « ils ne vont pas trop s’effaroucher d’une politique américaine au Viêt Nam qui, partant d’une position de force, vise une solution consistant à soumettre par notre puissance militaire des populations locales avec lesquelles nous sommes en désaccord ». Ce qui troublerait les Japonais, c’est « une politique indécise, une politique qui refuserait de s’attaquer aux problèmes [en Chine et au Viêt Nam] et d’assumer nos responsabilités là-bas d’une manière qui soit constructive » – comme celle que nous venons de citer. Ce qui pourrait « vivement inquiéter le peuple japonais et remettre en cause la bonne intelligence entre nos deux pays », ce serait d’« hésiter à faire usage d’un pouvoir qu’ils savent entre nos mains ». En réalité, un déploiement de toute notre puissance militaire serait même éminemment rassurant pour eux, dans la mesure où ils ont eu la démonstration « de la formidable force de frappe des États-Unis, […] et en ont fait eux-mêmes l’expérience ». Voilà sûrement un parfait exemple du salutaire « point de vue de la realpolitik » qu’Irving Kristol admire tant.
Mais, pourrait-on se demander, pourquoi se limiter à des moyens aussi indirects que la famine de masse ? Autant bombarder ! À n’en pas douter, c’est le message qu’a tenté de faire passer à la même commission le révérend Raymond J. de Jaegher.
Mais, pourrait-on se demander, pourquoi se limiter à des moyens aussi indirects que la famine de masse ? Autant bombarder ! À n’en pas douter, c’est le message qu’a tenté de faire passer à la même commission le révérend Raymond J. de Jaegher, membre du conseil d’administration de l’Institut d’études extrême-orientales à la Seton Hall University. Selon lui, comme tous les peuples qui ont vécu sous le communisme, les Nord-Vietnamiens « seraient tout à fait ravis qu’on les bombarde pour les libérer ».
Évidemment, il doit bien y avoir des Vietnamiens qui soutiennent les communistes. Mais c’est là une question vraiment secondaire, comme le souligne l’honorable Walter Robertson, qui fut secrétaire d’État adjoint pour l’Extrême-Orient de 1953 à 1959. Si l’on en croit ses déclarations devant la même commission, « le régime de Peiping5 […] représente quelque chose comme moins de 3 % de la population ».
C’est dire si les dirigeants communistes chinois ont de la chance ! Selon Arthur Goldberg, les dirigeants du Vietcong, eux, ne représentent qu’environ « 0,5 % de la population du Sud-Viêt Nam », soit à peu près la moitié des nouvelles recrues du Sud pour le Vietcong en 1965, si l’on se fie aux statistiques du Pentagone. Goldberg poursuit en affirmant que les États-Unis ne sont pas certains que tous ces gens-là soient des adhérents volontaires. Ce ne serait pas la première démonstration de la duplicité communiste. Un autre exemple a été observé en 1962, lorsque, selon des sources du gouvernement américain, 15 000 guérilleros ont subi 30 000 pertes. Face à des experts comme ceux-là, les scientifiques et les philosophes dont parle Kristol feraient bien de continuer à tracer leurs cercles dans le sable.
Ayant réglé la question de la non-pertinence politique du mouvement de contestation, Kristol se tourne vers celle de ses motivations – plus généralement, ce qui a poussé, selon lui, des étudiants et de jeunes professeurs d’université à « virer à gauche » dans un contexte de prospérité générale et un régime politique libéral de type État-providence. C’est là, note-t-il, « une énigme à laquelle aucun sociologue n’a encore trouvé de réponse ». Puisque ces jeunes gens ont de l’argent, un bel avenir devant eux, etc., leur contestation est forcément irrationnelle. Ce doit être le résultat de l’ennui, d’une trop grande sécurité, ou quelque chose dans ce goût-là.
D’autres hypothèses viennent à l’esprit. Il se pourrait, par exemple, qu’en toute honnêteté ces étudiants et ces jeunes professeurs cherchent à découvrir la vérité par eux-mêmes plutôt que de déléguer toute la responsabilité aux « experts » ou au gouvernement ; et il se pourrait qu’ils réagissent avec indignation à ce qu’ils découvrent.
De l’intellectuel au « savant-expert »
Ce qui doit nous importer au premier chef dans cette réflexion sur la responsabilité des intellectuels, c’est leur rôle dans la production et l’analyse de l’idéologie. Et, de fait, l’opposition que Kristol établit entre les idéologues déraisonnables et les experts responsables est formulée en des termes qui font aussitôt penser à l’intéressant essai de Daniel Bell, La Fin de l’idéologie, aussi important pour ce qu’il ne dit pas que pour son contenu proprement dit6.
Bell présente et examine l’analyse marxiste qui voit dans l’idéologie un moyen de masquer l’intérêt de classe, selon la célèbre formule de Marx : la bourgeoisie est persuadée que « les conditions particulières de son émancipation sont les conditions générales en dehors desquelles la société moderne ne peut être sauvée et la lutte des classes évitée ». Bell soutient ensuite que l’ère de l’idéologie est terminée, supplantée – du moins en Occident – par un consensus selon lequel chaque question doit être réglée selon les modalités qui lui sont propres, dans le cadre d’un État-providence où les experts en conduite des affaires publiques sont voués à jouer un rôle prépondérant. Bell prend soin, cependant, de préciser le sens d’« idéologie » dans ce qu’il appelle l’« épuisement des idéologies ». Il ne se réfère à l’idéologie qu’au sens de « conversion d’idées en leviers sociaux », d’« ensemble de croyances, animé par la passion, et [qui] cherche à transformer la totalité d’un mode de vie ». Les termes clés sont « transformer » et « convertir en leviers sociaux ». Selon lui, les intellectuels occidentaux se sont désintéressés de la conversion des idées en leviers sociaux en vue d’une transformation radicale de la société. Maintenant que nous avons atteint la société pluraliste de l’État-providence, ils ne voient plus la nécessité d’une transformation radicale de la société ; nous pouvons sans doute aménager de-ci, de-là notre mode de vie, mais ce serait une erreur que d’essayer de le modifier en profondeur. C’est ce consensus des intellectuels qui fait que l’idéologie est morte.
[Bell] ne mentionne pas à quel point ce consensus des intellectuels sert leurs propres intérêts.
Il y a plusieurs points qui interrogent dans l’essai de Bell. Tout d’abord, il ne mentionne pas à quel point ce consensus des intellectuels sert leurs propres intérêts. Il n’établit pas de lien entre son observation – selon laquelle, dans l’ensemble, les intellectuels n’ont plus à cœur de « transformer l’ensemble d’un mode de vie » – et le fait qu’ils jouent un rôle de plus en plus important dans la gestion de l’État-providence. Il n’établit pas non plus de lien entre leur acceptation de ce type d’État et le fait que, comme il l’observe ailleurs, « l’Amérique est devenue une société d’abondance, offrant position […] et prestige […] aux anciens radicaux ». Ensuite, il n’apporte aucun argument sérieux montrant que les intellectuels ont « raison » ou « objectivement le droit » de rechercher ce consensus hostile à l’idée d’une transformation de la société. En effet, bien que Bell n’ait pas de mots assez durs sur la rhétorique vide de la « Nouvelle Gauche »7, il semble avoir une confiance bien utopique dans la capacité des experts techniques à régler les quelques petits problèmes qui continuent de se poser. Ainsi, le fait de traiter le travail comme une marchandise ou les problèmes d’« aliénation ».
Il semble assez évident que les problèmes classiques sont encore et toujours d’actualité. On pourrait même affirmer sans prendre trop de risques qu’ils ont gagné en ampleur et en gravité. Par exemple, le paradoxe ancestral de la pauvreté au sein de l’abondance prend des dimensions de plus en plus alarmantes à l’échelle internationale. Mais l’inconvénient du consensus intellectuel décrit par Bell est que, s’il semble possible, du moins en théorie, d’envisager une solution au niveau national, il n’y a guère de chances de voir un jour émerger un projet cohérent de transformation de la société au niveau mondial pour faire face à l’accroissement de la misère. Cela nous conduit tout naturellement à décrire le consensus des intellectuels selon Bell en des termes quelque peu différents des siens.
En reprenant la terminologie de la première partie de son essai, on pourrait dire que le technicien de l’État-providence trouve la justification de son statut social particulier et privilégié dans sa « science », plus précisément dans l’affirmation que les sciences sociales peuvent soutenir une technologie de bricolage social à l’échelle nationale ou internationale. Il passe ensuite à l’étape suivante, qui est d’attribuer une validité universelle à ce qui n’est qu’un intérêt de classe : il affirme que les conditions particulières sur lesquelles se fonde la prétention au pouvoir et à l’autorité de l’intellectuel sont, en fait, les conditions générales en dehors desquelles la société moderne ne peut être sauvée ; que le bricolage social dans le cadre de l’État-providence doit remplacer l’engagement dans les « idéologies totales » du passé, idéologies qui visaient la transformation de la société. Parvenu à une position de pouvoir qui offre à ses intellectuels aisance et sécurité, l’État-providence n’a plus besoin d’idéologies qui prétendent à un changement radical. Le savant-expert remplace l’« intellectuel libre », pour qui « les mauvaises valeurs étaient à l’honneur, qui rejetait la société » et qui a perdu son rôle politique – maintenant que les bonnes valeurs sont à l’honneur.
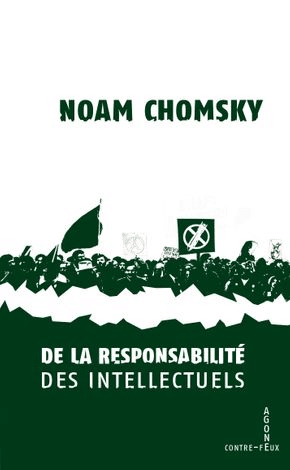
[…]
On serait tenté de conclure qu’il y a une sorte de consensus au sein des intellectuels qui ont pu accéder à l’aisance et au pouvoir – ou se croient en passe d’y accéder – en « acceptant la société » telle qu’elle est et en défendant ses valeurs. C’est encore plus vrai des savants-experts qui remplacent les intellectuels libres de jadis.
Pour lire la suite et commander le livre, rendez-vous sur le site des éditions Agone.
[1] Cet affrontement, près de Pékin, entre soldats japonais et chinois, marque le début de la seconde guerre sino-japonaise (1937-1945). [ndt]
[2] Les auteurs de cette formule considèrent les voyages de Vasco de Gama, ainsi que ceux de Fernand de Magellan et de Christophe Colomb, comme le début de cinq cents ans d’ascendant de l’Occident sur l’Orient. [ndt]
[3] Ces teach-in sont des forums constitués de débats, conférences, projections de films et concerts organisés à partir de 1965 par les étudiants pour protester contre l’intervention américaine au Viêt Nam. Sur Walter Lippmann (1889-1974), lire infra. [ndt]
[4] Bien que, par souci des proportions, il faut avoir à l’esprit que, dans ses pires moments de folie, le théoricien et ministre du Reich nazi Alfred Rosenberg parlait d’éliminer trente millions de Slaves et non d’imposer une famine de masse à un quart de la population mondiale. Soit dit en passant, l’analogie établie ici est hautement « irresponsable », au sens technique de ce néologisme discuté précédemment, parce qu’elle est fondée sur l’hypothèse que les déclarations et les actions des Américains sont soumises aux mêmes normes et ouvertes aux mêmes interprétations que celles de n’importe qui.
[5] En 1928, le généralissime nationaliste et anticommuniste Tchang Kai-chek changea le nom de Beijing (Pékin) en Peiping. Cette appellation se maintint durant l’occupation japonaise (1937-1945). La ville reprit officiellement le nom de Beijing lorsque la République populaire de Chine fut proclamée, le 27 septembre 1949. [ndt]
[6] Je n’ai pas l’intention d’aborder ici toutes les questions soulevées depuis douze ans dans le débat sur la « fin de l’idéologie ». Une personne douée de raison pourrait difficilement contester nombre des thèses avancées : par exemple, qu’à un certain moment de l’histoire une « politique de la civilité » peut se montrer judicieuse et même efficace ; que celui qui préconise l’action (ou l’inaction) a la responsabilité d’en évaluer le coût social ; que le fanatisme dogmatique et les « religions séculaires » devraient être combattus (ou, si possible, ignorés) ; qu’il faudrait appliquer des solutions techniques là où c’est possible ; que « le dogmatisme idéologique devait disparaître pour que les idées reprissent vie* » (Raymond Aron) ; et ainsi de suite. Comme tout cela est parfois considéré comme l’expression d’une position « antimarxiste », il convient de garder à l’esprit que ces opinions-là n’ont aucun rapport avec le marxisme non bolchevique, tel qu’il est représenté, par exemple, par des personnalités comme Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek, Karl Korsch, Arthur Rosenberg, etc.
[7] Née de la révolte étudiante des années 1960 aux États-Unis, la New Left rejetait les principes de la « vieille gauche » des années 1930, notamment dominée par le parti communiste. Les activistes s’organisaient autour des libertés (politiques) des étudiants, des droits civiques des Noirs et de la paix en Asie, valorisaient la spontanéité et voulaient donner le pouvoir à la « base ». « Le “radicalisme” n’est pas l’affaire d’une élite chargée de diriger la conscience politique du peuple mais le problème des masses qui mènent elles-mêmes la lutte contre l’oppression. » On substituait l’action directe (violente et non violente) à la stratégie parlementaire 1. [ndt]