Depuis le 17 novembre, l’histoire s’écrit sous nos yeux. Il s’agit d’une de ces dates qui font l’histoire, tant les événements qu’elles ont vu advenir affectent les contemporains qui les ont vécus, et déterminent de manière décisive leurs actions futures.
Depuis plusieurs semaines, les routes de France et les rues de Paris sont le théâtre d’une mobilisation remarquable à la fois par sa spontanéité et par son ampleur. Nombreux étaient les acteurs politisés de gauche en France à faire preuve de circonspection à l’annonce de ces mobilisations, parfois jusqu’à l’excès, tant les acteurs politisés de droite semblaient déjà en avoir fait leurs choux gras. Beaucoup de choses ont été écrites sur la nature de ces mobilisations, et nous savons déjà que nous ne savons pas grand chose concernant ce mouvement, ou plutôt que nous ne sommes sûrs de rien. Nous savons qu’il a mobilisé spontanément, et en dehors de toute médiation politique, des centaines de milliers de personnes. Nous savons que le prix de l’essence n’est pas, n’est plus, la raison d’être de ce mouvement qui a déjà étendu son champ de revendications de façon impressionnante, jusqu’à n’en laisser audible que l’unique revendication commune « Macron démission ». Nous savons que ce mouvement est dès lors sans contour, sans limite, flou, qu’il émane du corps social de la façon la plus brute qui soit et pour des motifs les plus concrets et ordinaires. Ces trois derniers samedis nous ont donné à voir la colère de cette « France d’en bas »1, cette France moyenne, diverse, périphérique, spontanément réunie… Mais pour être plus exact, et saisir le moment historique que nous vivons, peut-être ne devrait-on pas vraiment parler d’une multitude spontanée : les gilets jaunes ne sont pas tant un mouvement issu d’une France spontanée, que d’une France affectée.
L’ILLUSION DE LA RAISON
Sans prétendre expliciter tous les tenants et les aboutissants d’un tel mouvement populaire, il est nécessaire de tenter d’en proposer une lecture qui permette d’en tirer des conclusions politiques et, en définitive, d’agir. L’une des réalités qu’il nous faut accepter, malgré son caractère si brutalement opposé aux certitudes morales de notre époque, est que les individus agissent d’abord sous le coup des affects et non sous celui de la raison. Les citoyens présents dans les rues depuis le samedi 17 novembre n’agissent pas sous le coup d’une impérieuse rationalité d’homo economicus qui les enjoindrait à s’insurger contre la baisse mathématique de leur pouvoir d’achat. Ils agissent davantage par colère, par tristesse ou par peur.
L’ère moderne est philosophiquement inaugurée par ce vaste et long courant philosophique dit des « Lumières ». Un courant tout à fait hétérogène regroupant des philosophes qui s’opposent parfois très nettement. Mais tous ces philosophes ont en commun de construire une pensée qui rompt avec l’ordre ancien et qui entend constituer un paradigme nouveau, humaniste, révolutionnant des concepts tels que l’individu, les droits naturels, la souveraineté, etc. Et l’on peut ainsi distinguer deux grandes tendances parmi les Lumières : les Lumières « libérales » d’une part, qui construisent leur paradigme philosophique autour de l’individu, d’une conception naturelle de la liberté, et qui conçoivent une concurrence entre les libertés individuelles et l’ordre collectif ; et les Lumières que l’on pourrait qualifier de « républicaines » d’autre part, dont le paradigme philosophique repose sur le social, qui conçoivent l’individu d’abord comme citoyen faisant partie intégrante d’un tout, et la liberté comme un bien à construire. Spinoza, notamment, se retrouve dans la deuxième catégorie, le caractère original de sa pensée s’oppose, à l’époque, au libéralisme classique naissant.
Spinoza postule que cette unité du corps et de l’esprit amène à déduire une unité des idées et des affects, toute idée est le résultat d’une affection du corps.
La philosophie de Spinoza constitue une approche inédite de la condition humaine en postulant tout d’abord l’unité entre le corps et l’esprit. « L’objet de l’idée constituant l’Esprit humain est le Corps, c’est-à-dire un certain mode de l’Étendue existant en acte et n’est rien d’autre. »2
-

Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle
Selon Spinoza l’esprit n’est pas distinct du corps et ne commande pas le corps, il n’est rien d’autre que la conscience plus ou moins claire que le corps a de lui même.
Spinoza postule que cette unité du corps et de l’esprit amène à déduire une unité des idées et des affects, toute idée est le résultat d’une affection du corps. Pour comprendre le mécanisme que décrit Spinoza il faut bien faire la distinction entre « affection » et « affect ». Une affection désigne uniquement une affection du corps, soit une modification de ce dernier par un autre corps qui exerce sur lui une action et qui, par là, augmentera ou diminuera sa puissance, sa capacité d’agir. Par exemple, si je consomme un aliment au goût agréable et qui apaise ma faim, mon corps s’en retrouvera positivement affecté, par diminution de la faim et augmentation de sa force. L’affection positive qu’a produit cet aliment sur mon corps va amener mon esprit à concevoir une idée positive de cet aliment, sous la forme d’un affect que l’on peut qualifier d’amour pour cet aliment.
C’est à partir de ce mécanisme fondamental que Spinoza développe ses conceptions de la liberté et de la condition humaine, soit du point de vue du corps, déterminé par des causes extérieures.
DU DOUTE A LA REVOLTE
Ce détour théorique paraît complexe et peut bousculer certains de nos présupposés, mais il s’avère très utile pour éclairer les événements actuels. L’Histoire, en effet, n’est pas constituée d’événements qui surgiraient comme autant de coups de théâtre, et viendraient ponctuer la grande pièce que joue l’Humanité depuis des milliers d’années. Marx aimait dire « ce sont les hommes qui font l’Histoire mais ils ne savent pas l’Histoire qu’ils font ». L’Humanité joue sans en connaître le texte la grande pièce de l’Histoire, dont elle est pourtant l’auteure.
L’autorité et l’ordre que cette première entretient ne peuvent se maintenir légitimement que par le consentement de la multitude sur laquelle ils agissent.
Il existe des événements, peut-être en apparence anodins dans la grande fresque du temps humain, qui surgissent et font basculer l’Histoire dans un nouveau chapitre. Cette conséquence est due à un phénomène de cristallisation qui s’opère autour d’un tel événement, par le prisme duquel une série de repères, de mémoires, de passions et d’affects se rencontrent en un même point. Un point de convergence, donc, qui donne sens à des doutes, des intuitions et des incertitudes. Un point de basculement, mais un basculement avant tout dans l’esprit des hommes et, donc, un basculement en conséquence dans le cours de l’histoire. C’est ce que nous permet de comprendre Spinoza et c’est ce que nous appelle à comprendre le philosophe spinoziste Frédéric Lordon, figure de la gauche radicale depuis quelques années3.
-

Frédéric Lordon, chercheur au CNRS et philosophe spinoziste
L’autorité, et l’ordre social que cette dernière met en place, ne peuvent se maintenir légitimement que par le consentement de la multitude sur laquelle ils agissent. Ce consentement ne s’obtient que par l’entretien d’affects positifs à l’égard de l’ordre dominant. Notre esprit est tel une balance affective déterminant nos actions : la multitude ne remettra pas en cause l’ordre dominant tant que la balance affective de la plupart des individus la composant ne se trouvera pas inversée, et ne les amènera pas à considérer comme davantage désirable d’abolir l’ordre dominant que de le conserver. Cette conversion de la multitude se déroule par un lent processus d’affection mutuelle entre les individus qui la composent. Les plus directement affectés par la domination en place seront les premiers à connaître le basculement de leurs désirs, et les autres individus, capables de compassion, se verront progressivement affectés à leur tour jusqu’au lent basculement de leurs désirs. D’abord naîtra la pitié, puis le doute, puis l’indignation et la révolte. Dans une société sur le chemin du basculement, le moindre événement peut amener du doute à la révolte.
LE POINT POTEMKINE
Frédéric Lordon aime nommer ce moment « le point Potemkine »4, en référence à la révolte des marins du cuirassé Potemkine, en 1905, mise en scène dans le célèbre film du cinéaste russe Sergueï Eisenstein.
-

Affiche du “Cuirassé Potemkine”, Einsenstein 1925 © Goskino Films
Dans ce film de 1925, une scène retient l’attention du philosophe. Les marins du cuirassés s’indignent des conditions dans lesquelles ils vivent et les plus vaillants d’entre eux se confrontent au capitaine, lui mettant sous les yeux la viande avariée, infestée de vers, qu’ils ont pour seul repas. Le capitaine, incarnation de l’ordre et de la hiérarchie en place, se refuse à reconnaître la réalité de leur condition et tente de les convaincre que cette viande impropre à la consommation est excellente et bonne pour eux. La dissonance se créée alors entre leur constat du réel (la viande est avariée) et le discours de l’incarnation de l’ordre (la viande est bonne). C’est ce moment de dissonance que nous pouvons appeler le « Point Potemkine », avec une dissonance qui pousse les individus à la remise en question de leurs affects. Ici, c’est la confiance envers la hiérarchie qui est mise en cause, appelant le doute. Si le doute naît chez l’un des individus du collectif et se transmet d’individu à individu par affection mutuelle, il peut ainsi faire naître le sentiment de révolte contre l’ordre régnant devenu illégitime.
Lorsque Louis Capet fut ramené à Paris le 23 juin 1792, son peuple avait compris. Compris qu’il avait plus à gagner dans la destruction de l’ordre dominant que dans sa préservation.
Ce genre d’événements de basculement, ce genre de « Point Potemkine », est relativement courant dans l’histoire. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 une berline lourdement chargée quittait la cité parisienne encore fébrile de plusieurs mois révolutionnaires. A bord de ce convoi inhabituel se trouvait Louis Capet, Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine et leurs deux enfants, tentant de fuir vers la frontière pour retrouver des forces armées qui reprendraient ensuite Paris et mettraient à bas les premiers pas révolutionnaires accomplis depuis 1789. L’histoire, nous la connaissons. La fuite fut un échec, Louis Capet et sa famille firent leur retour à Paris dans un silence de mort. Le 10 août 1792, les Tuileries furent prises d’assaut par les révolutionnaires, le 21 septembre, la République fut proclamée et, le 21 janvier 1793, Louis vit sa tête tomber.
-

The arrest of Louis XVI and his family at the house of the registrar of passports, at Varennes in June, 1791, Thomas Falcon Marshall ,1854
Cet événement, connu sous le nom de la fuite de Varennes, fut pour le peuple de France un « point Potemkine ». Lorsque Louis Capet fut ramené à Paris le 23 juin 1792, son peuple avait compris. Compris qu’il avait plus a gagner dans la destruction de l’ordre dominant que dans sa préservation. En voyant ce monarque traître revenir dans la capitale, le peuple comprit qu’il n’avait plus à faire à son protecteur mais à un bourreau. Le peuple saisit la portée de siècles de dominations, de privilèges, d’oppression, de mensonges et réalisa, dans un mélange probable de colère froide et de désespoir brûlant, que ce bon roi n’était pas le garant de droit divin du seul ordre possible et souhaitable, mais bien la figure d’un ordre dominant à destituer.
L’une des réactions du peuple de Paris, le mois de juillet suivant la fuite de Varennes, fut de se réunir sur le Champs de Mars afin de rédiger une pétition demandant la déchéance du Roi. Nous connaissons là aussi la suite tragique de l’histoire : l’Assemblée législative nationale, alors largement composée de défenseurs de la monarchie, ordonna la dispersion de la foule par la force. Sans sommation des coups de feu furent tirés et de nombreuses victimes de la répression tombèrent sur le Champs de Mars.
LE POIDS DES AFFECTS COMMUNS
Certes, il peut sembler facile et emphatique d’établir un lien de parenté historique entre les gilets jaunes de 2018 et les sans-culottes de 1791. Mais ce lien n’est pas si fantaisiste, dans la mesure où les uns comme les autres se sont constitués autour d’affects communs. Ce qui différencie la foule d’un peuple, c’est justement cette construction par des affects communs, qui confère à la masse un caractère plus spécifique que la simple addition d’individus, et au mouvement une dimension plus profonde que le caractère éphémère de la spontanéité apparente.
En observant les mobilisations des gilets jaunes, nous observons également l’importance d’affects communs qui signent la construction d’un peuple. Le gilet en lui même, cet objet autrefois symbole du pouvoir gouvernemental à opérer un contrôle sur l’usage de l’automobile et la régulation de la sécurité routière, est aujourd’hui le symbole à la fois de cette révolte et de ce basculement des affects d’un peuple, qui se retourne contre l’autorité de l’Etat et dont il se réapproprie les symboles. Le gilet jaune est le dénominateur commun, avec l’essence, de tous les automobilistes, de toutes celles et ceux contraints par des déplacements quotidiens à parcourir les routes de nos campagnes et des périphéries de nos villes.
En apparence plus cocasses, des signifiants populaires festifs se retrouvent également lors des rassemblements des gilets jaunes. Ainsi, on a vu la chorégraphie des pouces en avant ou encore la chenille qui redémarre, animer les blocages de ronds-points. Il n’est pas anodin que ces danses, typique des fêtes et célébrations populaires en France depuis de nombreuses années, se retrouvent au milieu d’un mouvement de révolte d’un peuple, à l’instar du bal-musette qui investissait les usines lors des grandes grèves de 1936.
Le peuple révolutionnaire qui se construit sous nos yeux n’émerge pas du néant, ne surgit pas de façon spontanée : il est le fruit d’une histoire.
Il est indéniable que de vastes mouvements sociaux, tels que les grèves de 1936 ou les événements de 1968, structurent l’imaginaire des gilets jaunes. De nombreux signifiants historiques et nationaux sont d’ailleurs mobilisés. Les drapeaux tricolores et la Marseillaise, symboles s’il en est de la Révolution française, se donnaient à voir et à entendre lors des dernières manifestation. Il s’agit incontestablement d’un mouvement national, ancré dans une histoire et un héritage. Et le peuple révolutionnaire qui se construit sous nos yeux n’émerge pas du néant, ne surgit pas de façon spontanée, il est le fruit d’une histoire et d’une pratique collective du patrimoine, du territoire, d’infrastructures. Il est le fruit d’une domination commune par une caste et par son Etat. Vécu commun qui s’incarne en autant d’affects, structurant le peuple. Des affects communs négatifs à l’égard de cette caste qui nous domine, et des affects positifs à l’égard de notre patrie, de notre histoire révolutionnaire et de nos concitoyennes et concitoyens en souffrance.
-

©Virginie Cresci
Le mouvement des gilets jaunes est celui d’un peuple qui se construit, dans la colère contre l’injustice, dans la haine des dominants, dans l’empathie envers les dominé.es et dans l’amour du commun. Le théoricien post-marxiste Antonio Gramsci envisage la société comme un bloc historique5 : les Hommes sont soumis à l’influence des circonstances sociales mais eux-mêmes, en retour, sont capables de modifier ces circonstances. « Du passé faisons table rase » n’est donc pas un mot d’ordre gramscien, selon le penseur il est au contraire nécessaire d’absorber de manière critique les apports du passé. Ce passé nourrit les Hommes du présent d’affects communs permettant de structurer les corps sociaux, de construire les identités collectives et ainsi d’agir politiquement, par l’avènement d’un clivage nous/eux.
En définitive, le mouvement des gilets jaunes est ce peuple qui se construit après le basculement. Après ce « point Potemkine », ce point de prise de conscience des illusions qui camouflent les dominations, nous sommes seuls face à la dureté d’un système aliénant et oppressant. La caste aussi se trouve dès lors démunie : les tenants de l’ordre n’ont désormais plus que la force des matraques pour imposer leur réalité. Comme l’a écrit à plusieurs reprises François Ruffin, député de la France insoumise, le président Emmanuel Macron est haï, lui et son monde. Les affects que mobilisait la caste pour soumettre sont aujourd’hui les même par lesquels le peuple se construit et se soulève.
Aujourd’hui, il devient certain que le gouvernement aura beau mentir, négocier, s’incliner ou riposter, cela n’aura plus guère d’importance. L’ordre semble déjà rompu, le basculement s’est produit, et plus jamais les centaines de milliers de gilets jaunes, avec celles et ceux qu’ils représentent, n’accorderont leur consentement à l’autorité d’une caste désavouée. Le gouvernement sera autoritaire ou ne sera plus. De ce constat, nous réalisons que la caste doit chuter pour que le peuple puisse vivre, mais l’unique question qui doit désormais animer nos esprits est la suivante : Quel peuple doit vivre ? Quel peuple pouvons nous construire ? S’ouvre une époque nouvelle et s’ouvre, dans cette vaste clairière, brumeuse et effrayante, la possibilité d’un chemin vers un ordre humaniste, social et écologiste, porté par un peuple (re)naissant.






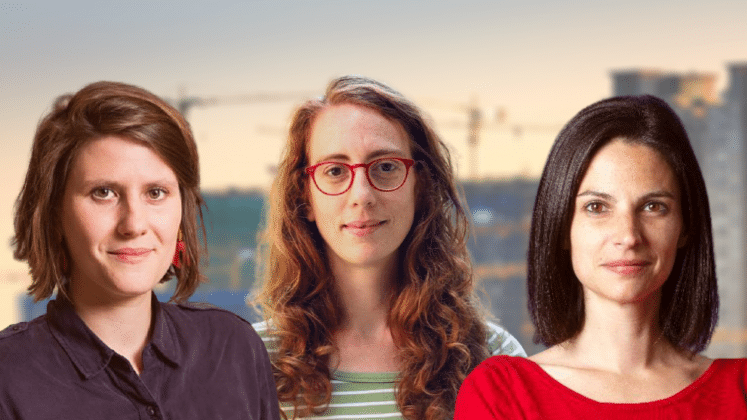




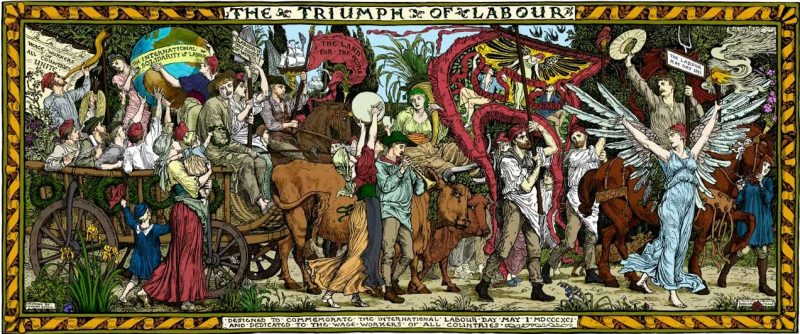




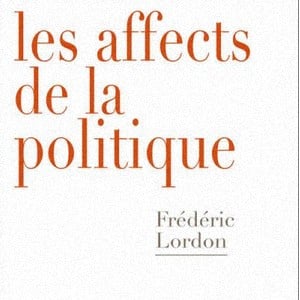 Frédéric Lordon est incontestablement l’un des théoriciens critiques les plus fins et importants de la décennie. Son dernier ouvrage, Les affects de la politique, s’inscrit dans la proposition théorique qu’il nourrit depuis maintenant plusieurs années : construire un structuralisme des passions . L’ambition est de dépasser l’aporie apparente du structuralisme : comment rendre compte des changements historiques, de l’action des individus et de leurs revirements plus ou moins soudains tout en accordant un caractère prépondérant aux structures ? En introduisant à l’équation, explique Lordon, la théorie des affects de Spinoza : « une chose exerce une puissance sur une autre, cette dernière s’en trouve modifiée : affect est le nom de cette modification. » Proposons une illustration. Le régime néolibéral, jusque dans les années 2000, exerce une domination idéologique d’apparence inébranlable. Par l’intermédiaire de l’immense majorité des médias qui lui sont acquis, le capitalisme néolibéral est parvenu à faire passer pour naturelles de pures constructions politiques (« la dette, il faut bien la rembourser ! », bégaient les thuriféraires béats et paresseux de l’ordre dominant) : « Tel est le pouvoir de l’hégémonie, pouvoir de conformer un imaginaire majoritaire, et d’y inscrire sa manière de juger. » (Lordon, 2016, p.135)
Frédéric Lordon est incontestablement l’un des théoriciens critiques les plus fins et importants de la décennie. Son dernier ouvrage, Les affects de la politique, s’inscrit dans la proposition théorique qu’il nourrit depuis maintenant plusieurs années : construire un structuralisme des passions . L’ambition est de dépasser l’aporie apparente du structuralisme : comment rendre compte des changements historiques, de l’action des individus et de leurs revirements plus ou moins soudains tout en accordant un caractère prépondérant aux structures ? En introduisant à l’équation, explique Lordon, la théorie des affects de Spinoza : « une chose exerce une puissance sur une autre, cette dernière s’en trouve modifiée : affect est le nom de cette modification. » Proposons une illustration. Le régime néolibéral, jusque dans les années 2000, exerce une domination idéologique d’apparence inébranlable. Par l’intermédiaire de l’immense majorité des médias qui lui sont acquis, le capitalisme néolibéral est parvenu à faire passer pour naturelles de pures constructions politiques (« la dette, il faut bien la rembourser ! », bégaient les thuriféraires béats et paresseux de l’ordre dominant) : « Tel est le pouvoir de l’hégémonie, pouvoir de conformer un imaginaire majoritaire, et d’y inscrire sa manière de juger. » (Lordon, 2016, p.135)