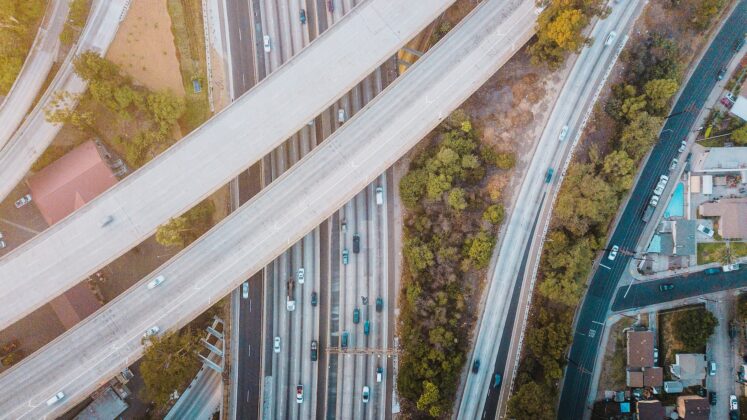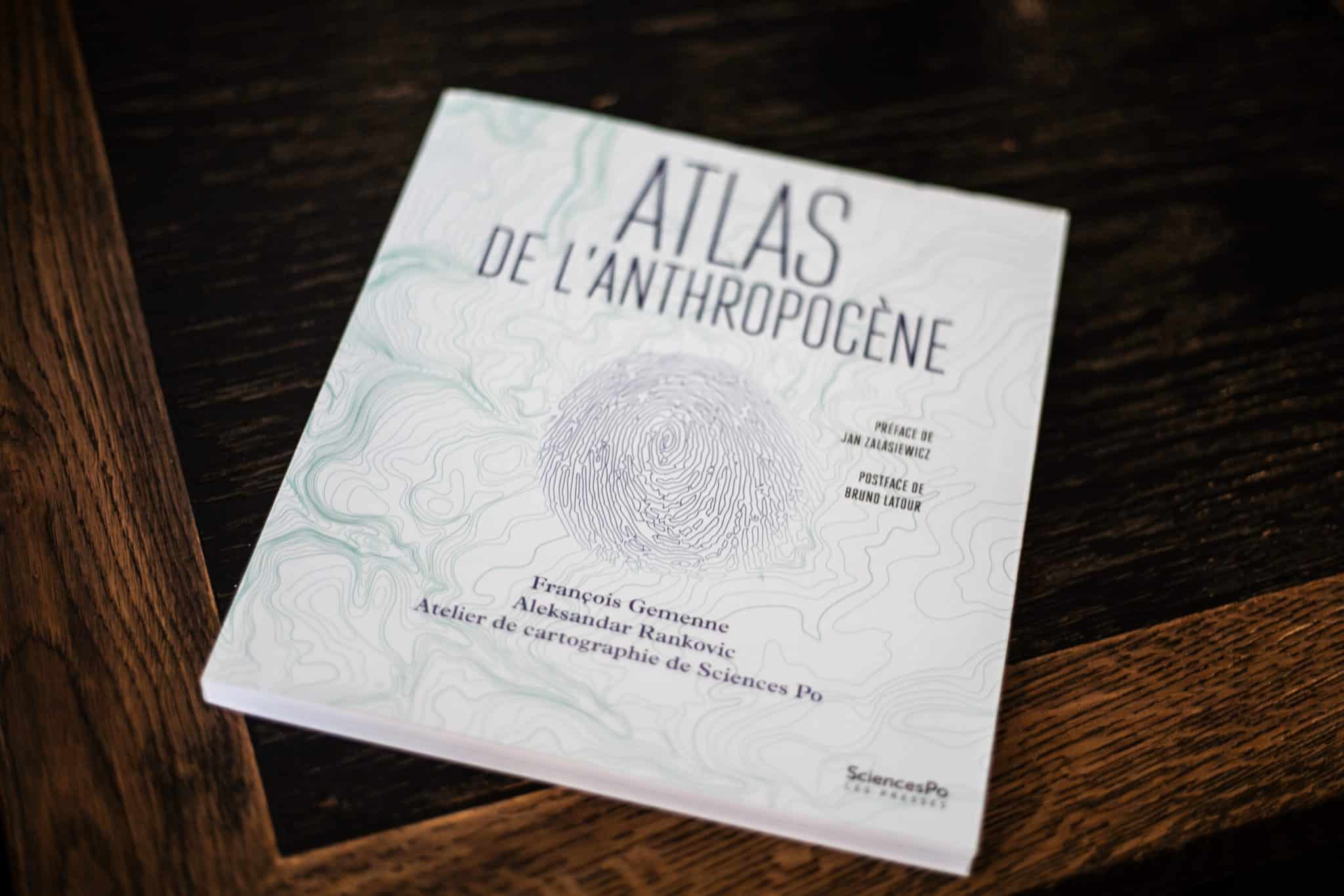En 2017, l’auteur japonais Kohei Saito publiait La nature contre le capital : L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital. Cet ouvrage est central pour comprendre les récents développements sur la pensée écologique de Marx. Il défend la nécessité de conserver les apports du marxisme – en les amendant au besoin – pour mieux penser et lutter la catastrophe climatique.
Le travail de Saito s’ancre dans une vaste littérature dédiée à la relation du marxisme à l’écologie. Pendant longtemps, Marx a été critiqué par des auteurs écologistes pour l’inspiration prométhéenne de ses textes et sa croyance dans un développement technologique et économique illimité – particulièrement prégnante à son époque. Cette interprétation semblait rendre le marxisme obsolète pour penser la crise climatique.
Depuis une vingtaine d’années cependant, une nébuleuse de chercheurs en propose une lecture alternative, à l’instar de Paul Burkett et de John Bellamy Foster (analysée dans les colonnes du Vent Se Lève). Ils ont cherché à mettre en évidence la dimension « écologique » de la critique marxiste du capitalisme. Leurs travaux ont cependant été accueillis avec une once de scepticisme dans les milieux écologistes, en raison du caractère périphérique et limité des intuitions de Marx en la matière.
Kohei Saito propose alors, dans la première partie de son ouvrage, une reconstruction systématique et complète de la critique écologique de Marx. Son examen philologique vise à démontrer que cet aspect n’est pas périphérique mais constitue au contraire un pilier essentiel de sa pensée. À cet égard, les théories de la valeur et de la réification (ou du fétichisme de la marchandise), centrales dans son œuvre, ne peuvent se comprendre pleinement sans prise en compte de leur dimension matérielle – c’est-à-dire écologique.
Dans la seconde partie de l’ouvrage, Kohei Saito utilise les récentes publications des carnets de notes de Marx. Longtemps négligés et n’ayant pas été publiés dans la première édition Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), qui a longtemps fait référence, ils font l’objet de redécouvertes depuis quelques années. Leur publication complète est assurée dans le deuxième projet MEGA dont l’achèvement est prévu pour 2025. Ces carnets, qui contiennent les études de Marx en sciences naturelles (biologie, chimie, géologie), sont essentiels pour comprendre les dimensions écologiques de sa pensée. Par leur étude, Saito montre comment Marx s’est éloigné d’une croyance naïve dans un progrès illimité et en est venu à considérer les crises écologiques comme des contradictions fondamentales du capitalisme.
L’aliénation, le métabolisme et le capital
Pour débuter sa démonstration, Kohei Saito revient sur les Manuscrits de 1844 et la notion d’aliénation. Dans ce texte, Marx s’inspire de la théorie de l’aliénation religieuse de Feuerbach pour l’appliquer au capitalisme. Dans la société religieuse, l’imagination des hommes les conduit à créer la figure d’un Dieu devenant une force étrangère, aliénée, qui s’impose à eux. Dans la société capitaliste, en raison de la propriété privée des moyens de production et de subsistance, l’homme est contraint de s’aliéner le produit de son travail pour obtenir un salaire. En retour, le travail ainsi aliéné donne de la valeur aux marchandises et à la propriété privée. Mais le raisonnement de Marx semble ici être circulaire : l’aliénation engendre la propriété privée qui engendre l’aliénation.
Toutefois, cette apparente circularité ne vaut que si l’on considère que les Manuscrits forment un travail achevé et indépendant. Or, selon Saito, ces manuscrits ne peuvent être séparées de l’ensemble que constitue les « carnets de Paris » de la même époque. Le premier de ces carnets ajoute une dimension économique à la critique philosophique de l’aliénation. Marx y compare les relations entre les hommes et la nature entre au sein des deux modes de production capitaliste et féodal.
À l’ère féodale, un lien personnel unit le seigneur, la terre et les humains qui y vivent. En effet, la terre est la possession du seigneur et les humains peuvent d’ailleurs être assimilés aux animaux ou aux plantes, l’ensemble constituant le domaine du seigneur. Toutefois, le lien personnel et intime du seigneur à son domaine autorise un lien tout aussi intime entre les serfs et la terre qu’ils habitent. La terre assure la domination personnelle et politique du seigneur mais les humains conservent leurs conditions objectives de production et de reproduction. Le seigneur impose un prélèvement mais ne recherche pas à maximiser son profit et les hommes restent libres d’organiser la production.
La transformation du métabolisme par la valeur est une réification : les relations sociales et naturelles entre les hommes et la nature se transforment en des rapports de valeur entre les marchandises.
À l’inverse, le capitalisme dissout ce lien personnel entre le seigneur et sa terre. Celle-ci devient une marchandise et le travail est mis au service de l’accumulation de capital plutôt que des besoins humains. Les serfs sont alors chassés des terres qu’ils habitent et contraints de trouver un salaire auprès des propriétaires des moyens de production et de subsistance. Les travailleurs vivent une situation de pauvreté absolue : ils s’aliènent le produit de leur travail, mais aussi l’acte de production lui-même et leur propre nature en tant qu’êtres créatifs. L’aliénation du travail de l’homme n’a alors d’autre origine que le développement capitaliste et la dissolution de la relation de l’homme à la terre qu’il entraine, dont le mouvement des enclosures est la manifestation historique.
Par ailleurs, les « carnets de Paris » contiennent les éléments philosophiques d’une critique écologique du capitalisme. Pour Marx, l’homme est une partie de la nature, il forme une unité avec celle-ci pensée comme totalité agissante. Dans son expression concrète, la nature constitue à la fois le corps organique de l’homme et son corps inorganique, celui qui lui est extérieur. L’homme entre alors dans un rapport (un ensemble de relations) avec la nature qui est médié par le travail et qui forme une unité. Comme unité au sein de laquelle se noue des rapports, la nature est alors sujette à des transformations historiques comme celle que constitue l’aliénation moderne – pour plus de détails sur l’ontologie de Marx, on se rapportera utilement à l’ouvrage de Frank Fischbach La production des hommes.
Toutefois, dans L’idéologie allemande (1846), Marx exprime le souhait de ne pas en rester à une critique strictement philosophique pour ancrer son travail dans une analyse scientifique du capitalisme. Marx ne reniera pas son ontologie mais cherchera à mettre en évidence les déterminants historiques et concrets de l’aliénation. En étudiant l’économie politique ou l’étude des sciences naturelles, Marx visera à éviter un discours philosophique abstrait et anhistorique, celui de Feuerbach, dont la seule portée stratégique serait de faire prendre conscience aux travailleurs de leur aliénation.
Le concept permettant son passage à une analyse scientifique et matérialiste sera celui de « métabolisme », que Marx emploie dès les Gründrisse de 1857. Le rapport de l’homme à la nature y est pensé comme une interaction métabolique, un processus constant d’absorption, de transformation et d’excrétion de matière dans le corps. Marx reprend un concept émanant de la chimie et de la physiologie du XIXe siècle pour l’étendre à sa compréhension de la société, parlant notamment de métabolisme social.
Dans son aspect transhistorique et universel, le métabolisme entre les hommes et la nature s’opère par le travail. Pris indépendamment de toute forme sociale spécifique, le travail est l’activité humaine spécifique de production volontaire et consciente de valeurs d’usage (répondant à des besoins), une transformation continue des conditions matérielles et sociales de l’existence humaine. La nature y joue un rôle central puisque le travail, en tant que médiation métabolique, dépend essentiellement de la nature et est conditionné par elle. Marx fait ainsi du travail et de la nature les matrices de toute richesse.
Toutefois, ni le travail ni le métabolisme ne doivent être compris uniquement de manière abstraite, comme un cycle anhistorique d’échange de matières. La définition abstraite, prise hors de toute détermination naturelle et socio-historique particulière, du métabolisme et du travail relève d’un constat banal et n’est que le point de départ de la théorie de Marx. S’arrêtant ici, on s’interdirait de comprendre comment le métabolisme de l’homme dans la nature peut varier dans ses déterminations particulières. Plutôt qu’une critique moraliste de séparation d’avec la nature, il est nécessaire de comprendre comment le mode de production capitaliste, en tant qu’étape historiquement spécifique de la production humaine, produit la destruction de l’environnement.
Il s’agit alors, pour Saito, de montrer comment la théorie de la rupture métabolique de Marx peut être déduite de sa théorie de la valeur, fondement de sa critique du capitalisme. L’enjeu est ici de contredire une lecture de Marx qui fait de la théorie du métabolisme un simple appendice, où il y aurait d’un côté la critique du capital et de l’autre une théorie naturaliste du métabolisme. Pour Saito, Marx analyse comment les catégories économiques formelles – celles de marchandises, de valeur, de capital –, dans leur interaction avec la réalité matérielle, produisent des ruptures métaboliques.
Réintroduire la nature dans la production
La théorie de la valeur – théorie centrale du Capital, l’œuvre majeure de Marx parue en 1867 – débute par une analyse de la marchandise, à la fois valeur d’usage et valeur d’échange. Une distinction similaire s’opère pour le travail, qui produit la marchandise, entre travail abstrait et travail concret. Les travaux concrets sont les infinités de travaux qu’entreprennent les hommes pour produire des valeurs d’usage (du pain, du tissu, des ordinateurs etc.). Le travail abstrait est le travail compris abstraitement, hors de ses déterminations particulières, et qui s’analyse traditionnellement comme la source de la valeur d’une marchandise.
Saito va mener une interprétation particulière de la théorie de la valeur de Marx en s’appuyant sur des commentateurs japonais de Marx, notamment Samezo Kuruma. Son interprétation s’inscrit dans le débat sur la nature du travail abstrait. Est-il une pure forme sociale, celle qui donne de la valeur aux marchandises uniquement dans le contexte du capitalisme, ou bien est-il une réalité matérielle transhistorique, une simple dépense d’énergie physiologique pour produire ?
Toute société humaine doit s’assurer de la production des conditions nécessaires à sa reproduction. Or le capitalisme est marqué par le caractère privé de la production qui ne permet pas de garantir que les conditions sociales de reproduction seront atteintes. Concrètement, chacun produit des objets sans savoir si la production agrégée permettra à chacun de vivre décemment. Il s’agit d’une des contradictions fondamentales du capitalisme qui le distinguent d’autres modes de production où l’allocation des travaux privés est prévue ex ante. Par exemple, dans la société féodale, les paysans travaillent ensemble pour assurer leurs besoins en tenant compte des prélèvements exercés par l’Eglise et le seigneur. Dans le capitalisme, le caractère nécessairement social de la production humaine se constate ex post, lorsque la production et l’échange de marchandises ont permis de satisfaire les besoins de la société.
Lorsque le processus de production et d’échange est réussi, les travaux privés ne se rapportent plus alors seulement entre eux comme autant de déterminations particulières d’un même travail abstrait, une même dépense physiologique d’efforts. Dans l’échange, les produits du travail acquièrent une reconnaissance de leur valeur sociale, car ils ont réussi à satisfaire les besoins d’autrui. Le travail abstrait, la dépense physiologique de chacun, a produit de la valeur pour la société et acquiert ainsi son caractère social. Le travail abstrait apparaît alors comme une réalité toute aussi matérielle que sociale. Plus précisément, le travail abstrait est d’abord une réalité physiologique qui acquiert un caractère social en s’objectivant comme valeur dans le cadre de la production capitaliste de marchandises. Le débat explicité ci-dessus est tranché : le travail abstrait est à la fois une réalité matérielle transhistorique et une forme sociale spécifique au capitalisme.
Finalement, le problème que pose le capitalisme pour le métabolisme entre l’homme et la nature commence à apparaitre. Dans le capitalisme, marqué par le caractère privé de la production, le métabolisme entre l’homme et la nature – médié par le travail d’un point de vue général, abstrait et transhistorique – devient médié par la valeur en tant que travail abstrait objectivé. Alors, la tension entre production privée et reproduction sociale se généralise dans une contradiction entre la valeur et le métabolisme. La manière capitaliste de gérer le métabolisme naturel et social passe par la valeur. Les hommes ne cherchent pas à régler rationnellement leurs relations aux autres et à la nature mais à acquérir de la valeur.
La transformation du métabolisme par la valeur est une réification : les relations sociales et naturelles entre les hommes et la nature se transforment en des rapports de valeur entre les marchandises. Les hommes en deviennent de simples porteurs et la valeur s’autonomise, se met à gouverner les relations sociales, à transformer les désirs, les normes, les représentations et la rationalité des hommes. On retrouve ici le thème de l’aliénation où la valeur, produit des relations sociales, devient la logique qui guide les rapports sociaux et naturels. La marchandise incarne la valeur et apparait ainsi comme un nouveau fétiche, selon l’expression de Marx, un nouveau Dieu.
Par quoi la contradiction entre valeur et métabolisme se caractérise-t-elle ? En premier lieu, la recherche du profit, de l’accroissement de la valeur en vient à modifier les propriétés matérielles des choses. Le sol est modifié par l’utilisation extensive de fertilisants chimiques pour augmenter la production, l’eau est polluée par son utilisation intensive pour l’irrigation. Ce constat montre qu’on ne peut séparer le social et le naturel, l’un étant modifié par l’autre constamment. En second lieu, l’augmentation indéfinie de la production épuise les ressources naturelles et notamment la force de travail des hommes, conduisant à des crises sociales et écologiques. Ces crises sont à la fois des crises du capitalisme, celui-ci ne pouvant plus garantir un même taux de profit lorsque l’exploitation ne peut se poursuivre au même rythme, et des crises écologiques, caractérisées par des ruptures métaboliques des milieux de vie.
Toutefois, il faut souligner que le maintien de contradictions dans le temps est permis par l’élasticité de l’homme et la nature. La disponibilité des ressources est une limite à l’accumulation mais ni la nature, ni le capital ne sont des agents passifs. La nature possède des mécanismes de compensation et le capital peut essayer de surmonter les obstacles matériels par l’innovation technologique ou l’exploitation de nouvelles ressources. Par les expressions de « nature » et « capital », il s’agit bien de résumer un ensemble de mécanismes naturels et sociaux permettant temporairement la poursuite l’accumulation.
Marx suit les nouvelles parutions de Liebig relatives à la fertilité des sols en vue de préparer la rédaction du Capital. Il reconnaît l’existence de limites naturelles et s’éloigne de la vision optimiste d’Engels.
On le voit, nous sommes désormais loin d’une critique moraliste d’une séparation de l’homme et de la nature, mais plutôt ancrés dans l’analyse des conditions matérielles de production. Dès lors, l’enjeu devient pour Marx de multiplier les régulations conscientes du métabolisme pour contrecarrer les tendances destructrices du capitalisme qui ira jusqu’à la rupture de l’élasticité évoquée. Ces régulations, par exemple la réduction de la journée de travail, doivent à terme viser le dépassement de la réification qui contraint le travail et la nature à être objectivés comme de simples choses permettant l’accumulation. En ce sens pour Saito, le combats contre l’exploitation du travail et celle de la nature constituent deux dimensions essentielles de la lutte contre le capital.
« Carnets de Londres » : Marx et les sciences naturelles
Dans la deuxième partie de sa démonstration, Saito s’appuie sur les publications récentes de l’édition MEGA. Elles portent sur les écrits les plus tardifs de Marx, qui ont souvent été négligés par ses interprètes. Depuis quelques années, ils ont permis de critiquer les interprétations classiques de Marx sur de nombreux sujets tels que les supposés productivisme et eurocentrisme de Marx – comme l’a mis en évidence Paul Guillibert, Terre et Capital.
La section sur la rente foncière au livre III du Capital, publié par Engels après la mort de Marx sur la base de ses manuscrits, semble constituer attester de la dimension prométhéenne de la pensée de Marx. En effet, elle comporte un passage faisant l’apologie du progrès technique permettant de dépasser les limites naturelles – notamment celle de la fertilité des sols.
Or, selon l’étude de Saito, les « carnets de Londres » établissent une évolution dans sa pensée au fil des années 1850 et 1860, qui le conduit à remettre en cause sa vision initiale. Cherchant à fonder scientifiquement sa critique de la théorie de la rente différentielle de Ricardo, il dut alors étudier les sciences naturelles et prendre en compte les débats qui l’agitaient, notamment sur la question de la fertilité des sols.
La théorie de la rente différentielle de Ricardo reposait sur une loi des rendements décroissants. À mesure que la population croît, des terres moins fertiles sont cultivées, conduisant à l’élévation des prix et des rentes sur les terres les plus fertiles. Marx étant en désaccord avec cette théorie anhistorique qui n’attribuait aucun rôle au mode de production capitaliste et faisait de la fertilité une donnée et une limite naturelle.
L’enjeu, pour Marx, était de prouver la possibilité de surmonter les limites posées par Malthus et Ricardo. Le progrès agricole était perçu comme une condition du succès de la révolution. Ainsi, dans les années 1850, Marx s’intéressa aux travaux qui affirmaient que la fertilité des sols pouvait être améliorée par des interventions scientifiques et technologiques. Il ne tenait pas alors compte des préoccupations relatives à l’épuisement des sols aux Etats-Unis qu’il attribuait à une gestion précapitaliste et primitive de l’agriculture.
Dans l’évolution successive de Marx, le « père de la chimie agricole », Justus von Liebig a eu un rôle central. Au cours des mêmes années, Liebig considérait aussi que la fertilité des sols et les rendements pouvaient être améliorés. Liebig s’inquiétait de l’épuisement des minéraux inorganiques dans le sol mais suggérait que le stock pouvait se reconstituer, par la mise en jachère, la rotation des cultures, ainsi que par l’apport direct de minéraux par le biais du fumier. Il anticipait même l’utilisation d’engrais synthétiques industriels pour améliorer les rendements agricoles.
Les années 1860 sont le théâtre d’une évolution majeure de Liebig et de Marx. Face aux critiques, Liebig se met à nuancer le rôle des minéraux dans la fertilité des sols et reconnaît les risques d’épuisement des nutriments présents dans le sol. Marx suivait alors les nouvelles parutions de Liebig en vue de préparer la rédaction du Capital. Il se mit à reconnaitre l’existence d’une limite naturelle et à s’éloigner de la vision par trop optimiste d’Engels.
Saito aura d’abord démontré que Marx ne fut pas un utopiste technocratique, mais plutôt un auteur dans un « bouillonnement intellectuel permanent »
L’évolution de Marx fut intégrée à sa compréhension du capitalisme. Contre ceux qui affirmaient que l’épuisement des sols était causé par l’ignorance des agriculteurs ou allait être corrigé naturellement par le marché, Marx affirma que le problème était inhérent au capitalisme. En effet, la réalisation d’un profit rapide et reproductible est en contradiction avec l’exigence du temps long qui permet au sol de reconstituer son stock de nutriments. Les rendements agricoles peuvent certes être améliorés par l’introduction de machines, d’engrais et de méthodes scientifiques, mais le problème de l’épuisement des sols n’est que repoussé.
L’évolution de Marx est parachevée par le concept de « rupture métabolique ». L’épuisement des ressources naturelles occasionne une dégradation durable des milieux de vie. L’impérialisme anglais et américain conduit à l’épuisement des ressources naturelles et perturbe les formes traditionnelles d’agriculture durable dans les pays périphériques et colonisés. L’exploitation appauvrit l’ensemble des travailleurs des pays du centre et de la périphérie. Les pratiques agricoles industrielles détériorent le bien-être des animaux. Dans ce contexte, les agricultures précapitalistes sont réévaluées car elles assurent un mode de production durable et qui satisfaisaient les besoins essentiels.
Marx plaide alors pour une transformation radicale des relations entre l’homme et la nature. Cette transformation doit permettre une agriculture rationnelle, en harmonie avec les limites naturelles. La régulation du métabolisme naturel et social devra être consciente et fondée sur les sciences naturelles. L’émancipation ne saurait abolir une nécessité évidente, celle des interactions constantes des hommes et de la nature qui leur permet d’assurer leurs besoins fondamentaux.
L’examen de Saito sur l’écologie de Marx se conclut par l’analyse des notes et extraits copiés par Marx dans ses carnets, après la publication du Capital en 1968. Les carnets témoignent d’une nouvelle évolution de Marx autour de son interprétation des limites naturelles et de son appréciation des écrits de Liebig, qui établit un scepticisme croissant à leur égard : Marx craignait que cette théorie nourrisse une analyse naturaliste, anhistorique et pessimiste d’inspiration malthusienne. L’idée de limite naturelle conduit à concevoir un effondrement prochain et n’offre pas de solution concrète.
Le scepticisme grandissant de Marx le conduisit à lire un auteur critique de Liebig, Carl Fraas, dont la théorie mettait plus en avant le rôle des facteurs climatiques dans la fertilité des sols. Pour Fraas, le problème de l’agriculture est d’abord la surproduction due à la concurrence internationale. Alors que les nutriments peuvent être reconstitués naturellement par les alluvions et l’irrigation, Fraas craint que la surproduction n’entraine un changement climatique dévastateur. La déforestation engendrée par la surproduction modifierait le niveau d’humidité, de pluie et de température, ce qui perturberait les processus d’alluvions et d’irrigation puis, en conséquence, la fertilité des sols et la végétation. Il plaide alors pour une agriculture raisonnée et basée sur des processus naturels et non le recours à des engrais chimique.
Marx intégra alors les idées de Fraas à sa théorie. Elles lui permirent d’élargir sa compréhension de la perturbation capitaliste du métabolisme et d’éloigner le spectre malthusien de la pénurie de ressources. En effet, le problème n’apparaît plus tant dans la « limite naturelle » comme donnée, mais plutôt dans le caractère perturbateur des activités capitalistes sur le métabolisme qui assure la reproduction de la société, notamment la stabilité du climat. L’objectif demeure d’établir une régulation consciente et collective des activités humaines mais doit s’élargir, au-delà de la question de l’épuisement des sols, à la question écologique dans son ensemble.
Penser conjointement écologie et critique du capitalisme
La destruction de l’environnement et l’expérience de l’aliénation créée par le capital commandent la nécessité de transformer radicalement le mode de production pour bâtir un développement soutenable de l’homme. L’écologie de Marx et sa théorie du métabolisme illustrent l’importance stratégique de lutter contre le pouvoir réifié du capital et de transformer la relation entre les humains et la nature pour assurer un métabolisme socio-écologique soutenable et émancipateur.
Que retenir de l’étude de Saito ? Il aura d’abord démontré que Marx ne fut pas un utopiste technocratique, mais plutôt un auteur dans un « bouillonnement intellectuel permanent » selon l’expression de Romaric Godin, qui affina tout au long de son existence sa compréhension de l’économie politique et du capitalisme. Il est possible, grâce à Saito, d’écarter de nombreux arguments qui invitaient à oublier Marx, rendu anachronique par une série de manques qui n’étaient pas les siens. Il ne s’agit en aucun cas d’en revenir à une certaine idolâtrie de Marx, qui tendait à interdire de nouvelles interprétations – bien plutôt de continuer à recueillir minutieusement et inlassablement les enseignements accumulés à la lueur de nouvelles théories critiques.
Plus précisément, l’ouvrage de Saito alerte sur les écueils auxquels se heurtent parfois les critique du capitalisme. Ainsi, la technologie ne saurait être une solution tant que les rapports sociaux existants, ceux du capitalisme, détériorent gravement le métabolisme de la nature. À l’inverse, la notion de « limites » doit être maniée avec précaution pour éviter de diffuser des raisonnements malthusiens inadéquats. Les limites sont à la fois sociales et écologiques, elles ne constituent des barrières que dans un état donné du métabolisme social et naturel. Des limites écologiques ont déjà été franchis car la société n’est pas encore parvenue à s’organiser différemment, à imposer une régulation consciente et rationnelle du métabolisme. À cet égard, le parti-pris sans nuances de Kohei Saito en faveur du concept concept stimulant et critiquable de « décroissance », dans un ouvrage ultérieur, n’est pas nécessairement éclairant.
À la lecture de l’ouvrage de Saito, une question demeure cependant ouverte. À l’instar de l’institutionnalisme monétaire français (André Orléan, L’empire de la valeur), Saito constate l’origine sociale de la valeur (instituée par la monnaie) dans la séparation marchande qui isole les producteurs. On a relevé que la particularité du capitalisme a été d’avoir radicalisé la logique de la valeur marchande. Comme l’indique Orléan (2023), « en faisant de la force de travail une marchandise, [les économies capitalistes] ont poussé la logique de la valeur jusqu’à sa plus extrême extension, de sorte que, dans le mode de production capitaliste, l’entièreté des fonctions économiques, production, circulation, distribution et consommation, se trouvent régies par la valeur. C’est tout l’édifice du capital qui repose sur elle, de sorte que la valeur constitue la substance même du capital, ce que le capital produit, échange, distribue ou transforme ».
La radicalité des transformations à imposer au système capitaliste, et les modalités pour y parvenir, demeurent des questions ouvertes auxquelles l’œuvre de Kohei Saito invite à réfléchir. Gageons que sa popularité contribuera à y apporter des pistes.