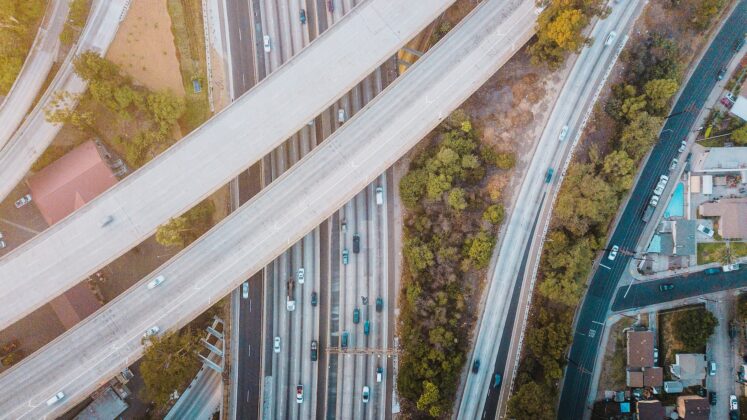Le choc des espèces (Éditions de l’Aube, 2022) a fait réagir. Dans cet essai que nous avions déjà recensé, Renaud Large tente de poser un regard mesuré sur l’antispécisme, loin de l’exubérance de ses défenseurs et contempteurs médiatiques. Nous publions ici deux autres contributions. L’une, de la plume de Léonard Nayrach, lui reproche « d’infliger à ses lecteurs tous les poncifs de la critique de l’antispécisme » et de verser dans un « rousselisme en carton-pâte digne de TPMP ». L’autre, rédigée par Renaud Chenu – président d’Ad Astra Influence – salue au contraire un « plaidoyer pour la mesure » qui « cherche les voies d’une réponse tout en nuances, où l’animaliste serait à l’écoute du chasseur ».
Le flop des espèces
Au mois de novembre dernier, sortait aux éditions de l’Aube sous le prétentieux nom de Choc des espèces un plaidoyer pro-domo pour la chasse. L’auteur, Renaud Large, est communicant et fils de chasseur. Sorte de rousselisme en carton-pâte digne de TPMP, complémenté d’un supplément d’âme attaché à la tradition, cet essai inflige à ses lecteurs tous les poncifs de la critique de l’antispécisme. Par Léonard Nayrach.
Résumons l’ouvrage. Un fils de chasseur nous explique que la chasse, dont le domaine s’étend chaque année, ainsi que le nombre de licences, est menacée de disparition. Qu’à cet égard, c’est une tradition multiséculaire qui risque d’être rayée des radars. Multiséculaire et populaire, puisque l’auteur passe vite sur les origines nobiliaires de cette pratique, pour convoquer les chasses communistes de l’Allier. Notre Georges Marchais du fusil et du couteau mobilise par conséquent des artifices rhétoriques bien ficelés pour laisser entendre au lecteur que la chasse aurait une fonction d’encadrement social et de lien communautaire dans la France périphérique, celle qui serait « menacée de disparition par la mondialisation ».
Le procédé est tout trouvé : l’auteur s’essaie à des portraits et entretiens croisés dans cette France qui lui est chère afin de donner de la chaire et de l’humain à une pratique qui en manque. L’inspiration semble lui être venue du Peuple de la frontière, essai à succès de Gérald Andrieu, sur les terres de l’Est de la France, où le vote RN est puissant. A tel point qu’on aurait pu conseiller à Renaud Large d’intituler son essai Le peuple de la chasse, plutôt que de faire référence au magistral ouvrage de Darwin : l’Origine des espèces.
Sociologie de comptoir. Portraitisme de plateau télé. À la lecture, on entendrait presque l’auteur nous chuchoter : « tel Bernanos, je ne peux écrire que dans les cafés, entouré de mes semblables ».
Une réflexion anthropologique particulièrement pauvre
Pour critiquer l’antispécisme et muscler sa contre-offensive culturelle, cet ouvrage s’attarde sur l’idée qu’un droit positif animaliste est impossible. À titre d’exemple, il cite l’impossibilité d’un droit opposable au logement d’un cochon. L’auteur développe ainsi sa critique en prenant appui sur les versions les plus caricaturales de l’antispécisme.
L’antispécisme est pourtant une définition négative. Nous entendons par-là qu’elle conteste avant tout la position dominante de l’homme dans l’ordre naturel comme justification de sa violence et de ses excès. L’animalisme est autre chose.
Disons-le, donner un droit opposable au logement à un cochon est le sommet de l’anthropocentrisme. En effet, un cochon ne réfléchit pas dans des catégories humaines. L’idée même d’un « droit » n’a pas de sens pour les animaux. Calquer des catégories anthropologiques sur l’ordre animal est donc l’aboutissement ultime de l’épopée prométhéenne, le narcissisme le plus pur de l’humain qui se transpose dans tous les objets et sujets de l’ordre naturel.
Pour autant, un animalisme universaliste est possible. C’est celui qui consiste à assumer l’idée que l’homme s’abaisse par sa violence envers les animaux, sans préjuger de sa capacité à penser à la place des animaux. En un sens, libérer les animaux de la domination humaine est un projet de libération de l’humanité, qui délivrera les hommes de leurs aspects les plus violents – et écocidaires.
C’est ce sur quoi Renaud Large est muet. Il se contente de contester l’antispécisme dans ses versions les plus fantaisistes. Il trouve ainsi une cible facile pour défendre le modèle de la chasse. Cette dernière est pourtant l’incarnation symbolique ultime des dérives du modèle carnivore et viriliste dominant.
Truffades et tartufferies
Alors que l’auteur semble se revendiquer d’une tradition républicaine, il mobilise les arguments les plus caricaturaux du multiculturalisme anglo-saxon. Résumons le syllogisme : la chasse est une pratique culturelle populaire qui participe de la diversité culturelle ; il faut protéger la diversité culturelle ; il faut donc protéger la chasse.
Les Jacobins de Quatrevingt-treize se retournent dans leur tombe. S’il avait fallu protéger chaque parcelle de diversité culturelle, nous en serions restés à l’Ancien régime, celui des barons et des privilèges. Notre tartuffe est plus attaché à sa côte de bœuf qu’à la République.
La chasse doit disparaitre car le modèle qu’elle porte en son sein n’a pas d’avenir. Le changement climatique ; le besoin de sortir de la civilisation carnée et de réduire nos émissions ; le refus de la violence organisée pour les animaux, considérés comme un moyen pour l’homme. Tout converge pour que la chasse ne passe pas le XXIème siècle si l’humanité décide de maintenir le cap du progrès.
Il faudra bien évidemment régler des problématiques, telles que les espèces invasives, qui peuvent menacer des espèces protégées, et la régulation des populations animales. Nous avons devant nous un formidable chantier de réorganisation des rapports entre l’humanité et les animaux.
Pendant que nous poursuivrons cette œuvre commune, il nous faudra subir les complaintes victimaires des conservateurs qui ne s’assument pas.
L’écologie contre l’antispécisme
Les arguments des défenseurs de la cause animale commencent à peine à s’installer dans le débat démocratique que déjà se dessine un immense bouleversement culturel : le repositionnement volontaire de la place de l’homme dans le monde du vivant. Le chasseur-cueilleur domina de sa superbe le monde sauvage durant tout le Pléistocène supérieur. L’agriculteur-éleveur remodela la nature et les paysages durant tout l’Holocène. Et nous ? Fourmilière humaine nourrie par l’industrie agro-alimentaire à l’incroyable productivité, inaugurant l’Anthropocène, quelle est notre place au sein du vivant ? Par Renaud Chenu.
Renaud Large nous invite dans un essai malin, Le choc des espèces, à nous poser la question en évitant tout manichéisme, cherchant les voies d’une réponse tout en nuances, où l’animaliste serait à l’écoute du chasseur qui aurait lui à coeur d’entendre les arguments de son contradicteur. L’auteur nous plonge d’entrée dans ses souvenirs d’enfance, au coeur d’une France pagnolesque, ouverture façon roman d’apprentissage : une partie de chasse, les lueurs de l’aube perlant de lumière le canon du fusil cassé sur l’épaule, le souffle court des chiens excités, l’émerveillement du gamin réveillé au coeur de la nuit pour une équipée en forêt. C’est un partisan du style littéraire. Un style joueur, dribblant avec son lecteur. Fini la chasse, nous avons affaire à un repenti, place aux portraits !
La plume se fait empathique. Il aime les Français et leur véritable patrie commune : la générosité. Il remonte les parcours de vie avec élégance pour nous faire ressentir un impalpable national : la décence des sentiments envers les animaux, quelle que soit la manière avec laquelle on leur déclare notre flamme. L’éleveuse de chat végane ou le boucher, la grammaire de l’altérité aux autres sensibilités du vivant doit-elle être jugée ? Dans ce plaidoyer pour la mesure, il en appelle à « la pensée de midi », chère à Camus, pour éviter que la « tenaille alimentaire » installe un procureur dans chaque estomac.
Sachant votre temps aussi précieux que le sien, il a fait court, efficace, et nous quitte avec un dernier tour de piste nerveux en se faisant théoricien de l’animalisme. Un atterrissage en douceur pour un accord démocratique sur la souffrance animale façon « pragmatisme révolutionnaire ». La « méthode Large » exposée au fil des pages est un guide pour la refondation démocratique à l’heure de la réinvention du rapport à la nature par une humanité à huit milliards. Autant d’êtres humains qui se livrent chaque année à ce que les générations futures pourraient bien qualifier de « plus grand crime de tous les temps » (Yuval Noah Harari, Homo Deus) : 1380 milliards d’animaux sont tués chaque année (chiffres 2018, source L214) pour nous nourrir.
Ces chiffres parlent autant de notre rapport brutal à la nature que du déni tranquille dans lequel le consommateur organise son petit confort alimentaire : pour un Français, ce sont 128 animaux qui meurent chaque année, souvent dans des conditions déplorables. Mais qui n’a jamais salivé devant un chapon doré dans la vitrine de la boucherie de quartier à l’approche de Noël ? Qui ne s’est projeté derrière ses fourneaux en jetant un oeil sur la sole attendant d’être choisie, posée sur le lit de glace de l’étale du poissonnier un dimanche de marché ?
Grande terreur de l’évolution cavalant à la tête de la chaîne alimentaire depuis deux cents mille ans, homo sapiens jouit de l’incomparable supériorité sur les autres espèces que lui confèrent ses capacités cognitives et son organisation sociale. C’est un fait historique et même une donnée géologique depuis la caractérisation scientifique de l’anthropocène. Il y aurait de quoi se satisfaire. En atteignant le nombre de huit milliards, n’avons-nous pas fait la preuve que l’humanité hyper-protéinée est une immense réussite, que jamais notre espèce ne s’était aussi bien portée ? Si, naturellement, mais la grande marche du bipède le plus gourmand du règne animal est aujourd’hui perturbée par les animalistes, antispécistes et autres végans qui ont débarqué avec fracas dans le débat public en criminalisant les plaisirs de la grande bouffe qui fonde toutes les civilisations.
74% des Français sont favorables à l’interdiction de la corrida, 76% prêts à manger moins de viande et de poissons (IFOP). Nous sentons collectivement que nos comportements doivent changer et entrons dans cet inconnu où plus rien de possible ne semble venir du côté du monde qui s’en va quand on ne perçoit pas encore ce qu’il adviendra du monde qui vient. Dans cet entre-deux, nous sommes traversés par le vertige des possibles qui s’ouvrent devant nous. Mais l’écologie réveille aussi l’angoisse ancestrale de la disparition. Fin du monde, effondrement du vivant… Les animalistes comme les collapsologues s’imposent en cavaliers messianiques de l’apocalypse, adeptes du marketing de la culpabilité, invitant l’humanité à une grande rédemption.
La Terre est érigée en déesse que nous aurions trahie et sous nos yeux ébahis l’écologie, hier sympathique courant politique, est en passe de devenir une religion à laquelle ceux qui refuseraient de se soumettre sont d’avance voués aux gémonies. L’air de rien, nous nous engageons dans une curieuse phase de l’histoire des idées où l’homme pourrait devenir le parasite terrestre par excellence. Faut-il abdiquer et s’engouffrer dans les subtilités de la dépopulation, de la désindustrialisation, du retour à l’agriculture vivrière, du véganisme pour tous, sous la houlette d’une joyeuse bande rêvant de mettre en œuvre les principes de la « dictature verte » ?
Je me fais l’avocat du diable, mais la formalisation du concept d’urgence écologique dominant désormais la métapolitique mondiale ne laisse que peu d’alternatives pour une transformation des comportements individuels et collectifs. Soit la solvabilisation des comportements grâce à une action robuste de répartition des richesses par des États-providence écologistes, soit une limitation drastique des libertés individuelles et de la concertation démocratique. On ne prend pas vraiment la première voie. Dans l’urgence écologique, le sujet alpha est la nature. Pour la sauver, le sujet bêta qu’est l’homme est conjugué au passif, perdant la main sur l’Histoire, prié de revoir ses ambitions à la baisse, ou de disparaître. Quand des gens censés commencent à expliquer avec le plus grand sérieux qu’il est criminel de faire des enfants, on peut légitimement s’inquiéter à l’idée de les voir parvenir au pouvoir.
La pénétration de cette réjouissante manière d’envisager le futur de l’homme, qui s’illustre dans l’affirmation d’une radicalité écologiste qui fait fi du droit, des décisions de justice ou encore du doute inhérent à la méthode scientifique (pullulement des ZAD, attaques de boucheries, discours anti-scientifique…) ouvrira-t-elle les marches du pouvoir aux partisans de ce qui s’apparente à une grande régression ? Et ce au moment même où l’histoire, malicieuse, éclaire l’horizon d’un nouveau jour habité de promesses que jamais aucune génération avant nous n’aurait imaginé atteindre ?
Avec le développement des NBIC dans la seconde moitié du XXème siècle, nous sommes entrés dans la phase d’accélération exponentielle de la révolution technologique et scientifique entamée à la Renaissance, l’enjeu du siècle présent est désormais de mettre la science et la technologie au service de nos intérêts écologiques et sociaux. La protection de la nature, le bien-être animal, la lutte contre l’effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique sont des défis désormais existentiels. Renaud Large propose de concilier les principes des Lumières et de l’écologie pour les relever. Son regard est plus que le bienvenu pour nous aider à construire du consensus là où nous en avons le plus besoin.