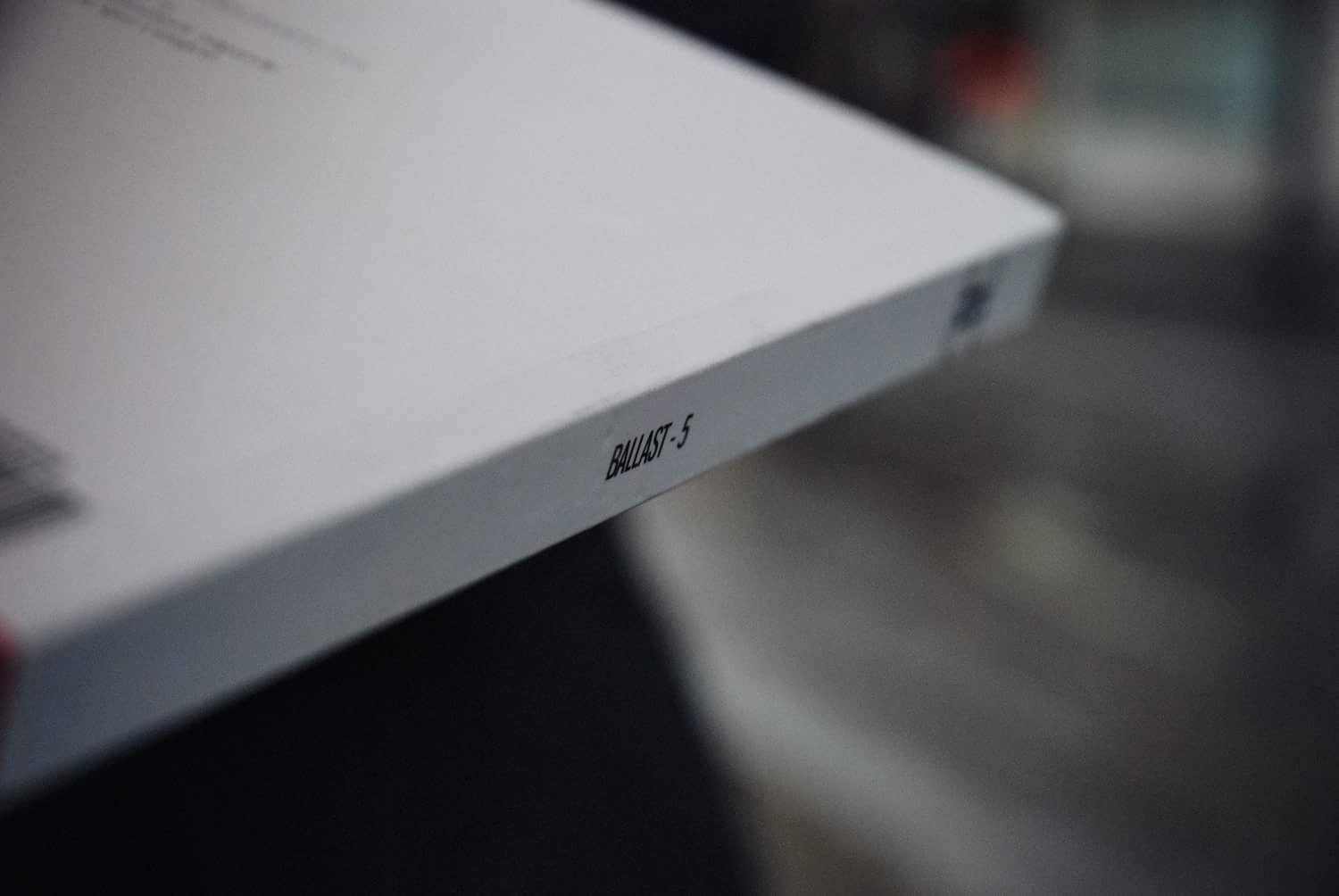Ballast – Macron est l’une de vos cibles de prédilection : pourquoi le pays a-t-il visé de travers ?
LVSL – Il est évidemment tentant d’affirmer que les Français ont voté à côté, qu’ils ont été, une fois de plus, trompés par un as du marketing électoral et de la manipulation des masses. C’est trop facile. Nous pensons qu’il faut avant tout décrypter la stratégie de l’adversaire, déceler chez lui les ressorts de sa capacité à susciter l’adhésion — afin de mieux la déconstruire. Force est de constater que, dans un contexte de brouillage des frontières idéologiques, lié notamment à la relative indifférenciation des politiques économiques menées par les deux précédents présidents de la République, le clivage gauche/droite a perdu de sa centralité dans les mentalités des Français. D’ailleurs, trois des quatre candidats arrivés en tête à l’élection présidentielle se sont évertués à s’affranchir de cet axe structurant de la vie politique : Marine Le Pen, en opposant les « patriotes » aux « mondialistes » ; Jean-Luc Mélenchon, en instaurant une ligne de fracture entre le « peuple » et l’« oligarchie » ; Emmanuel Macron, en prétendant incarner le rassemblement des « progressistes » contre les « conservateurs » de tous bords.
« Nous nous efforçons de mettre au jour Emmanuel Macron pour ce qu’il est : l’incarnation politique d’un néolibéralisme assumé, émancipé des complexes des socialistes et débarrassé des obsessions identitaires des droites. »
La frontière dressée par Emmanuel Macron est habile : elle renvoie dos à dos une droite hostile au changement et une gauche arc-boutée sur la défense d’acquis sociaux jugés d’un autre âge. Pour résumer, tandis que gauche et droite, par leurs querelles artificielles et leur manque d’audace, ont enfoncé la France dans l’immobilisme, Emmanuel Macron se présentait comme le candidat à même de libérer le pays de ses carcans, de lui redonner un « esprit de conquête ». Cette image est fondamentale : celle d’une France qui avance, qui relève de nouveaux défis. Là où les néolibéraux « traditionnels » font de l’austérité un horizon indépassable, fidèles à la formule « There is no alternative » de Margaret Thatcher (que l’on songe un instant à la morosité d’un François Fillon ou d’un Alain Juppé), Emmanuel Macron propose un nouveau récit politique mobilisateur axé sur l’ambition et la modernité. Cette nouvelle frontière, il l’a construite pour maintenir le système et non pour le changer réellement — c’est pourquoi le terme de « transformisme » est plus adéquat pour qualifier son projet. Emmanuel Macron est également parvenu à capter une profonde demande de renouvellement politique en capitalisant sur la désaffection de nombreux citoyens à l’égard des partis traditionnels. En lançant son propre mouvement bâti comme une start-up, en appelant au retour de la société civile et de l’expérience professionnelle en politique, au nom de l’efficacité et par opposition à une élite politique carriériste et sclérosée, il a incontestablement marqué des points. Bref, Emmanuel Macron s’est façonné le costume de la figure iconoclaste, inclassable, brisant les tabous et transgressant les codes pour faire progresser le pays et balayer le « vieux monde ». Un carnet d’adresses bien fourni, une large couverture médiatique, un spectaculaire alignement des planètes (affaire Fillon, victoire de Benoît Hamon à la primaire socialiste) et un épouvantail bien commode (Marine Le Pen) ont fait le reste.
Quant à nous, à LVSL, nous nous efforçons de mettre au jour Emmanuel Macron pour ce qu’il est : l’incarnation politique d’un néolibéralisme assumé, émancipé des complexes des socialistes et débarrassé des obsessions identitaires des droites. C’est peut-être une cible de prédilection, mais il faut reconnaître qu’il facilite aujourd’hui la tâche de ses adversaires. Au bout d’un certain temps, les actes finissent immanquablement par prendre le pas sur la puissance du récit politique. Notre rôle consiste donc tout à la fois à défaire le discours et à poser un regard critique sur les actes. Emmanuel Macron ne peut pas scander à la face du monde « Make our planet great again » et en même temps accepter l’application provisoire du CETA ou céder sur les perturbateurs endocriniens. Il ne peut prétendre propulser la France dans la modernité tout en adoptant une réforme du marché du travail qui signe une profonde régression dans le quotidien de millions de salariés. Ajoutez à cela « les gens qui ne sont rien », les « fainéants », les « cyniques » ou ceux qui « foutent le bordel », et le travail de déconstruction de l’entreprise macroniste est déjà bien entamé.
Ballast – Votre ligne défend le « populisme de gauche », porté notamment par Podemos. Dans une tribune publiée cette année par Attac, Pierre Khalfa, syndicaliste et coprésident de la Fondation Copernic, estimait qu’il est un « non-dit » délétère derrière ce populisme : son autoritarisme, son culte de la représentation, sa mythification du leader comme incarnation populaire. Qu’objecter à cela ?
LVSL – Pierre Khalfa fait une mauvaise lecture du populisme. Dans son texte, il oppose la construction du peuple à son autoconstruction. Il perçoit la première comme étant le processus actif et exclusif de construction du sujet politique par le leader, ce qui implique un risque d’autoritarisme, et la seconde comme étant une forme spontanée d’autoconstruction horizontale du peuple. Il y a ici à la fois une incompréhension de ce que les intellectuels populistes nomment « construction du peuple » et une pure incantation sur l’autoconstruction spontanée : on attend toujours l’autoconstruction d’un sujet politique… Bref, l’erreur de Khalfa consiste dans le fait qu’il n’a pas lu, ou mal lu, le fait que le processus de construction du peuple était un processus dialectique, à la fois top-down et bottom-up, et non un processus qui descendait magiquement du leader. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de leader sans sujet à incarner, sans groupe qui fasse un travail discursif et symbolique sur lui-même, et qu’à l’inverse, ce groupe — nécessairement hétérogène — ne peut se maintenir sans des formes d’unification dont l’incarnation par une figure tribunitienne est l’un des principaux vecteurs. À ce jour, personne ne défend l’idée qu’un leader immaculé viendrait créer ex nihilo un sujet politique.
« Prenez Manuel Valls : son autoritarisme était corrélatif de son pitoyable score à la primaire de la gauche de 2011, de l’absence de base sociale de son projet et de son manque de légitimité. »
Passées ces caricatures, il convient tout de même de prendre à bras le corps la question de l’autoritarisme et du culte de la représentation. Ce risque est à l’évidence réel, mais il ne faut pas l’exagérer. Pierre Khalfa part du postulat que la nature du lien entre le leader et le mouvement ou le peuple est nécessairement autoritaire et verticale. La question qui se pose est l’existence de contre-pouvoirs qui viennent contrecarrer les tendances à l’autoritarisme qui peuvent émerger. Mais tout d’abord, il est nécessaire de clarifier ce qu’on entend par autorité et autoritarisme. Il ne faudrait pas, par rejet légitime de l’autoritarisme, refuser tout principe d’autorité entendue comme forme légitime et reconnue d’exercice d’une fonction. L’autorité et l’autoritarisme sont deux choses antagoniques : on verse dans l’autoritarisme lorsqu’il n’y a plus d’autorité légitime. Prenez Manuel Valls : son autoritarisme était corrélatif de son pitoyable score à la primaire de la gauche de 2011, de l’absence de base sociale de son projet et de son manque de légitimité. Ou encore le traitement infligé par l’Union européenne à la Grèce en 2015 : l’autoritarisme des institutions et leur manque de légitimité étaient bien évidemment liées. Dès lors, si l’approche populiste ne fait pas l’économie de formes d’autorité en politique, elle ne défend aucunement l’autoritarisme, au contraire. C’est l’existence d’un sujet politique conscient qui permet de contrecarrer les phénomènes de capture du politique, de mise à distance de la souveraineté, et de contournement démocratique. Il est plus difficile de prendre des petites décisions scandaleuses dans le secret des conciliabules face à un peuple conscient de lui-même que face à une multitude éparpillée. À moins que l’on considère que c’est le peuple comme sujet qui est autoritaire, mais dans ce cas, on en revient à la logique néolibérale qui consiste à se méfier un peu trop des peuples lorsqu’ils surgissent dans l’Histoire…
Venons-en au culte de la personnalité : c’est une question difficile. Le mouvement ouvrier a toujours oscillé sur ce sujet. Chacun a en tête les paroles de L’Internationale : « Il n’est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun ». Néanmoins, on connaît aussi la suite : on refuse l’incarnation dans les mots et on la pratique dans les faits, parfois sur un mode incontrôlé et délirant. L’histoire du mouvement ouvrier est parsemée de leaders et de tribuns : Jean Jaurès, Léon Blum, Lénine, Rosa Luxemburg, Léon Trostky, Joseph Staline, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Georges Marchais, François Mitterrand, etc. L’hétérogénéité de cette liste, lorsque l’on prend par exemple des figures aussi opposées que Staline et Rosa Luxemburg, ou encore Jaurès, laisse percevoir qu’il y a des modalités différentes d’incarnation. Par ailleurs, il faut aussi voir que des appareils politiques désincarnés ne sont pas pour autant plus démocratiques et moins sujets à des formes de déviation autoritaires. On ne peut maintenir une horizontalité pure qu’en coupant toutes les têtes qui dépassent… La question qui se pose est dès lors : quelle incarnation voulons-nous ? C’est à cela qu’il faut répondre, et non repartir dans des oppositions binaires entre horizontalisme et incarnation. Une piste peut par exemple consister à chercher à articuler des formes d’incarnation verticale avec des contre-pouvoirs populaires importants : référendum d’initiative populaire, autogestion ou cogestion de certaines entreprises, possibilité de révoquer certains élus en établissant des modalités pertinentes, etc. Ce n’est pas contradictoire avec la méthode populiste. L’enjeu est de concilier les exigences d’une compétition politico-électorale qui valorise les individualités fortes — d’autant plus en France sous la Ve République où les institutions concentrent l’essentiel des pouvoirs entre les mains d’un seul homme — et l’indispensable mise à contribution des membres d’un mouvement dans la définition des orientations, du programme, dans le choix des représentants, etc. Prenez Madrid, par exemple : nous avons rencontré Rita Maestre, qui nous a expliqué comment la mairie avait mis en place un système de vote qui permettait aux habitants des différents quartiers de la ville d’arbitrer entre différents investissements publics : une école, un parc, etc. Les gens votent et reprennent la main sur leur vie. Cela se fait aussi par des modalités décisionnelles. Beaucoup de choses restent à inventer.
Ballast – Votre réflexion et le lexique qui la structure sont ouvertement gramscien (« hégémonie », « guerre de position », « journalisme intégral », etc.) : que peut le communiste italien embastillé sous Mussolini en 2017 ?
LVSL – Il peut beaucoup. Gramsci est un théoricien du politique fondamental si l’on veut sortir des impuissances structurelles du mouvement ouvrier, à condition qu’on en fasse une lecture correcte et que l’on n’en retienne pas uniquement la vulgate habituelle sur la « bataille des idées » et sur « l’importance du culturel à côté de l’économique ». Ces interprétations commodes, reprises tant à gauche qu’à droite (souvenez-vous du discours de Nicolas Sarkozy où celui-ci cite Gramsci, ou encore, plus récemment, Marine Le Pen lors de sa rentrée politique) prennent le risque de l’idéalisme et le risque d’affaiblir le potentiel révolutionnaire de cet auteur. La pensée d’Antonio Gramsci est beaucoup plus dialectique que cela. C’est un néomachiavélien, qui perçoit l’autonomie du politique et qui, en ce sens, rejette le déterminisme et l’eschatologie « marxiste » selon lesquels la révolution est inéluctable avec le développement du capitalisme, et selon lesquels la structure idéologique de la société est un pur reflet de la vie matérielle des individus. Pour Gramsci, il y a une interpénétration profonde entre ce qui relève de la culture et ce qui relève de l’économie. Bien évidemment, la vie matérielle des individus vient modeler leurs perceptions idéologiques, mais la culture joue à son tour le rôle de médiation et de condition des relations économiques. Croit-on réellement qu’il pourrait y avoir des relations économiques sans relations contractuelles implicites ou explicites ? sans le droit ? sans des préférences collectives et individuelles de consommation ? bref, sans production idéologique ? Il est évident que ce n’est pas le cas. Gramsci permet ainsi d’opérer une analyse fine de la façon dont les relations économiques et culturelles s’articulent. Il permet de sortir de cette dichotomie stérile qui consiste à les opposer. Aux « marxistes », il rappelle que les mouvements du politique ne résultent pas de la variation du taux de profit et de l’augmentation du taux de plus-value. Aux idéalistes, il rappelle que les idées sont travaillées par la vie matérielle des individus, par leur insertion sociale et leur quotidien (dont le travail est une composante non-négligeable !).
« Le journalisme intégral nous conduit aussi à développer une nouvelle conception du journaliste. Celui-ci n’a pas uniquement le rôle d’informer, il doit prendre parti. »
Au-delà, Gramsci permet au mouvement ouvrier de sortir de sa négation du rôle de l’intellectuel et de son refus de l’élitisme. Chez le communiste italien, l’intellectuel organique joue un rôle de médiation, de traduction, entre les catégories populaires et la société politique. Les intellectuels doivent à la fois s’extirper du sens commun, des représentations majoritaires et immédiatement accessibles qui structurent le rapport des individus à la réalité, et y replonger en permanence. Leur fonction est profondément dialectique et exigeante, car ils doivent faire des allers-retours continus, et parce qu’ils meurent comme intellectuels organiques dès lors qu’ils se coupent de ce sens commun. C’est à cette condition que le « Prince moderne » (terminologie empruntée à Machiavel pour désigner ce que doit être le Parti) peut être réellement efficace et jouer son rôle révolutionnaire. Il y a une vraie pensée stratégique et politique chez l’auteur des Quaderni del carcere (Cahiers de prison). De même, on entend beaucoup parler de « conquête de l’hégémonie culturelle » comme enjeu fondamental de la politique lorsqu’on évoque Gramsci. Beaucoup de militants et de journalistes pensent qu’il s’agit uniquement de diffuser ses idées dans la société civile. Mais cette conquête est beaucoup plus exigeante. Il s’agit, pour le militant, l’intellectuel et le journaliste, de travailler le sens commun, de l’orienter vers son propre projet politique. Cela implique de ne pas être trop éloigné de ce sens commun. Il faut se situer en permanence à mi-chemin entre les représentations majoritaires et le projet de société que l’on souhaite, et pas uniquement contre le sens commun. Il faut donc admettre qu’il y a une part de vérité chez l’adversaire, parce que celui-ci est souvent bien meilleur que nous pour se faire entendre de la majorité de la population — et l’on doit saisir cette part de vérité pour la retourner et mieux combattre cet adversaire. Lire Gramsci ainsi invite à se remettre en cause en continu : « Suis-je déconnecté du sens commun de l’époque ? Est-ce que je vis et évolue dans un système en vase clos qui me fait diverger des subjectivités des gens ordinaires ? » La pensée gramscienne est alors une invitation au décloisonnement culturel, au fait de partir des demandes politiques et des subjectivités, et non de ses propres idées. Sans cela, on prend le risque de se contenter d’aller évangéliser le reste de la population en lui dévoilant la réalité des mécanismes décrits dans Le Capital et Le Manifeste du Parti communiste.
Venons-en au journalisme intégral. En ce qui nous concerne, et sans que celle-ci soit précisément définie, il s’agit de construire et d’imprimer une vision du monde — Gramsci utilise le terme allemand Weltanschauung, qui renvoie à un ensemble de représentations qui forment une conception, une totalité. Celle-ci doit nécessairement s’articuler avec le sens commun de l’époque. C’est pourquoi nous avons repris l’ensemble des codes des réseaux sociaux pour mieux les détourner. C’est aussi pourquoi nous avons évacué toute la vieille esthétique gauchisante qui était une barrière mentale et symbolique à la réception de nos articles. Le journalisme intégral nous conduit aussi à développer une nouvelle conception du journaliste. Celui-ci n’a pas uniquement le rôle d’informer, il doit prendre parti, et adopter un style percutant. Son rôle est de se construire comme intellectuel organique, de faire le pont entre ses lecteurs et la société politique. Le lecteur ne doit pas être perçu comme un simple réceptacle passif qui reçoit la production idéologique, il doit être actif dans cette relation. D’une certaine façon, le journaliste a une mission d’éducation — et non de pédagogie, terme si cher aux néolibéraux. Il doit aider le lecteur à s’élever et à devenir lui-même journaliste. À Le Vent se lève, cela se traduit par le fait qu’un nombre non-négligeable de nos lecteurs sont devenus des rédacteurs.
Ballast – Vous ne cachez pas votre proximité idéologique avec la France insoumise. Votre média est-il compagnon de route, soutien critique, ou rien de tout ceci ?
LVSL – Il y a méprise, mais nous comprenons qu’elle existe. Cela est probablement lié au fait que quelques articles remarqués assumaient une proximité idéologique avec la France insoumise, et que nous avons réalisé un certain nombre d’entretiens avec des cadres de ce mouvement. En même temps, il aurait été absurde de ne pas le faire, dans la mesure où la FI est à l’évidence devenue la force politique hégémonique dans ce qu’on a coutume d’appeler « la gauche ». Nous ne pouvions passer à côté de ce phénomène. Et, bien entendu, certains membres de LVSL se retrouvent à titre personnel dans la stratégie populiste mise en œuvre par la FI. Pour autant, nous sommes radicalement indépendants, et nous devons le rester, sinon notre projet serait tué dans l’œuf. Notre rôle n’est pas de soutenir tel ou tel mouvement. Le faire serait contre-productif, et vous noterez que nous n’avons jamais donné une seule consigne de vote. Nous prenons nos lecteurs au sérieux, ils sont suffisamment grands pour faire leurs choix politiques en conscience. Par ailleurs, nous sommes plus de 80 dans la rédaction de Le Vent se lève, et celle-ci est hétérogène. Il y a des anciens du PS, des communistes, des Insoumis, quelques chevènementistes, et un nombre important de personnes qui ne se sont jamais encartées nulle part. Nous n’avons pas à parler d’une seule voix. En fait, et c’est peut-être là le plus difficile à comprendre, nous n’avons pas de ligne politique ou idéologique unique. Nous partageons certes un ensemble de principes — par exemple : la justice sociale, l’écologie politique, l’internationalisme, etc. —, mais ce qui fait surtout l’unité et l’originalité de Le Vent se lève, c’est la méthode. On peut la qualifier de populiste, ou de gramscienne, mais cette méthode ne présuppose aucune adhésion partidaire ou programmatique.
Ballast – Vous vous revendiquez du « sens commun ». Olivier Besancenot nous confia un jour être circonspect quant à cette notion, en ce qu’elle peut conduire à épouser, par cynisme ou stratégie, le discours de l’adversaire. Comment tenir le cap du « progrès » que vous revendiquez ?
« Un espace médiatique sain est nécessairement pluraliste. Nous sommes très attachés à cette valeur cardinale : elle est constitutive de notre rédaction. »
LVSL Bien évidemment, le risque d’épouser le sens commun existe, mais cela n’est absolument pas la méthode que nous revendiquons. Il faut être à mi-chemin, c’est-à-dire ni contre, ni avec le sens commun. Cette exigence est une ligne de crête, car il existe tantôt le risque de tomber dans une simple opposition, tantôt le risque d’épouser complètement le sens commun néolibéral. Pour tenir ce cap, il faut que les rédacteurs exercent un travail exigeant de réflexivité et de remise en cause critique des idées qu’ils développent et des formes que celles-ci prennent. Sans ce travail d’articulation de notre vision du monde avec les représentations majoritaires, sans cette éducation à tenir la ligne de crête, notre travail est vain. C’est un effort quotidien si l’on veut tenir le cap du progrès.
Ballast – L’un de vos textes s’est élevé contre les « récupérations douteuses » d’Orwell par des « intellectuels plus ou moins réactionnaires ». Deux écueils guettent tout média critique : la grosse tambouille (on sait l’intérêt grandissant que suscite, dans une frange du camp anticapitaliste, une Natacha Polony) et le sectarisme (on sait la chasse à la virgule prisée par une frange de l’extrême gauche). Comment manœuvrez-vous ?
LVSL – Vous le savez probablement aussi bien que nous, c’est compliqué. Un espace médiatique sain est nécessairement pluraliste. Nous sommes très attachés à cette valeur cardinale : elle est constitutive de notre rédaction et nous devons la protéger si nous désirons maintenir une liberté de ton féconde. C’est pourquoi nous avons publié un article qui critiquait le traitement dont Natacha Polony a fait l’objet. Pour autant, comme vous l’avez noté, cela ne nous a pas empêchés de publier un texte contre les récupérations douteuses d’Orwell. Notre ligne consiste donc à défendre le pluralisme tout en organisant le débat d’idées. Récemment, nous avons réalisé un nombre important d’entretiens dans lesquels des acteurs de la France insoumise comme de Podemos défendaient le populisme de Laclau et Chantal Mouffe. Il nous a paru nécessaire de réaliser un entretien avec Guillaume Roubaud-Quashie, du PCF, qui critique la stratégie populiste, parce que le débat contradictoire, lorsqu’il est bien organisé, c’est-à-dire lorsqu’il ne ressemble pas aux caricatures qu’on en fait dans les médias dominants, permet de faire avancer les choses. Ainsi, si l’on veut défendre le pluralisme, cela implique de bien préparer les entretiens que nous faisons, et de montrer une certaine distance critique. Cette exigence est d’autant plus forte lorsqu’il s’agit d’intellectuels et de personnalités controversés. Si nous devions réaliser un entretien avec Natacha Polony, par exemple, vous pouvez être sûrs que nous préparerions bien nos questions. Il n’y a donc pas de choix à faire entre le sectarisme et la tambouille. Le tout est de prendre ses lecteurs au sérieux, de les traiter comme des adultes, et non comme des enfants qui épouseront nécessairement les positions développées dans tel ou tel article ou tel ou tel entretien. Cela exige évidemment de mener l’entretien de façon adéquate, et d’exercer en permanence cette distance critique si nécessaire à un débat d’idées bien organisé.
Ballast – Iñigo Errejón, cadre de Podemos, vous disait cet été qu’il aspirait à la victoire du pôle « de droite » du FN, dans la bataille qui fait rage dans ses rangs, afin de mettre à mal, une fois pour toutes, l’idée que le FN serait la voix du peuple. C’est ce qu’il s’est produit, à la rentrée : l’aile « sociale » (Philippot) a été limogée, Marine Le Pen s’est lancée dans une diatribe hallucinée que n’aurait pas reniée son père et Ménard, libéral en chef, se frotte les mains. Le FN « défenseur des sans-grades, des petits, des invisibles » est-il en train de mourir ?
LVSL – Lorsque l’on voit la dernière performance de Marine Le Pen à l’émission politique, ce qui est sûr, c’est que le FN est très affaibli, et qu’il y a donc un espoir de pouvoir désaffilier certaines catégories populaires du vote frontiste. Le FN est plongé dans de profondes contradictions. S’il adopte une ligne d’union des droites, ce qui n’est pas encore fait mais qui est en bonne voie, il doit nécessairement abandonner la sortie de l’euro, qui est un casus belli pour la droite version Wauquiez. Mais en abandonnant ce discours critique, les frontistes devront normaliser certaines positions économiques hétérodoxes qu’ils tenaient jusqu’à ce jour. Cela implique le risque de perdre les catégories populaires conquises ces dernières années. En fait, la crise du FN révèle la crise de la droite post-sarkozyste. L’équation qui a permis à la droite d’arriver au pouvoir et de se maintenir était l’union de la bourgeoisie conservatrice retraitée et des catégories populaires de la France périphérique. Mais en réalité, ces deux électorats ont profondément divergé sous l’effet de l’approfondissement de la crise en zone euro et sous l’effet de la polarisation économique provoquée par la mondialisation. Dès lors, comment reconstituer un bloc historique majoritaire ? Les Républicains rassemblent essentiellement des retraités qui défendent leur épargne aujourd’hui, et ils sont concurrencés par Macron sur ce créneau. Le FN, lui, a fédéré un temps la France des « petits » et des « sans-grades » que vous évoquiez. Pour pratiquer l’union, le parti peut maintenir son discours identitaire, mais doit abandonner son discours économique et social, qui lui a permis de prospérer. En fait, l’extrême droite a aujourd’hui le choix entre le fait de retomber à 15-18 % et d’arriver au pouvoir, ou de faire 25 à 28 % mais de rester confiné dans un ghetto électoral.
« La France insoumise a sensiblement limité la progression du FN dans les catégories populaires et les jeunes à la dernière élection présidentielle. »
Les cadres du FN, notamment les plus récents, veulent exercer des responsabilités et obtenir des postes. Ils ont donc logiquement fait pression pour marginaliser Philippot, qui incarnait d’une certaine façon l’option d’un score élevé, mais sans perspective d’arrivée au pouvoir. Celui-ci a en retour organisé son expulsion pour partir avec les honneurs et renvoyer le FN dans la poubelle de la diabolisation. Marine Le Pen, qui est de notoriété publique idéologiquement philippotiste, doit maintenant appliquer une ligne qui diverge de plus en plus de sa ligne idéologique. Elle est complètement affaiblie et symboliquement déclassée depuis le débat de l’entre-deux tours. Néanmoins, le FN va essayer de limiter la casse auprès des catégories populaires. C’est pourquoi le parti essaie de développer un discours plus « civilisationnel », de défense des « communautés » contre « l’individualisme libéral », de retour des « frontières » contre la société « liquide ». Dans ses discours les plus récents, Marine Le Pen n’a eu de cesse d’opposer à la « France nomade » d’Emmanuel Macron une « France durable » soucieuse de préserver son identité et de protéger ses citoyens des multiples méfaits de la mondialisation. C’est un mélange de la ligne Buisson et de la pensée d’un auteur comme Alain de Benoist. Il s’agit de continuer de prendre en charge le sentiment que « tout fout le camp » dans la France périphérique et de faire passer la pilule de l’abandon progressif de la sortie de l’euro et du verni social du programme. En fait, il n’était tout simplement pas possible de tenir un discours de sortie de l’ordre européen tout en fracturant les classes populaires par un discours identitaire qui oppose les « petits Blancs », les « Français de souche », et les Français dits des « quartiers populaires », terme commode pour parler de la banlieue et de l’immigration post-coloniale. Un tel programme de sortie de l’ordre européen implique de coaliser ces catégories qui souffrent toutes deux de l’ordre économique actuel. Bref, le FN est pris entre le marteau et l’enclume. Le marteau de Wauquiez, Dupont-Aignant et Philippot à droite, et l’enclume de la France insoumise qui a sensiblement limité la progression du FN dans les catégories populaires et les jeunes à la dernière élection présidentielle. Le risque est pour le parti de se faire avaler tout cru des deux côtés, et c’est une très bonne nouvelle.
Ballast – Les questions post-coloniales, décoloniales ou raciales paraissent absentes de votre spectre de réflexion : n’est-ce pas problématique lorsque l’on aspire à « construire un peuple », pour reprendre une formule qui doit vous être chère, et que ce peuple est également modelé par ces questions ?
LVSL – Ce n’est pas tout à fait juste. Nous avons par exemple publié un article de Cyprien Caddeo sur le racisme latent dans le cinéma français, et cet article avait donné lieu à une émission sur France culture. De même, nous avions publié un article lors de l’affaire Théo qui mettait en cause le racisme dont les descendants d’immigrés post-coloniaux font régulièrement l’objet. Ou encore, plus récemment, nous avons publié un article sur Thomas Sankara et l’absence scandaleuse de commission d’enquête parlementaire sur son assassinat, ainsi qu’un entretien avec le biographe de Sankara. Nous traitons donc ces sujets à notre façon. Mais nous n’esquiverons pas votre question. Il y a dans notre rédaction une pluralité d’approches sur la façon dont on doit lutter contre le racisme, et nous sommes de ce point de vue aussi hétérogènes que la gauche. Nous avons donc à cœur de ne pas importer les conflits qui ont miné notre camp à l’intérieur de LVSL. Nous avons tiré les leçons des polémiques qui ont eu lieu après les attentats de Charlie Hebdo et nous refusons aujourd’hui de participer au jeu médiatique qui consiste à racialiser les débats. Nous refusons l’agenda que veulent imposer tant les Indigènes de la République que Manuel Valls, qui n’existent que par ces polémiques. Bien sûr, on peut nous rétorquer que cela invisibilise ces enjeux, mais nous croyons que les dégâts produits par des discours performatifs qui racialisent la société et nos représentations sont aussi très élevés. Nous essayons de traiter ces questions sans fracturer la gauche, de façon pacifiée, sans jamais rien concéder aux discriminations.
Par ailleurs, nous doutons que les questions de racisme structurel puissent être traitées par le simple discours médiatique. Nous avons la conviction que c’est par l’action politique, par la mise en mouvement de ce peuple qu’il faut construire, que nous pourrons faire reculer le fait que les individus se regardent en fonction de leurs identités et non en fonction de ce qu’ils ont de commun : le fait d’être des citoyens français qui doivent récupérer la souveraineté sur leur vie et sur le destin de leur pays. Moins il y a de souveraineté, plus il y a un repli identitaire. Ce qui fait la France, ce n’est pas une couleur de peau, ni une ascendance historique, mais un ensemble de principes citoyens, un horizon politique en commun. C’est une communauté solidaire qui doit se protéger de l’offensive néolibérale en développant ses services publics, en opposant au mépris de ceux d’en haut la dignité de ceux « qui ne sont rien ». Nous adhérons en ce sens à l’idée d’un patriotisme démocratique, progressiste et inclusif défendue par Íñigo Errejón. Et en même temps, il faut avoir une vision sociale à la hauteur des difficultés. La ghettoïsation de notre société ne peut pas continuer. Il faut mettre fin aux ghettos de riches comme aux ghettos de pauvres. Il faut en finir avec cette logique néolibérale qui dresse des murs partout, qui développe des normes explicites comme implicites qui font diverger la société française et qui la fracturent.
Ballast – Vous évoquez les « bastions enclavés » que sont les grands médias alternatifs (Le Monde diplomatique, Fakir, Là-bas si j’y suis, etc.) et le « public restreint » qui reste malgré tout le leur. Vous espérez, comme beaucoup, toucher un public plus large que celui des fameux « déjà convertis » : le support écrit est, nous sommes les premiers à le savoir, un frein ! De quelle façon espérez-vous briser ce cercle « vicieux » ? Les médias indépendants ne manquaient pas. Quel axe inédit Le Vent se lève comptait-il, dans l’esprit de ses créateurs, porter ; quel angle à ses yeux mort souhaitait-il combler ?
« Depuis trop longtemps, beaucoup d’intellectuels se sont repliés sur eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils se sont coupés de la stratégie politique. »
LVSL – Si nous devions nous définir, et quitte à être un peu pompeux, nous pensons le média comme une entreprise culturelle globale. Nous considérons que LVSL est un lieu de formation, de construction de nouveaux journalistes qui assument le fait de faire du média d’opinion. Le fait de prendre la plume n’est pas un acte neutre et, de ce point de vue, nous avons essayé d’insuffler l’esprit suivant à nos rédacteurs : il faut, lorsque l’on écrit un article, penser en permanence à sa réception, au niveau des termes que l’on utilise comme des idées que l’on développe. Cette discipline permet de rester connectés au sens commun. Ensuite, nous avons pour but de faire le lien entre les intellectuels, les militants et les lecteurs par les entretiens que nous faisons, mais aussi par les cercles de réflexion que nous venons de créer et par les événements que nous allons organiser. Nous voyons Le Vent se lève comme un échafaudage, et non comme l’édifice. Depuis trop longtemps, beaucoup d’intellectuels se sont repliés sur eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils se sont coupés de la stratégie politique, même s’ils sont restés engagés ; ils ont arrêté de penser à la traduction de leurs idées dans des termes politiquement pertinents, donc dans des termes connectés au sens commun. De même, les partis, quels qu’ils soient, se sont vidés de leurs ressources intellectuelles depuis 30 ans, et ont de ce fait perdu en qualité d’élaboration stratégique. Nous voulons mettre un terme à ce cloisonnement, et donc être un lieu relativement neutre où les gens peuvent discuter, échanger et éventuellement travailler ensemble. Une discussion entre un lecteur peu politisé et un militant chevronné peut parfois rappeler à ce dernier qu’il constitue une minorité dans la société, et qu’il doit donc penser à la façon de traduire ses idées. C’est important : sans changement culturel des militants, aucune possibilité de prise du pouvoir dans la société civile comme dans la société politique n’est envisageable.
Nous voulons aussi utiliser tous les formats médiatiques, qui sont autant d’outils pour mener notre combat culturel : l’écriture en ligne, les colloques, les photos, les vidéos, les infographies, une éventuelle université d’été, voire une version papier, à terme. De même, nous cherchons à influencer le débat politique, c’est pourquoi nous avons produit des notes stratégiques. D’une certaine façon, nous voulons insuffler une conception machiavélienne de la politique, dans le bon sens du terme. C’est un peu l’identité de ce média. D’ici peu, nous annoncerons de nombreux développements de notre projet. Enfin, ce qui fait la particularité de Le Vent se lève, c’est sa volonté de ne pas laisser le monopole de la modernité et du progrès à ses adversaires, c’est le fait de toujours essayer de subvertir les codes et de réfléchir en permanence au fait de ne pas finir cornerisé. Nous voulons être transversaux, parler à tout le monde, et pas uniquement à notre petite clientèle. Ce qui implique des actes très concrets, beaucoup d’ambition et une remise en question permanente. Nous existons depuis décembre 2016, soit depuis moins d’un an, et nous allons continuer à essayer de nous dépasser.