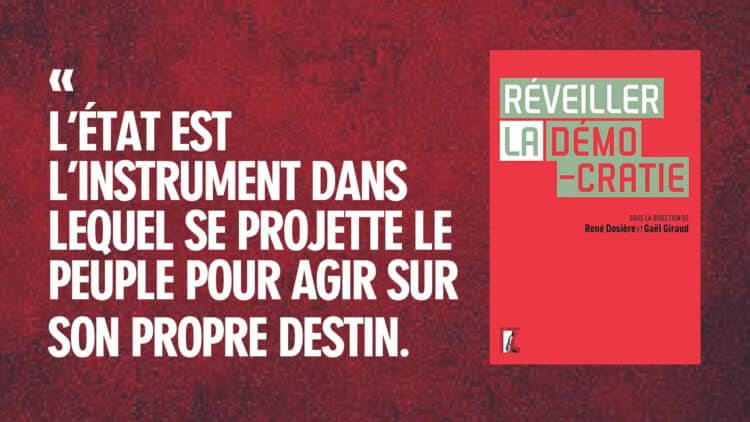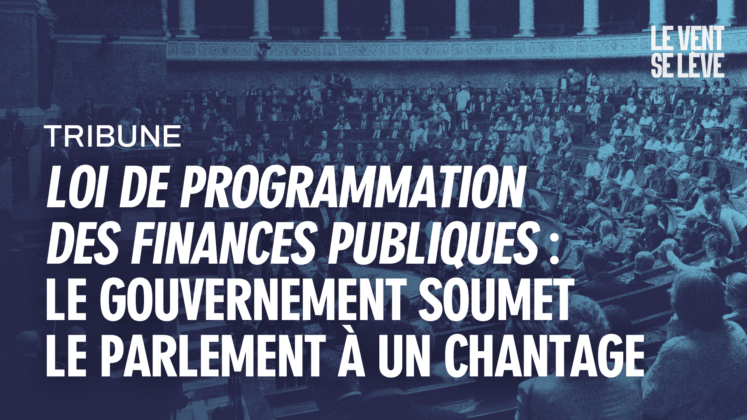Alors que le gouvernement tente de passer en force son budget à l’aide de l’article 49-3, l’opposition parlementaire a répondu par plusieurs motions de censure, qui « n’avaient a priori aucune chance d’être adoptées ». Face à une telle asymétrie, comment réveiller la démocratie ? C’est notamment le titre d’un ouvrage dirigé par Nicolas Dufrêne, Matthieu Caron et Benjamin Morel, qui donne la parole à des économistes, politologues et journalistes afin de réfléchir, proposer, et étudier les possibilités d’un renouveau démocratique. Entretien réalisé par Aitana Pérez et Albane Le Cabec.
LVSL – Le contexte actuel est marqué par certaines tensions démocratiques : les Français sont de plus en plus nombreux à bouder les urnes mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à réinventer les formes de mobilisations – les gilets jaunes ayant constitué une mobilisation exemplaire de ce point de vue – et réclamer plus de démocratie – avec la proposition du RIC par exemple. Avec ce livre, souhaitiez-vous éclairer le débat, nourrir les aspirations des Français de revendications concrètes ?
Nicolas Dufrêne – La démocratie est fragilisée par l’abstention et la montée des vieux démons – l’extrême droite et ce que Léon Poliakov appelait la causalité diabolique, c’est-à-dire le fait de désigner des boucs émissaires. Elle est fragilisée également par l’absence de tuyaux qui permettraient un contrôle citoyen de la politique ou une participation directe. En conséquence, les citoyens perdent le contact démocratique et l’envie de s’intéresser à la démocratie. Or, il n’y a pas de République sans républicains. Lorsque ceux-ci s’en détournent, elle ne peut qu’être dégradée. Avec cet ouvrage, nous voulions proposer aux citoyens des débouchés concrets à cette crise démocratique sans verser dans une prise de position excessive car nous ne vivons pas en dictature.
Matthieu Caron – Le débat public est extrêmement dégradé. D’une part, ce qu’on appelle la démocratie juridique va très bien : nous vivons dans un grand État de droit, même si certaines libertés publiques ont pu être fragilisées ces dernières années. Mais d’autre part, la démocratie politique est très fatiguée à cause de l’arrivée des chaines d’information en continue et des réseaux sociaux, qui ont participé à appauvrir le débat public. Au contraire, ces technologies favorisent les fake news, l’ère du complotisme et le tout-émotionnel. Nous avons voulu sortir du tout-émotionnel pour prendre de la hauteur. En formulant des solutions concrètes, nous espérons revenir à des postures saines et sortir des clivages idéologiques stériles.
Benjamin Morel – Je rajouterais que la crise de la démocratie est à la fois structurelle et conjoncturelle. Malgré des différences sociales et des systèmes politiques distincts, toutes les grandes démocraties occidentales vont mal ; les dernières élections en Suède nous montrent que même le modèle scandinave – sur lequel on s’est extasié pendant longtemps – est lui aussi entré en crise.
Le sentiment général de beaucoup de gens est qu’ils n’ont pas la capacité d’agir sur les grandes décisions et, qu’en retour, le politique ne peut rien non plus. Devant cette situation sans issue, les citoyens ont généralement deux réactions. D’abord le repli sur soi et l’abstention ; les citoyens pensent que si le politique ne peut rien pour eux, alors la seule solution est de protéger sa petite tribu. Cette réaction est amplifiée par la croyance selon laquelle les problèmes économiques et sociaux d’aujourd’hui seraient trop complexes et que seul un régime technocratique est de taille face aux enjeux de nos sociétés. La deuxième réaction possible est le désir de « faire péter le système ». Mais sans désir de changer les institutions politiques, ces citoyens désœuvrés se tournent vers celui ou celle qui se présente comme un Bonaparte, promettant de faire tomber à lui seul le système. Carl Schmitt, en bon critique de la démocratie, expliquait très bien ce mécanisme : un homme qui incarnerait cette capacité à agir sur le réel aurait toujours un avantage en cas de crise du politique.
Proposer des solutions concrètes permet justement d’éviter cette disjonction funeste. Mais ne soyons pas dupes, si les institutions sont un outil pour sortir de la crise, elles ne font pas de bonnes thématiques de campagne. Ces thématiques ne convainquent pas encore dans le champ électoral. C’est pourquoi nous cherchons davantage à réengager les citoyens avec ces propositions.
LVSL – Depuis 2017, et l’élection d’Emmanuel Macron, la volonté de l’exécutif de légiférer toujours plus efficacement et rapidement, notamment par un recours accru aux ordonnances, a accentué les craintes relatives à un affaiblissement du Parlement, qui serait dessaisi de sa fonction législative. Comment revaloriser le rôle du Parlement et des parlementaires ?
B. M. – La soumission politique du Parlement français est son principal problème. Son mode de scrutin, mais aussi sa faible autonomie d’expertise est en cause. Le manque de moyen du Parlement est criant : le coût d’un collaborateur en France est trois fois moins élevé en France qu’en Allemagne ; de sept par rapport aux États-Unis – ce qui les empêche de construire un contre-projet.
Toutefois les ressources ne sont pas seulement en jeu concernant le travail parlementaire. On donne aux parlementaires une tâche impossible : palier par l’abondance de lois, des problèmes qui ne relèvent justement pas de la rédaction de la loi. Pour comprendre l’enjeu des ressources, il suffit de considérer le problème de la sécurité publique : celui-ci ne peut être réglé qu’avec plus d’argent, de policiers, de juges, de coûts de force diplomatique avec les pays exportateurs de drogue, mais non en passant de nouvelles lois. Le problème de la sécurité publique n’est pas législatif, les lois qui sont passées pour le résoudre servent essentiellement à satisfaire un électorat.
C’est de cette façon qu’on alimente le phénomène communément appelé « inflation législative ». Or cela participe à délégitimer l’action du Parlement et favorise l’arbitraire, car ces lois ambiguës sont ensuite interprétées par des juges dont le pouvoir est de fait étendu, alors qu’ils ne sont pas élus par le peuple.
M. C. – Guy Carcassonne disait que « ce qu’il manque au Parlement, ce ne sont pas des droits mais des parlementaires pour les exercer ». Le Parlement a de nombreux pouvoirs, mais les parlementaires ne les exercent pas de crainte notamment de la dissolution. Et il faut dire que le Président porte peu d’estime au travail des parlementaires. Si l’on peut légiférer à coups de 49-3 pour résoudre une crise, il n’est pas acceptable ni légitime d’utiliser cet instrument pour réformer le marché du travail ou les retraites.
Il faudrait que le Président entre dans une logique de co-construction avec le Parlement en évitant d’avoir recours à ce type d’instrument lorsqu’il rencontre une opposition ou en acceptant les propositions du Parlement. Renforcer les rôles du Parlement ne nécessite pas de réformer la constitution comme on l’entend souvent. Commençons par respecter et valoriser le Parlement par une autre pratique politique de la Constitution.
LVSL – Les événements politiques de ces dernières années ont montré que les Français aspirent à plus de démocratie participative et directe. Vous alertez également sur les risques de « consultation washing », sorte d’ersatz de la démocratie participative. Qu’est-ce que la démocratie participative et directe et qu’est-ce qu’elle n’est pas ?
B. M. – Tout d’abord j’aimerais définir ces deux concepts, souvent utilisés de manière interchangeable alors qu’ils ne renvoient pas exactement aux mêmes revendications. La démocratie participative c’est chercher à consulter les citoyens, à les intégrer dans le processus de décision, en soit en consultant les citoyens qui veulent entrer en dialogue, grâce à des consultations citoyennes ou le droit d’amendement, soit en recourant au tirage au sort par exemple.
La démocratie directe consiste plutôt à ne pas déléguer la formulation de la volonté générale aux représentants et s’ancre dans les traditions rousseauistes et celles des Montagnards. Elle repose sur l’idée que les représentants ne peuvent pas connaître la volonté générale, ils peuvent seulement la deviner ; c’est pourquoi il faut des outils d’expression directe pour que les citoyens puissent corriger leurs représentants lorsqu’ils ont mal interprété leur volonté.
Notre ouvrage étudie les façons de faire de la démocratie participative et directe, en étudiant les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles et en formulant des propositions concrètes qui permettent d’éviter leurs écueils. Par exemple, les consultations citoyennes ne permettent d’inclure qu’un échantillon restreint de la population, peu représentatif de son ensemble, puisqu’y participeront ceux qui sont déjà politisés. C’est pourquoi le modèle a ses limites et peut être caricaturé à la façon des conventions citoyennes organisées par Macron pendant son premier mandat. De l’autre côté, le tirage au sort permet un meilleur brassage de la population mais il faut bien avoir en tête que les citoyens non-politisés se politiseront auprès d’experts, ce qui suppose qu’un cadre de formation des citoyens et de délibération soit pensé pour favoriser l’expression citoyenne la plus éclairée possible.
Mais je tiens à dissiper d’entrée de jeu des peurs infondées. Nous craignons souvent que le peuple choisisse mal, qu’il soit populiste. Or les nombreuses expérimentations de démocratie directe dans certains États américains, ou certains de nos voisins européens, montrent que non seulement ces initiatives sont techniquement et juridiquement possibles à mettre en place, mais aussi que l’avortement n’a jamais été interdit ni la peine de mort rétablie par référendum. La raison en est que les citoyens s’informent et se politisent lorsqu’ils sont consultés. L’exemple du référendum de 2005 est assez significatif, il n’aurait pas constitué un aussi grand traumatisme démocratique si les citoyens ne s’étaient pas instruits dans le but de formuler un choix éclairé : les gens ont lu et écouté les politiques et les universitaires pour préparer leur vote. Il faut se souvenir que l’école forme à la politique mais que la politique forme le citoyen, faisons donc confiance aux citoyens.
N. D. – Il faut des instruments plus fréquents de consultation des citoyens par l’usage des référendums d’initiative populaire, et assurer les conditions d’une expression populaire informée en communiquant suffisamment pour impliquer les citoyens autrement que de façon ponctuelle, et/ou sous l’initiative des politiques.
La proposition d’amendement citoyen de Beverley Toudic va dans ce sens, car ce droit permettrait à des citoyens de proposer un amendement et, s’ils obtiennent plus de 100 000 soutiens, ils verraient leur texte étudié par l’Assemblée nationale et participeraient de fait au processus législatif.
Cette proposition aurait une vertu démocratique majeure : il serait difficile pour la majorité de traiter sous la jambe un amendement issu directement de l’expression populaire.
Pour revenir à la question du « consultation washing », il n’y a rien de pire pour la démocratie que de faire semblant d’associer des citoyens à une décision sans que cela ne se reflète dans les faits, comme nous l’avons vu avec la Convention citoyenne pour le climat. Cela a pour effet de tenir la parole des citoyens – la seule légitime pourtant – comme suspecte, ou peu légitime tant qu’elle n’est pas corrigée par celle des experts. En 2005, le peuple a refusé un projet de traité par référendum et ce choix n’a pas été respecté. Les gouvernants peuvent penser que le peuple s’est trompé, mais ils ne peuvent pas bafouer son choix. Lorsque le peuple est consulté, les politiques doivent respecter leur expression, peu importe le choix des citoyens, au risque de dévaluer leur parole et de renforcer le sentiment que « ceux d’en haut » méprisent la parole populaire
M. C. – Face à l’effondrement culturel que nos sociétés connaissent, le réengagement politique des citoyens est crucial. Pour cela, il ne suffit pas de légiférer et de changer les règles du jeu institutionnel, il faut aussi accompagner les citoyens tout au long de leur vie pour leur donner le bagage culturel nécessaire la participation.
Notre ouvrage formule plusieurs propositions parmi lesquelles la formation citoyenne tout au long de la vie afin de sensibiliser à l’écologie, l’entrée de la philosophie beaucoup plus tôt dans la formation scolaire, ou encore l’enseignement de l’économie à l’école pour que les citoyens comprennent les mécanismes de base de ce domaine.
LVSL – L’éveil de la démocratie suppose non seulement de renouveler les structures démocratiques existantes mais aussi d’étendre la démocratie à des domaines qui ne sont aujourd’hui régulés par aucun principe démocratique – l’entreprise, le marché de l’emploi, la politique monétaire… Sans cette dimension de démocratisation de l’économie, le réveil démocratique est-il compromis ?
M. C. – Plus j’avance, plus je pense que les grandes réponses démocratiques sont du côté de l’économique, du social et de l’environnemental. L’entreprise est par exemple un impensé démocratique. En France, nous sommes enfermés dans une vision caricaturale de l’entreprise entre ceux qui la résument à un lieu du profit, et ceux qui la réduisent à un lieu d’antagonisme de classes. L’entreprise mérite plus que cela : elle est un lieu de création des richesses humaines, de socialisation et d’innovation. La transformation économique et sociale n’adviendra pas sans elle. Or il faut construire les conditions pour qu’elle favorise l’« altercroissance », imaginer les conditions de l’avènement d’une « écolo-démocratie ».
N. D. – On a tendance à penser les questions du pouvoir et de la démocratie en termes d’institutions politiques. En réalité, ces questions dépassent ce cadre institutionnel. Les questions relatives aux médias, à la finance ou à la monnaie sont également cruciales pour la vie démocratique et pour l’expression de la population. On ne peut pas avoir une démocratie qui s’arrête aux portes de l’entreprise et du fonctionnement du marché. Cela résulte d’un choix idéologique qui n’a rien de naturel ou d’inaltérable, même si un certain nombre de pratiques ultralibérales, comme le dogme de la libre concurrence, ont été constitutionnalisés par les traités européens. De la même manière, les autorités administratives indépendantes ou les institutions indépendantes comme la BCE posent un problème démocratique majeur : leur indépendance du pouvoir politique est un moyen de soustraire leur action au jugement collectif et démocratique. Il y a ainsi une série d’institutions et de pouvoirs qui pourraient être élus. À titre d’exemple, on peut penser à l’ancien fonctionnement de la Sécurité sociale. Si on ne démocratise pas ces institutions, on court le risque qu’elles deviennent impuissantes. En effet, ces institutions indépendantes n’ont par définition pas la « légitimité » d’opérer par elles-mêmes des changements majeurs, car ces derniers ne peuvent venir que d’une décision politique. Par conséquent, leur indépendance conduit à une forme d’immobilisme. En outre, ceci génère un jeu malsain entre les différents pouvoirs : le gouvernement se déresponsabilise en affirmant que telle ou tell politique (par exemple la politique monétaire de la BCE) ne relève pas de son domaine tandis que les institutions indépendantes se déresponsabilisent également en disant qu’elles se limitent à respecter son mandat.
Nous sommes donc face à une déresponsabilisation croissante du pouvoir, que nous souhaitons combattre par le récit des biens communs, qui supposent une gouvernance commune entre l’Etat et le corps social de toute une série de fonctions fondamentales : la sécurité sociale, la politique monétaire (nos ancêtres du CNR voulaient ainsi établir un « parlement du crédit et de la monnaie »), les règles relatives au chômage ou à la retraite. Il n’y a aucune raison pour que ces biens communs échappent au regard de la collectivité. Au lieu de fossiliser l’État social par un recours excessif à des normes et à des institutions indépendantes, nous devons réintroduire la pratique et l’idée du dialogue permanent.
B. M. – La démocratie est confrontée à trois crises distinctes. D’abord, la crise de la représentativité, qui est ressentie en France et dans le monde entier. Ensuite, nous connaissons une crise du débat public : la campagne présidentielle, tout comme les élections départementales, régionales et municipales, n’ont pas été couvertes, noyées dans les informations sur la guerre en Ukraine ou l’épidémie de Covid. Tout ceci est la conséquence d’une certaine façon de prioriser l’information. Les réseaux sociaux favorisent un système d’information en silos où prospèrent les fake news, par lequel les points de vue se confrontent et dont peut surgir une forme de vérité qui est entrainée par une dialectique du débat.
Le troisième aspect de la crise de la démocratie est l’impuissance politique. L’élément central de l’action politique reste l’économie : reprendre le contrôle de la sphère économique est un impératif démocratique. En ce sens, la réimplication du peuple dans l’appareil économique est nécessaire. Mais il y a aussi le rôle de l’État. Au début de la crise des gilets jaunes, on ne parlait pas de RIC. Le sujet initial du mouvement concernait le fait de remplir son frigo pour nourrir ses enfants, et de faire en sorte que l’État en prenne sa part de responsabilité. Mais l’État s’est dit incapable de le faire. Le RIC n’est donc pas à l’origine des gilets jaunes, mais c’est le moyen que les gens ont trouvé pour forcer l’instrument de souveraineté qu’est l’État à mener une politique économique qui semble légitime car nécessaire. En pleine crise du Covid, les gens disaient que l’État était en incapacité d’agir. Or, les enquêtes montrent que les Français croient que le niveau d’intervention adéquat n’est pas international ou local mais national. L’État reste ainsi l’instrument dans lequel se projette le peuple pour agir sur lui-même et son destin. Si jamais on ne donne pas les moyens d’agir à l’État, les citoyens feront soit le choix du renversement du système en votant Le Pen, soit le choix de la désaffection et de l’abstention politique.
LVSL – Certaines institutions françaises ont perdu les principes démocratiques qui guidaient leur organisation. Comme vous le rappelez, les assurés votaient pour élire les administrateurs de la Sécurité sociale jusqu’en 1962. Alors que le gouvernement semble aujourd’hui prêt à mettre en œuvre une réforme des retraites largement rejetée par les Français, quel rapport de force permettrait le retour de ce modèle démocratique de la Sécurité sociale ?
B. M. – Lors du premier quinquennat Macron, la question du pouvoir des partenaires sociaux s’est posée. Macron a pu recevoir les syndicats, mais uniquement pour faire de la pédagogie et les consulter de manière fictive puisque les projets de loi étaient déjà écrits et n’avaient pas vocation à évoluer. Il s’agit d’un Président totalement omnipotent en ce sens, avec une majorité pléthorique à ses ordres, qui est d’ailleurs peu représentative de la population. Les députés LREM-MODEM au premier tour représentaient 30% des votants, soient 17% des inscrits. Les contrepouvoirs au sein des institutions démocratiques sont ainsi totalement neutralisés. Macron peut faire la réforme des retraites grâce au 49-3 ; pourquoi dialoguerait-il alors ? Le peuple a perdu la possibilité de s’opposer à ses représentants : pour mettre en place le référendum d’initiative partagée, un nombre très élevé de signatures est nécessaire, et les deux chambres doivent refuser d’examiner le texte pour qu’il y ait référendum. Un changement de perspective est nécessaire pour intégrer les citoyens dans les institutions.
M. C. – Les gens ont compris qu’une réforme des retraites est nécessaire, mais ils ne veulent pas entendre qu’il n’y a qu’une seule solution possible : celle de travailler plus longtemps. Ils savent bien qu’un changement peut advenir en agissant sur bien d’autres facteurs – la durée des cotisations, la pénibilité, le travail à temps partiel ou le plafonnement des pensions notamment. L’enjeu aujourd’hui est de créer des nouveaux corps intermédiaires et de nouveaux contrepouvoirs pour penser ces réformes de manière sereine. Les syndicats sont de moins en moins légitimes aux yeux des Français car ils s’enferment trop souvent dans une logique de conflictualité. Les nouveaux corps intermédiaires pourraient ressembler à la Convention citoyenne pour le climat qu’on aurait dû respecter. Ce modèle mériterait d’ailleurs probablement d’être utilisé pour la réforme des retraites.