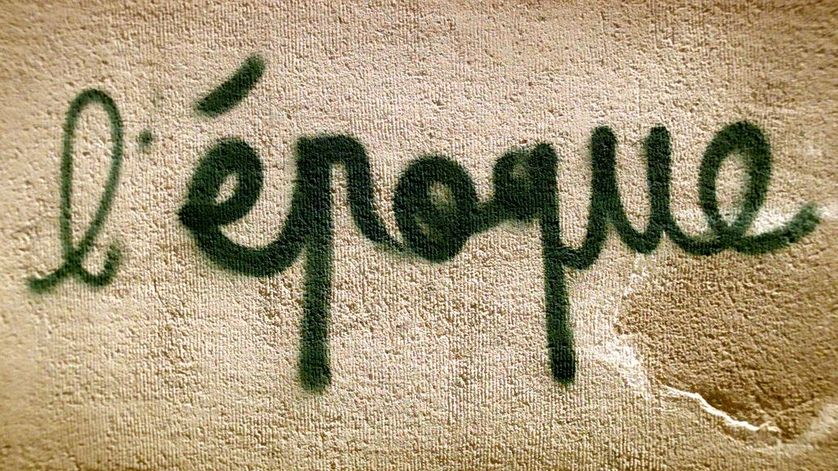Antonin Baudry est le réalisateur du film à succès « Le chant du loup », dans lequel il met en scène la réaction de la Marine française dans le cadre d’un potentiel conflit nucléaire. Avec les acteurs Omar Sy, François Civil, Mathieu Kassovitz, Paula Beer, Reda Kateb et un budget adéquat, il nous plonge avec brio dans le monde mystérieux des sous-marins, et pose la question de la pertinence des systèmes établis pour répondre aux situations de crise. Par Pierre Gilbert et Pierre Migozzi.
Antonin Baudry est un homme au parcours atypique. Avant de se lancer dans le cinéma, il était diplomate aux États-Unis et conseiller du ministère des Affaires étrangères. Polytechnicien puis normalien, il s’est illustré dans le domaine des arts avec la BD à succès “Quai d’Orsay”, qu’il a écrit sous le pseudonyme d’Abel Lanzac – pour laquelle il a remporté le Fauve d’or (prix du meilleur album de l’année) au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2013 – avant de scénariser lui-même l’adaptation cinématographique éponyme aux côtés de Bertrand Tavernier, ce qui lui a valu une nomination aux César en 2014. Il a également créé à New York, dans le quartier de Manhattan, en 2014, la librairie francophone et francophile « Albertine ».
Ceux qui ont vu le Chant du loup, son premier film, auront noté le réalisme et l’originalité du scénario, qui n’est pas sans rapport avec cette biographie particulière. Avec lui, nous avons voulu parler de son film, mais aussi de géopolitique, du rôle du cinéma dans le “soft power français” ou encore de la mise en récit cinématographique de la crise écologique.

LVSL : Dans Le chant du loup, vous présentez une situation géopolitique complexe, où un groupe terroriste s’empare d’un ancien sous-marin soviétique lanceur d’engins, et tente de déclencher une guerre nucléaire. Pensez-vous qu’une telle situation puisse arriver aujourd’hui, alors que l’État islamique a été vaincu en Syrie ? Quelle est, selon vous, la forme la plus probable que prendra le terrorisme dans les prochaines années ?
Antonin Baudry : Ça dépend de nous… Le terrorisme, ce n’est pas un État, c’est une méthode, donc la méthode s’adapte. C’est une méthode qui consiste à utiliser les forces et les faiblesses de son adversaire. En l’occurrence, plus les médias ici donnent de l’importance à des actes qui seraient liés au terrorisme, plus il y aura de terrorisme.
Là, dans le film, on a des gens qui essaient de prendre le contrôle d’armements, parce qu’ils n’en ont pas. Et ça fait partie des scénarios qui sont redoutés un peu partout, parce qu’évidemment, c’est ce qu’il y a de plus dangereux. Dans le film, ils essaient d’utiliser les faiblesses de leurs adversaires : ce qui fait vraiment des dégâts, c’est notre réaction à nous. La réaction au « 11 septembre » a fait plus de dégâts que le 11 septembre : la guerre d’Irak. Dans le film, la réaction à un missile non chargé risque de faire plus de dégâts que le missile lui-même : déclencher une guerre nucléaire. En fait, le terrorisme c’est un miroir, parce qu’on ne peut pas prévoir les formes qu’il prendra, surtout si on ne voit pas clair sur la société dans laquelle on veut vivre.
L’État islamique a perdu du terrain, oui… Mais le terrorisme en reprendra, sous une forme ou sous une autre. C’est un film qui se situe dans un futur qui va de nos jours jusqu’à dans 10-15 ans. Quand un groupuscule terroriste meurt, un autre émerge. Je ne pense pas, malheureusement, que la source de conflits soit tarie.
Dans le film, cette question sur l’arme nucléaire, c’est évidemment pris dans un contexte qui me semble assez réaliste, en tout cas j’ai fait beaucoup de recherches pour que ça soit réaliste. Mais c’est aussi une métaphore plus large, c’est-à-dire qu’on vit dans un monde où l’homme peut se détruire lui-même, et c’est quand même assez nouveau. L’arme nucléaire, c’est un symbole de tout ça, mais on peut aussi penser à l’environnement, au changement climatique, etc. La question qui est posée dans le film, c’est : qu’est-ce qui peut nous sauver de la menace qu’on fait nous-mêmes peser sur le monde ? Est-ce que ce sont les systèmes de manière générale ? Les systèmes d’alliances diplomatiques, le système militaire, les systèmes politiques… ou est-ce que ce sont des relations humaines, de conscience à conscience, ou est-ce que c’est un mélange de tout ça ?
Je n’ai pas de réponse, et le film n’en apporte pas vraiment non plus, mais je pense qu’il pose ces questions-là.

LVSL : Le cinéma français – actuel, et même en général – peut-il se permettre de jongler avec des faits géopolitiques d’actualité dans des films de divertissement, comme le font les films américains depuis les années 50, ou même les séries depuis les années 2000 (on pense à « 24 heures chrono », par exemple) ? Vous a-t-on fait des remarques du côté du Ministère des Affaires étrangères par exemple ? Peut-on parler de tout, aujourd’hui, dans un film en France ?
A.B. : La réponse est oui ! J’en ai été très agréablement surpris. Même si ce film a nécessité une collaboration avec l’Armée, à aucun moment il n’y a eu de quelconque tentative pour influencer le discours, ou ce qu’on montrait… Je pense qu’il y a, en France, un vrai respect de l’auteur, qui s’est propagé à tous les niveaux de la société, y compris dans l’armée.
Je suis persuadé qu’un film comme celui-là aux États-Unis, n’aurait pas vu le jour parce que la Marine américaine n’aurait pas supporté qu’à la fin, un sous-marin soit coulé, qu’il n’y ait pas de méchants qui meurent, pas de gentils qui s’en sortent bien. Ç’aurait été à la fois briser les codes d’Hollywood, et à la fois, ça aurait probablement posé un problème à la Marine. En France, on peut faire ça, oui.
Et je trouve important qu’en France et en Europe, on crée nos propres images du monde, et quand vous demandez « est-ce qu’on peut, sous forme de divertissement, parler du monde ? », je pense qu’on peut et on doit, à condition cependant de ne pas manipuler, ne pas raconter n’importe quoi.
C’est pourquoi j’ai voulu que cette histoire soit réaliste. J’ai voulu m’assurer que tous les mécanismes que je décrivais soient réalistes. Que ce soit à l’intérieur du sous-marin, l’irréversibilité d’un ordre de tir nucléaire une fois que le Président l’a envoyé, tout cela est totalement exact. Je ne me serais pas amusé à inventer des choses comme ça pour créer des rebondissements scénaristiques, ce sont des sujets graves, il ne faut pas raconter n’importe quoi.
Cela dit, qu’on puisse en faire de l’aventure, c’est important aussi ! Ça permet aussi de faire prendre conscience du moment dans lequel on vit à un plus grand nombre. Quand j’ai plongé pour la première fois dans un sous-marin, et que j’ai vu pour la première fois les missiles nucléaires dans leurs silos, avec des gens qui font des entraînements toutes les semaines pour qu’ils soient prêts à partir à tout moment, ça m’a fait un drôle d’effet ! Comme beaucoup de gens, je sais que ces missiles existent, mais le fait de les voir, prêts à partir… Moi, en plus, j’ai des enfants assez jeunes. Ma fille n’a pas du tout conscience de cet aspect-là du monde dans lequel elle vit, ça m’a fait d’autant plus d’effet. Mais ça existe bel et bien, et je pense que c’est important de faire connaître au public les questions que ça pose. Je pense qu’il ne faut ni se censurer, ni renoncer aux images et se dire qu’Hollywood devrait avoir le monopole de la représentation de ce sujet, ça suffit… On n’a pas la même vision du monde qu’eux.

LVSL : Justement, comment s’est passée votre collaboration avec la Marine ? C’est peu commun en France que l’Armée, qu’on appelle « La Grande Muette », facilite ce genre de projets, alors quel est l’intérêt pour eux, et comment avez-vous fait pour les convaincre ?
A. B. : La relation de confiance est difficile à instaurer avec les sous-mariniers, mais une fois qu’elle s’instaure, elle est là. En fait, leur préoccupation à eux était vraiment qu’on ne révèle pas des choses qui pouvaient porter atteinte à leur sécurité… Typiquement, ils étaient vraiment nerveux sur la profondeur maximum jusqu’où peuvent descendre les sous-marins, etc. Ce ne sont pas des choses qui sont cinématographiques, en fait, donc ça ne me posait aucun problème de ne pas révéler. À partir de là, il n’y avait plus de méfiance de leur côté, pas de problèmes. Après, c’est toujours excitant pour tout le monde qu’un film raconte un peu votre métier. Si je voulais faire un film sur vous, je pense que vous seriez content !
Il y a une convention qui se met en place entre la production et la Marine, parce que ce n’est pas rien. Les sous-marins ont des missions. On ne savait pas où se mettre dans leurs exercices pour ne pas créer de complications, mais il y a eu toute une logistique, il n’y a pas eu de débat moral parce qu’il n’y a pas eu d’empiètement. À partir du moment où on ne révélait pas des informations qui peuvent mettre en danger leurs systèmes ou leurs personnes, il n’y avait pas de tentatives de contrôler le message. Ça n’a posé de problèmes, ni à nous ni à eux. Honnêtement, je pense que l’idée de la Grande Muette, c’est une idée d’une autre époque.
LVSL : Et pour eux, quel intérêt ?
A. B. : Ça, je n’en sais rien, il faut le leur demander. Il y a déjà un engouement du fait qu’on raconte votre métier ! Il y a plein de films américains sur les sous-mariniers américains, il y a eu des films en France sur les gens de l’Armée de l’Air, et de Terre… Peut-être que les gens de la Marine étaient un peu frustrés aussi… Ce sont des gens qui disparaissent pendant 70 jours sous l’eau, sans communication avec personne. Il y a un côté complètement fou dans leur mission… Même leurs femmes, enfants, frères et sœurs, mères et amis, ne savent pas où ils vont ni comment c’est à l’intérieur, ils ne sont jamais rentrés dans un sous-marin… Il y a plein de gens qui me disent, après avoir regardé le film, « ça y est, je sais ce que fait mon père, maintenant ! »
Ils n’ont pas le droit de parler, ils n’ont rien le droit de dire, donc je pense qu’il y avait de ça aussi, il y a un plaisir à voir une représentation de ce qu’on fait.

LVSL : Aviez-vous conscience que, pour porter à l’écran un tel récit, vous deviez disposer d’un budget très conséquent, rare dans le cinéma français, relevant même de l’exceptionnel, voire de l’inédit, pour un premier long métrage. Le besoin de réunir un casting prestigieux et populaire était-il une condition sine qua non à l’existence du film ? Pour des questions de financement, ou était-ce une volonté personnelle dès le début du projet ?
A. B. : Quand j’ai écrit le film, je ne me suis absolument pas soucié de ça. La seule chose dont je me suis soucié, c’est d’écrire un film que j’avais envie de voir, et j’ai fait abstraction de la gestion de production qui pouvait avoir lieu après.
Ensuite, une fois que j’ai eu ce scénario sur la table, j’ai eu envie de le faire tel quel, et je suis effectivement tombé sur des producteurs qui avaient envie de prendre ce risque, de faire en France un film qui sorte de l’habituel et de le faire sérieusement.
Quand on m’a dit « oui », j’ai eu très peur, je me suis dit « merde, on va le faire pour de vrai ! ». Et je me suis demandé dans quoi je m’étais fourré, parce qu’effectivement, c’était mon premier film et ça me mettait une sacrée pression. Mais en même temps, c’était ce dont j’avais toujours rêvé.
C’est évident, quand on se lance dans un projet comme ça, qu’on a des producteurs qui jouent le jeu, je n’allais pas leur dire « les gars, vous savez quoi, j’ai une super idée, on va prendre 4 mecs qui n’ont jamais fait un film »… Je ne pouvais pas les mettre à ce point-là dans la merde. Donc, forcément, on essaie de trouver aussi des gens dont on se dit que ça va aider à ce que le public rencontre le film, mais il n’y a jamais eu de contrainte de type « il faut tel ou tel acteur ».
Moi, je n’étais pas du tout hostile à l’idée qu’il y ait des gens connus dans le film, j’étais hostile à l’idée que le héros soit quelqu’un qu’on a vu et revu. C’est quelqu’un qui sort d’un monde invisible, il faut qu’il ait cette « fraicheur ». C’est pour ça que j’étais ravi avec François Civil : il a fait plein de films, mais ce n’est pas quelqu’un dont on se dit, quand on le voit à l’écran, « je l’ai vu déjà 13 fois dans les 3 dernières années ». C’était important pour moi.
Après, j’ai eu de la chance, parce que les acteurs que je voulais m’ont tous dit « oui »… Reda, Omar, Paula et Mathieu m’ont tous dit « oui ». C’était eux que je voulais. Ça coïncidait à peu près avec ce qu’il fallait pour rassurer un peu les producteurs qui avaient pris de gros risques.
LVSL : Quand vous écrivez, par exemple, le personnage d’Omar Sy ou de Reda Kateb, vous pensez à des archétypes qui se rapprochent de ces comédiens-là, ou pas du tout encore à ce moment-là ?
A. B. : Non. Au moment où j’écris, je veux rester complètement libre. Je veux avoir mes propres personnages, et il y a ce moment, très beau et compliqué, où on confie ce personnage qu’on a en tête à un comédien, et qui va du coup le transformer, en faire son propre personnage, et en même temps on va le faire à deux, parce qu’on travaille ensemble… Ce moment-là est très beau. Mais j’évite d’écrire en pensant à un acteur, parce que le problème c’est que vous écrivez en pensant à lui dans un autre rôle que vous avez déjà vu, et presque obligatoirement vous allez lui faire refaire un rôle qu’il a déjà tenu, même si c’est dans un autre contexte. Je trouve intéressant quand on arrive à faire un peu différemment. J’essaie donc de ne pas trop écrire en pensant aux mimiques d’un acteur, je suis plutôt libre.
LVSL : Dans une interview récente, vous dites : « De par mon expérience en Cabinet ministériel, je sais que l’humain prévaut. Je me souviens d’une semaine de négociations à Hong-kong, qui nous a permis de sauver l’agriculture française. De fait, beaucoup de ministres étrangers avaient fréquenté les lycées français dans leur pays. Ils connaissaient la France, notre langue, notre histoire, cela nous a aidés à les convaincre ». Vous pointez ici l’importance du soft-power français. Comment, selon vous, pouvons-nous renforcer ce soft-power aujourd’hui ? Quelle politique publique concrète pourrait nous y aider ?
A. B. : J’ai assisté, effectivement, à des scènes où des gens qui étaient passés par des lycées français n’avaient pas du tout la même position de départ dans les négociations que des gens qui étaient complètement étrangers à notre paysage. Et de même, quand un Américain vous raconte son bla-bla, vous y êtes plus sensible parce que vous avez vu Game of Thrones. C’est idiot, mais c’est vrai.
Alors, comment peut-on faire ? En faisant plus de films qu’on exporte à l’étranger, peut-être en étant plus nous-mêmes, en refusant de vivre dans une culture dominée ou sous hégémonie américaine. J’ai vécu 5 ans aux États-Unis, j’adore ce pays ! Mes meilleurs amis sont là-bas. J’adore la culture américaine. Je trouve juste dommage que tout ce qu’on reçoit ici de la culture américaine soit « cheap » c’est à dire qu’on ne reçoit pas les bonnes parties de la culture américaine, en gros, on reçoit le McDo.
Et surtout, autant j’adore la culture américaine, autant je déteste toutes les attitudes de dominés qu’on peut avoir ici. Chaque fois que je rencontre un Français qui se résigne ou se complaît à être dominé par les États-Unis, ça me rend dingue.
Peut-être faudrait-il qu’on ait plus confiance en nous, qu’on soit plus à se dire qu’on est capable d’inventer un système différent, qu’on est capable de faire quelque chose qui fonctionne, par nous-mêmes. Il y a aussi la question de savoir comment arriver à utiliser politiquement l’échelon européen.
Je pense que tout ça va ensemble : arriver à créer des systèmes de pensée, ça va avec créer de l’imaginaire, créer des films et des livres. Je pense qu’il n’y a pas de réponse unique pour créer du soft-power, il y a juste la question de comment essayer d’aller au bout de nos convictions. C’est ce que vous faites, vous, à travers votre engagement dans ce journal. C’est ce que, moi, je fais, quand je fais un film.

LVSL : La création peut aussi se soutenir, ne faudrait-il pas abolir les accords de Blum-Byrnes de 1946, qui obligent la France à passer un très fort taux de films américains ?
A. B. : On a une assez bonne part de marché du film français en France, mais c’est sûr qu’il faut résister à cet envahissement. Il y a des films américains qui sont géniaux, et c’est cool qu’on les ait ici ! Ce qui est dommage, c’est d’avoir les détritus aussi… Les gens se précipitent pour voir des détritus de films américains, parce qu’ils sont américains. Ça veut dire qu’on n’a pas confiance en nous, quelque part.
Mais je ne suis pas sûr que ça ne passe que par la régulation. Les politiques publiques de soutien à la culture française, il y en a aussi, et je pense que c’est bien. J’ai travaillé dedans, je les connais un peu, elles pourraient même être un peu plus fortes.
Je trouve toujours dommage que l’Etat se désinvestisse, de manière générale, parce que je pense qu’en France, l’État est vraiment important, et à chaque fois qu’il se désinvestit d’un champ, et je ne parle pas seulement de la culture, très souvent, il n’est remplacé par rien… En termes de soutien à la culture, il faut réfléchir exactement à « comment », et « quoi », mais il y a vraiment de la marge.

LVSL : Le budget de la culture aujourd’hui est à 0,35 % du PIB, il était autrefois à 1 %. Cela dit beaucoup de choses. Le cinéma français allait très bien pendant cette période de près de 20 ans. De la fin des années 80 au milieux des 90 on a des films hallucinants comme Cyrano de Bergerac, Le Hussard sur le toit de Rappeneau, Nikita de Luc Besson, La Haine, Pialat qui gagne une Palme d’or en 87… On avait un cinéma d’une variété incroyable : du grand public, du grand spectacle, du film d’auteur… jusqu’aus films de festivals. Nous n’avons plus cela aujourd’hui.
A. B. : Non, on n’a plus ça… Et puis on se fait embarquer dans les idéologies dominantes américaines. Par exemple, on ne croit pas au cinéma, on ne croit pas aux librairies… C’est marrant, moi j’ai créé une librairie à New York, qui s’appelle « Albertine », une librairie française*, quand j’ai été conseiller culturel là-bas. Je l’ai créée pour le compte de l’État. Elle appartient à l’État. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui me riaient au nez, en me disant « quand même, aux États-Unis, créer une librairie c’est absurde ! C’est le pays du numérique, on n’est pas à Kinshasa ! » Mais ces gens ne connaissaient pas New York, en fait… New York, c’est la ville où les gens lisent le plus au monde, même les mendiants lisent des livres dans la rue, et pas que les mendiants ! C’est le pays du papier, New York. C’est l’endroit, avec le Japon, où les gens lisent le plus de papier.
Et donc, on se fait embarquer dans ces idéologies, comme quoi ça ne sert à rien, les librairies, et qu’en revanche les tablettes, c’est bien… Et il y a un moment où c’est absurde, parce que si on créait de bonnes librairies en France, elles marcheraient très bien. Il y en a déjà plein qui marchent bien, et ma librairie à New York marche très bien ! Si on crée de nouveaux cinémas qui sont bien, ils marchent !
On a tendance à faire des prophéties auto-réalisatrices : « voilà c’est fini, la culture française est finie, elle est dominée par les États-Unis ». En fait, on crée ça en le pensant. Et je pense que vous avez raison, en baissant le budget de la culture, on crée ce qu’on redoute.

LVSL : Dans cette même interview, vous avez dit que « Plutôt que de faire de la diplomatie par les voies classiques, je préfère travailler sur les représentations du monde ». Après avoir traité avec brio l’hypothèse d’un conflit nucléaire mondial, comment aborderiez-vous, par exemple, la question du changement climatique ? Le 7e Art a-t-il un rôle à jouer, selon vous, pour sensibiliser à l’urgence climatique, et comment intéresseriez-vous le grand nombre à cette question ?
A. B. : Évidemment, je pense qu’il a un rôle très important à jouer… En ce qui me concerne, je n’ai pas encore trouvé la façon de l’aborder.
Il y a un truc que je regrette : il y a un film génial de Charles Ferguson, celui qui a fait « Inside Job » sur la crise financière, et qui a eu l’Oscar du meilleur documentaire. C’est un film génial.
Il a fait un 2e film génial, qui s’appelle « Time to Choose » sur l’environnement. C’est un film qui m’a appris tout ce que je sais sur les questions environnementales. Il n’est jamais passé en France, sauf quand je l’ai invité à passer au Théâtre de la Ville, parce que j’avais fait une programmation là-bas, mais il n’a jamais été distribué en France.
Je me dis un peu que, plutôt que de faire un autre film sur le même sujet – je ne ferai jamais aussi bien que lui ! – pourquoi ne pas essayer de diffuser ce film en France ?
Après, je pense qu’on a tous envie d’infléchir ce qui est en train de se passer, qui est une catastrophe absolue, et on cherche tous ce qu’on pourrait faire. Moi, c’est évident que si je trouve une façon de le faire, qui me corresponde, dont j’aie l’impression que quelqu’un d’autre le ferait moins bien que moi, je le ferai… Pour l’instant, je n’ai pas trouvé la façon d’aborder la question.

LVSL : Le mot de la fin : en 1987, Libération avait publié un hors-série où la même question était posée à 700 cinéastes venus du monde entier « Pourquoi filmez-vous ? ». Nous vous proposons le même jeu, donc : « Antonin Baudry, pourquoi filmez-vous ? »
A. B. : Ce qui me travaille, c’est le rapport au réel. C’est très curieux de filmer : on crée une fiction, mais c’est le réel qu’on capture dedans qui crée la magie, donc c’est une façon d’interroger le monde.
En fait, j’essaie de comprendre ce qui se passe autour de moi. J’ai toujours l’impression de ne pas comprendre le monde, et d’essayer de le comprendre. C’est pour ça que je suis parti dans la diplomatie, c’est pour ça que j’ai fait des maths quand j’étais petit, que je lis des livres, et c’est pour ça que je filme quand je filme, c’est pour essayer de comprendre… Je crois.
* située sur la Cinquième Avenue, en face du Metropolitan Museum of Art, à Manhattan
Retranscription : Hélène Pinet
Photo à la Une : Antonin Baudry © Vidhushan Vikneswaran pour Le Vent se Lève