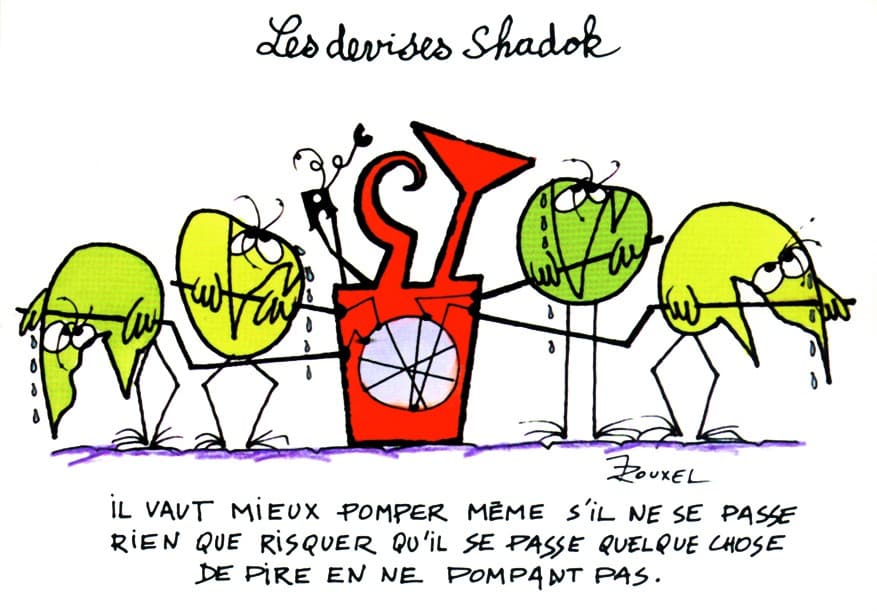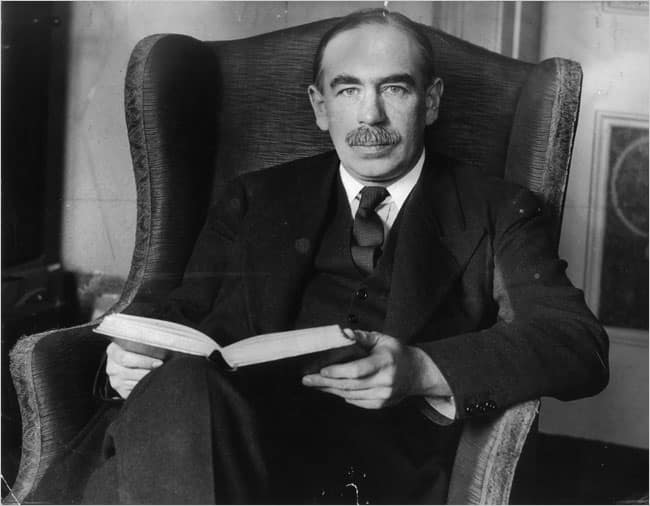David Graeber nous a quittés en 2020 mais ses intuitions continuent d’alimenter les critiques du capitalisme. Ainsi celle du journaliste Nicolas Kayser-Bril, qui a publié en début d’année Imposture à temps complet, pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde (éd. Faubourg), livre-enquête et réflexion sur le concept de l’anthropologue américain.
Le terme de bullshit job a été victime de son succès puisqu’il est parfois utilisé pour tout et n’importe quoi. Dans son essence, il désigne un emploi improductif, un boulot qui ne sert à rien. Il exprime le désespoir de travailleurs qui triment sans savoir dans quel but, qui errent « en quête de sens », selon l’expression à la mode. Une première tension apparait : le bullshit job relève-t-il du système de production et de ses failles, comme le pensait David Graeber dès 2013, ou tient-il plutôt de la psychologie des travailleurs et de leurs possibles vague-à-l’âme ?
L’aspect théâtral des bullshit jobs
Revenons à la définition de David Graeber qui était la suivante : un bullshit job, que l’on pourrait traduire par métier du baratin ou poste à la con, est une « forme d’emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflue ou même néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu’il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu’il n’en est rien » (Bullshit jobs, 2018, p.39). Cette définition a été critiquée par des chercheurs en sciences sociales car elle repose sur le ressenti des travailleurs et ne constitue pas une théorie de la valeur sociale. Pour autant, elle permet d’approcher la réalité du phénomène car les gens ont généralement du mal à avouer que leur emploi est inutile : s’ils le disent, on peut raisonnablement les croire.
L’autre intérêt de la définition de David Graeber est son second volet, souvent oublié, portant sur l’aspect théâtral des bullshit jobs. En effet, ceux qui en occupent un doivent faire semblant qu’il n’en est rien. Nicolas Kayser-Bril reprend cette idée fondamentale en filant la métaphore du conte d’Andersen Les Habits neufs de l’empereur. Dans celui-ci, l’empereur se fait tisser des habits dans une étoffe extraordinaire, qui selon ses concepteurs n’est visible qu’aux personnes intelligentes. Personne ne voit ce tissu mais tout le monde se garde bien de le dire, de peur de provoquer le courroux de l’empereur. Les bullshit jobs provoquent les mêmes comportements : souvent au sein d’un service personne ne voit l’utilité de certaines choses, mais tout le monde se garde bien de poser la question, de peur de perdre sa crédibilité voire son emploi. Certains pensent aussi ne pas être légitime à juger de l’utilité de telle ou telle activité. Pourtant, c’est bien à nous tous en tant que peuple qu’il revient de décider ce que nous jugeons utile de produire ou non.
Quantifier la proportion de bullshit jobs
David Graeber utilise des sondages pour évaluer la proportion de bullshit jobs dans nos économies occidentales. Nicolas Kayser-Bril perçoit là une limite et essaie de construire une méthodologie plus robuste. Il se porte au niveau des tâches de travail, composant les postes : participent-elles à produire un bien ou un service utile à la collectivité, ou non ? Pour le déterminer, il classe les organisations (entreprise ou administration) selon deux critères : disposent-elles des ressources en augmentation ou en diminution ? et ont-elles une « mission » ou non ?
Ici, il faut entendre la « mission » comme un besoin social préexistant à l’entreprise et auquel celle-ci répond. Cette « mission » n’est pas celle des « entreprises à mission ». Dans ces dernières, la mission n’est bien souvent qu’un supplément d’âme affiché a posteriori pour « engager » leurs « talents », ceux-là mêmes qui sont « à la recherche de sens ». Ce nouveau statut juridique créé par le gouvernement Macron est une mauvaise façon de poser le problème du « sens » au travail, car celui-ci émerge de ce qui est produit et de comment il est produit. Le sens vient du contenu même de la production et pas des engagements éventuels de la direction d’une entreprise quand ils ne portent pas sur la production elle-même.
Ces deux critères (ressources et mission) créent donc quatre catégories d’organisations. Pour Nicolas Kayser-Bril, il faut qu’une organisation possède une mission et des ressources en croissance pour que les tâches valorisantes et utiles y soient possibles et favorisées. Dans une organisation avec des ressources mais sans mission, les tâches valorisantes sont selon lui encore possibles, mais simplement non encouragées. Enfin, les organisations où les ressources stagnent ou diminuent favorisent pour lui l’émergence des bullshit jobs et même rendent impossible les emplois valorisants quand, en plus, l’organisation n’a pas de mission.
Une question demeure alors : comment déterminer si tel ou tel employeur possède une « mission » ? Avec sa définition, Nicolas Kayser-Bril retombe sur le problème sur lequel avait buté David Graeber. Il doit revenir au niveau des individus pour leur demander quelle est, selon eux, la mission de leur organisation. Si, au sein d’une organisation, les réponses obtenues sont qu’il n’y en a pas ou sont contradictoires entre elles, on peut conclure qu’elle n’a pas de mission. Si les réponses sont de cette même teneur dans tout un secteur d’activité, on peut supposer que tout le secteur manque d’une mission.
Pourquoi le manque de ressources favorise les bullshit jobs
Cette matrice des organisations proposée par Nicolas Kayser-Bril et en particulier son critère des ressources ne sont pas efficaces pour traquer les bullshit jobs. Son argumentation est lacunaire sur ce point : pour lui, disposer des ressources pour mener à bien son travail est nécessaire pour établir des relations de confiance entre les salariés, confiance elle-même nécessaire pour permettre les emplois valorisants. Or on peut très bien imaginer une entreprise aux ressources stagnantes, voire en augmentation, avec une bonne entente entre ses membres, mais qui ne produirait rien de tangible pour l’extérieur. Ce cas avait été rapporté à David Graeber dans son enquête pour son livre de 2018 par des personnes déclarant être finalement plutôt satisfaites de leur bullshit job.
Son hypothèse mène Nicolas Kayser-Bril à une conclusion contestable selon laquelle l’émergence du thème des bullshit jobs dans les années 2010 tient à la crise économique mondiale de 2009, qui, ayant cassé la croissance et augmenté le chômage, a empêché les personnes occupant des bullshit jobs de démissionner, de peur d’avoir des difficultés à trouver un autre emploi. Pourtant, le concept du bullshit job a précisément touché une autre corde que celle des simples emplois mauvais, aux mauvaises conditions de travail (appelés les shit jobs, en opposition). La question fondamentale soulevée par les bullshit jobs est bien celle de la « mission » des organisations et on ne peut pas la mettre sur le même plan que celle des ressources.
Toutefois, ce premier chapitre contient également des conclusions intermédiaires intéressantes qui montrent que la réflexion sur les bullshit jobs est un renouvellement de la pensée critique du travail en régime Toutefois, ce premier chapitre contient également des conclusions intermédiaires intéressantes qui montrent que la réflexion sur les bullshit jobs est un renouvellement de la pensée critique du travail en régime capitaliste. Il montre par exemple que la théorie économique dominante se révèle totalement incapable d’admettre l’existence même des bullshit jobs.
En effet, un bullshit job est fondamentalement un poste surnuméraire. Son existence implique que l’employeur ait agi de manière « irrationnelle » du point de vue économique, en gardant un poste qui ne participe pas à la production et donc pas à la création de profit et à l’accumulation du capital. Or, le fondement néoclassique de la pensée économique dominante postule que les agents économiques sont parfaitement rationnels. Il est donc impossible pour elle d’admettre l’existence des bullshit jobs. Si ces hypothèses sont souvent dépassées dans la recherche aujourd’hui, elles sont importantes car elles composent toujours une partie de l’imaginaire économique collectif.
Les bullshit jobs, une activité ostentatoire
C’est ensuite dans le chapitre central que le livre de Nicolas Kayser-Bril révèle son plus grand intérêt. Il s’ouvre avec une enquête sur la profession de gestion de portefeuilles. La gestion de portefeuille est une activité de service visant à optimiser le rendement financier du patrimoine de ses (riches) clients, en choisissant les titres financiers dans lesquels investir.
Il est manifeste que les gestionnaires de portefeuille n’œuvrent pas pour l’intérêt général. Pour autant, la question des bullshit jobs est à la fois plus simple et plus exigeante : est-ce que telle activité a bien l’effet qu’elle prétend avoir ? Autrement dit, les gestionnaires de portefeuille permettent-ils à leurs clients d’augmenter le rendement financier de leur patrimoine ? La réponse à cette question est non, comme cela a été montré à plusieurs reprises par des expériences et rappelé par l’auteur. Les gains réels à la bourse cachent bien souvent des délits d’initiés et c’est d’ailleurs ainsi que les gestionnaires de portefeuille font gagner de l’argent à leur client, lorsque c’est le cas.
Les gestionnaires de portefeuille ont donc un bullshit job : ils ne produisent pas l’effet escompté, bien qu’ils doivent prétendre l’inverse pour honorer les termes de leur contrat. Pour Nicolas Kayser-Bril, cet exemple relève de ce que Thorstein Veblen nommait les consommations ostentatoires. Selon sa célèbre thèse, les membres des classes supérieures achètent des biens et services superflus pour afficher leur rang social. Or, la consommation ostentatoire c’est-à-dire non nécessaire implique une production non nécessaire[i].
Justifier sa position dominante par le travail
Pour comprendre la possibilité d’un travail ostentatoire, il faut revenir au temps où le travail n’était pas valorisé pour tous, en l’occurrence sous l’Ancien Régime. Dans la société d’ordres, seul le Tiers-État travaillait, les nobles et le clergé étant même défendus de le faire. Or comme l’explique la sociologue du travail Marie-Anne Dujarier, durant le Moyen-Âge « le développement du capitalisme marchand dans les villes européennes fait monter en puissance une nouvelle classe sociale qui vit dans les bourgs : la bourgeoisie. […] Contrairement à l’aristocratie et à l’Église, toutes deux caractérisées par leur relative oisiveté, la bourgeoisie conquérante construit sa place par un certain rapport à l’action et aux choses plus qu’aux gens ou à l’honneur. […] Désormais, œuvrer dur et avec régularité est considéré comme bon, bien et nécessaire dans la bourgeoisie ». Ainsi, « de manière spectaculaire, le sens et la valeur de la pauvreté, mais aussi de l’oisiveté, sont donc inversé dans l’Europe chrétienne : celles-ci, de moyens de perfection ascétique, deviennent désormais une transgression sociale »[ii]. Suivant ce développement historique, Nicolas Kayser-Bril conclut : « [Le travail] est devenu le mode d’existence sociale principal pour tout le monde, entre la fin du XVIIème et le XIXème siècle, suivant les régions d’Europe. Ne pas travailler revient à s’exclure de la société. […] Il faut travailler pour exister socialement, mais l’objet de ce travail n’a aucune importance ».
Pour Nicolas Kayser-Bril ce changement ouvra immédiatement une possible multiplication des bullshit jobs : les nobles cherchant des emplois adaptés à leur rang, et ceux-ci venant à manquer, ils durent en inventer de toute pièce, multipliant les postes inutiles. Il prend ainsi l’exemple du prince William, duc de Cambridge, qui met sans cesse en avant son « travail » comme pour justifier son existence.
Cette observation centrale en entraîne plusieurs autres. Plus une société est inégalitaire, plus elle est propice à ces bullshit jobs d’apparat. Une société sans ordres et sans classe n’en aurait pas besoin. Deuxièmement, les bullshit jobs recoupent les dominations déjà présentes dans la société. Les bullshit jobs sont accaparés par la classe dominante car ils sont pour la plupart associés à un statut social élevé, et réciproquement c’est parce qu’ils sont souvent occupés par des personnes au statut social élevé que ces postes peuvent être convoités. Donc, inversement, aujourd’hui les métiers les plus essentiels comme les métiers du soin sont pour beaucoup féminisés.
Cela ne signifie pas pour autant que les classes populaires soient exemptées de bullshit jobs. David Graeber l’avait remarqué, mais Nicolas Kayser-Bril observe qu’une discrimination raciale s’y ajoute, que David Graeber n’avait pas relevée. Par exemple, les hommes noirs non qualifiés sont cantonnés aux métiers de la sécurité privée, dont « la production de travail […] reste difficile à définir »[iii]. Troisièmement, les bullshit jobs ont tendance à s’agglomérer : pour avoir l’air de plus en plus puissant, un cadre d’une grande organisation voudra engager un maximum de subordonnés, qu’il ait une activité à leur faire faire ou non (c’est le cas déjà défini par Graeber des larbins).
Le travail, « mode d’existence social principal »
Par ailleurs, si le travail devient nécessaire pour les puissants, il n’en demeure pas moins moralement indispensable pour le reste de la société, et même encore plus qu’avant. Dès cette époque, la droite politique appuie cette injonction morale à travailler (la « valeur travail ») pour justifier les conditions de travail épouvantables dans les manufactures du XIXème siècle et elle continue de le faire aujourd’hui – le dernier exemple en date étant la proposition d’Emmanuel Macron de faire travailler les bénéficiaires du RSA 15 à 20 heures par semaine.
Cette injonction morale entretient les bullshit jobs, d’abord en les justifiant, ensuite en empêchant celles et ceux qui les occupent de s’en rendre compte. Nicolas Kayser-Bril résume ainsi que « l’existence [des bullshit jobs] n’est pas due à l’avidité des capitalistes ou à la loi de l’offre et de la demande, mais au besoin de distinction sociale des riches, au besoin pour les managers d’avoir des subalternes et à la nécessité politique de maintenir au travail la majeure partie de la population » (p. 122). Il rappelle en passant que la rémunération d’une personne n’a aucune espèce de lien avec son talent ou ses mérites mais bien plus avec les us et coutumes du secteur où il ou elle travaille et avec les inégalités structurantes de la société (de genre, de couleur de peau)[iv].
L’évaluation d’un bullshit job est l’évaluation d’un rôle
Le dernier tiers du livre de Nicolas Kayser-Bril s’attache ensuite à développer les conséquences que l’hypothèse des bullshit jobs, quand on la prend au sérieux, entraine dans la société. Cela porte tout d’abord sur le travail lui-même et son évaluation :« un employé travaillant dans une organisation sans mission ne peut pas s’attendre à être récompensé quand il accomplit un excellent travail » (p. 171). Car si son organisation n’a pas de mission, au regard de quoi son travail serait-il excellent ? On peut évaluer si la baguette d’un boulanger est trop cuite ou pas assez, etc. L’évaluation du travail du boulanger peut être biaisée voire malhonnête de la part de son patron, mais dans une certaine limite, car ce travail a des conséquences dans le réel, qui peuvent être observées par lui-même et par les autres.
Mais comment évaluer le travail d’un consultant, d’un gestionnaire de portefeuilles, d’un officier dans une armée en paix ? Si leur travail ne produit rien de tangible, il n’y a rien à évaluer. Dans ce cas, c’est la discipline du travailleur qui est évaluée. De plus, si personne ne peut donner son avis sur le travail effectué, et en particulier pas les gens du métier (puisqu’il n’y a pas de métier), alors tout le monde peut le faire (comme dans le cas des « évaluations 360 »).
Cette absence d’évaluation ne signifie pas pour autant qu’occuper un bullshit job soit de tout repos : faire semblant, donner l’impression qu’on sait ce qu’on fait, demande un entraînement et du travail (au sens de la peine qu’on se donne). C’est en revanche une désillusion pour ceux qui sont en bas de l’échelle et qui souhaiteraient gravir les échelons au mérite, ce mérite ne pouvant pas être défini par des critères réellement objectifs (si des grilles de compétences peuvent être utilisées, elles sont souvent bullshit elles-mêmes, c’est-à-dire absconses et inclarifiables). À l’inverse, pour ceux en haut de la pyramide, les postes vides de sens peuvent être une aubaine. Bullshitiser son propre poste permet de ne plus être pris en défaut et d’être assuré de conserver sa position. Les bullshit jobs cimentent les relations de pouvoir dans la vie professionnelle.
« Pas d’idée, pas d’emmerde » : le retour des liens d’allégeance au travail
Dans une organisation sans mission, ce qui est récompensé n’est donc pas le travail proprement dit (au sens d’œuvre, puisqu’il n’y en a pas) mais l’assiduité et la loyauté, par exemple par le présentéisme. La loyauté dans ce cas ne se manifeste pas à la cause de l’organisation (puisqu’elle n’en a pas), mais au chef. Elle peut amener les salariés à fermer les yeux sur d’éventuelles conséquences de leur action, pour ne pas risquer de froisser leur employeur.
Enfin, les bullshit jobs génèrent de la souffrance chez les salariés. Comme l’ont montré les travaux de la sociologie du travail, la grande majorité des travailleuses et travailleurs cherche en réalité à « bien faire » son travail. Le travail réel dépasse régulièrement les attentes du travail prescrit, comme la sociologie du travail l’a documenté. Mais ceci n’est plus possible dans une organisation sans mission : dans quel sens dépasser les prescriptions ? En faisant quoi ? Pire, la direction peut parfois voir ce comportement comme un manque de discipline. C’est ce qu’Alain Supiot a appelé la règle PIPE : pas d’idée, pas d’emmerde[v].
Dans le dernier développement de son livre, Nicolas Kayser-Bril reprend justement la thèse d’Alain Supiot sur le retour des liens d’allégeance caractéristiques des systèmes féodaux – développée notamment dans La gouvernance par les nombres, 2015, réed. 2020 Pluriel [lire sur LVSL un article du même auteur consacré à cet ouvrage NDLR]. David Graeber parlait quant à lui de « féodalisme managérial ». Alain Supiot montre que cette féodalisation est alimentée par la marchandisation du Droit, qui signe la fin du régime de droit (rule of law, plutôt qu’Etat de droit) c’est-à-dire du régime où l’individu est protégé de l’arbitraire par les lois. Sans ce régime de droit, l’individu doit chercher sa protection auprès de plus puissant que soi, d’où le retour des liens suzerain-vassal. La casse du code du travail alimente le phénomène dans les entreprises. Par la suite, Nicolas Kayser-Bril remarque qu’un régime qui repose sur les liens de dépendance personnels sans institution n’est pas le féodalisme mais la mafia, ou l’État-mafia. Cette remarque avait en réalité déjà été faite par Alain Supiot dans son ouvrage précédent, L’esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total (Seuil, 2010, réed. Points).
Austérité dans les services publics et bullshitisation de l’Etat : qui est l’œuf de la poule ?
Notre auteur arrive à cette conclusion en remarquant que les institutions comme la Justice, l’Université ou encore l’hôpital sont de plus en plus vidées de leur substance par le manque de moyens et par la « nouvelle gestion publique » qui leur est imposée. Là encore, pour lui, c’est la diminution des ressources qu’on impose à ces institutions qui engendre la multiplication des tâches inutiles en leur sein.
Mais cette hypothèse est fragile. David Graeber avait intuité que le processus se produisait plutôt dans l’autre sens : l’arrivée des bullshit jobs accompagne voire précède la baisse des ressources. Ce phénomène a été démontré récemment par la commission sénatoriale d’enquête sur le recours aux cabinets de conseil (comme McKinsey) par les administrations centrales. Ce recours ne fait pas baisser la facture pour l’Etat, bien au contraire : les consultants coûtent bien plus cher que des fonctionnaires, alors même que la matérialité de leur production est difficile à établir.
Pourquoi ce recours aux prestataires externes alors ? Sans doute car, comme l’a dit la rapporteuse Éliane Assassi, le but de ce recours serait moins de faire des économies que de transférer un maximum d’activités de l’État vers le privé, supposé plus efficace, dans les discours du gouvernement. L’objectif de baisse des dépenses publiques serait alors un paravent amenant l’idée que les privatisations et délégations de services publics seraient nécessaires. Enfin, la méthodologie en apparence complexe des indicateurs de performance (inutiles), maîtrisée par les consultants, permet quant à elle de justifier qu’on ait recours à eux.
Que faire contre les bullshit jobs ?
Pour lutter contre les bullshit jobs il sera donc nécessaire de réduire le temps de travail, la bureaucratie, les inégalités sociales. Mais quelles options nous restent-ils, individuellement, lorsque nous occupons un bullshit job ? Trois selon l’auteur, qui revient à ce sujet en conclusion. Premièrement, on peut nier l’existence même du bullshit. Cela consiste à croire qu’on mérite sa position sociale, son salaire, et cela permet dans les faits de les solidifier. Sinon, on peut chercher à faire changer les choses, mais comme celui qui dit que le roi est nu, cela expose à des conséquences sur sa position sociale. Enfin, la dernière option est de se réfugier dans le cynisme, c’est-à-dire de voir les caractéristiques de ce monde mais de n’en tirer aucune conséquence. La plupart des gens choisissent cette option, mâtinée de déni, car il est très difficile d’avouer que son activité principale n’apporte rien d’utile à la société.
Faut-il toujours être productif ?
C’est donc collectivement que nous devons lutter contre les bullshit jobs. On peut se dire qu’il n’est pas en soi mauvais de ne pas être productiviste[vi] voire de ne pas être productif du tout. Les bullshit jobs sont réputés mauvais car ils ne produisent rien, mais leur problème plus sérieux est de faire dépendre la subsistance matérielle de ceux qui les occupent à une hypocrisie quotidiennement renouvelée quant à la justification de leur poste. C’est le sens de la conclusion remarquable tirée par Nicolas Kayser-Bril : faut-il supprimer le bullshit, ce langage inclarifiable ? Non selon lui car « le bullshit n’est un problème que si l’on est sommés de prétendre qu’il n’existe pas » (p. 242). Dans les bullshit jobs, le problème ne venait donc pas du bullshit, mais des jobs : devoir à tout prix faire croire qu’on produit pour avoir sa place dans la société.
David Graeber quant à lui présentait en ouverture de son ouvrage le revenu universel comme une réponse aux bullshit jobs, car il permettrait à n’importe qui de quitter son emploi s’il ne trouvait pas celui-ci satisfaisant. Or l’apparition des bullshit jobs, comme celle du dérèglement climatique, ne tient pas à nos comportements individuels, mais à l’organisation du système de production. C’est donc lui qu’il faut réformer. Pour ce faire, il faut choisir collectivement ce que nous produisons (c’est-à-dire ce nous jugeons utile de produire), comment nous le produisons et en quelle quantité. Il est essentiel de le faire pour que la lutte du travail ne se limite pas aux conditions dans lesquelles le travail s’exerce, mais qu’elle attaque également le contenu même du travail. Cette lutte pour réduire les tâches inutiles dans l’emploi doit aller de pair avec le mouvement historique de réduction du temps de travail[vii]. Ce « gouvernement par les besoins », qui a été appelé selon les contextes autogestion ou contrôle ouvrier, transformerait le système de production actuel pour mettre fin à ses absurdités.
Notes :
[i] Ce qu’avait relevé George Orwell dans les années 1930 en travaillant dans une brasserie du Montparnasse, restaurants alors accessibles uniquement aux classes supérieures. Dans la Dèche à Paris et à Londres, 10/18, chapitre XXII (p. 158).
[ii] Marie-Anne Dujarier, Troubles dans le travail. Généalogie d’une catégorie de pensée, PUF, septembre 2021
[iii] Sébastien Bauvet, sociologue, 2010 ; cité par N. K-B. p.40.Sur la « division raciale du travail », voir Lawrence Grandpre, cité p. 161.
[iv] À l’appui de ce point N. K-B. cite en p.119 le premier chapitre de Kessler-Harris, 1990.
[v] Anecdote rapportée lors de la conférence inaugurale des 24èmes rendez-vous de l’histoire de Blois, d’octobre 2021.
[vi] Laëtitia Vitaud, En finir avec la productivité, Payot, 2022
[vii] C’est la proposition politique de Juan Sebastián Carbonell dans son livre Le futur du travail, Amsterdam éditions, 2022.