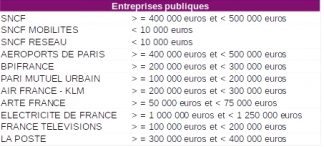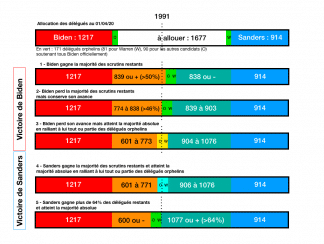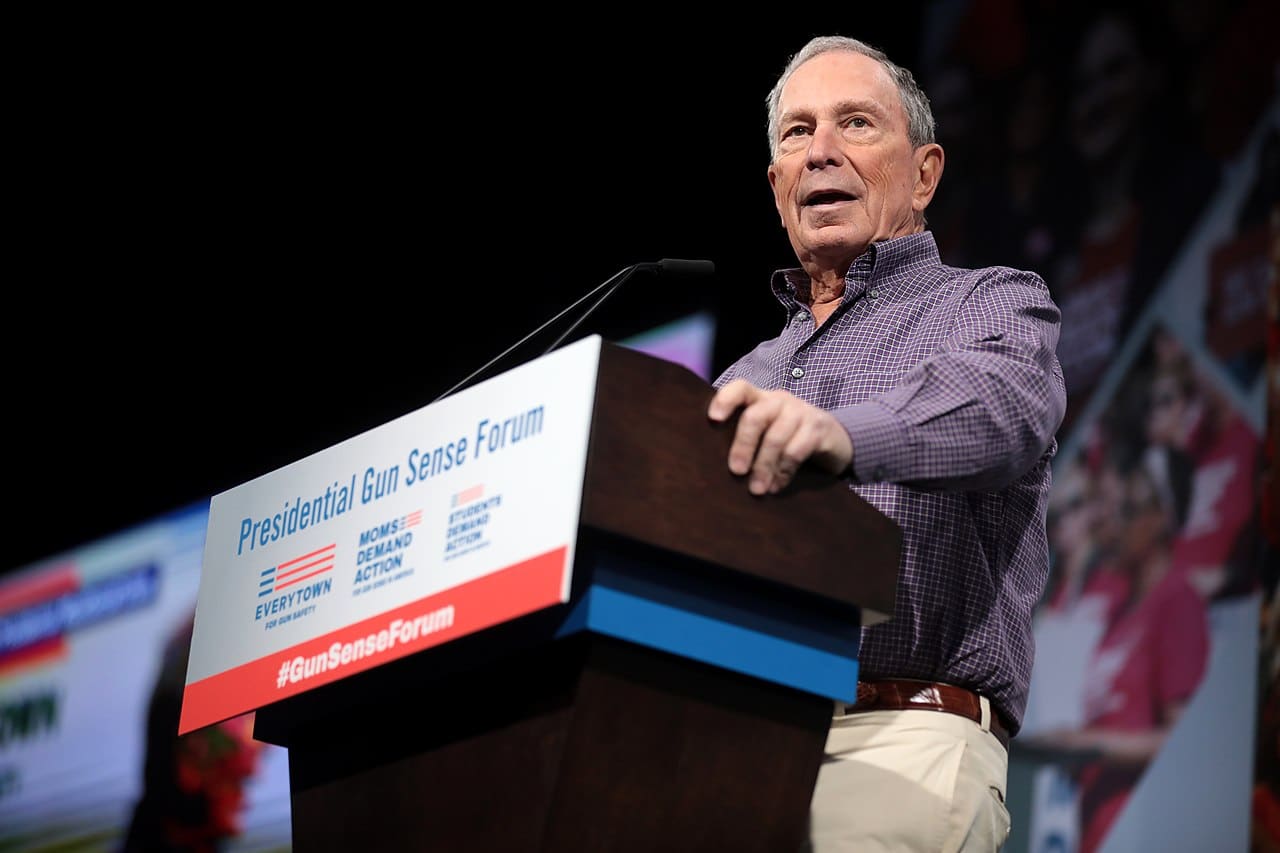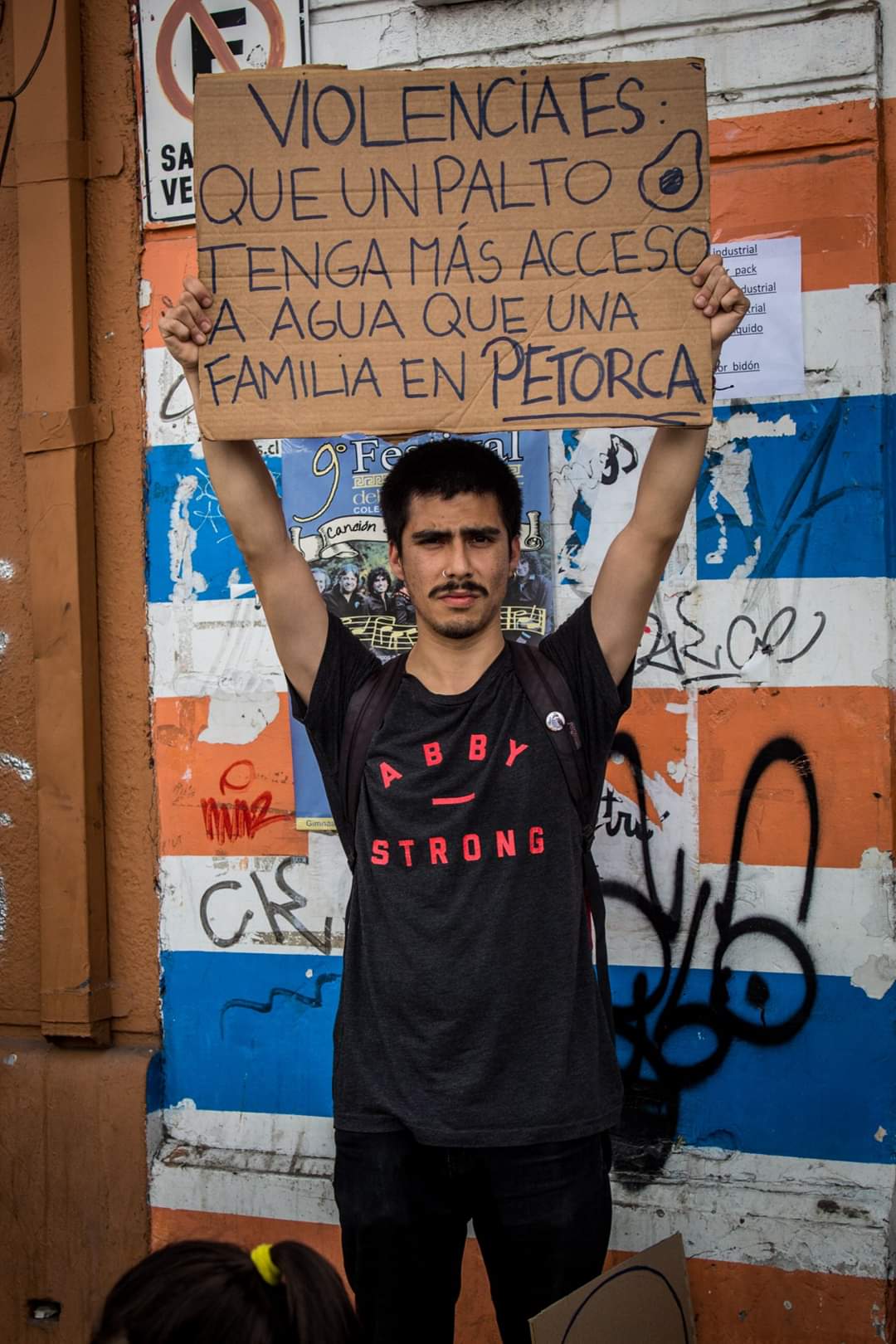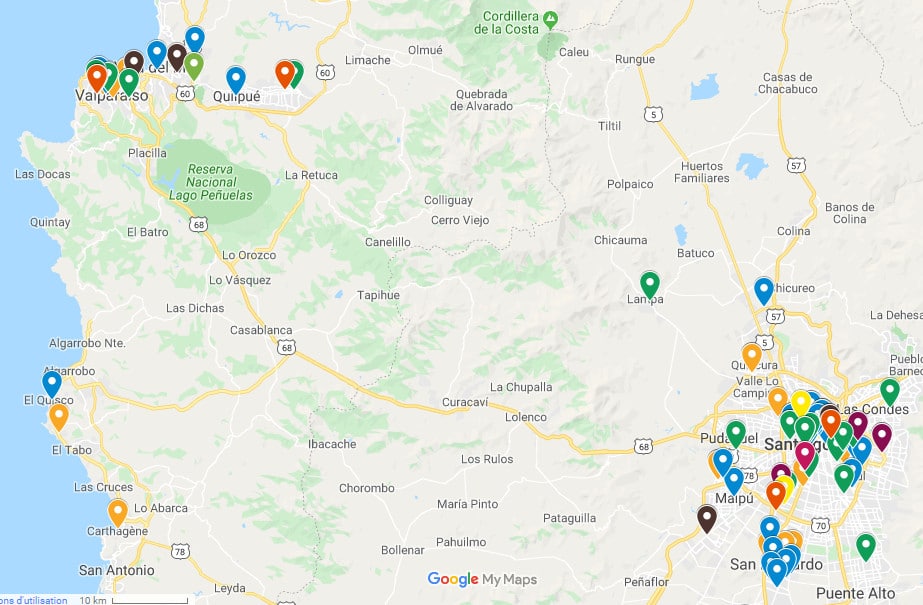Le dimanche 4 octobre prochain aura lieu le deuxième référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, le premier s’était soldé par la victoire du « non » à l’indépendance à 56,7% des voix contre 43,3% pour le « oui ». Cette série de consultations des habitants du Caillou intervient après un long processus de pacification commencé il y a 30 ans, au moment des « événements » de la grotte d’Ouvéa. En effet, en 1988, entre les deux tours des élections présidentielles, des indépendantistes du FLNKS[1] prennent des gendarmes en otage. La prise d’otages se terminera dans un bain de sang lors de l’assaut ordonné par le Premier ministre de l’époque, Jacques Chirac, qui considérait le FLNKS comme un groupe terroriste[2]. Avant cette consultation déterminante pour l’avenir de l’archipel et de ses relations avec la France, nous nous sommes entretenus avec Alban Bensa, anthropologue spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et du peuple kanak, très favorable à l’indépendance, afin de revenir sur l’histoire de ce territoire ultramarin plus que jamais à la croisée des chemins. Entretien réalisé par Lauric Sophie.
LVSL – Pouvez-vous nous relater brièvement l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, de la colonisation par l’Empire en 1853 jusqu’aux pudiquement nommés « événements » des années 80 ?
Alban Bensa – En 1853, l’État impérial français prit unilatéralement possession de la Nouvelle-Calédonie (la Grande Terre et les îles Loyauté), ensemble insulaire découvert et peuplé par des populations mélanésiennes il y a environ 3500 ans. En 1774, elles avaient accueilli le capitaine écossais James Cook, faisant ainsi entrer la, somme toute, brève histoire de l’expansion européenne dans celle, millénaire, de l’archipel. Lorsque la France s’empara de toutes les terres, elle repoussa les autochtones, les confinant dans des réserves jusqu’en 1946. La colonisation, à travers l’installation d’un bagne en 1864, le développement de l’élevage extensif et l’exploitation du nickel à partir de 1880, porta des préjudices irréparables aux indigènes dénommés Kanaks par l’occupant. Les cultures vivrières, les déplacements côtiers, la mobilité et la démographie des groupes, ainsi que leur liberté politique et religieuse subirent les coups d’un ordre militaire, administratif et missionnaire implacable. La France fit venir en Nouvelle-Calédonie des Asiatiques, des Océaniens et des Kabyles d’Algérie pour travailler sous contrat dans les mines et sur les propriétés des Européens. Cela contribua peu à peu à minoriser les autochtones.
Toutefois, l’accès des Kanaks à la citoyenneté française dans la seconde moitié du XXe siècle inaugura les prémices d’un apurement possible de cette dette. L’entrée des partis politiques autonomistes puis indépendantistes dans l’Assemblée Territoriale[3] fit entendre une autre voix qui vint s’opposer à celles des colons et de l’État français. La reconnaissance du fait kanak ne fut cependant véritablement acquise qu’après une période de lutte sur le terrain, appelée localement « les événements », qui aboutit en 1988 à la concession d’espaces de pouvoir aux colonisés, en particulier dans deux des trois Provinces de Nouvelle-Calédonie où ils prirent enfin leur destin en main.
LVSL – Pouvez-vous expliciter le processus dit de décolonisation en cours en Nouvelle-Calédonie depuis les accords de Matignon ?
A.B. – Les accords de Matignon et d’Oudinot de 1988 ont inauguré une politique de « rééquilibrage » visant à compenser les injustices profondes qui stigmatisaient la condition kanake dans de nombreux domaines tels que le foncier, la formation, l’emploi, la représentation politique, la reconnaissance culturelle, etc. Afin de conjurer le constat du Premier ministre d’alors, Laurent Fabius – selon lequel « la France a fait trop peu et trop tard » –, il s’est agi de moderniser enfin la Nouvelle-Calédonie non urbaine en la dotant d’institutions décolonisées et même décolonisatrices.
« Pour atteindre cet idéal, il faudrait que l’État français renonce à ses prérogatives dominantes, qu’il imagine un fédéralisme calédonien au sein duquel cohabiteraient des expériences privilégiant le contrat et les apports mutuels des deux grandes civilisations, mélanésienne et française, au pays en construction. »
En 1998, l’accord de Nouméa a accéléré le pas dans cette direction, avec en préambule la reconnaissance des torts de la France dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la mise en place d’un transfert irréversible de compétences de l’Hexagone vers la Nouvelle-Calédonie, la réduction du corps électoral en vue de référendums d’autodétermination à mettre en œuvre après vingt années et la confirmation d’une politique identitaire ambitieuse plaçant la culture kanake au cœur de l’avenir calédonien ont marqué une période d’émancipation particulièrement intéressante. Toute la question actuelle reste de savoir si l’essai va être transformé.
Pour cela, il faudra innover politiquement, c’est-à-dire sortir du tout ou rien des anciennes décolonisations – soit un maintien de la tutelle française pleine et entière, soit une indépendance sèche qui couperait tout lien avec la métropole. Il faudrait plutôt envisager une indépendance en partenariat avec la France, la possibilité d’une double nationalité calédonienne et française, une souveraineté intelligente en somme qui maintiendrait sans exclusivité les apports des Calédoniens et des Français à un pays aux institutions originales. Pour atteindre cet idéal, il faudrait que l’Hexagone renonce à ses prérogatives dominantes, qu’il imagine un fédéralisme calédonien au sein duquel cohabiteraient des expériences privilégiant le contrat et les apports mutuels des deux grandes civilisations, mélanésienne et française, au pays en construction. La recherche d’un tel dispositif se trouve au cœur de la réflexion politique kanake actuelle. Il n’est pas certain que la France fasse en ce moment le même effort. C’est pourtant, à mes yeux, la seule voie pour sortir de la colonisation par le haut. [NDLR : ces propos n’engagent qu’Alban Bensa].
LVSL – Vous qui avez côtoyé des leaders kanaks, comment s’est créée la conscientisation politique de ce peuple ? Autour de quelles figures ?
A.B. – La prise de conscience de la nécessité de renverser la table s’est opérée dans la génération kanake de l’après-guerre, d’abord par lassitude. Lassitude d’être déconsidérée partout et à toute occasion, lassitude à la fin des années 1970 d’être mise en minorité sur sa propre terre par des métropolitains ne cherchant que le soleil et l’argent au mépris des populations locales, lassitude d’appartenir à la catégorie toute métropolitaine de « l’Outre-mer ». [NDLR : ces propos n’engagent qu’Alban Bensa].
« Quels que soient les résultats des référendums, rien ne semble pouvoir résister à cette aspiration à davantage de justice. »
Le hiatus était grand entre ce sentiment d’être considérés comme des citoyens de seconde zone et celui, au quotidien, d’être les représentants d’une haute civilisation mélanésienne, riche de langues, de valeurs et de savoirs foulés aux pieds par les Européens fraîchement arrivés. Ces derniers apparaissaient de plus en plus aux Kanaks comme des gens ayant peu de foi en l’humain et en ses capacités d’amélioration par le respect mutuel. C’est ainsi que des hommes comme Jean-Marie Tjibaou, Yeiwéné Yeiwéné, Pierre Declercq, Eloi Machoro, Jean-Pierre Haïfa, Elie Poigoune, Louis-José Barbançon et des femmes comme Déwé Gorodey ou Marie-Adèle Jorédié (et bien d’autres) ont œuvré, au péril de leur vie, pour une élévation de tous les Calédoniens au-dessus des préjugés coloniaux et ont proposé un véritable vivre-ensemble.
LVSL – Avez-vous constaté du progrès dans les conditions de vie des Kanaks depuis les accords de Nouméa ? En outre, la question mémorielle est très importante sur le « Caillou », comme l’attestent les cérémonies de réconciliation ou encore la création d’une citoyenneté coutumière. Les relations entre populations se sont-elles apaisées depuis ? En somme, existe-il aujourd’hui un vivre-ensemble calédonien ?
A.B. – C’est évident. Seuls les imbéciles ou les gens de mauvaise foi peuvent aujourd’hui dire le contraire. L’ouverture de structures hospitalières, d’établissements scolaires, culturels et universitaires, et le soutien à la maîtrise d’une partie de l’industrie du nickel a permis aux Kanaks et à leurs alliés non-kanaks de relever la tête. Leur présence dans les médias, les administrations, les tribunaux, dans la littérature, la musique et les arts plastiques a modifié les conditions mêmes du débat sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks donnent désormais le ton et chacun a compris que rien ne pourra avancer sans eux dans ce pays. Il reste cependant beaucoup à faire. Le creusement des inégalités entre les Européens les mieux nantis et les Kanaks, l’insuffisance du développement économique local en particulier dans l’agriculture et la pêche, l’apparition de poches de misère urbaine aux abords de Nouméa et la sclérose de l’université pas assez ouverte aux Kanaks appellent des mesures d’envergure qui bousculeraient les hiérarchies en faisant plus de place à la jeunesse et à ses exigences de démocratie, toutes communautés confondues. Aujourd’hui, les progressistes du Caillou, conscients de cette nécessité absolue, combattent résolument les idées conservatistes qui profitent seulement à une poignée de Calédoniens. Quels que soient les résultats des référendums, rien ne semble pouvoir résister à cette aspiration à davantage de justice.
La politique mémorielle kanake menée par le Centre Culturel Tjibaou, le Sénat coutumier et les départements culturels des Provinces de Nouvelle-Calédonie a multiplié les espaces de rencontre et de débats entre toutes les composantes de la population. Ce travail de fond a permis aux jeunesses d’origine mélanésienne, indonésienne, polynésienne et européenne de l’archipel de développer une synergie créatrice qui s’efforce de dépasser les clivages. Ce mouvement rencontre certes des réticences mais si l’on en juge par les festivals de films et d’éditions, les expositions, les publications et les débats, il est certain qu’un rapprochement s’opère entre les uns et les autres, conduisant chacune et chacun à reconnaître, selon moi, l’évidence – la Nouvelle-Calédonie n’est pas tout à fait la France mais un pays pluriel en cours de formation.
LVSL – La situation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie fait qu’elle est relativement autonome. En effet, l’État y exerce uniquement ses compétences régaliennes comme le prévoit l’article 77 de la Constitution et toutes les autres compétences sont gérées localement, de manière définitive. En quoi cette situation n’est-elle pas satisfaisante pour les indépendantistes et en quoi l’est-elle pour les loyalistes ?
A.B. – Cette situation n’est pas satisfaisante pour les indépendantistes en ce qu’elle maintient la tutelle française dans des domaines essentiels. Actuellement, les habitants de la Nouvelle-Calédonie se trouvent privés d’un libre pouvoir d’intervention quant à leur destin. L’archipel ne peut en effet décider ni de coopérations bilatérales, ni d’une politique étrangère, ni d’une police, ni d’un appareil judiciaire, ni d’une identité culturelle qui lui soient propres. L’Hexagone, en plaçant la Nouvelle-Calédonie sous tutelle, y mène sa politique d’Outre-mer, celle qui n’est pas atteinte par le transfert de compétences. La marge de manœuvre concédée aux pouvoirs locaux est effective tant qu’elle n’empiète pas sur celle de l’État français. La pleine souveraineté de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, pensent les indépendantistes, permettrait au nouveau pays d’ouvrir avec la France ou tout autre pays des négociations et des accords d’État à État.
Sur le plan économique, il faut savoir que 86% des richesses en nickel sont gérées par la France – 4% seulement ayant été rétrocédés aux indépendantistes de la Province Nord. En outre, toutes les potentialités futures de la Nouvelle-Calédonie, comme les aires de pêche et les fonds sous-marins, restent encore aux mains de la France. En favorisant l’importation de denrées venues d’Europe, le peuplement par des expatriés, le maintien de fonctionnaires jouissant de nombreux avantages qu’ils n’auraient pas en métropole, la France ne permet pas aux domaines d’autonomie, certes concédés, de prendre toute leur mesure et leur efficacité.
« Tous les Kanaks ne se reconnaissent pas dans le mouvement indépendantiste, et tous les non-kanaks ne se placent pas sous la houlette des loyalistes. »
Les Loyalistes souhaitent pour leur part la perpétuation de ce type d’économie assistée et de cette administration encadrée parce qu’elle est la source principale de leurs activités et de leurs revenus. La loi Pons de défiscalisation des investissements immobiliers, les flux financiers privés, les versements de fonds d’État pour compenser les échecs, très fréquents, des politiques de développement engagés par la France, confortent leur pouvoir sur l’économie locale. Et sur le plan idéologique, le maintien de la Nouvelle-Calédonie « dans la France » évite aux responsables de ce front pro-français d’avoir à discuter avec les indépendantistes d’un autre modèle de société et de développement. Toutefois, tous les Kanaks ne se reconnaissent pas dans le mouvement indépendantiste, et tous les non-kanaks ne se placent pas sous la houlette des loyalistes.
[1] Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste.
[2] Lors du débat d’entre-deux-tours entre François Mitterrand et Jacques Chirac, ce dernier affirme : « Il y a un petit groupe qui s’appelle le FLNKS et qui a dérivé vers le terrorisme ».
[3] Parlement local appelé Congrès.