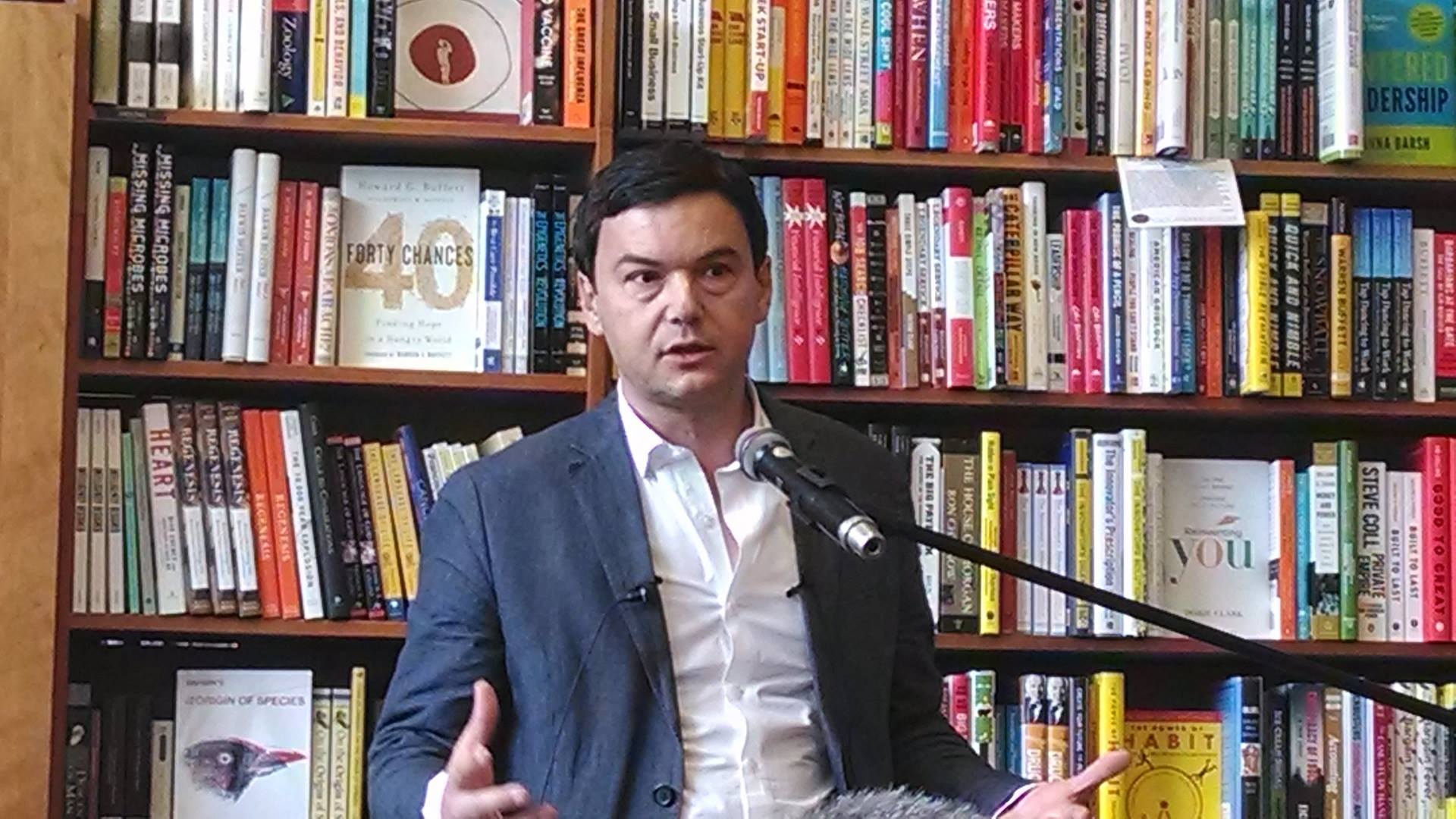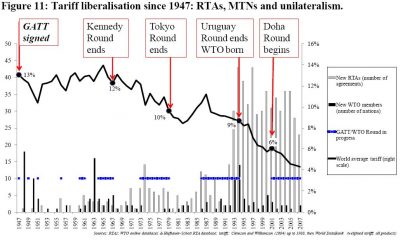Respecter la “loi de l’offre et de la demande”, “faire triompher la concurrence libre et non faussée”, “favoriser l’innovation”… Ces expressions sont désormais familières à tout un chacun, tant elles sont ressassées en boucle par des légions d’économistes et d’éditorialistes sur les chaînes de télévision. Elles sont constitutives de la vision du monde qui domine la sphère politico-médiatique : le néolibéralisme. Dans son nouveau livre, L’économie du réel face aux modèles trompeurs, David Cayla – Maître de conférences à l’Université d’Angers – s’attache à l’analyse et la déconstruction de ces concepts qui sont présentés comme des évidences incontestables. Il expose les fondements économiques, mais aussi anthropologiques et philosophiques du néolibéralisme, et la manière dont cette déclinaison du libéralisme s’est imposée comme la pensée dominante… jusqu’à exclure, comme non-scientifiques, toutes les conceptions divergentes de l’économie.
LVSL – Votre livre est consacré à la réfutation de la prétendue « loi de l’offre et de la demande ». Pouvez-vous rappeler à nos lecteurs en quoi consiste cette loi ?
David Cayla – Il faut d’abord rappeler que lorsqu’on évoque « la loi de l’offre et de la demande », personne ne sait exactement de quoi on parle. C’est le vrai problème de cette « loi » : on l’emploie sans arrêt, pour dire des choses qui sont souvent contradictoires. En fait, il n’y a pas « une » loi de l’offre et de la demande mais trois.
-
Il y a la loi de la demande : lorsque les prix augmentent, la demande diminue, et inversement.
-
Il y a la loi de l’offre, qui postule l’inverse : quand les prix augmentent, l’offre augmente, et inversement.
-
Il y a enfin la « loi de l’offre et de la demande » qui exprime la manière dont les prix varient. Selon cette troisième loi, lorsque l’offre est supérieure à la demande, les prix doivent baisser, et inversement les prix augmentent lorsque la demande est supérieure à l’offre.
On a donc deux lois qui décrivent les changements des quantités offertes et demandées, et une loi qui décrit la variation des prix. Le problème, c’est qu’en fonction des circonstances, on peut utiliser une loi ou l’autre. Imaginons que le prix des oranges augmente alors que la demande baisse ; les néoclassiques diront que la demande baisse parce que le prix des oranges augmente et estimeront que la loi de la demande est respectée. Mais si le prix des oranges avait baissé, et que la demande des oranges avait également baissé, alors les mêmes économistes auraient pu dire que le prix baisse parce que la demande a baissé. Autrement dit, quelles que soient les évolutions des prix et des quantités, ils ont toujours raison. La « loi de l’offre et de la demande » ne peut pas être invalidée par fait. C’est une loi qui, finalement, ne dit absolument rien. Cette loi ne parvient ni à décrire le réel, ni à prévoir ce qui arrivera. Je me suis amusé dans le livre à tenter de prédire la variation des prix des fruits et légumes d’après la « loi de l’offre et de la demande ». Bilan : c’est strictement impossible.
LVSL – En quoi est-ce important ? En quoi la croyance en cette loi est liée à la mise en place des politiques néolibérales ?
Pourquoi cette loi est-elle importante ? Il faut bien comprendre que derrière les prix, il y a les revenus. Le coeur des problèmes que l’on connaît actuellement, c’est celui du pouvoir d’achat et des inégalités considérables que l’on observe entre les professions. Entre l’intérimaire et le footballeur du PSG, il y a des rapports salariaux de 1 à 2000. Comment justifie-t-on ces écarts effarants de revenus ? Avec la loi du marché. Telle profession, tel footballeur est très demandé ; tel autre l’est moins. « Ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien » pour emprunter une formule de notre président.
Les bas salaires sont le produit d’un marché du travail qui organise la concurrence et hiérarchise la valeur des uns et des autres. De même, la faillite d’un petit entrepreneur sera justifiée par son incapacité à vendre ses produits au « bon » prix. La « loi de l’offre et de la demande » permet de fixer un prix, que l’on désigne comme le prix « normal », le prix du marché. Cette normalité qui émane d’un marché impersonnel et immanent sert surtout à justifier les écarts de revenus entre les personnes. Car tous les prix sont à la fois des coûts et des revenus. Il en va de même pour le salaire qui n’est que le prix du travail. Dans cette représentation, nous sommes tous acheteurs et vendeurs. Aussi, la « loi de l’offre et de la demande » ne sert pas tant à expliquer quoi que ce soit, qu’à justifier les équilibres du système économique. C’est le marché et non l’État qui décide de la distribution des revenus. Pour les néolibéraux, laisser au marché le soin de déterminer la hiérarchie économique et sociale c’est rassurant. Pour beaucoup de gens, c’est effrayant.
LVSL – La “concurrence” est un concept largement mobilisé dans le discours économique et la théorie économique qui dominent. Vous jugez pourtant que c’est un concept flou, mal défini, et en dernière instance contradictoire. Pouvez-vous rappeler les principales apories auxquelles se heurtent ce concept ?
David Cayla – Les économistes utilisent depuis longtemps le concept de « concurrence » dans des acceptions parfois très différentes voire contradictoires.
Il y a d’abord la concurrence vue comme une structure du marché. Dans cette conception, on considère la concurrence comme parfaite lorsque les offreurs et demandeurs n’ont aucun pouvoir sur les prix. Les produits sont homogènes, l’information est parfaite, les modes de production sont les mêmes, les offreurs et les demandeurs sont très nombreux et n’ont aucune influence sur le marché. Dans le même temps, le discours dominant fait de la concurrence le moteur de l’économie – c’est une grande idée de Schumpeter –, dans la mesure où la concurrence favorise l’innovation, le dynamisme des entreprises, etc… Mais s’il y a de l’innovation, cela veut dire que les entreprises vendent des produits différents ; cela veut dire qu’elles ont des brevets ; or le brevet implique un monopole sur l’usage du produit. Le dynamisme de l’économie est donc lié à un pouvoir de marché, et donc à un certain pouvoir de monopole de la part des producteurs, qui décident donc de leurs prix. On voit bien qu’Apple décide de ses prix, et c’est en cela qu’elle est innovante. Cette seconde conception de la concurrence considère que la concurrence émane non de la structure du marché mais des comportements des entreprises et des entrepreneurs.
Or, ces conceptions de la concurrence sont donc contradictoires. La première théorie postule que la concurrence est parfaite lorsque les producteurs n’ont aucun pouvoir sur le marché ; l’autre que la concurrence émane des producteurs… ce qui implique un certain pouvoir de monopole et un certain contrôle du marché par les entreprises. Des économistes distingués comme Jean Tirole mélangent allègrement ces deux acceptions de la concurrence : pour eux, la concurrence favorise à la fois la baisse des prix, qui seraient fixés par le marché, et l’innovation… qui implique un pouvoir de marché, et donc un pouvoir de décider au moins en partie des prix. Autrement dit, on ne peut affirmer à la fois que la concurrence favorise l’innovation et fait baisser les prix. Si on veut être cohérent, c’est soit l’un, soit l’autre.
LVSL – Vous mentionnez à plusieurs reprises le rôle joué par les institutions européennes dans la promotion d’une économie néolibérale. Dans quelle mesure peut-on dire que l’Union Européenne est le produit de ce système de pensée que vous analysez ?
David Cayla – Les textes de lois de l’Union Européenne se donnent pour objectif de garantir la liberté des marchés, et de promouvoir à cette fin une « économie sociale de marché » (c’est l’expression consacrée). L’Union Européenne a entièrement intériorisé le paradigme ordolibéral, selon lequel le marché doit être renforcé via des politiques menées par les autorités indépendantes. Il y a d’ailleurs aujourd’hui une multitude d’institutions indépendantes régulatrices du marché, dont les plus puissantes sont les autorités chargées de veiller au respect de la concurrence. À l’échelle européenne, une administration entière y est consacrée sous l’égide de la danoise Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, dont la tâche est d’organiser le marché en condamnant Apple, par exemple, dont on a estimé qu’elle avait porté atteinte à la libre concurrence en bénéficiant d’une fiscalité trop faible.
L’ordolibéralisme n’est pas une théorie au sens d’une science économique ; c’est une construction intellectuelle visant à établir ce que doit être une bonne politique économique. Il y a une époque où l’on considérait que l’État devait se faire stratège, qu’il devait planifier et contrôler en partie la production, posséder des entreprises publiques, aider les filières privées à se développer… On était alors dans le cadre de l’État-planificateur qui se substituait au marché, car on considérait que ce dernier n’allait pas, de lui-même, allouer les ressources là où elles devaient l’être.
Aujourd’hui, dans le cadre de l’Union Européenne, toutes les aides d’État sont interdites et toutes les politiques étatiques de mise en œuvre d’une stratégie économique sont, de fait, interdites. On estime que c’est le libre marché qui doit déterminer où les ressources doivent être allouées. Le seul rôle de l’UE sera donc de veiller à ce que le marché se cantonne à son rôle d’allocation optimale des ressources. On interdit donc à l’État d’intervenir ex-post, mais on demande à des autorités indépendantes du pouvoir politique de créer les conditions de l’épanouissement du libre-marché.
LVSL – Compte-tenu de cela, une rupture avec le néolibéralisme est-elle possible sans rupture avec l’Union Européenne ?
David Cayla – Ma réponse sera courte ! Les textes fondateurs de l’Union Européenne sont profondément imbibés d’ordolibéralisme. On ne pourra pas transformer l’Union Européene en réécrivant ces textes fondateurs – surtout avec la règle qui prescrit que l’unanimité des États est nécessaire pour faire évoluer les traités européens.
J’irais plus loin. L’enjeu le plus important n’est pas de sortir de l’Union Européenne, c’est aussi de prendre conscience que le marché n’est pas toujours efficace, que d’autres instruments économiques sont possibles. Sans prise de conscience de ces éléments, sortir de l’Union Européenne ne sert à rien. Mener les mêmes politiques ordolibérales à échelle française ne mènerait à rien. La bataille que je mène est idéologique. Si on retrouve une souveraineté (monétaire, budgétaire, etc…), à quelles fins l’utilise-t-on ? Il faut donc d’abord délégitimer le discours néolibéral, qui veut que l’offre et la demande, autrement dit les forces du marché, doivent être le moteur unique de toute organisation sociale ; une fois que cette bataille sera remportée, le moyen de rompre avec cette économie sera effectivement la rupture avec l’Union Européenne.
LVSL – Vous en appelez justement, à la fin du livre, au refus de l’hégémonie néolibérale. Il y a, depuis une décennie en Europe, une nébuleuse que l’on qualifie de “populiste”, et qui porte en elle une rationalité qui est, dans une certaine mesure, anti-néolibérale. Le populisme (tel que l’entendent Mouffe et Laclau par exemple) et l’imaginaire qu’il mobilise (un imaginaire de suprématie du collectif sur l’individu, de mobilisation du peuple contre les élites, de conflictualité politique) peuvent-ils selon vous constituer la matrice d’un mouvement de résistance au néolibéralisme ?
David Cayla – Je pense que le populisme se nourrit de la frustration démocratique de nos sociétés. Cette frustration vient du fait que les élites proclament le droit des peuples à la souveraineté démocratique, mais excluent les questions économiques du champ de la délibération politique en raison de la philosophie néolibérale qui est la leur. On dit aux citoyens qu’ils sont libres et souverains mais qu’ils doivent accepter la marchandisation du travail, la mise en compétition avec le monde entier, les méthodes les plus déshumanisantes du nouveau management…
« Populisme » est un mot-valise, mais il y a une caractéristique qui les englobe tous : la promotion du volontarisme politique. C’est le cas en Italie, en Hongrie, en Espagne – « Podemos » veut dire « nous pouvons » en espagnol. Ces mouvements entendent rompre avec la doxa néolibérale caractérisée par l’axiome de Margaret Thatcher « il n’y a pas d’alternative » [There is no alternative, souvent contracté sous la forme TINA]. C’est cela qui explique le succès des populismes. Je pense que c’est une première étape ; la prise de conscience de la capacité du politique à exercer un contrôle sur l’économie est la grande question de notre temps. Mais la résolution de cette question ouvre une foule de questions nouvelles : lorsqu’on a compris qu’on peut faire, que fait-on, et que veut-on faire ? C’est pour moi la limite du populisme dans ses multiples formes actuelles : ceux qui votent Podemos, Orbán, Salvini ou M5S ne sont absolument pas d’accord entre eux quant aux objectifs politiques. Ils veulent tous renverser la table, mais ne s’accordent pas sur ce qu’il y a à reconstruire derrière.
LVSL – Vous évoquez la différence entre l’ancien libéralisme, celui du XIXème siècle, qui ne jure que par la liberté absolue du marché et la défiance à l’égard du politique, et le nouveau libéralisme, qui s’appuie au contraire sur le politique pour faire advenir des mécanismes de marché (et notamment la libre concurrence), qui seraient imparfaits sans cette intervention du pouvoir politique. Dardot et Laval (La nouvelle raison du monde) en font même un point de rupture fondamental entre l’ancien et le nouveau libéralisme. Pensez-vous qu’il est faux, pour cette raison, de parler d’un “retour au XIXème siècle” lorsqu’on tente de décrire la situation actuelle ?
David Cayla – En réalité, il y a trois libéralismes.
Le libéralisme classique, celui d’Adam Smith et du siècle des Lumières, mêle l’économie et le politique. Il prend à bras-le-corps la question de l’émancipation individuelle, et, pour cette raison, n’écarte absolument pas l’idée d’un interventionnisme dans l’économie : émanciper l’individu implique, par exemple, de l’éduquer. Adam Smith était un libéral selon cette acception : il n’était pas opposé à l’intervention de l’État, pour peu qu’elle soit émancipatrice.
L’ultralibéralisme est une seconde forme de libéralisme. Libertarienne, issue de l’école autrichienne [l’école autrichienne d’économie, dite « école de Vienne », compte notamment Friedrich Hayek et Ludwig von Mises parmi ses représentants], cette forme de libéralisme considère que l’intervention étatique est nuisible. Dans mon livre, je cite Milton Friedman, qui est l’un des nombreux héritiers de cette école (avec quelques nuances… sur le plan académique il adopte une méthodologie néoclassique). Friedman considère que la société n’existe pas, que seul l’individu constitue une réalité tangible. Cette forme de libéralisme extrait donc l’individu de la société, et prescrit donc de ne lui imposer aucune contrainte extérieure, car cela équivaut à une forme d’oppression.
Il y a un troisième libéralisme, l’ordolibéralisme, qui est à mon sens représenté aujourd’hui par Jean Tirole (même si lui-même ne se définit pas comme tel). Tirole estime qu’un système purement libéral, sans aucune intervention étatique, ne peut pas subsister ; la concurrence, en particulier, finit par disparaître, car les grandes entreprises écrasent les petites et imposent leur monopole. De même, il existe une imperfection de l’information qui peut conduire certains acteurs à détourner à leur profit les allocations du marché. Celui-ci doit donc être régulé… mais seulement en amont : les partisans de ce libéralisme excluent toute intervention ex-post, pour se cantonner à des inteventions ex-ante. Il faut donc confier à des autorités indépendantes le soin de réguler le capitalisme de marché pour faire en sorte qu’il fonctionne. Ces autorités hautement techniques – technocratiques, pourrait-on dire – sont indépendantes du suffrage universel. C’est typiquement l’idéologie qui domine l’Union Européenne, et qui vient de l’ordolibéralisme allemand. C’est aussi la vision du monde de Jean Tirole, qui est à mon sens l’héritier des ordolibéraux : il pense un marché qui ne fonctionne que lorsqu’il est encadré par un ensemble de règles pré-établies, décidées par des autorités indépendantes, et dans lesquelles l’État n’intervient jamais.
LVSL – Vous critiquez l’approche de l’économie qui est celle d’une majorité de néolibéraux, à savoir une approche “normative”, alors qu’elle devrait être, selon vous, “scientifique”. Vous qualifiez l’approche normative de l’économie “d’aveugle”, puisqu’elle consiste à plaquer une grille de lecture sur le réel, alors que l’approche scientifique devrait étudier le fait économique en lui-même. Mais est-il possible d’étudier le fait économique sans une grille de lecture qui structure notre perception ? Est-ce qu’une approche qui ne serait que scientifique sans être normative est concevable ?
David Cayla – Non. L’économie est une science normative par nature. On ne peut demander aux économistes de se comporter comme des physiciens, c’est-à-dire d’avoir une approche purement positive, de décrire les mécanismes du chômage sans en même temps tenter de proposer une solution. Mais tout ne peut pas être normatif, notamment dans une discipline comme l’économie. L’économie pose des questions fondamentales (comment augmente-t-on la richesse, comment la répartit-on?) auxquelles il faut bien apporter des réponses concrètes qui permettent de changer le quotidien des gens. À ce titre, l’économie ressemble à une science de l’ingénieur. L’ingénieur essaie de trouver des solutions, il est donc normatif ; pour autant il reste un scientifique. Là où cela devient problématique, c’est lorsqu’on devient tellement normatif que cela crée un biais dans les observations et les analyses. On finit par avoir des idées préconçues que l’on garde, même lorsqu’elles ne collent pas à la réalité. C’est le normatif qui mange le positif. Tout le problème est là : comment gère-t-on ces deux aspects, qui sont tous deux consubstantiels à l’économie. Il faut avoir une démarche normative à un certain stade, lorsqu’on pose les problèmes, mais elle doit toujours s’appuyer sur une analyse qui revient sans cesse à la description. C’est cette dimension que l’on a tendance à oublier : on finit par réinterpréter les faits à l’aune d’une approche normative à travers laquelle on considère la réalité ; à la fin, on ne sait même plus de quelle réalité on parle : s’agit-il d’une réalité imaginée, qui est interprétée et réinterprétée, ou d’une réalité factuelle?
L’autre problème en économie est que les faits sont très difficiles à caractériser. Prenons la question de l’offre et de la demande, par exemple : il est quasiment impossible de les quantifier clairement. D’où d’ailleurs la difficulté de « prouver » empiriquement la loi de l’offre et de la demande.
LVSL – On entend beaucoup parler de “gouvernance” dans le discours politico-médiatique dominant. Vous évoquez dans votre livre l’œuvre d’Alain Supiot, qui analyse ce glissement du “gouvernement” à la “gouvernance”. Pouvez-vous revenir sur la signification de cette mutation ?
David Cayla – Alain Supiot étudie la philosophie du droit et la manière dont celui-ci a évolué sous l’empire de la société néolibérale. Il constate qu’avant la société du tout-marché, le droit est un instrument régalien qui sert à commander les gens, à leur dire ce qu’ils doivent faire au nom de valeurs supérieures ; dans le cadre de ces sociétés organiques, les individus étaient sujets de droit. On est passé aujourd’hui à un système où le droit doit être efficace, et se soumettre à la loi du marché : le droit cesse d’être le grand ordonnateur pour s’intégrer à une logique économique. C’est dans ce contexte qu’apparaît la gouvernance, c’est-à-dire un droit qui va chercher à piloter les gens en construisant des systèmes incitatifs, et non plus à en faire des sujets. Le droit est donc soumis à un impératif de compétitivité : d’un pays à l’autre, on trouve des systèmes législatifs que l’on met en concurrence les uns avec les autres.
On passe d’un système vertical à un système plat : il n’y a plus de principe supérieur qui organise les choses selon un idéal de société. Dans le système du droit contemporain il n’y a plus d’autorité suprême ; tout le monde est confronté à un environnement marchand, et le but du droit est donc d’instaurer la compétitivité et la performance plutôt que d’instaurer une société idéale.
On en arrive à la « gouvernance par les nombres ». Les nombres deviennent des indicateurs de performance, qui vont justifier les règles de droit et leurs évolutions. Au lieu de considérer les règles de droit comme des moyens de faire advenir une société meilleure, on les met au service d’un impératif, celui du « Marché total », selon la formule d’Alain Supiot.