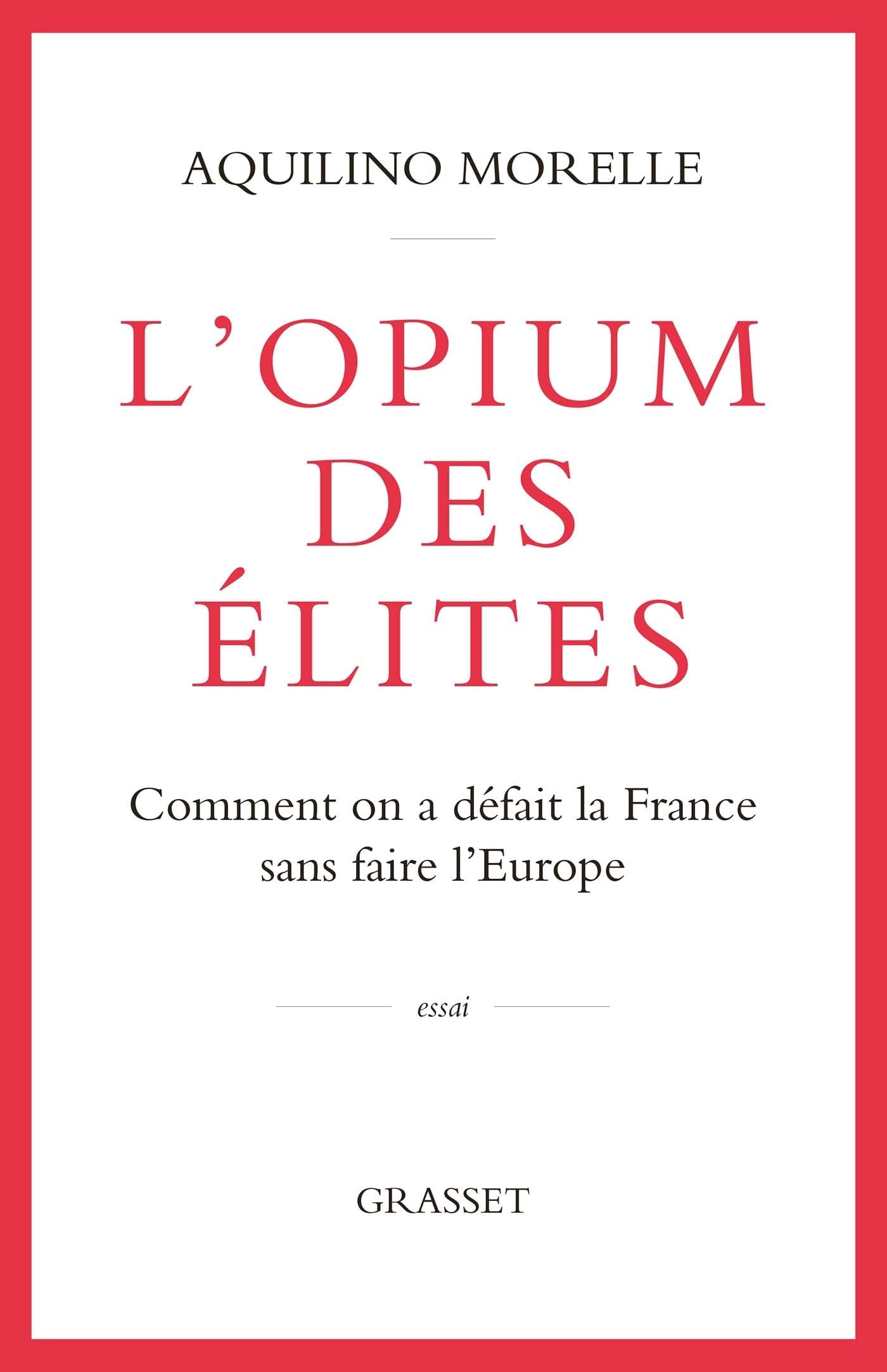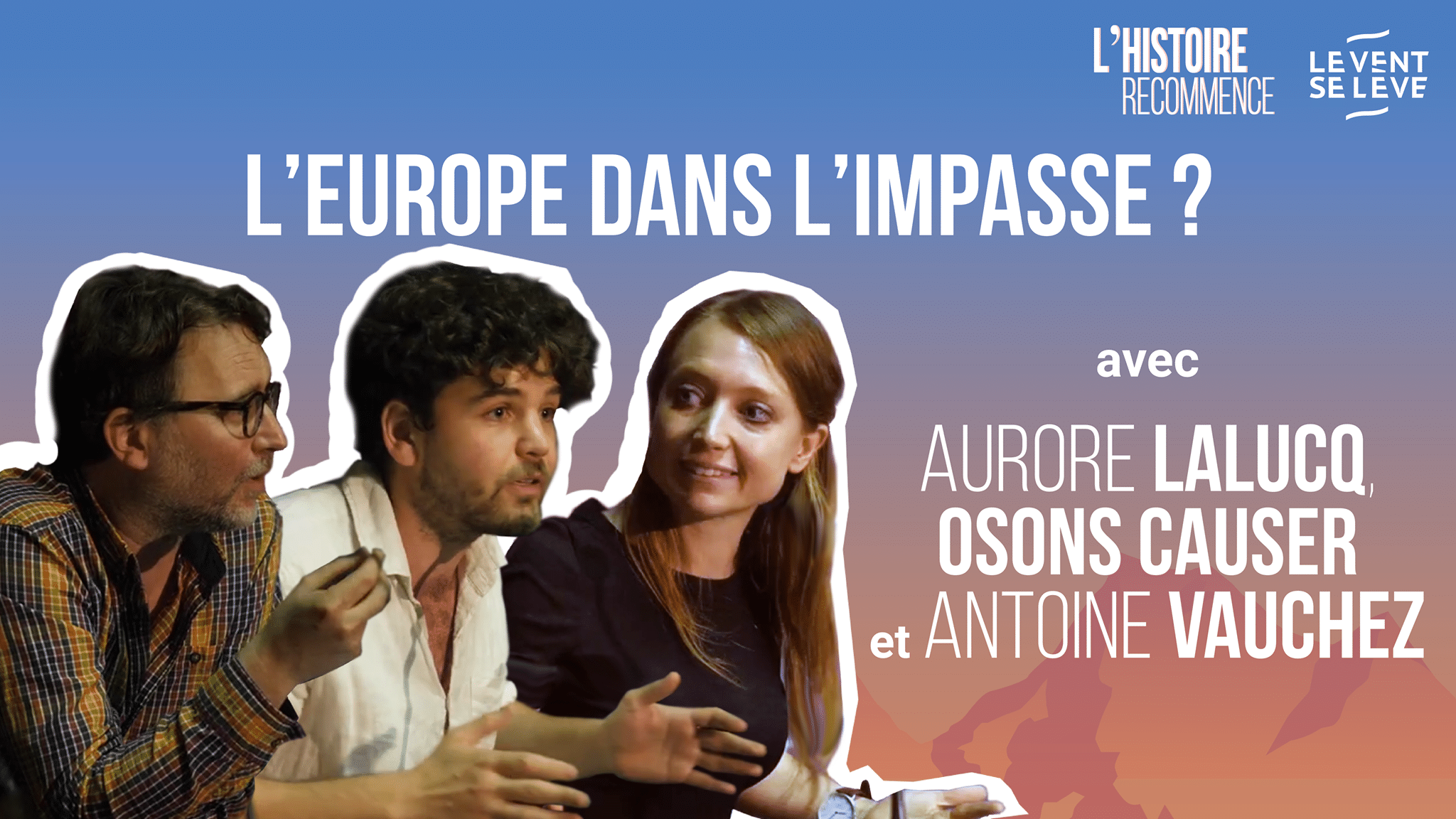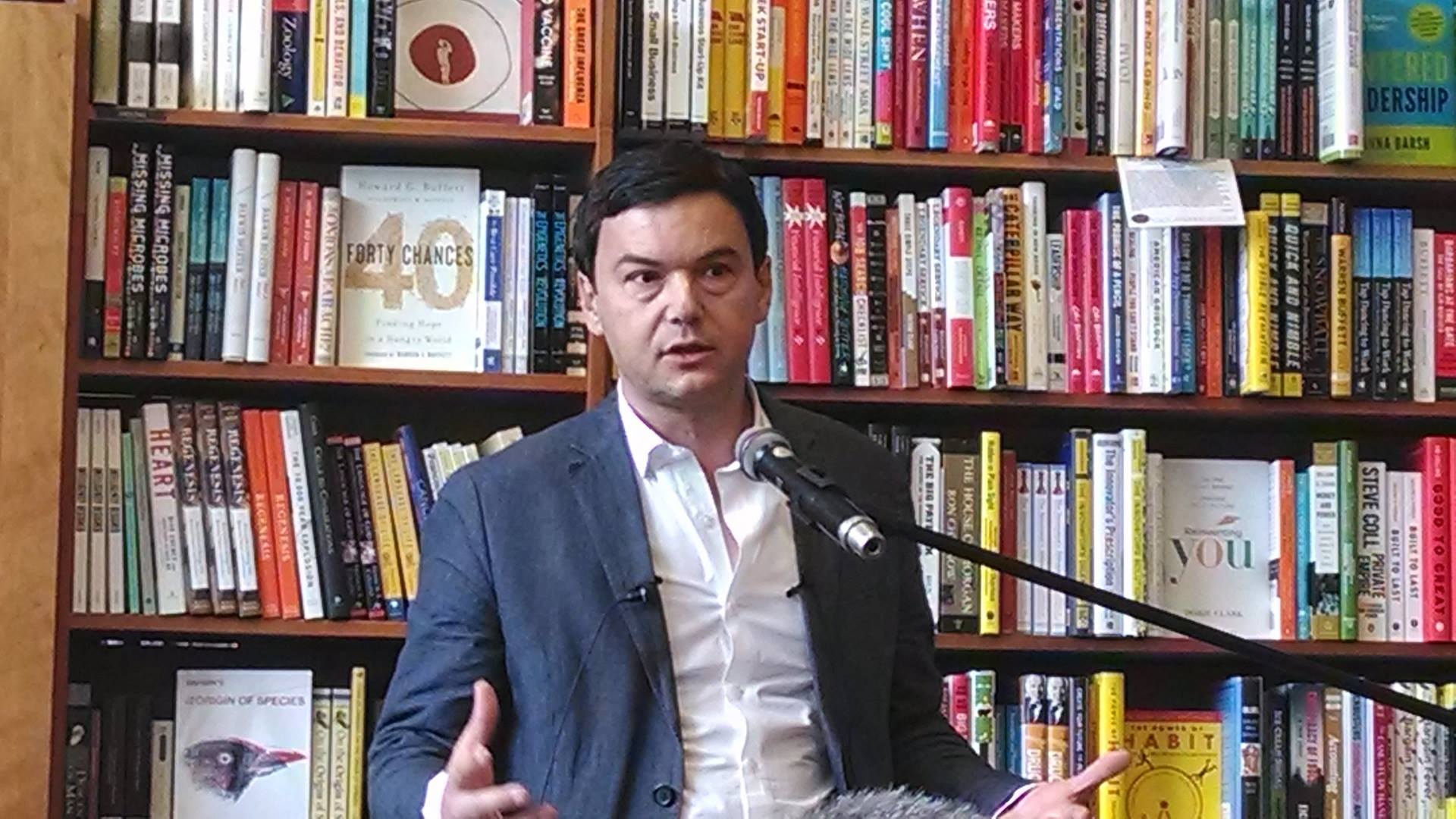Dans L’opium des élites, Aquilino Morelle, ancien conseiller politique de Lionel Jospin, d’Arnaud Montebourg et de François Hollande, propose un autre regard sur la construction européenne : celui d’un projet élitiste, jamais débattu devant le peuple. Dans ce long entretien, il revient en particulier sur le « fédéralisme clandestin » de François Mitterrand, qui a bâti une Union européenne néolibérale plutôt que le socialisme à la française qu’il avait promis. À l’aide de nombreuses références historiques, il aborde aussi l’absence de démocratie en matière européenne, la question du Frexit ou encore le manque de patriotisme des élites françaises. Entretien réalisé par William Bouchardon.
LVSL – Votre livre revient sur 60 ans de construction européenne et sur l’orientation de celle-ci. À vous lire, on comprend que le projet européen était fédéraliste dès l’origine, alors qu’on nous présente souvent celui-ci comme une lente construction conduite par les États-nations. Pouvez-vous revenir sur cet aspect ?
Aquilino Morelle – Pour bien comprendre, il faut faire un détour par la généalogie de l’européisme. Ce mot, apparu dans un récit de voyage dès la fin du XVIIIe siècle, servit en premier lieu à distinguer physiquement les populations européennes des autres ; puis, au XIXe siècle, dans le contexte politique russe, il désigna l’opinion favorable à l’Europe, par opposition à la slavophilie et au panslavisme. Enfin, il fut repris par l’écrivain Jules Romains, qui lui donna en 1915 son sens actuel : la « position politique favorable à l’unification de l’Europe ». En somme, il s’agit d’un mouvement intellectuel qui voit dans l’union politique de l’Europe une nécessité première et une priorité absolue, transcendant toute autre forme de conviction, en particulier partisane.
Né de la Première Guerre mondiale et de ses massacres de masse, ce courant de pensée a connu son âge d’or entre 1923 et 1933. En octobre 1923, le comte autrichien Richard Coudenhove‐Kalergi fait paraître le livre programmatique Pan-europa et lance en parallèle un mouvement politique éponyme, qui prendra fin avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir dix ans plus tard. Cette décennie fut marquée par une intense effervescence intellectuelle autour de très nombreuses revues, le premier Congrès paneuropéen à Vienne en octobre 1926, des projets de « grand marché » fondé sur une union douanière et une unification monétaire du continent, ainsi que la recherche d’une rationalisation de l’économie européenne avec le « plan Delaisi ». Ce projet réalise une première percée politique avec l’exposé du plan Briand lors de la Xe assemblée générale de la Société des nations en 1929 et le Mémorandum pour une « Union fédérale européenne », annoncé le 1er mai 1930.
Progressivement, l’« Europe » est apparue à un nombre grandissant d’intellectuels comme une idée politique belle et puissante, séduisante, attractive, ayant vocation à se substituer à celles du XIXe siècle, jugées épuisées, tels le nationalisme, le marxisme ou le libéralisme. Une idée politique possédant deux dimensions principales : le fédéralisme et le continentalisme.
Dans le prolongement de l’ouvrage fondateur de Pierre‐Joseph Proudhon, Du principe fédératif (1863), les tenants du fédéralisme voient en lui une loi centrale de l’évolution des sociétés humaines, permettant à celles‐ci de concilier, d’une part les impératifs de liberté et d’autonomie, et d’autre part l’ordre et la sécurité. Dans cette perspective historique, l’Europe unifiée est une étape nécessaire et capitale d’un fédéralisme universel. En ce sens, dès l’origine, l’européisme est un mondialisme.
« Progressivement, l’”Europe” est apparue comme une idée politique belle et puissante, séduisante, attractive, ayant vocation à se substituer à celles du XIXe siècle, jugées épuisées, tels le nationalisme, le marxisme ou le libéralisme. »
Quant au « continentalisme », dont le principal représentant fut Coudenhove‐Kalergi, c’est un courant inspiré du panaméricanisme, formalisé par le juriste et diplomate chilien Álvarez, qui proposa en 1926 une réforme de la SDN suivant des bases continentales. Selon Álvarez, la masse physique et humaine d’un continent est bien plus qu’une donnée géographique, elle forme un élément indépassable de solidarité, d’identité et d’unité. Il plaide donc pour une organisation politique du monde passant par le regroupement des États de chaque continent, considérés comme les seules bases géographiques culturellement cohérentes et à la mesure des enjeux économiques du temps. C’est le continentalisme qui, en 1823, a fondé la « doctrine Monroe » aux États‐Unis (formulé par le président américain James Monroe, cette politique étrangère condamne toute intervention européenne dans les affaires « des Amériques », préparant les visées impérialistes des USA sur leurs voisins du Sud, nldr), autant que suscité la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963.
L’européisme actuel est héritier de cette histoire. Comme son aïeul, il est à la fois un continentalisme et un fédéralisme, parfois avoué mais le plus souvent masqué. Jean Monnet est un des rares à assumer son fédéralisme. Dès août 1943, dans une note stratégique destinée au général de Gaulle, il souligne la nécessité que « les États d’Europe forment une fédération ou une “entité européenne” ». Dans la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considéré comme le texte fondateur de la construction européenne, Monnet demande que l’on souligne cinq lignes essentielles : celles où il précise que la future CECA réalise « les premières assises concrètes d’une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix ». En tant que Président de la Haute Autorité, organisme supranational de la CECA, il déclara que « notre Communauté n’est pas une association de producteurs de charbon et d’acier : elle est le commencement de l’Europe. » Tout au long de son action, qu’il poursuivit en tant que président du Comité d’action pour les États‐Unis d’Europe (CAEUE), il confirma sa profession de foi, affirmant : « C’est au fur et à mesure que l’action des Communautés s’affirmera que les liens entre les hommes et la solidarité qui se dessinent déjà se renforceront et s’étendront. Alors, les réalités elles-mêmes permettront de dégager l’union politique qui est l’objectif de notre Communauté : l’établissement des États‐Unis d’Europe. »
Loin de se cantonner à des soi-disant « petits pas », Monnet a installé, au cœur de la mécanique européenne, la technique fédéraliste de « l’engrenage » : chaque étape atteinte, chaque point marqué, prépare l’offensive suivante et doit rendre le retour en arrière pratiquement impossible, avec un « effet de cliquet ». Ses successeurs feront de même, en particulier Jacques Delors, qui reconnaîtra que la réalisation du grand marché unique, avec la signature de l’Acte Unique, en 1986, illustre cette « théorie de l’engrenage, une mesure en appelant une autre ». Ce moment est véritablement décisif : en élargissant considérablement le recours au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres européen, il affaiblit fortement la possibilité pour les États de s’opposer à de nouvelles avancées fédéralistes.
En 50 ans (1950-2000), cette méthode aura permis de construire un édifice juridique et institutionnel européen, par trois vagues successives d’engrenage. Dans ses mémoires, Jacques Delors écrit : « Deux périodes permettent de comprendre l’apport de la méthode de Jean Monnet, celle de l’engrenage, au processus d’intégration : la première remonte à l’origine même des Communautés […]. La réalisation de l’Union douanière, prévue par le traité de Rome, témoigne de la force de cette méthode lorsqu’elle est appliquée avec diligence […]. Ainsi, l’Union douanière entra en vigueur plus vite que prévu par le calendrier initial. Elle fut achevée le 1er juillet 1968, avec 18 mois d’avance. Plus près de nous, la relance de 1985 illustre, elle aussi, la méthode de l’engrenage […]. L’engrenage par l’économique a fonctionné jusqu’en 1992 : l’Acte unique permet de décider, en étendant le vote à la majorité qualifiée, et met en place les politiques structurelles, contrepartie indispensable du grand marché. » Vient ensuite la troisième époque : « L’Union économique et monétaire (UEM) peut être considérée comme le départ d’un nouvel engrenage. »
Ainsi, dès l’origine et jusqu’à nos jours, l’européisme est un projet fédéraliste, celui des « États-Unis d’Europe ». Certains l’ont ouvertement revendiqué, tels Jean Monnet, le philosophe Jean Benda, l’écrivain suisse Denis de Rougemont ou l’homme politique italien Altiero Spinelli, hier ; le philosophe Jürgen Habermas, l’ex Premier ministre belge Guy Verhofstadt (libéral), Daniel Cohn-Bendit (écologiste) ou l’ancien Premier ministre italien Enrico Letta (social-démocrate), aujourd’hui. Mais beaucoup d’autres, notamment Mitterrand et Delors, ont fait le choix de ce que Raymond Aron appelait « le fédéralisme clandestin ».
LVSL – Vous mentionnez à juste titre François Mitterrand. En France, cette orientation fédéraliste n’a-t-elle pas été bien plus portée par les socialistes que par la droite gaulliste ?
A. M. – En effet. Le général de Gaulle a toujours été un défenseur de la Nation en général et de la nation française en particulier. Pour cette raison, il était favorable à ce que l’on a appelé « l’Europe des peuples », c’est-à-dire une Europe respectueuse des identités de chaque nation et de la souveraineté de chaque État. Il a donc toujours rejeté le fédéralisme.
Quant à Mitterrand, son engagement fédéraliste commence dès sa jeunesse. En mai 1948, il participe au Congrès de La Haye, moment exalté de la relève fédéraliste d’après‐guerre et « en était ressorti très impressionné » selon Jacques Delors. Quelques mois plus tard, le 18 novembre 1948, en tant que secrétaire d’État auprès du président du Conseil Henri Queuille, il représente la France au congrès de l’Union européenne des fédéralistes à Rome. Il n’était alors pas encore socialiste, mais déjà fédéraliste. Mitterrand a cependant dissimulé cette conviction selon les aléas de sa vie publique. Comme le précise Delors : « l’engagement historique de François Mitterrand en faveur de l’Europe ne faisait pas de doute, même si l’expression en était plus ou moins explicite selon les contingences de la politique, surtout avant qu’il n’accède au pouvoir […]. C’est donc à partir de son choix décisif de mars 1983 qu’il a vraiment chaussé les bottes du grand européen qu’il était. »
« En mars 1968, dans une longue tribune dans Le Monde, Mitterrand expose de façon limpide l’alternative implacable qui s’offrirait à la gauche lorsque celle-ci accéderait au pouvoir : le socialisme ou l’Europe. »
Une fois aux responsabilités, il agit en fonction de ses convictions fédéralistes, en particulier lors du fameux « tournant de mars 1983 », qui ne fut pas un tournant « libéral » ou « de la rigueur », mais bien un tournant fédéraliste. A ce moment, il décide d’escamoter le socialisme et d’ériger l’européisme en idéologie de substitution. C’est une mystification politique sans précédent dans notre histoire. Contrairement à ce qu’on entend parfois, ce ne fut pas un choix dicté par les circonstances, mais bien une décision mûrement pesée et réfléchie de longue date, qui utilisa le contexte comme alibi.
On pouvait d’ailleurs le deviner dès mai 1981, à travers de ses nominations aux fonctions les plus stratégiques : Jacques Delors au ministère de l’Économie et des Finances et Claude Cheysson aux Relations extérieures. Le premier était un ancien collaborateur de Jacques Chaban‐Delmas et alors député européen. Le second un commissaire européen, nommé sous Pompidou et reconduit par Giscard d’Estaing, au Quai d’Orsay. Pour le premier gouvernement de gauche après 23 ans d’opposition, on était en droit d’attendre d’autres profils ! En tant qu’ancien adhérent du MRP (1944‐1946) et fondateur en octobre 1973 du club « Échange et projets » visant à dialoguer avec les milieux industriels et financiers, Delors fut d’ailleurs considéré par nombre de socialistes comme trop « à droite » et trop proche du patronat. Il réussit cependant à casser cette image en signant le « manifeste des Trente » en 1978, aux côtés des mitterrandistes du premier cercle (Édith Cresson, Lionel Jospin, Henri Emmanuelli, Charles Hernu, Pierre Joxe, Louis Mermaz) pour soutenir Mitterrand contre Rocard, en dépit de ses opinions affichées en faveur de la « seconde gauche ». Mitterrand le remercia ensuite en le faisant élire au Parlement européen.
Mitterrand savait ce qu’il faisait. Déjà en décembre 1965, lors du second tour de la présidentielle contre le général de Gaulle, en pleine crise « de la chaise vide », il se présentait comme « le candidat de l’Europe ». Surtout, en mars 1968, dans une longue tribune dans Le Monde, il expose de façon limpide l’alternative implacable qui s’offrirait à la gauche lorsque celle-ci accéderait au pouvoir : le socialisme ou l’Europe. Ce texte, publié en deux parties et intitulé « Une politique économique pour la France », présentait d’abord (29 février, « Une économie désarmée ») un lourd réquisitoire contre la politique économique et sociale conduite par les deux ministres de l’Économie successifs de Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing et Michel Debré ; puis (1er mars, « Mobiliser l’économie ») un exposé de la politique alternative qu’il préconisait, qui précise que la politique socialiste a « Une stratégie : l’Europe ». Les derniers mots sont sans détours : « Une France socialiste dans une Europe libérale : cette question est d’actualité brûlante pour la gauche […]. La gauche devra‐t‐elle opter pour l’Europe contre le socialisme, pour le socialisme contre l’Europe ? » Ainsi, dès mars 1968, quinze ans avant le mois de mars 1983, tout était déjà écrit par le premier secrétaire du PS.
LVSL – Si l’engagement européiste de Mitterrand était aussi fort, pourquoi l’a-t-il caché aux Français ?
A. M. – Ces quinze années d’ambiguïté savamment entretenue visaient à ménager les forces dont François Mitterrand avait besoin pour accéder au pouvoir. D’abord le PCF, qui était violemment hostile à la construction européenne, qu’il considérait comme un outil du « grand capital ». Mais aussi le CERES (Centre d’Etudes, de Recherche et d’Education Socialiste) de Jean‐Pierre Chevènement, qui fit partie des fondateurs du PS d’Épinay et était le stratège de l’union de la gauche. Ces quinze années ont aussi construit la légende qui entoure le personnage de Mitterrand, grand monarque qui prêtait l’oreille aux uns et aux autres, recevait, le soir venu, de très nombreux visiteurs et passa dix journées et dix nuits, du 13 au 23 mars 1983, à raturer des notes et à soupeser des arguments économiques et financiers.

En réalité, il n’avait que faire de tout cela. Le vieux roi en avait décidé autrement depuis fort longtemps. Durant cette « décade prodigieuse » de mars 1983, Mitterrand fut surtout le metteur en scène d’une pièce de théâtre dont il était le seul à connaître les tirades et le dénouement, puisqu’il les avait lui-même écrits. Toute cette comédie ne servait qu’à préparer les acteurs – le gouvernement, le PS, le PCF et la majorité parlementaire – et les spectateurs, c’est-à-dire les Français. Entre le socialisme et l’Europe, ce serait l’Europe.
Un premier avertissement avait déjà été lancé le 27 septembre 1982 à Figeac. Le Président y avait qualifié l’Europe d’« admirable construction » et rappelé : « oui, moi je suis européen de conviction, mes votes sont toujours allés dans ce sens ». Le tournant était déjà pris puisqu’il élevait au rang de « nécessité » la limite de 3 % du PIB pour le déficit budgétaire et assenait à son auditoire que « ce que j’ai appelé le socialisme à la française, je n’en fais pas une Bible ».
Pour Mitterrand, se défaire du socialisme, qu’il avait enfilé comme un costume de scène, pour retrouver sa vieille maîtresse, l’Europe, fut un vrai soulagement : celui de clore enfin ce « cycle d’Épinay » qui lui avait certes permis d’asseoir sa domination sur le PCF et d’accéder au pouvoir, mais qui lui avait tant pesé. Par ailleurs, il faisait ainsi d’une pierre deux coups, puisqu’il enclenchait l’engrenage qui aboutirait à l’« Europe de Maastricht », sa revanche posthume sur Charles de Gaulle et son « Europe des nations ».
La « rigueur » de 1982, puis l’« austérité » de 1983, plus que des objectifs en eux‐mêmes, furent conçues par Mitterrand et Delors avant tout comme des instruments, des étapes, vers une perspective fédéraliste. Maîtriser le déficit public et sauvegarder le cours du franc pour préserver ainsi la participation de notre monnaie au SME n’étaient que des préalables pour atteindre une visée autrement importante à leurs yeux. La véritable finalité de ce changement politique était de donner des gages à l’Allemagne et à son nouveau chancelier, Helmut Kohl, afin d’engager une relance politique de la construction européenne.
Cette stratégie fédéraliste fut pleinement déployée lors la présidence française de l’Europe au premier semestre 1984 avec le Conseil européen de Fontainebleau, qui entérinait la commande du « Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur » à Jacques Delors, qui deviendrait Président de la Commission européenne l’année suivante. Delors occupera cette fonction pendant trois mandats, de janvier 1985 à janvier 1995, dix années qui ont changé le visage de l’Europe et du monde.
LVSL – Vous affirmez donc que le « tournant de la rigueur » n’en était pas un et qu’il s’agissait uniquement d’une stratégie pour construire l’Europe ?
A. M. – Oui. Hubert Védrine rappelle ainsi que le « forcing européen des années 1984‐1992 est impensable sans le préalable de la rigueur de mars 1983. » Mais en réalité, il n’y a pas eu, en mars 1983, de « tournant de la rigueur » imposé par la « contrainte extérieure » comme on nous le raconte. Quelques semaines avant sa mort, Mitterrand a d’ailleurs mis les choses au clair : « Le tournant ? Quel tournant ? Il n’a jamais existé que dans la tête des journalistes. »
En fait, les statistiques économiques furent mises au service du projet politique de François Mitterrand. Comme l’a souligné Jean‐Pierre Chevènement, le déficit commercial de la France en 1982 était quatre fois moindre que l’actuel et, avec un taux d’endettement de 20 % du PIB cette même année (contre 116% en 2020, ndlr), notre pays respectait haut la main les critères de Maastricht. Ces chiffres ont été utilisés pour dramatiser une situation, certes sérieuse, mais pas dramatique. Jacques Delors l’a reconnu vingt ans plus tard, en 2004 : « Si on compare la France de mars 1983 avec les autres pays, en termes de croissance économique et d’emploi, nous faisions mieux et nous avions un des déficits budgétaires les plus faibles d’Europe, ce qui n’empêchait pas le franc d’être attaqué. Notre taux d’inflation nous situait au milieu du peloton européen, mais très au‐dessus de l’Allemagne. Mais nous étions franchement dans le rouge pour le commerce extérieur avec un déficit proche de cent milliards. »
« Le choix décisif de mars 1983 ne fut pas “un tournant libéral” mais un tournant fédéraliste . La finalité était de convaincre Kohl de relancer la construction européenne. »
Le choix décisif de mars 1983 ne fut pas « un tournant libéral » mais un tournant fédéraliste. La finalité était de convaincre Kohl de relancer la construction européenne. Puis, en faisant un chèque aux Anglais pour satisfaire le « I want my money back » de Margaret Thatcher, celle-ci entérina le choix, concocté par Mitterrand et Kohl, de nommer Delors à la tête de la Commission européenne, dont la principale mission fut de préparer l’Acte unique européen (1986), le premier traité européen depuis celui de Rome (1957). Tous ces événements majeurs des années 1983 à 1986 constituent une seule et même séquence politique avec une cohérence idéologique profonde : la relance du fédéralisme européen. Qualifier le tournant de mars 1983 de « libéral » est une facilité de langage et une erreur d’appréciation politique. Ce fut un tournant fédéraliste. Il ne s’agissait pas de « ne pas sortir de l’Europe », mais de fabriquer une nouvelle Europe, plus fédérale.
LVSL – N’est-ce pas cette adhésion des socialistes à la construction européenne, plutôt que, par exemple, la note de Terra Nova en 2011 ou la loi Travail de François Hollande, qui explique le divorce entre le PS et les classes populaires ?
A. M. – Vous avez raison. La piteuse note de Terra Nova – publiée le 10 mai 2011, un aveu involontaire autant qu’une provocation puérile – n’est qu’une conséquence lointaine de cet événement historique que fut le tournant de mars 1983. Ce retournement, jamais véritablement ni débattu, ni expliqué aux Français, ne correspondait en rien aux orientations validées en mai 1981. C’est à la fois un déni de démocratie pour la France et une trahison des électeurs de gauche, au premier rang desquels les couches populaires. Le printemps 1983 marque le début de la dislocation de l’alliance de classes qui avait porté la gauche au pouvoir deux ans plus tôt, cette longue chaîne humaine et politique qui unissait la professeure d’université, le cadre supérieur, l’institutrice, l’infirmier, l’ouvrière, les conduisait non seulement à déposer le même bulletin dans l’urne, mais aussi à rêver ensemble à une même société, plus libre et plus juste. Durant les trois décennies suivantes, la «majorité sociologique » réunie par Mitterrand en 1981 s’est de plus en plus effritée, avant de disparaître lors de la débâcle finale en 2017 avec un président socialiste empêché de se représenter et un candidat socialiste au score humiliant.
Dans son dernier livre écrit en tant que socialiste, en novembre 1980, Mitterrand portait une promesse d’« ici et maintenant ». En assumant son européisme, il la transforma en « ailleurs et plus tard ». À la place d’une France socialiste, il désigna l’Europe « sociale » comme horizon des jours meilleurs. Lorsqu’on lui demandait quand l’Europe deviendrait sociale, il répondait toujours « plus tard ». En réalité il savait que la vraie réponse était « jamais », car le cadre juridique de l’Europe s’opposait, dès le traité de Rome, à une telle évolution, puis l’a interdite avec l’Acte unique en 1986 et, plus encore, en 1992 avec le traité de Maastricht.
« La gauche est passée de la vénération du prolétariat à la “prolophobie”. »
Longtemps, la gauche s’est préoccupée en priorité de ceux qui allaient mal, dont la vie était dure, et qui réclamaient simplement de vivre mieux. Progressivement, elle s’est désintéressé d’eux, pour s’attacher à ceux qui vont bien et désirent une vie plus douce. En somme, la gauche est passée de la vénération du prolétariat à la « prolophobie », de l’ouvriérisme à la glorification du « bobo ». En devenant de plus en plus étrangère à des classes populaires qu’elle ne cherche plus à comprendre, la gauche n’a cessé de leur reprocher leur réticence à la mondialisation et à la construction européenne ou encore leur racisme, leur xénophobie, leur sexisme et leur homophobie supposés. Pour citer Bertolt Brecht, elle l’a accusé de venir grossir « le ventre encore fécond, d’où a surgi la bête immonde ». Bref, cette gauche autoproclamée « de gouvernement », cette gauche du « oui », héritière de la deuxième gauche, a excommunié le peuple.
Désabusé, dégoûté et résigné, le peuple s’est alors progressivement détourné de cette gauche. Le chômage de masse, le poids de l’intégration de la majorité des populations immigrées, la dégradation des services publics, notamment l’école qui permettait l’ascension sociale des enfants, l’explosion des prix du foncier… sont autant de motifs pour lesquels le peuple a délaissé la gauche. Au contraire, le FN, bien qu’il n’ait pas changé dans ses tréfonds, a fait l’effort, évidemment intéressé et insincère, d’écouter le peuple et de prendre en compte ses difficultés. Le travail de dédiabolisation accompli par Marine Le Pen et les accusations de « populisme » ont achevé d’asseoir l’assise du FN dans le monde ouvrier.
Un grand schisme, tragique, s’est installé : le peuple sans la gauche, la gauche sans le peuple. La gauche, sans le peuple, ne sert plus à rien et n’est plus rien. Elle a abandonné la lutte pour la justice sociale et se contente de réformes de société et de faire des sermons. La gauche sans le peuple, c’est le moralisme. Quant au peuple, sans la gauche, il est condamné à être abusé. Il n’est plus l’agent politique du progrès, mais le supplétif de forces mauvaises qui prospèrent sur le ressentiment. Le peuple sans la gauche, c’est le populisme.
LVSL – Un autre élément est assez frappant lorsque l’on parle de la construction européenne : alors que les enjeux sont considérables, les Français n’ont pu s’exprimer directement sur le sujet qu’à deux occasions : en 1992 et en 2005. Pourtant, l’Union était déjà très avancée avant Maastricht, comme vous l’avez rappelé. Quant à 2005, nous savons que le vote des Français n’a pas été respecté. Considérez-vous que la construction européenne s’est faite contre le peuple français ?
A. M. – Clairement, elle s’est faite contre le peuple français et sans lui. La France était une nation souveraine membre d’une structure de coopération internationale classique, la Communauté économique européenne (CEE). Prise dans une spirale fédéraliste, elle s’est faite absorber dans une entité juridique et politique supranationale, l’Union européenne. Un choix aussi considérable que celui du destin de la France, aurait justifié un débat national. Il n’y en a pas eu.
Le 23 mars 1983, lors de son allocution présidentielle inaugurant la césure européiste, Mitterrand a beaucoup parlé des enjeux du moment, comme le chômage, l’inflation et le commerce extérieur, mais n’a consacré que seize secondes à la vraie raison de cette rupture essentielle, à savoir la construction européenne. Seize secondes ! Voilà tout ce qui a suffit pour évacuer le programme commun de 1972 et ce qui restait des 110 propositions de 1981. Seize secondes pour prendre un tournant sur lequel il n’avait pas été élu, ni lui, ni les parlementaires de sa majorité. Imagine‐t‐on le général de Gaulle annoncer l’indépendance de l’Algérie en seize secondes ? Non. Après avoir signé les accords d’Evian le 18 mars 1962, il les a soumis à la ratification du peuple français par référendum le 8 avril.
En février 1986, lors de l’adoption de l’Acte unique, qui a étendu la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres européen et entériné l’adoption de près de 300 directives pour la réalisation du marché unique et la libéralisation des mouvements de capitaux intra-européens, pas non plus de référendum! Il s’agissait pourtant d’une étape clé vers le fédéralisme et d’un coup d’envoi de la globalisation financière qui allait submerger la planète entière. Quand le drapeau européen fut soudainement mêlé au drapeau français pour le trentième anniversaire du traité de Rome, en 1987, non plus. Ce ne fut qu’en 1992, devant la rupture flagrante représentée par le passage à l’Union européenne et la disparition du franc, et donc la nécessité de réviser la Constitution de la Ve République, que les Français ont enfin été consultés. C’était déjà bien trop tard.
« L’Europe des années 1980 est le pur produit d’une forme moderne de despotisme éclairé. »
Hubert Védrine, conseiller diplomatique, puis secrétaire général de l’Élysée de François Mitterrand.
Les Français ont été privés du débat auquel ils avaient droit. Hubert Védrine l’avait lucidement concédé en déclarant que « l’Europe des années 1980 est le pur produit d’une forme moderne de despotisme éclairé. » A propos des décideurs de l’époque, il explique qu ‘« autour de François Mitterrand, dans les années 1980, tout cela [la nécessité de contourner les opinions publiques] nous paraît si évident que nous ne nous posons à aucun moment la question [celle de consulter le peuple]. Au mieux pensons‐nous de temps à autre qu’il serait opportun de mieux informer le Parlement. » Le scandale démocratique de la ratification parlementaire du traité de Lisbonne, en 2008, après 56% de non des Français en 2005, ne se comprend que dans cette perspective historique. Cet événement indigne illustre bien la conception de la « démocratie » qu’ont les européistes.
LVSL – Si la religion est l’opium du peuple selon les marxistes, vous écrivez que l’Europe est « l’opium des élites ». Ce n’est pourtant pas le cas dans tous les pays, il suffit de regarder le Royaume-Uni, où l’élite économique et politique a toujours été divisée sur le sujet. De même l’Allemagne promeut une construction européenne correspondant à ses intérêts économiques. Comment expliquez-vous cette fascination de nos élites pour l’Europe ?
A. M. – La question de la loyauté des élites, qu’elles soient politiques, économiques et financières, intellectuelles et médiatiques, est devenue un enjeu central de nos sociétés. D’abord c’est un enjeu moral, puisque, comme nous l’a rappelé Raymond Aron, « la fonction d’une élite est d’assurer la grandeur d’un pays ». Nos élites nationales devraient se remémorer l’avertissement de Pareto, qui rappelait que « l’Histoire est un cimetière d’élites ». Ensuite, c’est un problème politique, puisque le peuple a répondu à la sécession des élites en faisant lui-même sécession. «Le populisme est la réponse du peuple à l’élitisme des élites » écrit si justement Jacques Julliard. Or, aucune démocratie ne saurait subsister longtemps à un tel écartèlement. Enfin, c’est un problème électoral, car cette décomposition qui perdure augmente le risque de voir l’extrémisme accéder au pouvoir.
La France souffre d’une pathologie démocratique singulière. En Europe, les élites françaises, en particulier celles de gauche, sont parmi les plus mondialistes, les plus européistes, les plus conformistes et les plus méprisantes à l’égard du peuple. Avec leur mode de vie et de pensée globalisé, elles adhèrent au discours de l’impuissance nationale et cultivent une forme de « haine de soi » bien propre à notre pays. Elle ressassent la dénonciation de l’« exception française », sans pour autant s’intéresser à la vie intellectuelle et politique de l’étranger, se contentant d’un mince vernis de culture anglo‐saxonne, baragouinant le globish et incapables de former une phrase en italien, en espagnol ou en allemand. Idéologiquement universalistes, elles se sont perdues dans une globalisation qu’elles imaginaient naïvement « heureuse » et qu’elles ont cru tout aussi naïvement pouvoir « maîtriser ». Résignées politiquement, considérant « l’Europe » comme la solution à tous les maux, elles sont adeptes de la fuite en avant fédéraliste et de l’idéologie post‐nationale. N’oublions pas la phrase de Christopher Soames, ancien vice-président de la Commission européenne : « Dans une organisation internationale, il faut toujours mettre des Français car ils sont les seuls à ne pas défendre les intérêts de leur pays. »
« Dans une organisation internationale, il faut toujours mettre des Français car ils sont les seuls à ne pas défendre les intérêts de leur pays. »
Christopher Soames, ancien vice-président de la Commission européenne.
Les élites françaises sont dépassées, elles sont incapables d’affronter le nouveau monde, de prendre les problèmes à bras le corps et de clarifier nos relations avec l’UE, un impératif pour relever notre pays. Le constat de Pierre Mendès-France, à l’époque d’une autre crise, celle de la décolonisation, reste d’actualité : « Il semble, par moments, qu’un grand sommeil se soit emparé de la Nation, coupé de rêves pleins de nostalgie à l’égard d’un passé révolu et de cauchemars remplis de craintes à l’égard d’un avenir qui paraît sombre. Il nous faut réveiller la France. C’est là une belle tâche ; c’est une tâche difficile ; c’est une tâche possible. » Ce réveil implique le remplacement de la vieille génération européiste et l’affirmation de responsables n’opposant plus Europe et Nation. La condition sine qua non du redressement de la France et du nouveau projet politique dont l’Europe a besoin est la restauration du patriotisme au sein des élites françaises. Il ne faut plus abandonner l’Europe aux européistes.
LVSL – Aujourd’hui, la France n’est plus souveraine en matière de monnaie ou de commerce, son budget est étroitement surveillé par Bruxelles, de nombreux domaines de nos vies sont régis par les règlements et directives de l’UE… Tout cela laisse peu de marge de manœuvre pour un gouvernement. Par ailleurs, comme vous le rappeliez, les Français n’ont pratiquement pas été consultés sur la construction européenne. Faut-il organiser un référendum sur le Frexit pour retrouver notre souveraineté ?
A. M. – Non. Mais avant d’expliquer pourquoi, je veux revenir sur certains éléments pour expliquer que la sortie de l’UE ne peut être écartée d’un revers de main moralisateur. D’abord, le malaise européen, fait de lassitude, de rejet, de distance et même de colère, est là. De plus, le Brexit nous a montré que la tentation de la sortie peut devenir une réalité tangible. De même, on ne peut écarter la sortie pour des raisons exclusivement économiques : lors de la crise financière, l’impact sur trois ans d’une sortie de la France de la zone euro avait été évalué à environ 10% du PIB, autant dire une broutille face à la crise COVID. Il faut aussi rappeler que Joseph Stiglitz et Paul Krugman, deux prix Nobel d’économie attachés à l’idée européenne, ont pointé l’échec patent de la zone euro, et proposé de la déconstruire, voyant bien qu’elle ne pouvait être réformée.
Par ailleurs, l’argument de l’« irréversibilité » est lui aussi irrecevable : bien sûr, se dégager d’un ensemble auquel on se trouve lié par d’étroites relations commerciales et des centaines de textes juridiques accumulés au fil du temps, représente une opération longue et d’une grande complexité, comme le montre le Royaume-Uni. Pour nos voisins britanniques, cette sortie signifie se défaire de 600 accords avec l’UE, puis renégocier 200 accords passés entre celle‐ci et diverses organisations internationales. Sans parler des 50 % d’exportations britanniques réalisées avec l’UE, alors que seules 6% des exportations européennes vont vers la Grande-Bretagne. Cela explique pourquoi cinq ans auront été nécessaires pour finaliser la décision prise par référendum le 23 juin 2016.

Quoiqu’il en soit, le choix d’un peuple, démocratiquement formulé, doit être respecté, quelle que soit la difficulté de sa mise en œuvre concrète. Même si nombre d’européistes, sur le continent et outre-Manche ont refusé de l’admettre, le Brexit était indispensable, puisque décidé par le peuple britannique. Il en irait de même pour notre pays si les Français faisaient ce choix.
Cependant, une telle rupture n’est aujourd’hui souhaitée ni par le peuple français, selon les études d’opinion, ni réclamée par aucune force politique importante. Dès lors, un « Frexit » ne pourrait résulter que d’une désagrégation générale de l’Union européenne, notamment à l’occasion d’une crise financière faisant éclater la zone euro. L’intérêt de la France n’est pas de quitter l’Union, mais de la transformer ; de redéfinir le projet européen plutôt que de l’abandonner. À la fois parce que trop de sacrifices ont été consentis par la Nation, parce qu’il est encore possible de rectifier la trajectoire politique de l’UE et, enfin, parce que l’avenir de notre pays est irréductiblement inscrit dans cette Union.
Suivons l’exemple du général de Gaulle : en 1958, alors qu’il s’était opposé au traité de Rome un an plus tôt, il a fait le choix pragmatique de le conserver et de le mettre en œuvre « pour en tirer le meilleur parti possible » selon ses mots. C’est ce qu’il a fait en obtenant en contrepartie la création de la Politique agricole commune (PAC) sans laquelle « le marché commun deviendrait une duperie ». Mais, en 1965, il a su dire « non » aux visées fédéralistes de la commission Hallstein, afin de rétablir le cours de la construction européenne. Pour de Gaulle, l’Europe était vivante et incarnait l’avenir du pays, parce qu’il la concevait comme une « Europe des nations ». C’était un homme d’État pénétré par l’Histoire, soucieux de l’intérêt national, mais aussi un Européen sincère, qui déclarait en 1963 vouloir placer « notre vie nationale dans un cadre européen ». La sortie de la France de l’UE ne doit donc pas être écartée par dogmatisme ou par idéologie, mais bien du point de vue de la raison et de l’analyse.
LVSL – Quoique l’on pense de l’Union européenne, on remarque en tout cas qu’elle est rarement un sujet majeur de la politique française. En témoignent l’élection présidentielle de 2017, ou la campagne actuelle. Comment l’expliquez-vous ?
A. M. – D’abord parce que, la plupart du temps, la méthode employée par les fédéralistes est celle du contournement. Il s’agit tant de contourner les États-nations avec des offensives fédéralistes assumées, comme la CECA en 1951, le projet de Communauté Européenne de Défense (CED) en 1954 ou l’offensive du président de la Commission Walter Hallstein en 1965, que du contournement des peuples qui résistent, à travers la politique des « petits pas » et du « fédéralisme clandestin », comme lors du tournant fédéraliste de 1983 où Mitterrand et Delors ont caché leurs intentions aux Français.
Cette pratique s’est répétée à plusieurs reprises. Par exemple, un traité aussi crucial que l’Acte unique n’a pratiquement pas été discuté. Comme le raconte Jean-Pierre Chevènement, le texte de 300 à 400 pages, présenté comme une « perfection du marché commun » a été avalisé par le Conseil des ministres en 1985 à l’unanimité et sans débat. De même lors du débat au Parlement en 1987 (la droite était alors majoritaire, ndlr), où seuls les communistes se sont opposés à ce texte qui allait faire déferler sur l’Europe une vague de déréglementation sans précédent. L’opération fut rééditée en 1990 avec la transcription de la directive sur la déréglementation des mouvements de capitaux en Europe, dont aucun ministre n’avait pris connaissance !
« Sous l’invocation lyrique de l’Europe, se cachait l’implacable mécanique de la dérégulation. »
Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, opposant de la politique européenne de François Mitterrand.
Jean-Pierre Chevènement a des mots très justes sur le sujet. Selon lui, « il y avait sur l’Europe une diplomatie qu’on aurait pu qualifier de “secrète”. […] Elle unissait la gauche qui signait et la droite qui ratifiait, traversait les gouvernements, survivait à la cohabitation […]. Sous l’invocation lyrique de l’Europe, se cachait l’implacable mécanique de la dérégulation ». De même avec Maastricht : « Le choix de répondre à l’unification allemande par l’accélération de l’intégration européenne a été tranché en dehors de tout débat public et même sans aucun débat au sein du gouvernement ».
La méthode mitterrandienne n’est toutefois pas la seule responsable. Ce qui est en cause, c’est aussi cette vision politique, dominante depuis cinquante ans, qui considère les questions européennes comme relevant des affaires étrangères, alors que l’évolution de l’Union est indissociable de la vie de la Nation et fait donc partie des affaires intérieures. C’est parce que les deux sont si imbriquées que je parle de « FrancEurope » dans mon livre. Continuer à rattacher l’action européenne de la France au domaine de la diplomatie est absurde.
Cette tactique est cependant fort commode pour le pouvoir exécutif, puisque cela lui permet de se dispenser de tout débat public et de contourner les procédures démocratiques. Depuis 1983, les décisions européennes ont été centralisées à l’Élysée, au sein de la cellule diplomatique du président. Or, en tant que « domaine réservé » du chef de l’État, les décisions diplomatiques échappent à toute véritable discussion démocratique, alors même qu’elles entraînent les plus lourdes conséquences sur la vie de la Nation. Nous l’avons à nouveau constaté à l’occasion du plan de relance européen, qui introduit un nouveau degré de fédéralisme : alors qu’il s’agit d’« un changement historique de notre Europe et de notre zone euro » selon les mots d’Emmanuel Macron, il n’a pas été débattu au préalable. Le Parlement, régulièrement appelé à se prononcer sur quantité de points secondaires ou sans véritable contenu juridique – ce que les juristes appellent l’« inflation législative » -, est en revanche mis devant le fait accompli en matière européenne, sommé de ratifier des textes déjà signés par le chef de l’État au nom de la France.
Bien sûr, cette concentration des pouvoirs est problématique. Mais il serait trop facile de dénoncer l’institution « monarchique » que serait la présidence sous la Ve République. Le général de Gaulle, qui avait certes une conception très verticale du pouvoir, informait régulièrement les citoyens des objectifs, des difficultés ou des succès de sa politique européenne durant ses conférences de presse. De même, entre les deux tours de la présidentielle de 1965, en pleine crise « de la chaise vide », il consacra un long entretien télévisé à la seule question européenne. Surtout, même s’il avait un exercice parfois solitaire du pouvoir, il considérait la souveraineté du peuple français comme inaliénable. Il l’a démontré lors de sa démission en 1969 après l’échec du référendum sur la régionalisation et la participation.
Cette « diplomatie secrète » a permis aux européistes d’imprimer un rythme beaucoup trop rapide au cours de l’Europe. A chaque fois, les doctrinaires des États-Unis d’Europe ont précipité les choses. Ce fut le cas avec la création d’une monnaie unique pour dix-neuf nations pourtant si diverses ou avec l’élargissement spectaculaire à l’Est, avec treize nouveaux États ayant adhéré en moins de dix ans, entre 2004 et 2013. Cette façon de forcer le cours des choses, qui est la marque de fabrique de l’idéologie fédéraliste, a donné à la construction européenne un caractère artificiel, déconnecté de la vie des peuples. Les nations ne se prennent pas à la légère : elles sont inscrites dans l’Histoire, elles sont la synthèse de siècles de formation et d’existence, mais aussi de cultures et de mentalités. Le temps des nations est un temps long, qu’il faut respecter. Les nations de l’Europe ne sont pas les treize colonies britanniques qui, ayant pris leur indépendance, se sont fédérées pour bâtir les États‐Unis d’Amérique.
Les affaires européennes doivent quitter le champ de la diplomatie et du secret et se soumettre aux lois de la démocratie et du débat. En sept décennies, une telle discussion publique n’a pu être ouverte que deux fois : en 1992 et en 2005. Or, la première fois, l’essentiel de la relance fédéraliste, portée par Mitterrand et Delors avec l’Acte unique, était déjà entré en vigueur, et malgré le talent de Philippe Séguin, la situation était alors trop inégale, avec une presse et une classe politique acquises à la ratification du traité de Maastricht. La deuxième fois, les Français se sont profondément intéressés au projet, pourtant aride, de TCE, mais leur choix a été piétiné par Nicolas Sarkozy, avec la complicité de François Hollande.
« Le peuple français va devoir se prononcer sur une dimension inédite de la “construction européenne” : les européistes visent désormais les prérogatives régaliennes des États, en particulier la défense et les affaires étrangères. »
Ce temps‐là est révolu. Un vrai débat doit avoir lieu en 2022, pour deux raisons. D’une part, l’élection présidentielle est le moment privilégié où la Nation est saisie du choix entre de grandes orientations à prendre. Or, le chef de l’État consacre environ un tiers de son agenda aux enjeux européens. Si l’Europe est donc bien un enjeu national décisif, elle demeure peu abordée pour l’heure.
D’autre part, le peuple français va devoir se prononcer sur une dimension inédite de la « construction européenne », qui menace l’identité même de la France : après l’économie, le commerce, la monnaie, et indirectement, la fiscalité, le budget, l’industrie et le système social, les européistes visent désormais les prérogatives régaliennes des États, en particulier la défense et les affaires étrangères. Cette atteinte sans précédent aux souverainetés nationales est justifiée par un alibi géopolitique, notamment la menace chinoise, face auquel « la taille nécessaire » serait celle de l’UE. Cette « souveraineté européenne » est ouvertement revendiquée par Ursula von der Leyen ou par des responsables politiques d’outre-Rhin, comme le futur chancelier Olaf Scholz, qui demande, comme Angela Merkel avant lui, que la France abandonne son siège au Conseil de sécurité de l’ONU au profit de l’UE ou d’un partage avec l’Allemagne. D’autres responsables allemands évoquent même le partage de notre arme nucléaire, notamment la ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp‐Karrenbauer.
Nous voilà donc à un moment de vérité : après avoir limité la souveraineté économique des États membres, la Commission européenne et ses soutiens veulent s’attaquer à leur souveraineté politique. L’enjeu est décisif : la France souhaite-elle rester une nation unitaire, politiquement souveraine, avec ses prérogatives régaliennes ou devenir une de ces « grosses régions » du nouvel empire européen que souhaitent les fédéralistes comme Jürgen Habermas et Bruno Le Maire ? La France n’est ni l’Allemagne, ni l’Italie, ni l’Espagne, ni la Pologne, encore moins le Benelux. Comme le Royaume‐Uni, elle entretient avec la puissance et la souveraineté un rapport forgé par l’Histoire, constitutif de son identité nationale.
Nous connaissons la stratégie du camp fédéraliste : ignorer la démocratie et avancer masqué. Emmanuel Macron a donné le ton lors du lancement de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, le 9 mai 2021, en appelant à « décider plus vite et surtout décider plus fort ». Au contraire, il nous faut un débat politique sincère, devant les citoyens. La campagne de l’élection présidentielle et la présidence française de l’UE doivent être l’occasion de plaider pour un souverainisme raisonné et raisonnable, prenant la forme d’une confédération respectant les États-nations, qui sont la chair et l’esprit de l’Europe.