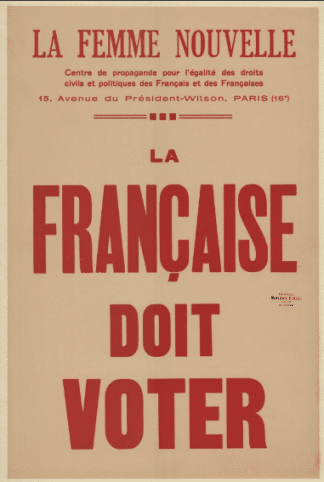Le 7 décembre dernier, le média et ONG Disclose a révélé une note rédigée par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) « classifiée défense ». Celle-ci s’opposait vigoureusement à la mission d’information parlementaire proposant d’impliquer le Parlement dans le processus de contrôle des exportations françaises en matière d’armement. La révélation de cette note interroge sur le processus actuel et la position du gouvernement autour d’un secteur vital pour l’économie hexagonale. La question du contrôle des exportations d’armement se pose avec d’autant plus d’acuité après le scandale de l’utilisation des armes françaises par la coalition de pays menée par l’Arabie Saoudite contre les populations civiles dans la guerre au Yémen en 2018, qualifiée par le secrétaire général adjoint des affaires humanitaires des Nations Unies, M. Mark Lowcock, de « pire crise humanitaire au monde ».
Complexe, robuste, opaque. Ces trois qualificatifs reviennent tout au long du rapport de 157 pages des deux parlementaires M. Jacques Maire (La République en marche, LREM) et Mme. Michèle Tabarot (Les Républicains, LR) pour définir le processus de contrôle des exportations françaises d’armement. Ce rapport, remis le 18 novembre dernier, propose « la création d’une commission parlementaire » dans le cadre du processus de contrôle. La veille, le 17 novembre, arrive sur la table du cabinet de M. Emmanuel Macron, Président de la République, une note « confidentiel défense » du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) qui avant même la diffusion du rapport, s’oppose à tous les arguments qu’il soulève. « Sous couvert d’un objectif d’une plus grande transparence et d’un meilleur dialogue entre les pouvoirs exécutif et législatif, l’objectif semble bien de contraindre la politique du gouvernement en matière d’exportation en renforçant le contrôle parlementaire », indique notamment l’un des passages de la note publiés par Disclose. Plus en avant, les analystes du SGDSN conseillent les membres du gouvernement concernés par la note sur la stratégie à adopter vis-à-vis du rapport parlementaire et de sa reprise par les médias et les ONG en vue d’éluder les volontés de transparence qui pourraient émerger à sa suite dans le débat public.
Matignon, le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Économie sont également destinataires de la note. En France, la constitution de la Ve République, en faisant du Président de la République le chef des armées, entérine la prééminence de l’exécutif sur le Parlement en matière militaire ; partant, cette tension entre le Parlement et le pouvoir exécutif concernant les exportations d’armes, chasse gardée de la raison d’État, n’a rien d’étonnant. Toutefois, la marge de manœuvre du pouvoir législatif grandit, comme l’a déjà révélé l’adoption par le Parlement de la loi renseignement de 2015 – prise sur initiative du gouvernement – qui avait fait grincer des dents dans certaines sphères étatiques et dont le rendu de la mission d’évaluation, prévu après cinq années son adoption, continue à soulever des interrogations sur sa véritable portée démocratique.
La révélation de cette note vient à nouveau nourrir les débats autour de l’un des secteurs les plus importants de la politique commerciale française et pourtant l’un des moins connus du fait de l’opacité qui l’entoure.
Secret défense : exécutif, industriels et partenaires-clients main dans la main
Pour comprendre plus en avant les enjeux du rapport de la mission d’information parlementaire, il est nécessaire de définir le fonctionnement du processus actuel d’autorisation de l’exportation d’armements. Aujourd’hui, le contrôle des exportations d’armement est entièrement organisé par l’exécutif et se déroule en deux phases : la délivrance de licence d’exportation (contrôle a priori) et le contrôle sur place de l’utilisation du matériel de guerre vendu (contrôle a posteriori). Il s’articule autour d’un processus interministériel de délibération et de consultation jusqu’à la délivrance des autorisations d’exportation par le Premier ministre. Ce processus est mis en œuvre par la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériel de guerre (CIEEMG) qui réunit le ministère des Armées, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l’Économie et des Finances. Celle-ci est présidée par le fameux SGDSN, service rattaché au Premier ministre, qui a rédigé la note parvenue à Disclose. Les services de renseignement interviennent également à titre consultatif, ajoutent les rapporteurs.
Concernant le contrôle a priori, les avis pour l’instruction de licence de la CIEEMG se fondent sur plusieurs critères dont entre autres l’expertise technique sur les matériels, l’emploi possible des équipements dont l’exportation est envisagée, l’impact stratégique de la vente, la soutenabilité financière des acheteurs ou encore le respect par la France de ses engagements internationaux et européens… Tout ce travail d’analyse et de délibération est réalisé sous le couvert du secret défense et ne circule donc qu’entre les ministères et entités concernés, l’exécutif se retrouvant seul juge de la qualité du processus d’examen. En 2019, 2,5% des demandes de licence ont été refusées par la France d’après le rapport. La faiblesse de ce chiffre suggère, selon Benjamin Hautecouverture, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) « que le critère du respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme n’est pas déterminant dans les décisions de la CIEEMG, alors même que plusieurs pays clients de la France sont réputés commettre de telles violations».
L’autre versant de cette activité est le processus a posteriori qui repose sur plusieurs points dont le respect par les industriels des conditions qui ont pu prévaloir lors de l’accord de la licence d’exportation, la maintenance sur place ou encore la formation au maniement du matériel livré.
Ce suivi de contrôle, en plus de vérifier le respect des règles internationales, remplit plusieurs objectifs. Il permet premièrement au pays vendeur d’évaluer l’efficacité de son propre matériel ; deuxièmement, la présence sur place des formateurs ou des agents de maintenance industriels sert des visées diplomatiques en développant des partenariats stratégiques avec les pays acquéreurs. Enfin, les contrats de maintenance représentent une grande part des exportations d’armement, et viennent donc appuyer une industrie nationale qui représente, selon les chiffres, entre 7 et 13% des emplois industriels en France. En ce sens, il est essentiel de noter que la France est dépendante de ses exportations. Les marchés domestiques et européens ne suffisent pas à couvrir les dépenses et investissements liés à cette industrie qui représentent quelques 40 milliards d’euros cumulés dont 10 milliards en investissements en 2018, selon les chiffres de la Direction générale de l’armement. La France se retrouve donc contrainte de se tourner vers d’autres pays du globe, notamment ceux des zones de conflits du Moyen-Orient. Cette dépendance justifie t-elle l’opacité qui s’exerce autour du processus de contrôle ?
D’autant que la concurrence sur le marché est de plus en plus importante avec l’émergence dans de nombreux pays d’industries d’armement soutenues par l’augmentation des dépenses militaires à l’échelle mondiale. Selon le classement annuel de l’Institut de recherche sur la paix internationale de Stockholm (Sipri) publié en 2019, le chiffre d’affaires des cent industriels les plus importants au niveau mondial avait augmenté de 47% par rapport à 2002 pour atteindre 420 milliards de dollars en 2018. En parallèle, les volumes d’exportations d’armes majeures (missiles, avions de chasse, navires de guerre) ont augmenté de 20% sur la période 2015-2019 en comparaison à la période 2005-2009, toujours selon le même rapport 2019 du SIPRI. Ces chiffres soulignent l’importance du contrôle à effectuer. Celui-ci est ainsi entrepris par l’exécutif au travers de la CIEEMG et ses mécanismes couverts du sceau « secret défense ». Le rapport parlementaire souligne par ailleurs que les entreprises considèrent le contrôle a priori comme « intrusif » et privilégient le contrôle a posteriori. Celui-ci se déploie sur les domaines de conformité aux règles d’exploitation et la vérification des problèmes éthiques.
La coopération des pays partenaires et clients est une autre dimension essentielle du contrôle. Or l’accord ou le refus d’une licence implique des répercussions géostratégiques : la politique française d’exportation d’armements est en effet un levier d’action diplomatique pour la France, qui à travers le commerce des armes, soutient certains intérêts stratégiques. Disclose a par exemple révélé en septembre 2019 que les Rafales vendus à l’Egypte en 2015 avaient été utilisés pour soutenir le Maréchal Haftar dans sa conquête du pouvoir. Paris soutenait discrètement Haftar, malgré les critiques de la communauté internationale : les exportations d’armement à destination de l’Egypte furent donc un moyen d’affirmer cette ligne sans qu’elle donne pour autant lieu à une prise de position diplomatique claire.

La décision d’accorder une licence d’exportation vers un pays donné peut également être un moyen de pression comme dans le cas destensions entre la France et la Turquie. Le Premier ministre grec M. Kyriakos Mitsotakis a ainsi annoncé, le 12 septembre 2020, une importante commande d’armes à la France dont 18 rafales auprès de Dassault Aviation pour un montant de 2,5 milliards d’euros. Cette commande intervient alors que la tension monte entre le régime turc de M. Recep Erdogan et la Grèce, pays de l’Union européenne, à propos de gisement d’hydrocarbures en Méditerranée orientale. La ministre des Armées Florence Parly s’est félicitée dans un communiqué de ce choix de la Grèce qui « vient renforcer le lien entre les forces armées grecques et françaises, et permettra d’intensifier leur coopération opérationnelle et stratégique ». Elle doit se rendre à Athènes, le 23 décembre pour conclure la vente. En plus de renforcer le partenariat stratégique franco-grec et de servir l’industrie aéronautique française, ce contrat sert donc aussi une visée diplomatique : il affirme le soutien français à la Grèce dans les tensions qui l’opposent à la Turquie et en creux, permet à Paris de mettre la pression sur Ankara.
Les enjeux diplomatiques, économiques, et juridiques liés au contrôle des exportations d’armement sont donc pour l’instant entre les seules mains du pouvoir exécutif, à travers les procédures de contrôle opérées par la CIEEMG.
Définir une arme : un enjeu crucial
Dans le cadre du respect des engagements internationaux, les rapporteurs insistent également sur un point fondamental : la définition des objets. Le cadre juridique définit deux types de biens : les matériels de guerre ou assimilés et les biens à double usage.
L’appartenance à la catégorie des matériels de guerre dépend des caractéristiques décrites dans l’arrêté du 27 juin 2012 relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés. Cet arrêté définit toute une liste de biens produits exclusivement pour l’usage militaire, comme les canons, les véhicules terrestres type char ou les navires de guerre. La catégorie des biens à double usage intègre un grand nombre d’objets utilisés dans le civil et militarisables comme les satellites et leurs principaux composants ou encore les drones et les radars.
La qualification de bien à double usage est régie par le règlement européen du 5 mai 2009 du Conseil de l’Europe, dont l’annexe 1 consolide les listes des régimes des biens à doubles usage dont le régime de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage de 1987. Le contrôle des technologies à double usage tient à ce que, comme le relève le rapport parlementaire du 18 novembre 2018, certains États tentent parfois de se doter « d’armes de destruction massive en pièces détachées via des réseaux d’acquisition sophistiqués », justifiant ainsi « la mise en place d’un contrôle en amont du cycle d’élaboration, de production et de transport de telles armes ». Le contrôle des biens à double usage est réalisé par une instance consultative distincte de la CIEEMG, la Commission interministérielle des biens à double usage (CIBDU) dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’industrie. En pratique, le processus d’examen de cette commission est le même que celui de la CIEEMG. La principale distinction est que les biens à double usage sont soumis à un régime d’autorisation sauf interdiction à l’inverse des matériels de guerre et assimilés, régis par un régime de prohibition sauf autorisation.
L’importance de la qualification de certains biens comme arme ou non définie par les traités internationaux et notamment le régime de Wassenaar qui en établit la liste est interrogée par les rapporteurs. « Des biens conçus pour un usage civil peuvent être détournés à des fins militaires ou de répression interne », soulignent-t-ils. Ils s’inquiètent de « certaines polémiques [qui] ont par exemple vu le jour à la suite de la vente, par la France, de camions anti-émeutes avec canon à eau à Hong-Kong, employés pour réprimer les manifestants qui protestaient contre la remise en cause de l’autonomie de la région administrative spéciale ». Ces camions, pour n’avoir pas été définis comme des armes, ont par exemple échappé au contrôle de la CIBDU. Selon le rapport, la définition stricte d’une arme est celle d’un objet conçu pour « tuer ou blesser ». Ces ambiguïtés concernant la définition de l’armement se nouent donc sous le voile du secret défense, et sous le seul contrôle du pouvoir exécutif.
Des hommes et des lois, propositions et illusion
C’est suite à la révélation par Disclose de la présence d’armes françaises dans le conflit au Yémen, utilisées notamment par la coalition de pays menée par l’Arabie Saoudite en 2015 que la création en avril 2018 d’une commission d’enquête parlementaire sur les ventes d’armes française aux acteurs du conflit au Yémen a été proposée par vingt députés de la majorité. Cette demande n’a pas abouti. Mais au regard de l’importance du sujet, la commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale a crée, en décembre 2018, une mission d’information parlementaire sur le contrôle des exportations d’armement dont est issu le rapport publié le 18 novembre 2020 par M. Jacques Maire (LREM) et Mme. Michèle Tabarot (LR). Long de quelque 157 pages, celui-ci après avoir défini de manière détaillée les conditions actuelles du processus de contrôle émet diverses propositions et en argumente les enjeux.
La première et principale d’entre elles est la création d’une délégation parlementaire au contrôle des exportations d’armement dotée d’un droit d’information et d’un droit à émettre des recommandations dans le cadre d’une base juridique retenue et sous couvert de confidentialité lors de certaines situations spécifiques dans le processus a posteriori. Outre sa mission principale de contrôle, les rapporteurs ajoutent que cette commission pourrait également enrichir le débat public en produisant un rapport annuel, contribuer aux échanges avec le Gouvernement au sein des commissions concernées de l’Assemblée nationale et animer un débat « hors-les-murs ». Le pouvoir législatif se verrait ainsi doté d’un droit de regard et de conseil sur des décisions prises aujourd’hui en toute opacité par le seul pouvoir exécutif.
Concernant les biens à double usage, les rapporteurs préconisent la création d’une liste nationale de bien inclus dans cette catégorie. Celle du régime de Wassenaar, du fait de son caractère international, étant contrainte « par les vicissitudes des négociations ». Pour appuyer cette proposition, les deux députés soulignent que le fonctionnement actuel fait courir des risques à la France sur plusieurs points. Sur son sol, la sensibilisation de la population par les médias et ONG, comme cela a été le cas avec le scandale du Yémen.
Selon Amnesty International, 83 % des Français pensent que le commerce d’armement manque de transparence et 77 % que le commerce des armes devrait faire l’objet d’un débat public en France.
Selon les auteurs du rapport Jacques Maire (LREM) et Michèle Tabarot (LR) en n’intégrant pas le Parlement à l’inverse d’autres pays, comme par exemple l’Allemagne, dont l’armée n’agit que sous mandat parlementaire ou la Suède, la France crée un sentiment de défiance à son égard du fait de son statut de puissance militaire. La France est aujourd’hui la cinquième puissance militaire mondiale, et est devenue, à la faveur d’une augmentation de 77 % de ses ventes en 2019, le numéro 3 mondial des vendeurs d’armes.
Mais de manière plus contestable et moins réaliste, les députés mentionnent également la relation de la France avec les pays européens : les rapporteurs insistent particulièrement sur ce point en agitant le miroir d’une Europe de la défense. S’ils reconnaissent le caractère fantaisiste d’un vote à l’unanimité sur chacune des exportations d’armement nationales, ils n’en plaident pas moins pour le renforcement de la Position Commune sur les exportations d’armement. Cette « mise en commun normative et pratique » servirait, selon les députés, à faire pièce à la concurrence internationale de pays comme la Chine ou les États-Unis. Pour ces derniers, le marché intérieur européen couvre les investissements dans le domaine de l’armement. Un dialogue interparlementaire pourrait ainsi, selon les rapporteurs, prévaloir afin de renforcer la coopération européenne. Cette question d’une éventuelle européanisation du contrôle du commerce des armes est balayée par la note du SGDN, qui souligne la position réelle de la France à ce sujet, et craint « le risque d’un effet de bord qui exposerait notre politique à des enjeux internes propres à certains de nos voisins européens », comme le précise le document révélé par Disclose. Pour le gouvernement, les domaines de la défense sont un des piliers de souveraineté nationale à défendre absolument. Cette question de l’européanisation du contrôle des exportations fait resurgir les débats sur l’Europe de la défense : si cette idée est presque irréaliste dans la pratique, elle n’en constitue pas moins un vocabulaire très utilisé par les dirigeants politiques, détournant par des effets d’annonce l’attention des questions sociales dans l’espace de l’Union, et permettant à peu de frais d’afficher des convictions européistes.
Bras de fer avec l’Allemagne
Par rapport à cette question, l’opacité du système français fait défaut, signalent les députés. Ils citent en exemple l’Allemagne, qui plaide tout simplement pour une européanisation du contrôle des exportations d’armement. La question est souvent soulevée outre-Rhin dans le débat public notamment par le SPD, Die Linke et les Verts. Cette radicalité, précisent-t-ils, est le fait de la volonté allemande d’amener la responsabilité sur l’UE de « décisions nationale très impopulaires auprès de l’opinion publique ». Pour l’Allemagne, il s’agirait ainsi de détourner des décisions difficiles à prendre sur les épaules de l’Union Européenne dans la mesure notamment où celle-ci est moins dépendante économiquement que la France de ses exportations d’armement et se retrouve en concurrence avec la France, dans un domaine où la diplomatie militaire française pèse bien davantage dans les enceintes internationales. La difficulté de réunir les votes des pays de l’Union Européenne à l’unanimité constituerait pour la France une concession de souveraineté inconcevable.
Si une démocratisation des exportations d’armement est bien nécessaire, il faut donc analyser la position allemande de manière réaliste : derrière les arguments de pression populaire, l’Allemagne cherche dès lors à maximiser ses intérêts. Et son cas est significatif de la lutte autour des enjeux de l’européanisation de la défense, source traditionnelle de dissensions entre la France et l’Allemagne. Un bras de fer se joue depuis des années entre les deux pays, oscillant entre opposition et coopération. Le récit de cette lutte démarre avec les accords « Debré-Schmidt » de 1972 dont l’article 2 prévoyait, que sauf cas exceptionnel, « aucun des deux gouvernements n’empêchera l’autre gouvernement d’exporter ou de laisser exporter dans des pays tiers des matériels d’armement issus de développement ou de productions menés en coopération ».
L’accord est significatif car de nombreuses armes produites par la France sont dotées de composantes de fabrication allemande. Cet accord préserve donc la souveraineté nationale des deux pays en matière d’exportation. Toutefois l’Allemagne a progressivement remis en cause ce principe au fil des années, en particulier après la crise au Yémen en 2018. Par le blocage de ses exportations de composants, en 2019, l’Allemagne a ainsi contraint la société MBDA dans son désir d’exporter le missile Meteor vers l’Arabie Saoudite. Le contournement par la France du problème se réglerait par des commandes auprès des États-Unis, confie M. Daniel Argenson, directeur de l’Office français des exportations d’armement (ODAS). Un pari perdant-perdant dans le recherche d’une entente européenne commune. Car les États-Unis, forts de la réglementation ITAR (International Traffic in Arms Regulations), peuvent imposer leurs contraintes à la France et gagner en influence, tout en s’octroyant des parts de marché. Les règles ITAR stipulent notamment « que dès lors qu’un sous-ensemble de produit entre dans le champ ITAR, c’est l’ensemble du produit qui est soumis au contrôle américain », comme le précisent les deux députés français.
Pour résoudre la tension de ce blocage, qualifiée par les industriels auprès des rapporteurs de « plus problématique » que la réglementation états-unienne, les deux parties ont tenté de nouveaux rapprochements. En 2019, le traité d’Aix-la-Chapelle est signé le 22 janvier 2019. Il définit alors la volonté politique commune dans la définition d’un cadre d’exportation. Quelques mois plus tard, le 16 octobre 2019, à la sortie du Conseil des ministres franco-allemand, est annoncé un accord juridiquement contraignant reposant sur la confiance mutuelle pour les programmes conduits en coopération et les systèmes contenant des composants de l’autre pays. L’article 3 de cet accord stipule en particulier que « dès lors que la part des produits destinés à l’intégration des industriels de l’une des parties contractantes dans les systèmes finaux transférés ou exportés par l’autre partie contractante demeure inférieure à un pourcentage arrêté au préalable par accord mutuel entre les partie contractantes, la partie contractante sollicité délivre les autorisations d’exportation ou de transfert correspondantes sans délai, sauf de façon exceptionnelle, lorsque ce transfert ou cette exportation porte atteinte à ses intérêts directs ou à sa sécurité nationale ». L’annexe 1 de l’accord fixe à 20% le seuil de la valeur du système final en projet d’exportation.
Sous cet angle, les raisons commerciales et géostratégiques semblent prévaloir de la part des deux pays. L’Allemagne, malgré les prises de position du gouvernement de la chancelière Angela Merkel, a en effet été également secouée par des affaires liées à ses exportations. En 2012, par exemple, les tractations autour de la vente de 800 chars allemands Léopard 2 à l’Arabie Saoudite pour 10 milliards d’euros ont été l’objet d’une forte opposition de la part des mouvements pacifistes et écologistes d’Outre Rhin. L’argument d’opposition était le non-respect des droits humains par l’Arabie Saoudite. Soumise à la pression populaire et aux anathèmes des partis d’opposition, Angela Merkel renonça à ce contrat, à l’approche des élections législatives. En 2018, la position allemande se durcissait face à Ryad après le meurtre du journaliste Jamal Kashoggi et proclamait un embargo sur l’exportation d’armements à destination de l’Arabie Saoudite. Or selon un article du Centre de ressource et d’information sur l’intelligence économique et stratégique, l’Allemagne a permis à ses industriels la livraison d’armes aux saoudiens par l’entremise de leurs filières à l’étranger.
Impliquer le Parlement, un remède démocratique
« La guerre, ce mal insupportable parce qu’il vient aux hommes par les hommes », écrivait Jean-Paul Sartre, semble alors mieux encadrée quand la responsabilité populaire à travers le Parlement est invoquée. Aux Pays-Bas, le contrôle parlementaire a par exemple empêché, en 2012, la vente de chars à l’Indonésie après la crainte que ceux-ci soient utilisés contre le mouvement séparatiste de Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme l’expose l’Observatoire des armements, dans une note analysant le fonctionnement des contrôles parlementaires néerlandais, britanniques et allemands. À cet égard, le pouvoir législatif se retrouve pleinement dans son rôle de contre balancier du gouvernement et de support démocratique majeur. Enfin, sauf quand la CIA intervient. En faisant un pas de côté, l’exemple de tentative de blocage de la commission de contrôle des exactions commises a Guantánamo par l’agence de renseignement états-unienne interroge sur les limites que peut rencontrer un Parlement sur des sujets qui révèlent de la raison d’État.
Néanmoins, démocratiser le processus de contrôle des exportations d’armement en y incluant une commission parlementaire peut apparaître comme un remède supplémentaire à « ce mal insupportable » qu’évoque Sartre. Car la guerre brise les vies et c’est sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale que nombre des engagements internationaux de la France se sont fondés. La Déclaration des droits de l’Homme de 1948 de l’ONU, ou la Convention européenne des droits de l’Homme de l’Union européenne de 1950 en sont les actes fondateurs. Entretemps, en 1949, les accords de Genève sont signés et mettent l’accent sur l’importance de la protection des civils en temps de guerre.
Depuis la France a ratifié, à travers l’adoption par le Conseil de l’Union européenne en 2008, la Position Commune qui régit le contrôle des exportations de technologies et d’équipements militaires. Ce texte stipule notamment que « les États membres sont déterminés à empêcher les exportations de technologies et d’équipements militaires qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou d’agression internationale, ou contribuer à l’instabilité régionale ». En 2014, enfin, une ratification a été faite du Traité sur le commerce des armes (TCA), adopté en avril 2013 par l’Assemblée générale des Nations-unies. Ce dernier a pour but la régulation du commerce des armes et notamment l’importance de l’évaluation par le gouvernement des risques de l’exportation et interdit tout transfert de matériel sujet à des risques de violation du droit humanitaire. Il s’avère toutefois non contraignant…
Les ONG comme palliatif ?
La mission parlementaire de M. Jacques Maire et Mme. Michèle Tabarot est ainsi comme un prémisse de remède qu’on ne teste sous peur des effets secondaires et dont s’inquiètent la note du SGDSN. Parmi ces principes actifs, se trouve le travail des ONG. En particulier, la campagne Silence ! on arme d’Amnesty International dénonce «l’omerta » autour du processus de contrôle des exportations et revendique que « la question de la vente des armes doit devenir un enjeu du débat démocratique ». Face à cette prise de position radicale, des questions se posent. Et ce sont des enjeux plus globaux de société qui transparaissent en ligne de fond.
Avec près de 60 milliards d’euros de déficit commercial en 2019, l’économie française se retrouve dopée par son industrie d’armement. La note du SGDSN publiée par Disclose souligne ainsi que la démocratisation de la question pourrait « entraîner des effets d’éviction de l’industrie française dans certains pays », évoquant le risque que « les clients» puissent être « soumis à une politisation accrue des décisions », nuisance pour les affaires, par la « fragilisation de notre crédibilité et de notre capacité à établir des partenariats stratégiques sur le long terme, et donc de notre capacité à exporter ». Le rapport parlementaire insiste sur la dépendance de la France dans le secteur. En 2019, les ventes d’armes ont atteint 8,3 milliards d’euros selon rapport au Parlement 2020 sur les exportations d’armes du ministère des armées. Et la loi de programmation 2019-2025 prévoit une augmentation des moyens financiers consacrés à l’industrie de défense. Dès 2022, le soutien à l’innovation par le ministère des Armées sera porté à 1 milliard d’euros par an.
Ces informations là, quant à elles, sont publiques et témoignent de la direction politique et économique du gouvernement dans sa dépendance. En 2019, contrainte de s’expliquer devant la commission de défense et des forces armées de l’Assemblée Nationale après l’affaire du Yémen, la Ministre des Armées Florence Parly a déclaré lors de cette séance houleuse, « l’Europe, on peut le regretter, ne peut être le seul marché de substitution du marché national : elle dépense trop peu pour sa défense, et quand elle le fait, elle achète encore trop peu au sein de l’Union européenne, et plutôt en dehors de l’Union européenne. Nous n’avons donc pas le choix : il nous faut exporter ». Le CNRTL définit la dépendance comme « l’état d’une personne qui est ou se place sous l’autorité, sous la protection d’une autre par manque d’autonomie ». L’implication du Parlement dans le processus de contrôle pourrait soulager cet état. Pour en sortir, certains parlent de décroissance. Il faut toutefois craindre que les exportations d’armement, en plus de représenter parfois des entorses aux droits humains, ne finissent par constituer un handicap stratégique : les coups médiatiques portés à l’exécutif suite à la révélation de la présence d’armes françaises au Yémen semblent bien plus élevés que les avantages financiers retirés de la conclusion de ces contrats.
Sources :
– Maire Jacques et Tabarot Michèle, Rapport d’information sur le contrôle des exportations d’armement, 18 novembre 2020.
– « Ventes d’armes : en secret, l’executif déclare la guerre au Parlement », Disclose, 7 décembre 2020.
– Dancer Marie, « L’armement, une industrie jugée stratégique pour la France », La Croix, 10 juillet 2019.
– SIPRI 2019 Yearbook.
– « Libye : Haftar et le soutien des rafales égyptiens », Disclose, 15 septembre 2019.
– « La Grèce commande des Rafales à la France, sur fond de tensions avec la Turquie », Capital
– Federico Santopinto, Crise libyenne, rôle et enjeux de l’UE et de ses membres, Notes du GRIP, 29 janvier 2018.
– Baeur Anne, « Rafale : la Grèce souhaite conclure l’achat de 18 avions avant Noël », Les Echos, 18 décembre 2020.
– Tristan Lecoq, François Gaüzère-Mazauric Défense de l’Europe, défense européenne, Europe de la défense –Cahier de la RDN, préface p. 5-10, 5 septembre 2019.
– Cabirol Michel, « L’Allemagne bloque l’exportation du missile Meteor de MBDA vers L’Arabie Saoudite », La Tribune, 5 février 2019.
– Schnee Thomas, « Scandale autour de la vente de 800 chars allemands à l’Arabie Saoudite », L’Express, 22 juin 2012.
– Lopez Thimothé, « Allemagne : des ventes d’armements à haut risque ? », Centre de ressources et d’information sur l’intelligence économique et stratégique, 14 novembre 2019.
– Fortin Tony, « Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni : quand le débat parlementaire fait reculer le gouvernement », Observatoire des armements, 16 novembre 2020.
– Bonal Cordélia, « Comment la CIA a délocalisé ses centres de tortures », Libération, 14 décembre 2014.
– « Silence ! on arme », Amnesty International
– Rapport au Parlement 2020 sur les exportations d’armement de la France, Ministère des Armées, 29 août 2020.