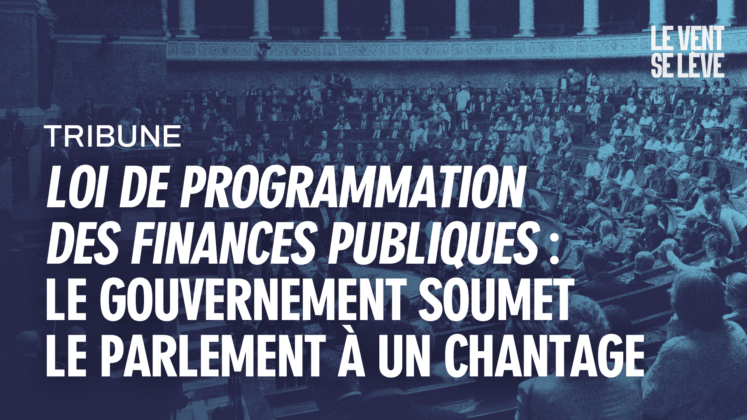La rentrée politique voit s’accroître les réflexions et manœuvres visant à éviter à la gauche la réédition du naufrage électoral vécu en 2017 : comment aborder la seule élection qui compte vraiment en France, l’élection présidentielle, en se mettant d’accord sur un candidat pouvant au moins atteindre la finale. Le « cartel de la revanche » semble se dessiner sur le papier, mais seulement sur le papier des journaux qui ont souligné à l’envi l’arithmétique des résultats aux élections municipales. Un cartel « logique » n’en fait pas un cartel de fait, et l’addition de partis politiques ne constitue pas un mouvement capable de gagner l’élection présidentielle. Par Yannick Prost, Président de l’Association Services Publics et maître de conférences à Sciences Po.
Le nouveau cartel de gauche pourrait, au mieux, dégager un compromis pour soutenir un personnage comme plus petit commun dénominateur, suscitant le moins d’appréhensions ou de ressentiment au sein des dirigeants (si désigné par accord), des militants ou du peuple de gauche (selon le type de primaire). Or, l’alliance, pleine d’arrière-pensées, de forces disparates et relativement affaiblies ne constitue pas une organisation capable de conquérir, puis d’exercer le pouvoir. Tout prétendant à la victoire présidentielle aujourd’hui reste sous l’effet sidérant de l’initiative du candidat Macron, qui a déjoué tous les pronostics : pas d’idéologie, un programme construit de bric et de broc, pas de parti, pas d’élus, peu d’argent (au départ), pas de réseau d’élus enracinés dans leur territoire pour confirmer la victoire durant les législatives, pas d’expérience de mandat majeur ou de poste ministériel.
La victoire d’Emmanuel Macron illustre un phénomène politique assez fascinant et complexe de la mise en mouvement d’une foule dans les « nouveaux pouvoirs » de la viralité des réseaux et de la facilité de constitution des communautés. Rééditer la blitzkrieg du candidat Macron apparaît pourtant un exercice délicat eu égard à l’état de la gauche. Après la déception et l’effondrement rapide du mouvement en Marche, qui peut croire à la création ex-nihilo d’un parti de masse ? Et surtout, face à la définition de plus en plus nébuleuse de ce qu’est la gauche, comment parvenir à concevoir un programme de rassemblement ?
Le rejet des partis politiques : privilégier une autre approche
La victoire à l’élection présidentielle apparaît sans doute comme la rencontre magique d’un grand homme et d’un grand peuple, mais c’est avant tout le fruit de l’amour entre ce grand homme et d’une organisation. Or, le climat est devenu hostile aux partis politiques, et la recette n’attire plus les foules (de potentiels militants). Les partis politiques ont été régulièrement dépeints comme des organisations syndicales de professionnels de la politique, qui veillent à assurer l’élection ou le recasage de quelques milliers de cadres qui, pour certains, n’ont pas connu d’autres expériences professionnelles. Les profils de ces cadres tendent à converger, les parcours se ressemblent. La « culture de l’arrangement » récemment aggravée par les anciens de l’Unef au sein du PS ou le clientélisme résultant du respect dû au chef (partis conservateurs) découragent les outsiders et des citoyens disposant déjà d’une solide colonne vertébrale intellectuelle. Dans de nombreuses fédérations, la cooptation ou le filtrage nécessaire à la pérennité du pouvoir des barons locaux ou des délicats équilibres entre les courants divisant le parti, opposent de vrais obstacles au recrutement.
La constitution d’En Marche a reposé sur une ouverture très large, sans frein, et techniquement simple (cliquer « oui » sur un site internet) qui a pu être moquée par les vétérans des partis traditionnels, mais qui a vu émerger pendant quelques mois des communautés militantes à l’activité intense qui auraient pu apporter du sang neuf à la vie politique. Las ! l’ADN de ce mouvement comportait aussi les gènes de la verticalité (les responsables locaux étaient désignés par la direction nationale), l’opacité, et vraisemblablement du clientélisme. Ce bel élan d’adhésions s’est évaporé à cause de l’incapacité de ses managers d’être en phase avec le style de ces militants, qui au fond attendaient un peu plus de démocratie. Admettons également que ce mouvement n’a pas inversé, loin de là, la tendance à la gentrification des partis politiques, tendance qui est sans doute le facteur le plus puissant du divorce entre les partis de gauche et les classes populaires.
Cette expérience malheureuse pourrait laisser penser que les partis existants restent la forme d’organisation propre à soutenir la candidature du candidat de la gauche. Au demeurant, ils refusent de s’effacer, ou de se dissoudre dans un grand mouvement personnalisé autour d’un leader (EM, LFI, et dans une moindre mesure le RN peuvent s’analyser ainsi). Le parti reste le fonds de commerce des élus et de leurs collaborateurs. Les solidarités, les réseaux préservent les insiders, souvent au défi de l’honnêteté (bourrer les urnes dans les élections internes) ; par ailleurs, les règles du financement public de la vie politique sont favorables aux partis déjà installés. L’ancienneté a permis d’accumuler un patrimoine, des réseaux dans les différents corps intermédiaires et dans l’administration… La cartellisation de la vie politique est non moins nocive à l’image de la République que la composition sociologique des partis.
Certes, rassembler – voire fondre – les partis politiques dans une fédération temporaire autour du candidat de l’union présente des avantages : le candidat peut s’appuyer sur leurs moyens financiers, sur des troupes aguerries, sur des cadres dont l’expérience dans la prise de parole et la chasse aux électeurs seront très appréciables.
Toutefois, une fédération de tribus constitue rarement une armée stable et, partant, efficace. Le leader passera son temps à négocier les équilibres, les promesses, le partage du futur butin, à craindre les défections. Et puis, une fédération de tribus impressionne moins qu’une armée de légions romaines. Au demeurant, ne surestimons pas la taille de ces tribus : les effectifs nationaux d’EELV sont inférieurs à ceux de la fédération PS du Nord dans ses beaux jours. Et le PS lui-même est devenu le palais des ombres.
Prendre le pouvoir aujourd’hui : le leader et le mouvement
La création ex-nihilo d’un grand mouvement affranchi de ces institutions de politiques « fonctionnarisés » prouverait qu’il y a rupture. il faut rétablir la confiance avec le peuple de gauche, et avec le peuple tout court. C’est une affaire d’images, d’identité et d’actes.
L’image et l’identité d’un mouvement neuf peuvent s’incarner dans un programme, mais il est plus raisonnable de penser qu’elles sont portées par le style du chef. Rançon d’une personnalisation de la vie politique, a fortiori dans un régime présidentialiste.
La tentation est grande, donc, de former le nouveau mouvement de gauche à partir de zéro, en mode start-up, c’est-à-dire avec une équipe projet déterminée et disciplinée autour du leader, et écrasant sous le mode horizontal de l’organisation numérique les baronnies politiques déjà en place. Le fantasme numérique a gagné depuis une bonne décennie les responsables politiques comme une des solutions afin de lutter contre le déclin des partis. Les platform politics ont plutôt apporté des déceptions, car le discours a rarement été suivi de la mise en œuvre d’une organisation et d’une vie militante correspondant au design de la plateforme (communauté ouverte, dont les membres seraient propriétaires du code, interagissant avec la direction, participant à la prise de décision par ailleurs largement décentralisée, etc.), mais l’ambition de la mise en œuvre d’une telle structure est élevée. Bien des partis affichant leur renouveau ou leur originalité autour d’une organisation numérique ont déçu. Mais il faut aussi reconnaître les quelques progrès réalisés en la matière, et l’on peut citer le cas honorable de Podemos. Ajoutons que la sociologie du peuple de gauche correspond plus facilement aux soubassements culturels et intellectuels d’une organisation agile, décentralisée, horizontale. Par ailleurs, une organisation numérique et décentralisée, voire réticulaire plutôt que hiérarchisée, correspond aux « nouveaux pouvoirs » capables de propager des idées, des pétitions, des mobilisations comme des feux de brousse. Ce type d’organisation repose sur un triptyque « propriétaire de la plateforme (le leader du mouvement) – superparticipants (les membres de la communauté les plus impliqués qui prennent des rôles d’animateurs) – participants » (qui ne participent que s’ils peuvent agir, partager leur opinion et leur engagement, dans un cadre qui leur semble honnête et égalitaire). Nombreux sont les orphelins de la gauche qui sont prêts à s’engager dans un mouvement de ce type.
La propagation d’un courant politique par les canaux numériques ne nécessite pas un budget considérable. En revanche, l’allumage de l’incendie médiatique peut prendre longtemps, et reste aléatoire. Il s’agit donc de déterminer comment attirer autour d’un personnage et de mots d’ordre, d’un squelette de programme, les « participants » et les inciter à s’inscrire durablement dans le mouvement. La personnalisation, le style et le narratif adoptés par le candidats seront cruciaux, et d’emblée seront critiqués par les militants écologistes traditionnels qui récusent l’affirmation d’une forte personnalité. Mais la mobilisation numérique vise quelques centaines de milliers de personnes, ce qui représente un changement d’échelle. Impact visuels, réactions émotionnelles plutôt que réfléchies, adhésion à des mots d’ordre sans nuances… A côté de ce système d’engagement sommaire, sans profondeur idéologique, le candidat et son mouvement ont besoin de construire un vrai programme pour convaincre une autre partie de la population, peu nombreuse mais stratégique : corps intermédiaires, journalistes, experts, dont la voix, malgré tout, compte encore en France, notamment pour confirmer ou mettre en doute la capacité du candidat à gouverner le pays, et donc, au-delà, convaincre les donateurs pour contribuer au financement de la campagne. Ce jugement joue un rôle important pour la crédibilité du candidat au sein de la gauche « raisonnable » -, et dont une partie a suivi En marche en 2017.
Mais quelle gauche ?
Construire un programme susceptible de rassembler l’électorat de gauche représente un défi redoutable, car il devient bien ardu de définir ce qu’est la gauche. Il existe traditionnellement deux grands faisceaux d’indices : d’une part, la gauche rassemble les mouvements œuvrant pour l’émancipation et une liberté accrues des individus, pour lutter contre les discriminations des personnes en fonction de l’origine, du genre, etc., affiche une plus grande confiance envers autrui, plaide pour un certain relativisme culturel, voire une permissivité sur le plan des mœurs et une justice plus équilibrée envers les délinquants. D’autre part, la gauche représente le combat des classes modestes et moyennes pour obtenir une part accrue dans la redistribution des richesses, et à tout le moins une amélioration des conditions de vie, d’une socialisation des dépenses d’intérêt général, d’un renforcement de l’État-providence et une défense des acquis du droit du travail.
Or, les citoyens préoccupés par le deuxième aspect d’un programme de gauche ne souscrivent pas forcément au premier : schématiquement, l’ouvrier inquiet de la désindustrialisation de son territoire et du départ des services publics ne se retrouve pas dans une gauche « sociétale » préoccupée sur les questions de genre et de discrimination ethnoraciale, reste sceptique à l’idée d’ouverture ou de disparition des frontières et se retrouve plus volontiers Français qu’européen. Le peuple de gauche des centres-villes, on l’a souvent dit, ne recouvre plus la définition du peuple de gauche de la mémoire des luttes collectives du siècle dernier. L’exploit sera de réaliser la réconciliation de ces deux peuples, en admettant que leurs attentes soient compatibles. L’écologie pourrait transcender cette contradiction, en déplaçant les termes du débat et en insistant sur l’articulation entre l’épuisement des ressources et la responsabilité d’un capitalisme maltraitant les travailleurs. Mais il faudrait, d’une part, que l’écologie politique, tels que les militants la pratique aujourd’hui, démontre sa prise en compte des questions sociales classiques (pouvoir d’achat, fiscalité, redistribution, développement des capacités – éducation, santé – pour permettre une meilleure égalité des chances des plus modestes), et, d’autre part, que ceux qui la promeuvent abandonnent leur obsession de gauche sociétale.
L’écologie politique pourrait également réconcilier les deux peuples de gauche autour d’une rénovation profonde de la prise de décision en France, autour des figures honnies du technocrate parisien et du professionnel de la représentation politique inapte à entendre la voix des citoyens. La complexité des attentes (un État fort qui protège en temps de crise et contre les semeurs de trouble, mais qui renonce à sa verticalité dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques) pourrait se résoudre dans la redéfinition des rôles qui devrait procéder d’une très forte décentralisation – la figure d’autorité du maire, encore plébiscitée, et la prise de décision la plus proche du terrain entraînant une acceptation accrue de celle-ci. Une telle décentralisation devra également prévoir une conception des services publics qui fasse une part plus grande aux associations et aux citoyens (bénévoles, notamment) dans la conception de l’action publique. L’essor d’un État plateforme [1] qui partage ses données avec les citoyens, agrège leur participation et celle des associations afin de construire en commun les politiques publiques, ouvre de belles perspectives en la matière.
Paradoxalement, les défis posés à la construction d’une organisation agile, numérique, suscitant l’adhésion de citoyens néophytes, dubitatifs ou orphelins de la politique apparaissent moins redoutables que celui de définir ce qui serait un programme de gauche. Sans doute un noyau dur autour de la défense des services publics, de la préservation des ressources et du cadre de vie des territoires, et d’un approfondissement de la démocratie, pourrait fonder un début de consensus ; mais le peuple de gauche, celui qu’écoutaient les Jaurès et les Thorez, sera sans aucun doute plus exigeant, au risque d’aller cherche ailleurs ses réponses.
[1] Il importe de préciser les différentes conceptions de l’État-plateforme, dont notre rédaction a, par ailleurs, fait une critique dès lors qu’il est un appui aux politiques libérales. Voir par exemple : L’État-plateforme ou la mort de l’état social : Castex et le monde d’après, par Léo Rosell.