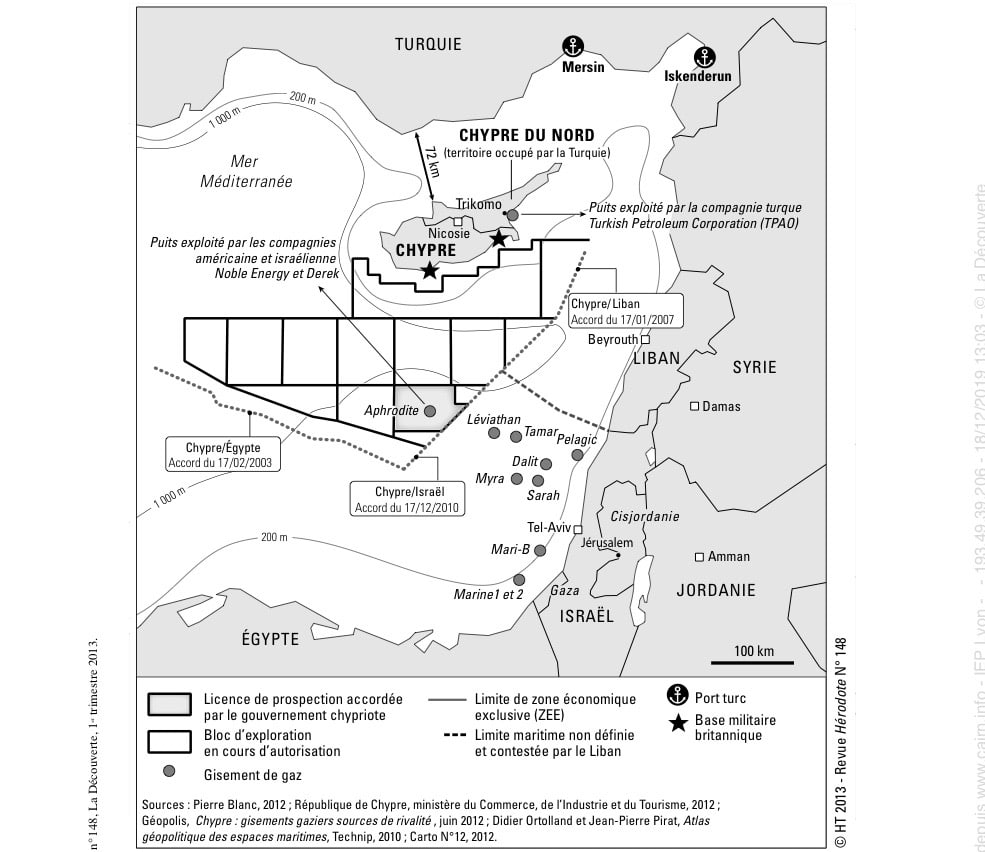La Turquie ne remplit plus un rôle de seconde puissance au travers d’une tutelle de l’OTAN et des États-Unis. Candidate à l’adhésion à l’Union européenne, la Turquie n’en a jamais été aussi éloignée, en témoignent le gel des négociations d’adhésion, l’adoption récente de sanctions en réaction aux forages de la Turquie au large de Chypre, les contentieux sur les enjeux migratoires (libéralisation des visas, réfugiés syriens, etc) et un glissement vers la Russie (contrats énergétiques avec le gazoduc Turkish Stream, centrale nucléaire d’Akkuyu, achats de S400). La Turquie d’Erdoğan, au travers d’un régime ultra-personnalisé et autoritaire s’est-elle, sous couvert d’une reconquête ottomane, affranchie d’une relation de tutelle absolue avec les États-Unis et l’Union européenne pour une relation de sujétions indociles et imprévisibles ?
LA TURQUIE ET LE VIRAGE ATLANTISTE
La République turque, fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, le « père des Turcs » a inscrit la Turquie dans la modernité avec la volonté de se rapprocher au plus du modèle de l’État-nation occidental. Cette construction s’explique notamment par le traumatisme vécu par le peuple turc à la suite de la défaite de la Turquie, alliée de l’Allemagne, lors de la Première Guerre mondiale et le dépècement progressif de l’Empire ottoman, plus communément appelé le « syndrome de Sèvres »[1]. Dans ce contexte, la guerre d’indépendance – de mai 1919 à octobre 1922 – menée par Mustafa Kemal reste aujourd’hui le mythe fondateur de l’identité nationale turque. Le processus de modernisation de l’État – voulu par le courant kémaliste nationaliste, laïc – se heurte au conservatisme religieux alors encore fortement présent dans la société turque. Dans un monde en reconstruction traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, ainsi que face au « danger » soviétique, la Turquie se rapproche des occidentaux.
Dans ce contexte, la Turquie adhère à l’OTAN en 1952 et se range ainsi sous la protection américaine. Pour l’Occident, la Turquie possède une position géostratégique fondamentale face à l’ennemi soviétique ainsi que pour son influence régionale. Affaiblie, la Turquie est contrainte de suivre la marche dictée par les Occidentaux. L’inscription de la Turquie dans le modèle de démocratie libérale permet de percevoir plus nettement la scission dominante au sein de la société turque, à savoir d’un côté l’élite kémaliste nationaliste, et de l’autre côté les couches populaires conservatrices séduites par le nouveau Parti démocrate. L’intégration de la Turquie au Plan Marshall témoigne également du rapprochement entre la Turquie et l’Occident ainsi que de la prise de distance avec l’URSS, renforcée par les velléités de Staline de réclamer une partie du territoire turc. De plus, la politique économique turque après la Seconde Guerre mondiale s’inscrit dans une logique capitaliste ce qui favorise le rapprochement avec l’Occident, ce dernier se mettant en place facilement à partir du moment où existent des intérêts économiques communs. Les alliances turco-occidentales de l’après-guerre enrichiront de façon considérable la classe bourgeoise turque.
C’est dans un souci de réprimer toute la floraison intellectuelle et progressiste marxiste qu’advient le coup d’Etat du 12 septembre 1980
Envers l’émergence des courants progressistes et révolutionnaires influencés par le marxisme, l’alliance entre la bourgeoisie turque et le capital occidental ne cessera de réprimer les velléités libertaires, démocratiques et émancipatrices. Les années 1970, à l’instar de Mai 68 en France et d’autres nombreux mouvements progressistes dans le monde, sont les années les plus riches de l’histoire politique de la Turquie contemporaine. Le Parti communiste de Turquie – TKP (Türkiye Komünist Partisi) –, le syndicat marxiste principal des travailleurs – DISK – ainsi que la société civile sont fortement représentés et ont une influence considérable dans la société. C’est dans un souci de réprimer toute la floraison intellectuelle et progressiste marxiste qu’advient le coup d’État du 12 septembre 1980. Quarante ans après, la Turquie ne s’en est toujours pas remise. Le coup d’État – sous influence américaine – instaure un État d’exception à la suite duquel le pouvoir militaire est transféré à Turgut Özal – avec l’assentiment des Américains. L’intérêt américain pour la région reste toujours très fort notamment avec l’avènement de la révolution iranienne en 1979 ainsi que l’invasion soviétique en Afghanistan. Alors que la tentation de l’Islam politique est restée en sourdine au sein des couches populaires conservatrices, notamment dans la période pré-coup d’État avec une opposition de plus en plus forte de la part des courants laïcs, progressistes et marxistes, Turgut Özal lui permettra à nouveau d’émerger à partir des années 1980-1990. L’özalisme peut être considéré comme une synthèse entre l’émergence d’un islam politique (développement des écoles religieuses « Imam Hatip ») et l’adhésion au projet néo-libéral de Thatcher et Reagan. C’est dans cet élan que sous la façade d’un discours d’un islamisme modéré émergeront des hommes politiques comme l’actuel président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan.
L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES IDÉOLOGIES AU SEIN DES CONSERVATEURS ISLAMIQUES
Fortement endettée et ainsi dépendante des États-Unis, elle y reste assujettie ce qui l’empêche dans ses velléités d’autonomisation vis-à-vis de ceux-ci. C’est dans ce contexte que naît le parti de l’actuel président Recep Tayyip Erdoğan, l’AKP – Parti de la justice et du développement – sur fond de crise économique et de méfiance grandissante vis-à-vis de la bureaucratie militaire kémaliste. Pur produit de la synthèse entre le parti ANAP de Turgut Özal, issu de l’après coup d’État de 1980 et le Refah Partisi de l’islamiste Necmettin Erbakan, l’AKP d’Erdoğan s’alliera dans un premier temps à la confrérie güléniste, du nom de son leader, Fethullah Gülen – communauté religieuse islamique influente au sein de l’administration turque depuis les années 1990 notamment dans la police et la justice mais aussi à l’international (« universitaires islamistes ») – pour renforcer son pouvoir. C’est avec l’aide de ces réseaux qu’Erdoğan montera par exemple de toute pièce le procès Ergenekon afin d’affaiblir l’armée, lequel se traduira par l’inculpation de nombreux hauts gradés. Ceci démontre bien le double jeu de la Turquie qui a souhaité par ce procès truqué démontrer sa capacité à reprendre l’acquis communautaire pour faire avancer les négociations avec l’Union européenne. Cela provoquera l’entrée de nombreux capitaux européens sur le marché turc. Déstabilisé par l’influence grandissante des gülénistes au sein du pouvoir, Erdoğan rompra l’alliance en 2013, ce qui débouchera sur la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 attribuée aux gülénistes. L’islamisme modéré prôné par l’AKP d’Erdoğan au début de son mandat, pour amadouer l’Europe, a été finalement un opportunisme politique considérant la radicalisation actuelle de sa politique. Parler d’ « agenda caché » peut paraître abusif, mais c’est ce même homme qui lors d’un discours en 1994 cita des versets du Coran à un conseil municipal ou en 1997 repris un texte du sociologue nationaliste Ziya Gölkap lors d’un meeting politique à Siirt : « Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées nos casernes », lorsqu’il était encore maire d’Istanbul, ce qui lui coûta plusieurs mois de prison, lors desquels il a travaillé sa stratégie.
L’islamisme modéré prôné par l’AKP d’Erdoğan au début de son mandat, pour amadouer l’Europe, a été finalement un opportunisme politique considérant la radicalisation actuelle de sa politique
Lors des élections législatives de juin 2015, Erdoğan sort affaibli principalement à cause de la mauvaise gestion du dossier syrien qui lui est reproché. Le glissement autoritaire et liberticide orchestré à partir des années 2009-2010 – remise en cause de l’État de droit, restriction des libertés individuelles et collectives, incessantes attaques contre la liberté de la presse ainsi que la répression disproportionnée du mouvement Gezi, mobilisation citoyenne contre la destruction d’un parc dans le quartier de Taksim à Istanbul, au printemps 2013 – se radicalisera à partir de juin 2015. Inquiet de la montée en puissance du parti pro-kurde HDP, en témoigne son entrée au Parlement après son résultat prometteur aux législatives de juin 2015, Erdoğan, qui considère le HDP comme le bras politique du PKK, sacrifiera le processus de paix établi avec le PKK depuis 2012. Les attentats de Suruç en juillet 2015 et d’Ankara en octobre 2015 permettront à l’AKP de jouer sur la peur et le tout sécuritaire pour remporter les législatives anticipées de novembre 2015. La Turquie ne connaîtra aucun autre attentat sur son territoire depuis. Notons que le PKK assassinera deux policiers turcs soupçonnés d’avoir commandité les attentats de Suruç. Le regain de tension avec le PKK ainsi que la confessionnalisation de la politique extérieure (en Syrie et en Irak) montrent à la fois la faiblesse, le début d’une fuite en avant de plus en plus difficile à contrôler ainsi que le visage islamiste conservateur du président turc. La tentative de coup d’État avortée du 15 juillet 2016 permettra à Erdoğan, à travers des purges massives disproportionnées dans l’armée, la justice, l’enseignement, les médias entre autres, un reformatage de l’appareil d’État, une mise en place d’un État-AKP et la négation de l’État de droit. Le référendum constitutionnel d’avril 2017 – passage d’un régime parlementaire à un régime présidentiel – remporté au moyen de nombreuses fraudes ainsi que la victoire aux élections législatives et présidentielle de juin 2018 grâce à l’alliance avec le parti ultra-nationaliste d’extrême droite (MHP) montre le virage autoritaire de la Turquie d’Erdoğan.

VERS UN AFFRANCHISSEMENT DE LA TURQUIE DE SES ALLIES OCCIDENTAUX ET LE RAPPROCHEMENT AU VOISIN RUSSE
Les débuts de l’ère Erdoğan peuvent et doivent ainsi être considérés comme une ouverture non pas seulement au Moyen-Orient mais également avec la Russie, la Chine, les pays turcophones d’Asie centrale, l’Afrique et l’Amérique latine, avec la constitution d’un réel réseau diplomatique (cinquième réseau mondial). En outre, l’affaiblissement de l’armée a favorisé une réorientation de la politique extérieure turque. L’onde de choc politique provoquée par les Printemps arabes avec un soutien d’Ankara aux Frères musulmans en qui elle voit le mouvement le plus structuré à même de prendre le pouvoir ainsi que le bouleversement géopolitique engendré par la guerre en Syrie vont venir influencer considérablement les orientations diplomatiques du pays. Le rapprochement progressif de la Turquie avec ses pays voisins de l’Est suscitera des inquiétudes du côté occidental. Américains et Européens se renvoyant la responsabilité de voir un allié stratégique s’éloigner. L’interdépendance entre Ankara et Washington, principalement la dépendance de l’économie turque au dollar et la position stratégique que représente la Turquie au Moyen-Orient pour les États-Unis, empêche qu’une rupture diplomatique réelle se concrétise.
L’interdépendance entre Ankara et Washington, principalement la dépendance de l’économie turque au dollar et la position stratégique que représente la Turquie au Moyen-Orient pour les Etats-Unis, empêche qu’une rupture diplomatique réelle se concrétise
Le conflit syrien est venu ainsi montrer les limites de l’expansionnisme turc. Le sentiment d’abandon après le refus américain d’intervenir suite aux utilisations d’armes chimiques par Damas en août 2013, l’acharnement à vouloir voir tomber le régime syrien – jusqu’à soutenir les groupes islamistes les plus radicaux – en opposition aux soutiens russes et iraniens au régime baasiste a renforcé l’isolement de la Turquie qui n’a pas été en mesure de devenir la véritable puissance régionale. Sous-estimant les influences russes et iraniennes, la Turquie s’est retrouvée sous le feu des critiques internationales suite à sa volonté de faire tomber le régime syrien. La para-militarisation à travers notamment le groupe Sadat au sein du « clan Erdoğan » dont le patron n’est autre que le père d’un gendre d’Erdoğan, démontre les liens étroits entretenus avec des groupes djihadistes, et l’incapacité de facto pour Ankara de respecter son engagement des accords de Sotchi visant à désarmer les groupes djihadistes à Idlib. Les incursions turques sur le territoire syrien à l’automne 2016 jusqu’au printemps 2017 (opération « bouclier de l’Euphrate ») puis de janvier 2018 (opération « Rameau d’olivier ») témoignent de l’obsession turque à ne pas voir émerger un Kurdistan syrien autonome à sa frontière. L’échec de la mise en œuvre des accords de Sotchi montre à la fois la difficulté des acteurs à trouver une sortie de crise et la cristallisation des tensions autour de la région d’Idlib en Syrie.
L’achat des missiles russes S400 par la Turquie exacerbera encore plus les relations entre Ankara et Washington, qui craint que des informations sensibles liées aux systèmes militaires de l’OTAN deviennent potentiellement accessibles pour Moscou. Prise entre les administrations de Trump et de Poutine, la Turquie cherche à renforcer son influence mais participe également à la déstabilisation de l’équilibre géopolitique international. Par ailleurs, force est d’observer que la Russie a pris la place que la Turquie souhaitait se donner comme leader régional sur le dossier syrien. Le risque d’affrontement direct entre Ankara et Moscou dans la région d’Idlib en février-mars montre à nouveau la fragilité du rapprochement russo-turc. Moscou a besoin d’Ankara et de ses liens avec les rebelles ainsi qu’avec les djihadistes tandis que Moscou représente pour Ankara le seul moyen d’avoir une prise sur la question kurde, considérée de portée existentielle pour son régime. Le renforcement des sanctions économiques américaines en 2019 est venu fragiliser encore un peu plus un pays qui, nous l’aurons compris, garde une position géostratégique déterminante dans le paysage géopolitique international.
Compte-tenu de son affaiblissement tant à ses frontières extérieures que la crise économique (à laquelle vient s’ajouter une crise sanitaire mondiale), il serait illusoire d’attendre de la Turquie un virage démocratique et une résolution des conflits à ses frontières. Le risque est bien celui d’un enlisement géopolitique de la Turquie, dans une atmosphère de « fin de règne » pour Erdoğan avec comme prochaine grande échéance l’élection présidentielle de 2023. La perte des mairies d’Istanbul et d’Ankara par l’AKP en juin 2019 a redonné de l’espoir aux opposants au régime de Recep Tayyip Erdoğan. La principale faiblesse de l’erdoğanisme peut être considérée comme sa dépendance aux élections.
La « personnalisation » du pouvoir – l’AKP étant devenu une machine personnelle – témoigne de l’instabilité de son propre régime. La société civile, très affaiblie depuis les évènements de Gezi au printemps 2013, ne parvient pas à trouver un second souffle. Il reste cependant de nombreux espaces de résistances (HDP, espaces culturels kurdes, quelques médias alternatifs, universitaires qui cherchent à s’organiser etc.). La constitution d’un front anti-Erdoğan existe sans projet politique concret alternatif. Tantôt proche de ses alliés historiques, tantôt de la Russie, la Turquie cherche sa place sur la scène internationale. Il convient de considérer également que le rapprochement avec la Russie s’inscrit dans un objectif d’affirmation de la Turquie contre l’Union européenne et les États-Unis.
Ankara maintient parallèlement une pression vis-à-vis de l’Union européenne au travers de la question des réfugiés. Le désengagement relatif américain en octobre 2019 a permis à la Turquie de renforcer son objectif de création d’une zone tampon à la frontière turco-syrienne afin d’anéantir la révolution autonome kurde, amenant à une politique de nettoyage ethnique, afin d’y installer les populations arabes réfugiées encore aujourd’hui en Turquie – dans l’indifférence de la communauté internationale.
[1] En référence au Traité de Sèvre de 1920, qui prévoit un partage de l’Empire ottoman, déjà largement affaibli, entre les Européens, les Kurdes, et les Arméniens.