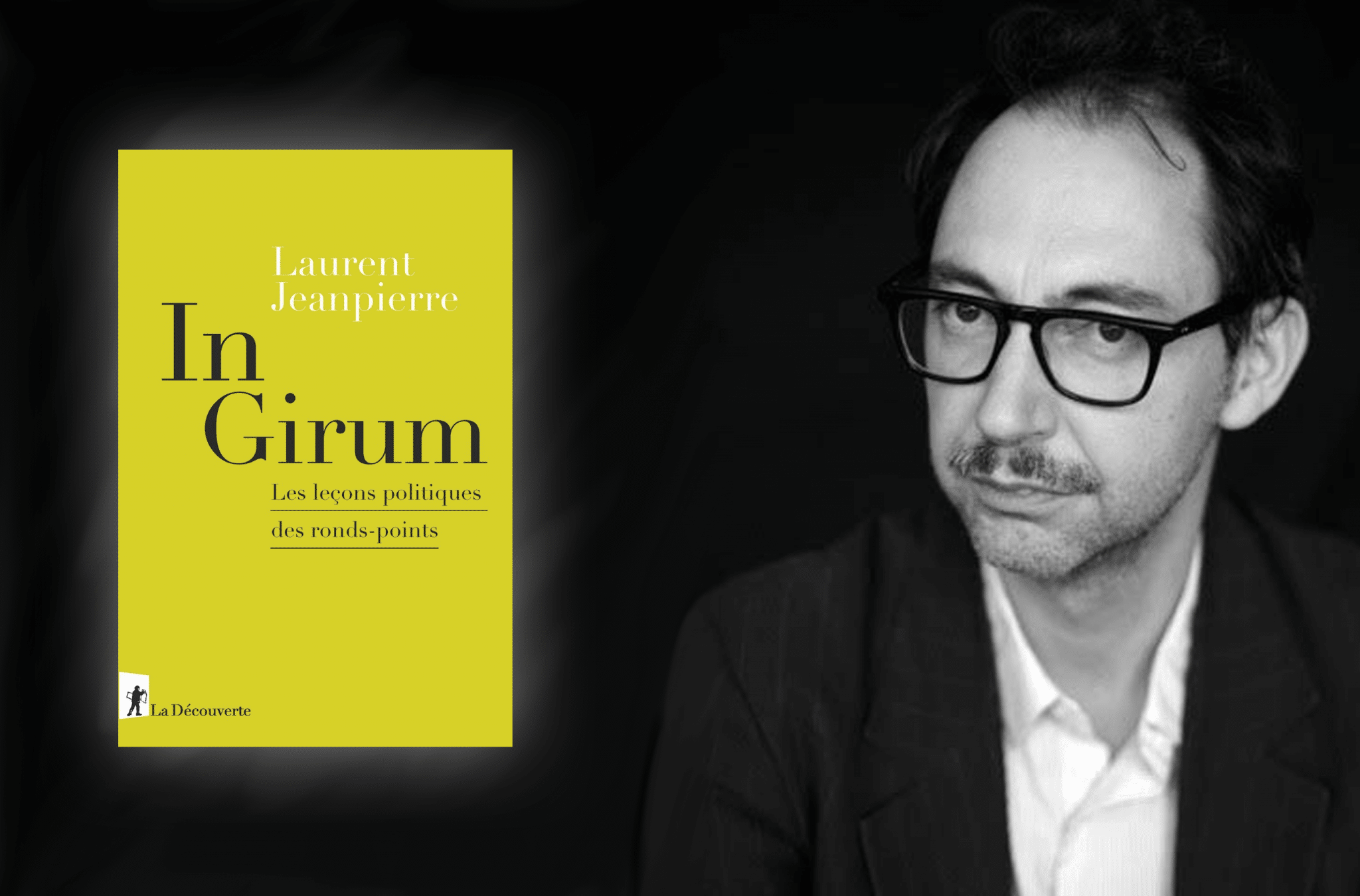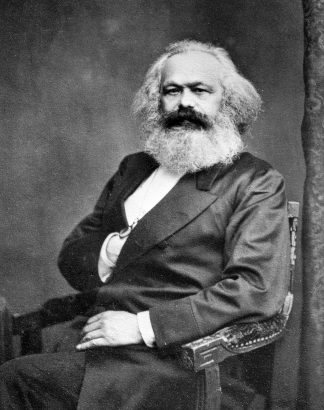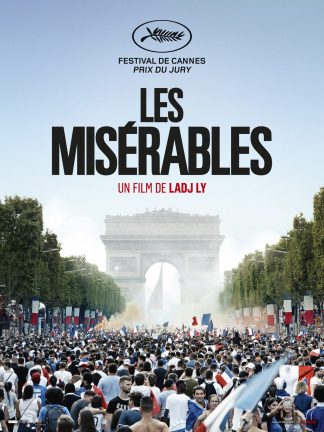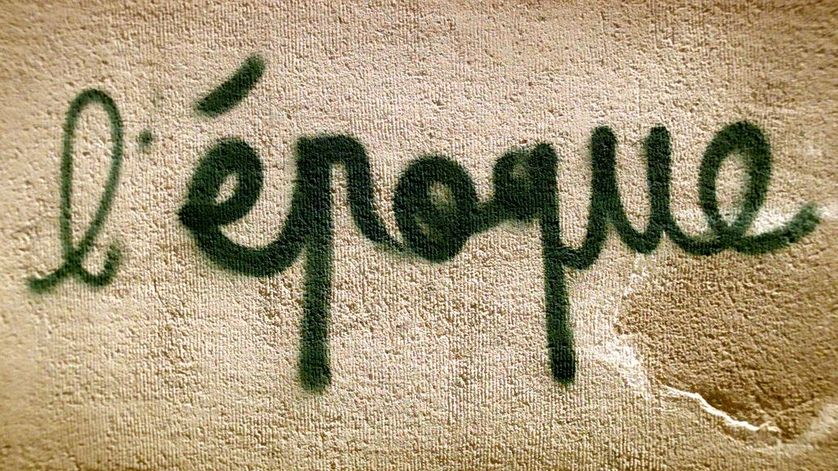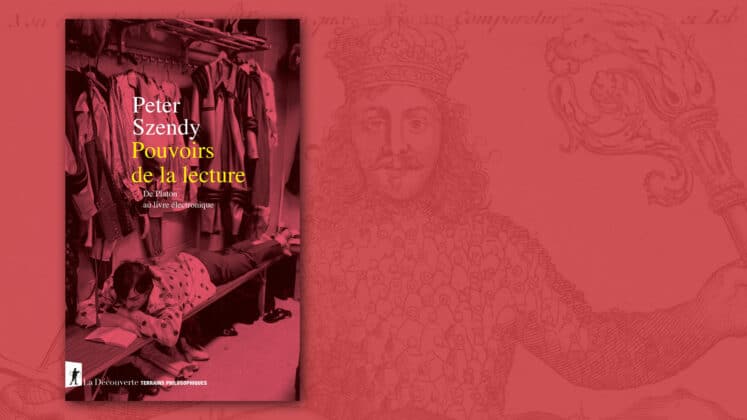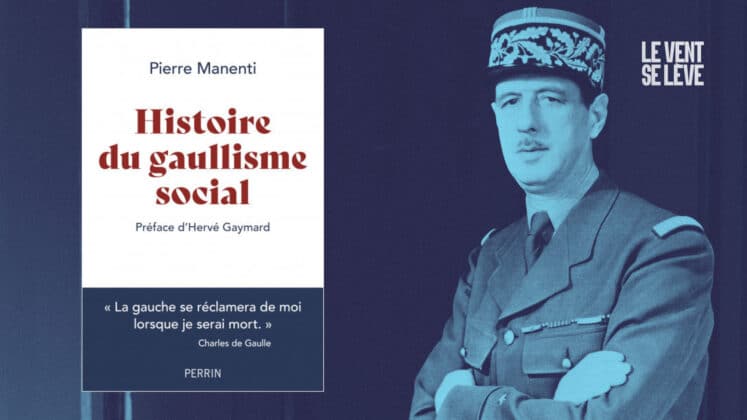Didier Eribon est revenu pour LVSL sur son parcours atypique d’intellectuel transfuge de classe, ainsi que sur Retour à Reims, essai qui a fait date en ouvrant une voie nouvelle à l’écriture autobiographique sur le mode de l’introspection sociologique. Nous avons évoqué son prochain livre qui portera sur la question politique du vieillissement, et la représentation des exclus qui n’ont pas voix au chapitre. Il nous livre son regard précieux sur l’actualité des mouvements sociaux, ainsi que sur l’évolution du vote ouvrier vers l’extrême-droite et la désintégration de la classe ouvrière. Premier volet d’un entretien réalisé par Noémie Cadeau et retranscrit par Jeanne du Roure et Victoire Diethelm. Découvrez la deuxième partie de cet entretien ici.
LVSL – Vous avez fait le choix d’écrire Retour à Reims sur le mode d’une autobiographie transfigurée en analyse historique et théorique, que certains critiques ont d’ailleurs nommé une auto-sociographie. Pourquoi ne pas avoir choisi la voie littéraire pour cette archéologie de la subjectivation, et quelle est finalement la supériorité de la théorie sur la littérature dans ce contexte ?
Didier Eribon – Ce mode d’écriture n’est pas vraiment un choix. Disons plutôt qu’il s’est imposé à moi dans la suite de mes ouvrages antérieurs, même si j’ai essayé de faire quelque chose de tout à fait nouveau. Je n’ai jamais envisagé d’écrire ce livre comme un texte littéraire, dans la mesure où je ne me considère pas comme un écrivain. Certains l’ont fait avant moi, et je pense notamment à Annie Ernaux avec ses livres superbes que sont La Place ou Une femme. Ce sont des livres que j’admire et auxquels je rends hommage dans Retour à Reims. Mais mon registre d’intervention et d’écriture est différent : c’est celui de la sociologie, de la théorie politique, de la philosophie. Je n’ai pas considéré ce livre, en l’écrivant, comme une autobiographie transfigurée en analyse politique, mais plutôt, à l’inverse, si j’ose dire, comme un ensemble d’analyses théoriques et politiques qui allait prendre comme modalité d’écriture un récit autobiographique ou, pour employer un terme plus exact, auto-analytique. J’ai voulu y développer une philosophie de la subjectivation : au cœur de ma démarche se trouve la question de la subjectivité, comme étant toujours inscrite dans le social, comme étant sociale de part en part. L’autoanalyse a été pour moi un moyen de mener à bien une analyse théorique générale ; mais cette démarche répondait aussi à une nécessité personnelle : je me suis senti poussé à écrire ce livre pour m’expliquer avec moi-même, c’est-à-dire m’expliquer sur mon rapport avec ma famille, mes parents, la classe sociale d’où je viens, et la distance entre celle-ci et la classe sociale dans laquelle je vis désormais…. L’autobiographie, l’auto-analyse, et l’analyse théorique se sont donc entrecroisées comme des éléments d’écriture ou des strates d’écriture dans cet effort pour « me » comprendre, c’est-à-dire, finalement, pour comprendre, à travers moi, la structure sociale, les rouages de l’existence et de la reproduction des classes sociales, dans et par le système scolaire notamment, et le fonctionnement du monde social.
J’ai défini mon projet comme une « introspection sociologique », ce qui peut sembler un oxymore, puisque la sociologie, précisément, est le contraire de la démarche qui consisterait à aller chercher la vérité en soi-même. Elle part de statistiques, d’enquêtes, d’entretiens, de descriptions pour reconstituer les mécanismes extérieurs. Mais il s’est agi pour moi d’explorer mon histoire et ma géographie – disons ma trajectoire – en mobilisant tous les instruments et les concepts de la sociologie telle que je la conçois (les déterminismes de classe, l’analyse du système scolaire, la reproduction sociale, le rapport à la culture, à l’art, les questions liées au genre, à la sexualité, etc.) pour établir une cartographie des mécanismes sociaux et de leur intériorisation par les agents sociaux que nous sommes tous. J’utilisais ces outils pour une exploration de moi-même à travers les strates historico-ethnographiques des différentes périodes de ma vie personnelle et collective – individuelle et sociale.

J’ai dit dans un entretien que Retour à Reims était un livre sur le système scolaire (son fonctionnement comme machine à trier, la violence qu’il exerce) : il l’est en grande partie. Je tiens à souligner que parler d’« introspection sociologique » ne signifie nullement que ce livre serait ou tendrait vers une analyse psychologique ou psychanalytique. J’essaie au contraire de réduire autant que faire se peut la place de la psychologie et du psychologique dans ma démarche. Cette tentative d’élucidation de moi-même est une analyse sociale, qui tourne résolument le dos à la psychanalyse. Le recours à la psychanalyse tend toujours à désocialiser, déshistoriciser et donc dépolitiser les phénomènes et les processus dont il faut rendre compte.
Ma trajectoire est à la fois banale et atypique. En quoi peut-elle permettre d’éclairer le monde social ? On m’a souvent dit que mes analyses sur la force durable des déterminismes sociaux étaient démenties par mon parcours. Mais c’est faux : ce qui peut apparaître comme une exception n’infirme pas la règle mais peut servir de point d’appui pour voir comment la règle fonctionne, comment les lois sociales gouvernent nos trajectoires que l’on imagine être personnelles, individuelles. D’ailleurs, tout mon parcours a été marqué par des échecs universitaires : je n’ai pas obtenu le CAPES ni l’agrégation, j’ai été obligé d’abandonner ma thèse parce que je n’avais pas d’argent…. Mon parcours de transfuge de classe est scandé par une série d’échecs qui m’ont obligé, à chaque fois, à recomposer mes aspirations, à réorienter mes choix. Les échecs, qui me plongeaient dans des abimes d’incertitude et d’angoisse, ont pu me conduire à des situations, à des rencontres, à des hasards qui, d’un seul coup, m’ouvraient d’autres possibilités. Il est important de comprendre en quoi la trajectoire de transfuge de classe n’est pas linéaire, mais plutôt une série d’étapes dans lesquelles des difficultés, des échecs, des troubles de l’inscription sociale se présentent et imposent de réagir différemment, de se positionner différemment… C’est tout cet ensemble de phénomènes complexes que j’ai essayé de déplier et d’exposer dans Retour à Reims.
L’introspection sociologique ne signifie pas que ce livre est une analyse psychologique ou psychanalytique, mais une tentative d’élucidation de moi-même qui me permet d’éclairer le monde social.
LVSL – Vous avez notamment expliqué dans Retour à Reims que, pour vous inventer, il fallait vous dissocier. Est-ce que vous ressentez toujours aujourd’hui ce clivage en vous, entre votre origine sociale et votre parcours universitaire, ou est-ce que finalement cette inadéquation a été « résolue » par la reconnaissance publique, par la fonction presque thérapeutique de l’écriture, ou même par la réconciliation avec votre mère ?
D.E. – Je disais que pour m’inventer moi-même, il m’avait fallu différer. Quand j’étais enfant, adolescent, j’avais depuis toujours entendu, chez moi, par exemple quand mon père regardait la télévision, et autour de moi, des insultes homophobes. Je savais donc qu’il s’agissait d’une identité insultée, insultable, avant de savoir que cette identité, c’était celle que j’allais bientôt venir habiter. En le découvrant peu à peu, j’ai d’abord ressenti de la peur, de l’effroi. J’étais ce « scared gay kid » dont parle un poème d’Allen Ginsberg. Et parce que j’étais « différent », il me fallait différer. Et dans Retour à Reims, j’ai donc essayé d’analyser sous cette lumière la déviation de ma trajectoire scolaire par rapport à celle qui m’était assignée, à savoir sortir très vite du système scolaire pour aller travailler, comme l’ont fait mes frères. Cette déviation a sans doute été, en grande partie, liée à la « déviance » sexuelle : à treize ou quatorze ans, quand j’ai commencé à comprendre que j’étais en train de devenir ce qu’il ne fallait surtout pas être, je n’avais guère d’autre choix que de me dissocier de ce milieu qui était le mien, de ses valeurs (et notamment du virilisme qui y régnait…). C’est passé aussi par une adhésion à la culture, je me suis pris de passion pour la littérature, le cinéma, puis pour la philosophie…Et très vite j’ai voulu quitter la ville où j’avais vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et qui était pour moi la ville de l’insulte, et je me suis installé à Paris, selon le parcours très classique, au fond, de ceux qui contreviennent à la norme sexuelle, qui doivent quitter l’endroit où ils vivent pour aller dans la grande ville afin de pouvoir se sentir plus libres. Ensuite, la différence, la distance avec ma famille, s’est accentuée puisque j’ai fait des études supérieures – j’étais le premier dans ma famille – et je suis devenu, après une série d’échecs universitaires, journaliste à Libération, puis au Nouvel Observateur. Puis, j’en ai eu assez du journalisme (un milieu, un univers assez détestable), et je me suis mis à écrire des livres, et puis j’ai enseigné aux Etats-Unis, avant de trouver un poste universitaire en France.

Tout cela évidemment m’éloignait de ma famille… A la mort de mon père, en janvier 2006, je me suis demandé pourquoi je n’avais jamais essayé de le revoir. J’ai voulu réfléchir sur cette distance – sociale, de classe – qui s’était instaurée entre nous. C’est le point de départ de l’écriture de Retour à Reims. L’idée de « retour » implique qu’il y a eu un départ, un éloignement, puis une distance durable… Et que cette distance a été produite par la fréquentation du système scolaire, par l’accès à la culture légitime, par l’entrée dans d’autres milieux sociaux, dans un autre monde, dans une autre classe, etc. C’est ce que j’ai voulu analyser. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas à propos de mon père, que j’aurais bien aimé savoir quand j’écrivais Retour à Reims. Mais il était trop tard, il était mort. Je ne lui ai jamais posé de questions sur sa vie, sur sa famille, sur son enfance. Ce que je sais de lui, c’est principalement ce que ce que ma mère m’en a raconté après sa mort. À ce moment-là, j’ai renoué une relation avec elle. Ce ne fut pas un processus « thérapeutique » au sens psychologique du terme, mais plutôt, pour reprendre un mot de Bourdieu, une « socio-analyse », qui impliquait de revenir sur la question des classes sociales, et l’inscription en chacun de nous des habitus de classe. Et quand il y a une discordance dans l’habitus, un clivage entre l’habitus incorporé dans l’enfance et celui qui se recréée en nous quand on change de milieu, il n’est pas simple de surmonter cette division du moi, cette séparation qui passe à l’intérieur de soi-même. Il ne suffit pas de prendre le train pour faire un « retour » : il faut analyser les mécanismes qui produisent l’éloignement en soi-même et la possibilité ou non de le surmonter.
Ma mère est morte il y a deux ans. Donc le livre que je suis en train d’écrire sera une sorte de « Retour à Reims, volume 2 ». Le volume 1 avait eu pour événement déclencheur la mort de mon père, le volume 2 prend naissance à la mort de ma mère.
LVSL – Pouvez-vous nous en dire plus sur ce livre en cours d’écriture ? Quels aspects vous permettra-t-il de développer par rapport à son premier volet ?
D.E. – Ma mère est morte beaucoup plus tard que mon père. On sait que les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Mais la question de l’espérance de vie, c’est aussi celle de l’espérance de vie en bonne santé. C’est pourquoi je voudrais étudier dans ce livre en cours d’écriture ce qu’est la réalité de la vieillesse, du vieillissement d’une femme qui a été ouvrière, dont le corps a été détruit par la pénibilité et la dureté des conditions de travail. Le vieillissement, le corps souffrant, la maladie, la perte d’autonomie, l’hôpital, la maison de retraite, la mort, ce sont des questions hautement politiques.
Le vieillissement, le corps souffrant, la maladie, la perte d’autonomie, l’hôpital, la maison de retraite, la mort, ce sont des questions hautement politiques.
Je ne suis évidemment pas le premier à m’intéresser à tous ces problèmes ! La littérature s’est emparée du sujet depuis longtemps. Je viens de lire un livre de Yasushi Inoué, Histoire de ma mère, qui est magnifique, tant dans sa description de la dégradation physique et mentale de sa mère, que dans le récit de sa mort. La littérature s’est beaucoup intéressée à ces réalités douloureuses et donc je ne prétends pas ouvrir des voies nouvelles dans leur évocation, mais plutôt essayer d’apporter quelque chose de neuf dans l’analyse, notamment dans le rapport à la politique. On analyse toujours le rapport au vieillissement et à la mort comme si c’étaient des mécanismes biologiques individuels. Or des historiens comme Philippe Ariès ou des sociologues comme Norbert Elias ont montré que les structures de la subjectivité, du rapport à la vieillesse et la mort se sont transformées au cours des époques. Ce sont donc des phénomènes sociaux et historiques, et donc politiques. Il y a un petit livre de Norbert Elias, La solitude des mourants, qui est un très grand livre, et que j’utilise beaucoup.
Parmi mes références principales dans ce travail en cours figure bien sûr le livre de Simone de Beauvoir qui s’intitule précisément, La Vieillesse. Elle l’a publié en 1970, c’est-à-dire 21 ans après Le Deuxième sexe. Elle a décrit cet ouvrage comme étant « symétrique » du Deuxième sexe. Elle dit avoir voulu poser à propos des personnes âgées des questions analogues à celles qu’elle avait posées à propos des femmes. Dans l’introduction, elle souligne que les « vieillards » (on dirait aujourd’hui les personnes âgées) sont exclus de la visibilité publique, relégués hors de la vie sociale. Et que personne ne s’intéresse à eux. Je voudrais dans mon livre faire entendre leur voix, déclare-t-elle.
Mais on voit bien que cela pose un problème. Dans Le Deuxième sexe, elle se demandait comment les femmes pourraient dire « nous », et elle analysait justement le processus par lequel les femmes cessent d’être l’objet du regard des autres pour se constituer comme sujet de leur propre regard et de leur propre discours. Dans La Vieillesse, elle dit qu’elle va faire entendre la voix des personnes âgées. Cela veut dire que c’est un problème tout à fait différent : elle ne se demande pas pourquoi ces personnes ne disent pas « nous », ni comment elles pourraient se constituer comme un « nous ». Je l’avais lu quand j’étais étudiant — j’avais lu tout Simone de Beauvoir —, mais en le relisant récemment, j’ai constaté qu’elle ne posait pas la question de la même manière que dans Le Deuxième sexe et qu’elle ne s’interrogeait pas sur cette différence d’approche. Ce n’est pas un reproche que je lui adresse, cela va de soi. Ce livre était une intervention majeure dans le champ intellectuel et politique à une époque où ces problèmes n’étaient guère constitués comme étant dignes d’intérêt. Elle ne pouvait pas poser toutes les questions, mais je veux engager la discussion avec son livre sur ce point, car cela renvoie à toute une série d’enjeux à propos des mouvements sociaux, de la mobilisation politique, de la représentation politique aussi : s’il est nécessaire que quelqu’un fasse entendre leur voix, c’est parce que ces personnes âgées ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Elles ne peuvent parler que si quelqu’un parle pour elles, c’est-à-dire en leur faveur, mais aussi à leur place.
Je pars encore une fois d’une expérience personnelle pour essayer de poser des questions théoriques et politiques. Ma mère, sur son lit, dans la maison de retraite, n’arrivait pas à se lever sans aide, et elle me laissait des messages désespérés sur mon répondeur en disant qu’elle était tout le temps seule, qu’elle était maltraitée, qu’on ne lui permettait de prendre une douche qu’une fois par semaine, etc. J’appelais le médecin de la maison de retraite, qui me répondait qu’il n’y n’avait pas assez d’aides-soignants, et que cela n’était donc possible qu’une fois par semaine. Je me disais qu’il n’était pas imaginable que la situation des EPHAD soit à ce point sinistrée. Mais c’était pourtant vrai, et le livre d’Anne-Sophie Pelletier, Ephad, une honte française, offre des descriptions précises et dresse un constat terrible sur cette situation.

Ma mère s’est littéralement laissée mourir. Elle est morte un mois et demi après son entrée dans une maison de retraite. On ne peut pas dire qu’elle ne protestait pas contre la situation puisqu’elle me laissait des messages angoissés et indignés sur mon répondeur. Mais c’est une protestation qu’elle énonçait seule, dans sa chambre, au téléphone, avec pour destinataire une seule personne – moi ou l’un de mes frères – qui l’écoutait. Il est certain que dans toutes les maisons de retraite, il y a des gens qui font chaque jour la même chose. Mais comment ces personnes âgées, dans une maison de retraite, surtout quand elles ont perdu leur autonomie physique, pourraient-elles dire « nous » ? Il n’y a pas de « nous » audible de ces personnes âgées, parce qu’il n’y a pas de « nous » possible : il n’y a pas de prise de parole publique possible, ni de mobilisation politique, si ce n’est – comme Simone de Beauvoir le proposait dans l’introduction de La Vieillesse – si des gens parlent pour elles et portent ainsi leurs voix inaudibles, étouffées, de l’isolement de la chambre à la sphère publique.
C’est une question assez vertigineuse : qu’est-ce que cela signifie de parler pour des gens qui resteraient silencieux si personne ne prenait la parole pour eux ? Si des auteurs comme Simone de Beauvoir ou moi (entre autres, bien sûr) ne prenons pas la parole pour les personnes âgées, elles ne parlent pas. Par conséquent, elles ne parlent que par l’intermédiaire de ceux et celles qui parlent d’elles, qui parlent pour elles. Donc, les personnes âgées dépendantes ne peuvent pas se constituer comme un « nous » : le « nous » leur vient de l’extérieur d’une certaine manière, il est constitué par la médiation d’un porte-parole. C’est cette médiation qui peut faire entendre des paroles individuelles dispersées et qui peut les transformer en une parole collective : si je restitue la parole de ma mère, ce n’est pas seulement le cri, la plainte de ma mère que je porte dans l’espace public, c’est le cri et la plainte de toutes celles (ce sont surtout des femmes à cet âge-là) et de tous ceux qui sont dans des maisons de retraite. Le collectif est constitué par la médiation des professionnels de la santé, comme les personnels des EPHAD qui ont récemment tiré la sonnette d’alarme sur l’état de délabrement scandaleux dans lequel se trouve tout le système des maisons de retraite, ou par des auteurs comme Simone de Beauvoir en 1970, ou comme moi aujourd’hui, qui me propose de poursuivre ce travail de Beauvoir. A partir du cas de ma mère, j’essaye de m’interroger sur les processus sociaux, et de réinscrire la vieillesse et la mort dans l’analyse sociologique et théorique. Car cela nous entraîne dans une série de questions emboîtées : est-ce que ce cas-limite des personnes qui ont perdu leur autonomie physique, en train de perdre leurs facultés cognitives, aussi, parfois, ce cas extrême de la nécessité d’une représentation politique – et donc des porte-parole : syndicats, associations, partis ou écrivains, artistes, philosophes… – ne dit pas quelque chose de la mobilisation politique en général. Je veux dire : est-ce que ce n’est pas toujours le cas, à des degrés divers, sous des formes diverses ?
J’essaye de m’interroger sur les processus sociaux, et de réinscrire la vieillesse et la mort dans l’analyse sociologique et théorique.
Découvrez la deuxième partie de cet entretien ici.
Crédit photo Une et entretien : Ulysse GUTTMANN-FAURE pour LVSL.