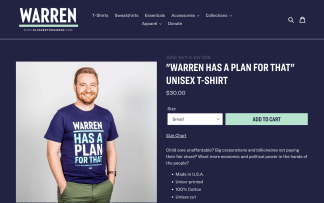Les dernières décennies ont fait disparaître les syndicats tels que nous les connaissions. De moteurs du progrès social, ils ne font plus office que de caution à une destruction systématique du code du travail. En conséquence la défiance s’accroît à leur égard. Sont-ils pris dans un jeu institutionnel les laissant sans leviers d’action ? Est-ce à cause de leur intégration à la construction européenne ? Ou bien est-ce la structure de l’économie qui les rend obsolètes ? Ce qui est certain, c’est que leur forme est amenée à changer. Sophie Béroud, politiste à l’Université Lyon 2, auteure avec Baptiste Giraud et Karel Yon de Sociologie politique du syndicalisme (A. Colin, 2018), nous éclaire sur le sujet. Entretien retranscrit et réalisé par Louis Blème.
LVSL – La dernière grève, née de l’embrasement suscité par la réforme des retraites, est une grève par procuration et non une grève générale. Pourquoi ? La grève par procuration nuit-elle à l’action collective ?
Sophie Béroud – Cette grève n’a pas été qu’une grève par procuration, loin de là. C’est d’ailleurs l’une des originalités de ce mouvement : le nombre de grévistes a été important, la grève a été reconductible dans certains secteurs et s’est étalée dans le temps (plus de 50 jours de grève à la SNCF et à la RATP). Ce mouvement a à la fois mis au centre de l’action syndicale la grève, et montré les difficultés de certains salariés à la rejoindre. Ces barrières ne sont guère nouvelles et sont particulièrement liées à la dégradation des statuts d’emplois, avec toutes les formes d’emploi précaires (intérim, CDD, stages…) et l’éclatement des collectifs de travail qui en découle et qui est également lié aux formes d’individualisation du travail, des rémunérations, etc..
Le mouvement social contre la réforme des retraites a ainsi ceci d’ambivalent qu’il a permis de montrer l’importance du recours à la grève, mais aussi la difficulté structurelle des syndicats à mobiliser les travailleurs dans leur ensemble.
LVSL – Les policiers ont obtenu le maintien de leur régime spécial de retraite grâce à l’action vivace de leurs syndicats. C’est aussi le cas d’autres corps de métier. Les intérêts catégoriels et corporatistes menacent-ils l’efficacité de la lutte pour tous les travailleurs ?
SB – Il y a une efficacité réelle du syndicalisme dans certains corps de métier, notamment pour les policiers qui sont, contrairement à une idée assez répandue, la plus syndiquée de toutes les professions. Dans un contexte où les forces de l’ordre ont été très mobilisées par le gouvernement, notamment pour réprimer le mouvement des gilets jaunes, les syndicats de policiers ont réussi à défendre avec succès leurs intérêts face au gouvernement.
Cependant, je ne crois pas que les revendications catégorielles soient une entrave à la production des intérêts communs ; elles peuvent constituer un premier socle pour l’action collective. Ce ne sont pas ces intérêts corporatistes qui minent la formation d’un bloc uni ou l’intérêt des travailleurs. Au contraire, ces secteurs dans lesquels l’activité syndicale est plus efficace peuvent servir de points d’appui à l’ensemble des salariés pour engranger des conquêtes. Ça a été le cas des syndicats de l’enseignement pendant une longue période, mais aussi d’autres corps de métiers à statut.
Après il en va aussi des syndicats de dépasser ces intérêts sectoriels et de montrer que malgré la diversité des luttes, il y a un intérêt commun. Les cheminots et les agents de la RATP ont bien montré pendant le mouvement qu’ils parvenaient à articuler la défense de leurs régimes spéciaux de retraite et un refus plus global d’une réforme défavorable à l’ensemble des salariés.
LVSL – Pouvons-nous dire que les dernières décennies ont vu un « apprivoisement » des syndicats par l’appareil d’Etat via une professionnalisation et une bureaucratisation croissantes ?
SB – Ces questions remontent plus loin dans le temps. Dès l’après seconde guerre mondiale, les syndicats ont connu ces processus d’institutionnalisation, mais ce fut pour gérer les acquis sociaux comme les caisses de la sécurité sociale, ou les entreprises nationalisées. Le problème, c’est qu’on demande désormais aux syndicats de participer sans avoir aucun levier de décision, seulement pour cautionner ce qui est déjà décidé. On a l’exemple de la CFDT qui, lors du dernier conflit sur les retraites, a décidé de mettre en place une conférence de financement dans l’objectif de trouver des solutions pour mettre en place une réforme néolibérale. Ici, il y a une intégration évidente au système qui conduit à ne plus contester la rationalité des décisions. L’institutionnalisation peut constituer un point d’appui pour les syndicats, en termes de reconnaissance et de droits, mais quand celle-ci tourne à vide, c’est-à-dire, sans pouvoir apporter de gains aux salariés, alors il y a un véritable problème.
« Le problème, c’est qu’on demande désormais aux syndicats de participer sans avoir aucun levier de décision, seulement pour cautionner ce qui est déjà décidé. »
Après, institutionnalisation et professionnalisation ne sont pas identiques. Le deuxième terme évoque aussi le fait que les représentants syndicaux consacrent tout leur temps à siéger dans différentes instances, c’est-à-dire éloignés des salariés qu’ils représentent. Toute une série de mesures, depuis la réforme de la représentativité syndicale en 2008 jusqu’aux ordonnances Macron, ont été dans le sens d’une plus forte professionnalisation des élus du personnel en les voyant avant tout comme des professionnels de la négociation et en intégrant la négociation à l’ordre managérial, en évinçant tout aspect conflictuel. Cette conception-là de la professionnalisation pose problème.
LVSL – Les syndicats français font partie de la Confédération européenne des syndicats (CES). Or cette confédération subventionnée par la Commission européenne est une actrice majeure du démantèlement du droit du travail en France. Pensez-vous qu’une telle dépendance peut être la cause de conflits d’intérêts expliquant leurs échecs successifs et leur délégitimation ? En outre, le mutisme des syndicats à l’égard de l’UE n’est-elle pas aussi l’illustration d’une certaine hypocrisie ?
SB – L’appartenance des organisations syndicales nationales à la CES ne pose pas problème en soi, mais bien par rapport aux objectifs que poursuit celle-ci, aux moyens dont elle dispose, à l’efficacité dont elle fait preuve. Le manque de combativité de cette confédération, sa faible capacité à se faire entendre par la Commission européenne sur les orientations des politiques économiques et monétaires et à se démarquer de ces politiques posent problème. Son efficacité et sa capacité à produire des solidarités transnationales sont également mises en question. Il faut pourtant toujours pouvoir agir au niveau européen, car, comme la question le formule, l’Union européenne a largement contribué à la diffusion des politiques néolibérales. Il faut savoir donner du contenu à l’action syndicale européenne en la faisant vivre avec des manifestations européennes, ou des coordinations au niveau européen comme cela se fait dans certains secteurs, comme les transports, à l’initiative des fédérations syndicales professionnelles européennes. Malheureusement, des travaux de chercheurs le montrent, la CES est complètement intégrée aux institutions européennes et est très dépendante du financement de la Commission européenne. Des espaces alternatifs se créent : à titre d’exemple, les syndicats et collectifs de livreurs se sont rassemblés au niveau européen pour créer une nouvelle fédération, hors de la CES.
On peut espérer que la mise en cause des orientations de l’Union européenne qui se généralise (avec l’éclatement par exemple des 3% dans ce contexte de crise sanitaire) propose un nouveau cadre à l’action syndicale et permette de faire entendre de nouveau des enjeux comme ceux de la défense des services publics par exemple. L’action européenne est indispensable, mais il est clair que la CES a montré ses insuffisances.
LVSL – L’heure de gloire des syndicats est sans nul doute les Trente Glorieuses. Leur effondrement est corrélé à l’avancée dans les Trente Piteuses. Aujourd’hui l’austérité empêche l’inflation, dont celle des salaires. Le chômage est haut. La croissance moribonde. Le succès des syndicats ne serait-il pas simplement directement lié au contexte économique, et plus précisément à l’importance de la croissance permettant le partage de la valeur ajoutée ?
SB – L’établissement d’un lien entre les cycles économiques et l’efficacité de l’action syndicale a nourri beaucoup de travaux de recherche. Il y a certainement des effets. Cependant, on ne peut pas avoir une lecture aussi mécaniste. Durant les périodes de récession, comme celle des années 30, nous avons assisté aux plus grandes conquêtes des travailleurs sous le Front Populaire en 1936. Alors que le contexte économique était moribond. Il est clair que les mesures proposées par les syndicats peuvent paraître plus crédibles en temps prospères pour les salariés. En même temps, le rôle des syndicats est aussi primordial durant les récessions pour éviter trop de mise en concurrence entre les salariés du fait de l’absence d’augmentation des salaires et du chômage, ou pour dénoncer l’écart entre les revenus du capital et ceux du travail. Donc les changements de conjonctures forcent les syndicats à s’adapter, sans pour autant ôter la pertinence de leur présence quel que soit le climat économique.
LVSL – Vous avez montré que la succession des lois El Khomri, Rebsamen et des ordonnances Macron ont permis le contournement des syndicats, par exemple via l’utilisation du référendum d’entreprise. Ne pensez-vous pas que la condition sine qua non d’une reprise de l’activité syndicale est fondée sur la capacité de l’État à accorder à ces mêmes corps intermédiaires plus de marges de manœuvre ?
SB – Oui, il faudrait complètement inverser la logique et créer de nouveaux droits pour consolider la représentation syndicale au lieu de l’affaiblir. Je pense qu’une possibilité de se développer pour les syndicats est avant tout liée au fait de reconnaître l’appartenance à un syndicat comme un droit, un acte de citoyenneté. Qu’il n’y ait pas de politique de discrimination ou de répression à l’encontre des salariés parce qu’ils sont syndiqués et que de telles pratiques fassent l’objet de plus fortes sanctions.

Deuxièmement, il faudrait créer des droits de représentation dans les Petites et Moyennes Entreprises (PME) de moins de onze salariés : donner des heures de délégation à des représentants pour faire tout un travail de recueil de mise en commun des expériences de travail et des problèmes, de mise en forme des revendications.
Troisièmement, créer des droits interprofessionnels, pas seulement entreprise par entreprise mais sur un territoire, de manière transversale. Ces droits permettraient de développer l’action syndicale dans certains secteurs d’activités très précarisés, par exemple dans l’aide à domicile ou la grande distribution où il est très difficile de construire dans le temps des implantations syndicales.
Bien d’autres droits seraient à renforcer ou à créer, en particulier pour agir sur les questions de santé au travail qui ont été affaiblies avec la disparition des Comités d’Hygiène, de Santé et de Conditions de Travail (CHSCT) et leur fusion dans les CSE (Comité Social Economique). Les CHSCT ont constitué auparavant des institutions importantes pour les syndicats qui pouvaient demander des enquêtes et expertises sur des enjeux liés à la sécurité et à la santé des travailleurs et mener des actions en justice. On voit aujourd’hui l’importance que cela revêt lorsque des directions imposent des accords de façon quasi unilatérale pour maintenir l’activité économique malgré la crise sanitaire. Ces exemples sont autant de droits qui pourraient aider au renforcement des syndicats.
LVSL – Vous relevez dans vos analyses l’importance pour les syndicats de se restructurer pour s’adapter aux nouvelles formes du marché du travail (passage du secondaire au tertiaire, explosion des contrats courts, etc.). Ne pensez-vous pas que la multiplication des CDD et la mobilité des travailleurs dans le marché du travail, compromettent la restructuration nécessaire des syndicats ?
SB – La multiplication des formes d’emplois précaires, comme les stages, les intérims, les emplois à temps partiels ou les CDD, complique beaucoup la tâche des syndicats. Il devient très compliqué de se syndiquer lorsque les individus ne peuvent pas se projeter dans un emploi. Ces formes précaires fragilisent l’assise des syndicats. Le défi pour eux consiste à atteindre ces travailleurs précaires en leur montrant que l’action collective paye. Et ils le font déjà dans certains secteurs – l’aide à domicile, les livreurs à vélo, les centres d’appel – sans pour autant être uniquement sur une démarche de récolte d’adhésions, mais en cherchant avant tout à construire des collectifs de travailleurs.
LVSL – Le statut d’auto-entrepreneur de plus en plus en vogue dans l’économie tertiarisée (Uber en est l’emblème) est une situation très précaire. En effet, l’employé ne peut jouir de droits sociaux du fait de l’absence de contrat de travail. Pensez-vous que la généralisation de telles pratiques pourrait rendre caduque l’existence même des syndicats à long terme ?
SB – La visée du statut d’auto-entrepreneur est de sortir les travailleurs du salariat pour qu’ils se pensent comme autonomes, maîtres de leur propre destin. C’est une illusion. Toutes les actions des chauffeurs Uber, des livreurs à vélo, montrent au contraire la nécessité de l’action syndicale. Ils réactivent et réinventent l’action syndicale car ils se sont organisés et ont mené des grèves et des actions devant les tribunaux pour mettre en évidence la réalité de la subordination. Les luttes menées dans ce type de secteurs contribuent à réinventer l’action syndicale sur des revendications très concrètes pour faire face à des formes de surexploitation. Ce sont des luttes très importantes dans le renouvellement du syndicalisme.
LVSL – Est-il encore nécessaire de nos jours de recourir au dialogue avec les partenaires sociaux ? Le gouvernement semble s’en être très bien passé avec la réforme des retraites. Les syndicats n’apparaissent-ils pas alors comme les cautions d’un jeu pipé ?
SB – Oui, complètement. Derrière la référence au dialogue social on peut mettre des choses très différentes. Les gouvernements, eux, ont tendance à y mettre des syndicats subordonnés qu’ils dénomment des « partenaires sociaux ». Cela implique pourtant une réalité très éloignée du terme : les concertations n’ont plus grand sens car les décisions sont prises en amont. Il n’y a donc plus de place pour la discussion, le mandat d’Emmanuel Macron le montre. Quand il n’y a pas de reconnaissance de l’interlocuteur, on ne peut pas parler de dialogue social.
Ainsi, l’expression apparaît aujourd’hui très galvaudée car elle a été complètement vidée de son sens. De ce fait, beaucoup de militants et syndiqués ne veulent pas entendre parler de ce terme. Elle est associée à des pratiques, qui, sous couvert de dialogue social, permettent de refuser la négociation. Bien entendu, il y a d’autres conceptions du dialogue social, je donne seulement celle qui est mise en pratique par les pouvoirs en place.
« Derrière la référence au dialogue social on peut mettre des choses très différentes. Les gouvernements, eux, ont tendance à y mettre des syndicats subordonnés. »
LVSL – Les gilets jaunes ont-ils court-circuité le syndicalisme ?
SB – Ce mouvement n’est clairement pas un court-circuitage du syndicalisme, il correspond plutôt à la mise en action d’autres composantes du monde du travail qui ne sont pas ou peu organisées par des syndicats. Le mouvement des gilets jaunes est majoritairement composé de travailleurs dans les Petites et Moyennes Entreprises, d’auto-entrepreneurs, de professions intermédiaires comme les infirmières libérales ou les aides-soignantes, d’indépendants. Ils habitent principalement dans des zones périurbaines et rurales, il comprend beaucoup de femmes. Les gilets jaunes font donc figure d’une partie du monde du travail éloignée du syndicalisme.
Je pense en conséquence qu’il faut voir un rôle complémentaire entre ce nouveau mouvement et les syndicats, des convergences ont d’ailleurs été construites dans plusieurs lieux. Les gilets jaunes permettent ainsi d’interpeller le mouvement syndical sur les limites de ses implantations et ses capacités à porter la voix de l’ensemble du monde du travail.