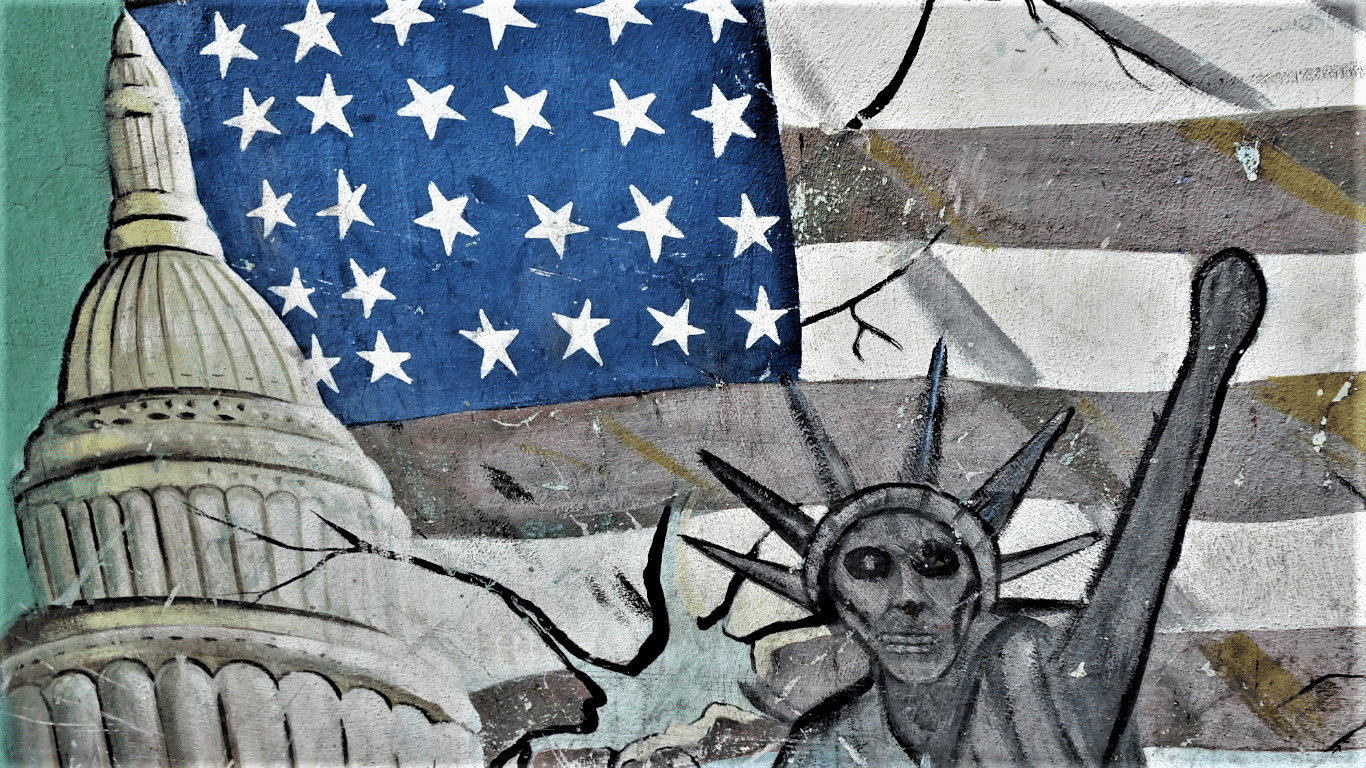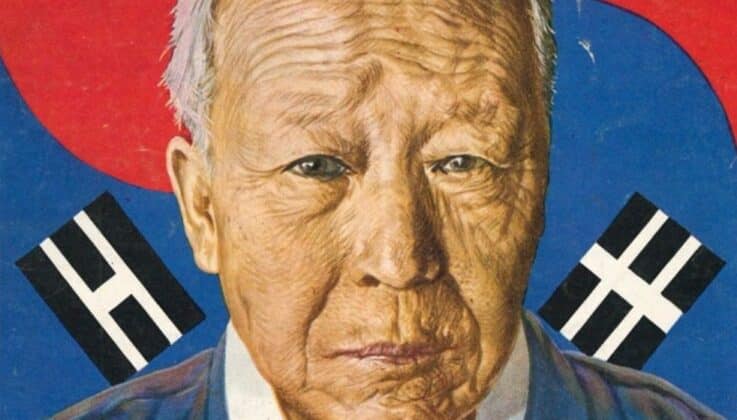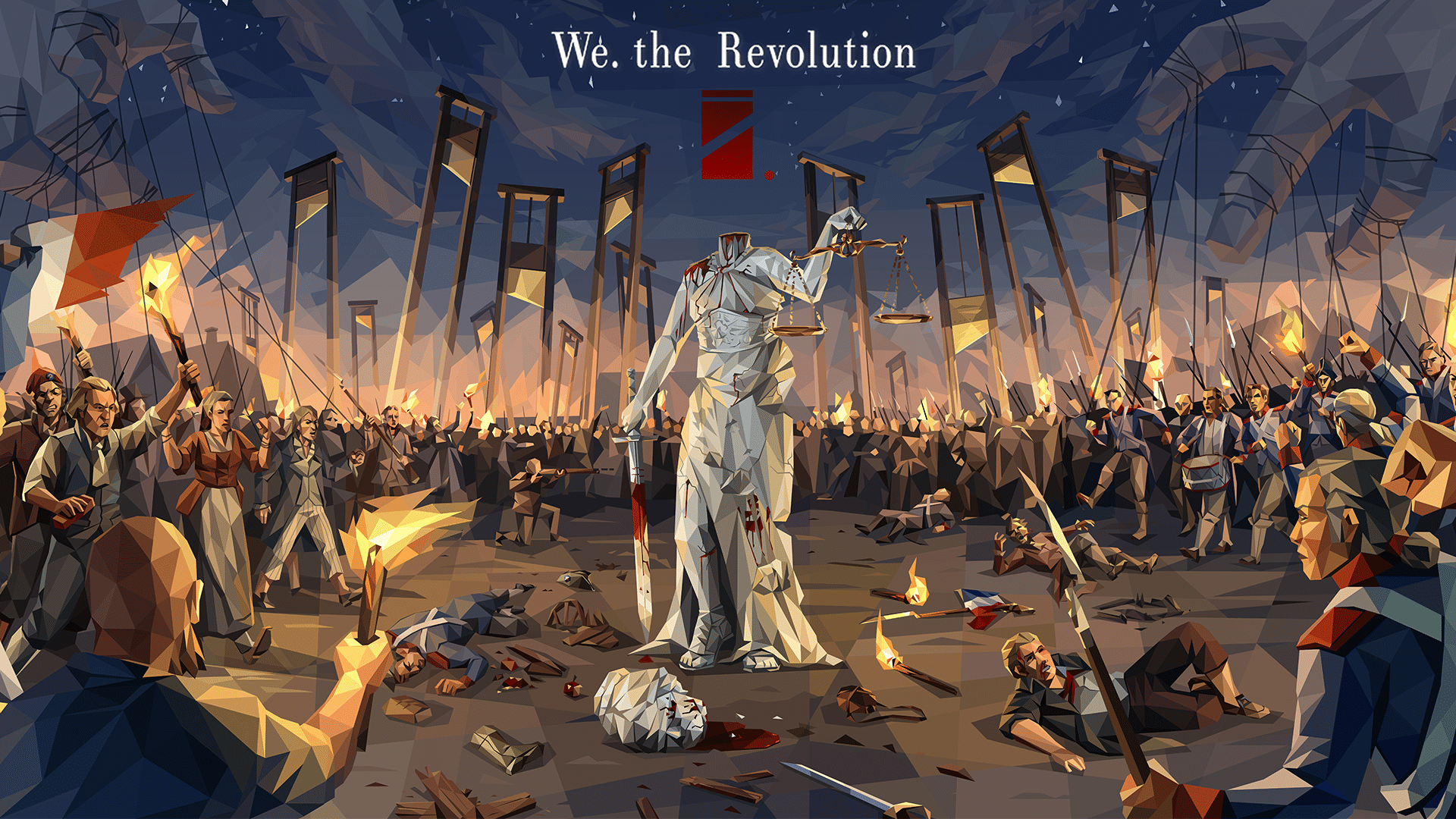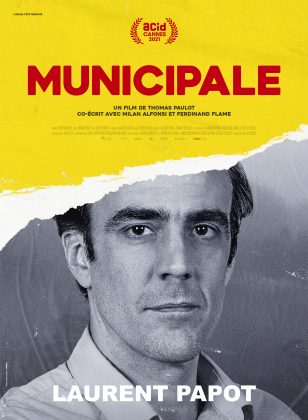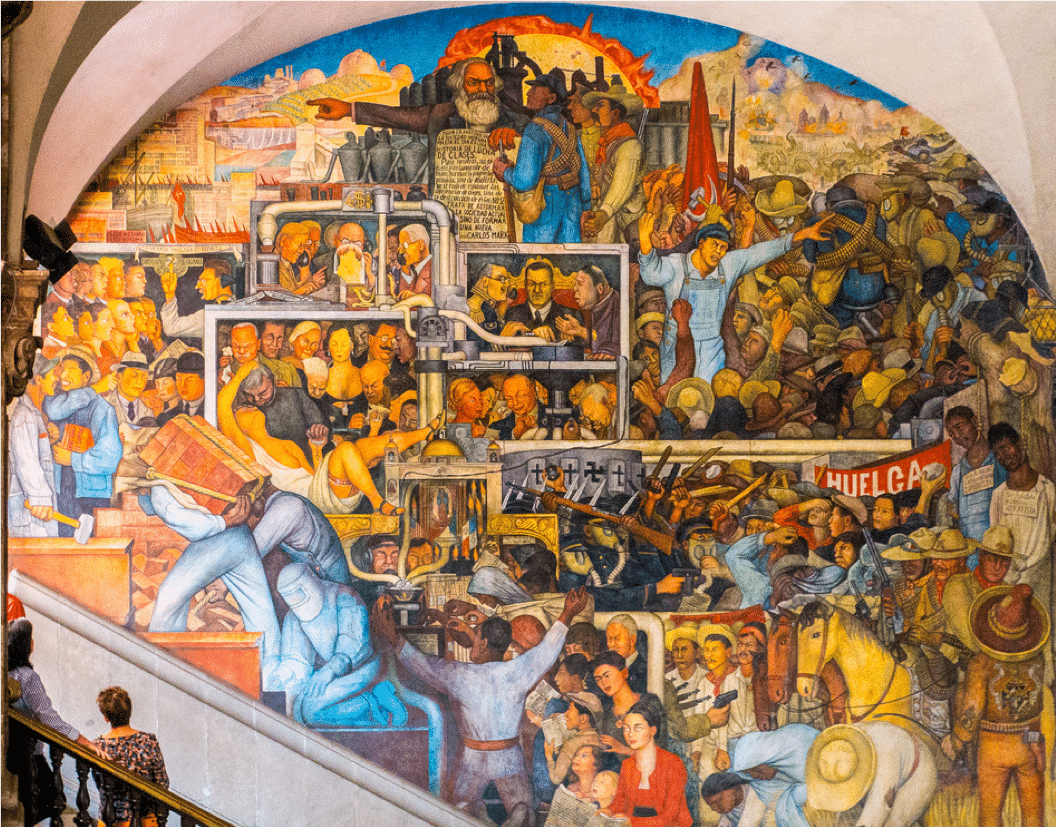Julie Gaucher est docteure en littérature française et chercheuse en histoire du sport à l’Université Lyon 1 (Laboratoire sur les vulnérabilités et l’innovation dans le sport). Elle propose des chroniques littéraires pour le blog « Écrire le sport », afin de donner de la visibilité à la littérature à thématique sportive. L’historienne a publié deux essais sur le sport, L’Écriture de la sportive. Identité du personnage littéraire chez Paul Morand et Henry de Montherlant (L’Harmattan, 2005), et Ballon rond et héros modernes. Quand la littérature s’intéresse à la masculinité des terrains de football (Peter Lang, 2016). Nous la rencontrons suite à la parution de son nouvel ouvrage De La « Femme de sport » à la sportive. Une anthologie (Éditions du Volcan, juin 2019), pour interroger les rapports de la littérature à la pratique sportive féminine dans l’histoire contemporaine. Entretien réalisé par Arthur Defond et François Robinet.
LVSL – Vous avez publié en juin dernier votre ouvrage De La « Femme de sport » à la sportive – Une anthologie, un recueil de textes que vous analysez et mettez en lien pour retracer l’histoire du sport féminin. Le titre interroge quant au choix du vocabulaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par « femme de sport » ou sportswoman, et par « sportive », ainsi que le passage de l’une à l’autre comme le suggère votre ouvrage ? Pour montrer cette évolution, vous passez par une sélection de textes ; comment avez-vous constitué cette anthologie ?
Julie Gaucher — L’expression « femme de sport » est empruntée au baron de Vaux qui trace les portraits de ces femmes au XIXe siècle. C’est une période où la pratique sportive émerge en dehors des fédérations, qui n’existent pas encore, et en dehors des compétitions (bien qu’il existe des concours informels). Les sportswomen sont des aristocrates qui investissent la pratique dans une logique de classe et non de performance. Leur pratique tient de l’activité mondaine passant par l’équitation, le tir à l’arc ou encore la chasse à courre, qu’elles pratiquent avec les hommes. On est dans une logique touche-à-tout, distractive et élitiste. La sportive n’apparaît que pendant la Première Guerre mondiale via la création de fédérations sportives féminines.
C’est ainsi qu’en 1904, Boulenger peut dire des femmes qu’elles ne sont « pas encore sportives ». Mais des figures émergent, notamment de nageuses avec de premiers clubs (L’Ondine de Lyon et L’Ondine de Paris, 1906), et des traversées de grandes villes à la nage. Les sportives sont aussi présentes dans les domaines de l’équitation et du tennis. Avec la natation, le sport s’ouvre à une plus grande diversité de pratiquantes, notamment en terme de classes sociales comme le développe la thèse d’Anne Velez : Les filles de l’eau. Une histoire des femmes et de la natation en France (1905-1939), soutenue en 2010.
En ce qui concerne le choix des textes, il découle de mon parcours universitaire. J’ai commencé mes études en suivant un double cursus : lettres et STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives). En maîtrise, je me suis intéressée à la figure de la sportive dans la littérature, sujet que j’ai continué à approfondir dans ma thèse soutenue en 2008. J’ai appliqué une approche genrée de la littérature. Le jour de la soutenance, on m’a proposé de mettre en valeur ce « trésor » littéraire, ce que je fais une dizaine d’années plus tard. Une anthologie est forcément une sélection avec ses partis-pris, mais la démarche est celle d’une chercheuse. J’ai retenu les textes les plus importants, les plus significatifs, mais aussi les moins connus, ceux pourtant essentiels qui ne sont plus accessibles. Cette sélection n’a pu se faire qu’après de nombreuses lectures et une longue fréquentation du corpus. Il ne faut pas négliger les contraintes au niveau des droits d’auteur pour les extraits les plus récents, même si l’accueil a souvent été bon du côté des auteurs.
LVSL — Au travers de l’anthologie que vous présentez, on peut découvrir deux étapes majeures : d’abord, le personnage de la femme sportive qui devient fréquent dans les poèmes du début du XXe siècle ; puis une légitimation de la sportive dans la littérature des années 1980.
Julie Gaucher — L’histoire du sport a longtemps été écrite à travers les seuls textes des acteurs, des médecins ou des entraîneurs. Pourtant, la littérature est une clef d’entrée pour comprendre l’histoire culturelle, l’histoire des représentations et des imaginaires. Dans mon ouvrage, ces textes sont mis en regard avec d’autres types de discours (notamment médicaux) afin de voir comment ils entrent en écho.
« La littérature est une clef d’entrée pour comprendre l’histoire culturelle, l’histoire des représentations et des imaginaires »
On le sait peu mais le sport a été très présent dans la littérature des années 1920 aux années 1950, avec l’organisation de prix littéraires comme celui de la Fédération française de football présidé un temps par Jean Giraudoux. La recherche, en littérature, de nouvelles figures héroïques s’explique par la lassitude vis-à-vis des figures du dandy décadent ou du soldat (après-guerre, les “gueules cassées” sont une réalité !). Certains écrivains ayant participé à la guerre ont la volonté de réinvestir le corps, cette fois dans la joie de vivre. Ils se mettent donc au sport et veulent en témoigner dans la littérature : un nouveau modèle de héros littéraire apparaît, le sportif. En franchissant les portes des stades, les écrivains remarquent également les sportives, figures qu’ils ne peuvent plus ignorer et dont ils s’emparent dans leurs romans.
Les années 1950 sont un tournant avec l’essor de la radio puis de la télévision : la littérature et la presse ne sont plus l’usine à rêve qu’elles étaient, et le domaine du sport est investi par l’image. En même temps, dans les années 1970, la pensée marxisante envisage le sport comme un opium du peuple, ce qui entraîne un désintérêt pour les choses du corps. C’est Guy Lagorce qui ouvre une nouvelle voie avec Les Héroïques (1979, Prix Goncourt de la nouvelle).
Les sportives sont une réalité sociale dès les années 1920. Certaines militantes luttent pour que les femmes trouvent leur place dans le domaine sportif, à l’exemple d’Alice Milliat, et elles doivent faire face à de nombreuses résistances (comme en témoignent les textes de l’anthologie). Dans les années 1980 au contraire, la place de la sportive sur le terrain de sport n’est plus contestée, même si cela est plus difficile dans certaines activités comme la boxe ou la perche. Pour autant, le combat n’est pas fini, notamment au regard des médias : il y a toujours une sous-représentation du sport féminin, une érotisation des corps, le discours journalistique survalorisant la beauté plutôt que la performance, et une minorité de femmes dans les instances dirigeantes.
LVSL — On voit au sein des textes que la question de la féminité est centrale, en lien avec la représentation du corps qu’il soit érotisé ou dominé par les questions de mode vestimentaire. De plus, il y a semble-t-il une tension entre la femme sportive masculinisée et la femme sportive érotisée.
Julie Gaucher — On retrouve cette dualité chez Montherlant dans Le Songe (1922), avec un idéal de l’androgyne. Sa sportive, qui excelle dans l’« ordre du corps », ne doit pas tomber dans « l’ordre de la chair » : athlète, elle est une figure androgyne d’excellence ; en devenant amante, elle est moquée, ridiculisée. La perspective est pour le moins misogyne, mais quoi de plus étonnant de la part de l’auteur des Jeunes filles (1936) et des Lépreuses (1939) ? Cependant, il est essentiel de passer par ces textes pour comprendre comment les choses se construisent, en mêlant une approche militante à une méthode scientifique.
On retrouve également un jeu des auteurs, voire une critique, avec par exemple l’abbé Grimaud qui va jusqu’à comparer les sportives à des prostituées, parce que les corps sont donnés à voir comme ils ne l’ont jamais été. Un corps de femme doit être caché, masqué. Si les sportives doivent faire des compétitions, il faut savoir dans quelles tenues et devant qui. C’est inconcevable qu’elles exercent devant un public, puisque la nudité doit être réservée à l’alcôve, à l’intimité, et donc au mari. Aujourd’hui, cela va être repris de façon ludique ou amusée par des auteurs qui vont jouer sur cette forme de sensualité avec la transpiration et l’effort qui peuvent rappeler un rapport sexuel.

LVSL — L’inégalité entre les femmes et les hommes devant le sport transparaît notamment dans votre ouvrage au travers des recommandations du corps médical et des manuels de bonne conduite, ces derniers étant souvent publiés par des femmes aux XIXe et XXe siècle. Tandis que les mouvements féministes émergents ne semblent alors jamais revendiquer l’accès au sport, il serait intéressant de comprendre comment la pratique sportive féminine a pu exister par la littérature.
Julie Gaucher — En effet, les acteurs du XIXe et du XXe siècles ont été amenés à réagir face à la pratique sportive des femmes, par laquelle ces dernières échappaient au contrôle masculin. Les premières fédérations sportives, masculines, ont fait un premier choix d’exclure inconditionnellement les femmes, mais se sont vite rendues compte qu’elles parvenaient à s’organiser seules pour pratiquer le sport. En réaction à cette prise de liberté, les fédérations ont alors décidé d’intégrer les femmes, en encadrant leur pratique dans une forme de mise sous tutelle.
Le corps médical permet alors de nouvelles justifications – qui se veulent scientifiques, rationnelles et justifiées par une observation médicale du corps – à la limitation du sport pour les femmes. On retrouve ainsi au XIXe siècle des thèses selon lesquelles l’utérus, à l’origine du mot hystérie, serait baladeur dans le corps des femmes, provoquant des crises d’hystérie en cas de mouvements trop intenses. Le discours médical intervient ainsi pour s’accaparer le corps des femmes et limiter davantage leur rôle social.
Malgré les avertissements, les femmes continuent de manifester leur envie de faire du sport et la pratique finie par être acceptée sous conditions : elle doit être encadrée et modérée, et on doit lui privilégier des activités comme l’éducation physique. De plus, il ne s’agit pas à l’époque d’accepter la recherche de performance, la pratique d’un sport raisonné doit au contraire permettre aux femmes de se forger un « bon corps » de mère.
Les manuels de bonne conduite au XIXe siècle sont écrits notamment par des femmes soi-disant aristocrates, mais qui appartiennent en réalité à la bourgeoisie (comme Blanche-Augustine-Angèle Soyer, qui écrit sous le pseudonyme de « Baronne Staffe » Mes secrets en 1896 ou encore Indications pratiques pour obtenir un brevet de femme chic en 1907), et donnent aux bourgeois qui voudraient gravir l’échelle sociale les codes pour y parvenir. Dès lors, le but est simplement de respecter les codes en vigueur et de vendre des livres : ces autrices ne cherchent pas à les remettre en cause dans une logique qui serait émancipatoire.
LVSL — Comment le combat féministe dans le sport est-il parvenu à s’exprimer à travers la littérature ?
Julie Gaucher — Des sportives vont produire dès le XIXe siècle des écrits dans lesquels elles réclament pour elles-mêmes le droit à la pratique sportive, sans volonté militante ou politique. Leur action en revanche ne doit pas être minorée : elles ont montré, par leur exemple, en dehors de tout discours militant, qu’il était possible pour des femmes de pratiquer le sport. Elles sont en ce sens les premières à avoir fait tomber des barrières.
Les premières militantes du sport féminin ne sont en outre pas des écrivaines. J’ai accordé une place à Alice Milliat en rapportant une interview de 1927. Actrice majeure qui a œuvré pour la reconnaissance de la pratique sportive féminine, elle a aussi dirigé la première fédération féminine française (Fédération des sociétés féminines sportives de France, créée en 1917). Tandis qu’au début du XXe siècle, Pierre de Coubertin refuse que les femmes participent aux Jeux olympiques, cette dernière va alors créer la Fédération sportive féminine internationale (1921) et organiser des Jeux mondiaux réservés aux femmes, qui continueront d’exister jusqu’en 1934, les portes des stades olympiques s’étant ouvertes aux femmes.
Également, une figure importante de la sportive a pu se détacher dans l’entre-deux guerres avec Violette Morris, qui inspire la littérature et que l’on peut qualifier de sportive transgressive : water-polo, natation, football, courses automobiles – elle aurait subi une mastectomie pour entrer plus facilement dans son cockpit –, lancer de poids et de disques, etc. Elle bat de nombreux records sportifs, y compris masculins. Exclue de la Fédération française sportive féminine pour son homosexualité (elle a notamment entretenu une relation avec Joséphine Baker) et son port du pantalon, elle sera d’ailleurs utilisée en contre-exemple de la sportive par Marie-Thérèse Eyquem.
LVSL — Le sport féminin semble aujourd’hui se démocratiser sur le petit écran, avec notamment la coupe du monde féminine de football en 2019. L’Insee pointait pourtant en 2015 une inégalité persistante tant dans la pratique sportive entre femmes et hommes que dans le choix des sports, où l’on observe que les femmes restent très minoritaires dans les sports collectifs alors qu’elles dominent par exemple en gymnastique. Quel rôle peut encore jouer la littérature au XXIe siècle pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’accès au sport ?
Julie Gaucher — Effectivement, le sport féminin devient de plus en plus accessible, à la télévision notamment. Une place est donnée aux sportives, mais il faut savoir comment on en parle. En juin 2019, au JT de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, on pouvait voir un reportage sur les footballeuses qui « tricotent sur le gazon » et qui « caressent la balle avec douceur »…
Concernant la pratique du sport par les femmes, on retrouve en effet un écart qui demeure, avec 50% des femmes de 16 à 24 ans qui ont déjà pratiqué une activité sportive, contre 63% des jeunes hommes. La progression peut passer par les supports comme la télévision, en montrant par exemple des joueuses de football, parce que si on ne les montre pas, ça ne viendra pas à l’idée des petites filles d’aller pratiquer le foot. Il faut savoir quelle figure d’excellence on donne à voir aux enfants.
« Ce n’est pas en donnant uniquement des modèles de princesses aux petites filles qu’on les amènera vers l’action, la conquête, la performance, voire l’épanouissement »
Dans ce sens, on observe une véritable rénovation de la littérature jeunesse avec des éditeurs comme Talents Hauts (il y en a d’autres) qui montrent justement que d’autres modèles de genre sont possibles, et que les petites filles ne sont pas nécessairement les princesses qui vont attendre le prince charmant mais qu’elles peuvent aussi être du côté de l’action. Je chronique d’ailleurs des ouvrages pour le blog « Écrire le sport » (que vous pouvez trouver sur Twitter), dont certains en littérature jeunesse. J’essaie par là de donner de la visibilité à ces textes, que j’aime faire découvrir à des parents ou à des enseignants.
En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train d’émerger. Pour changer ce qui se passe aujourd’hui dans les terrains de sport, il faut faire évoluer la mentalité des enfants et donc également faire de l’éducation auprès des parents. En effet, il faut se rendre compte que ce n’est pas en donnant uniquement des modèles de princesses aux petites filles qu’on les amènera vers l’action, la conquête, la performance, voire l’épanouissement. Si elles peuvent bien sûr pratiquer la danse ou la gymnastique, il faut que ce soit un vrai choix et pas la seule activité qui leur soit accessible.
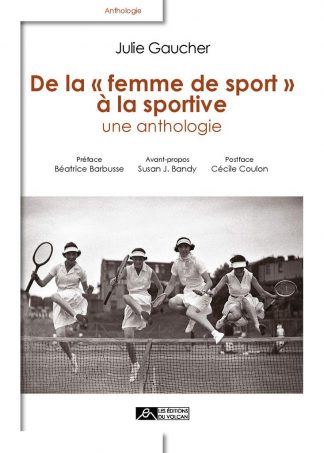
Julie Gaucher, De la « femme de sport » à la sportive. Une anthologie
Le Crest, Les Éditions du Volcan, 2019, 400 pages, 23,50 €
Voir sur le site de la maison d’édition.