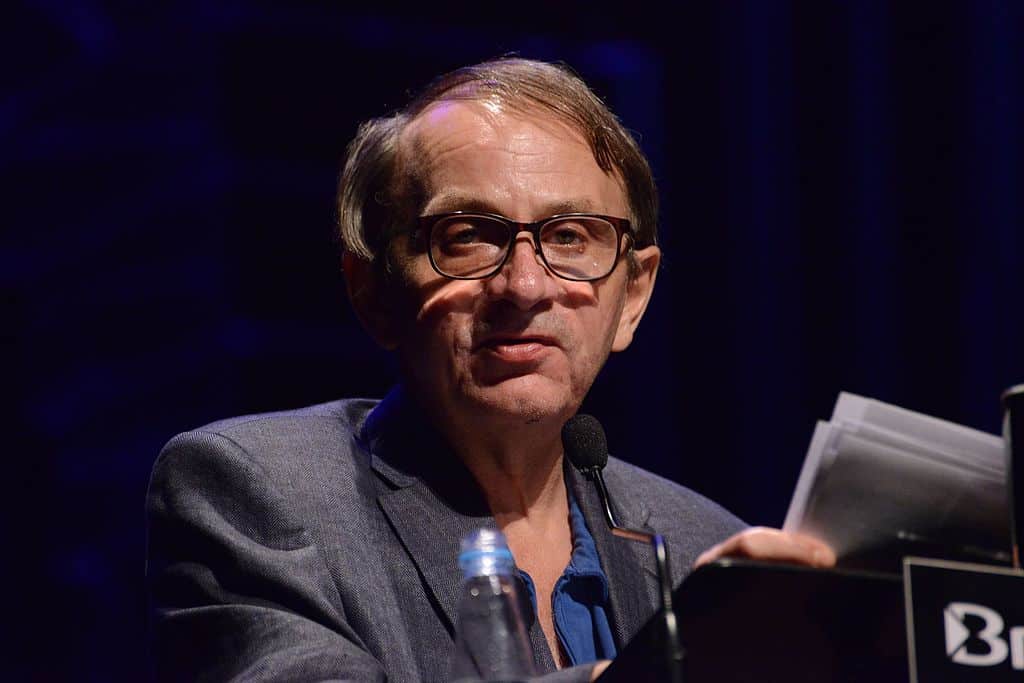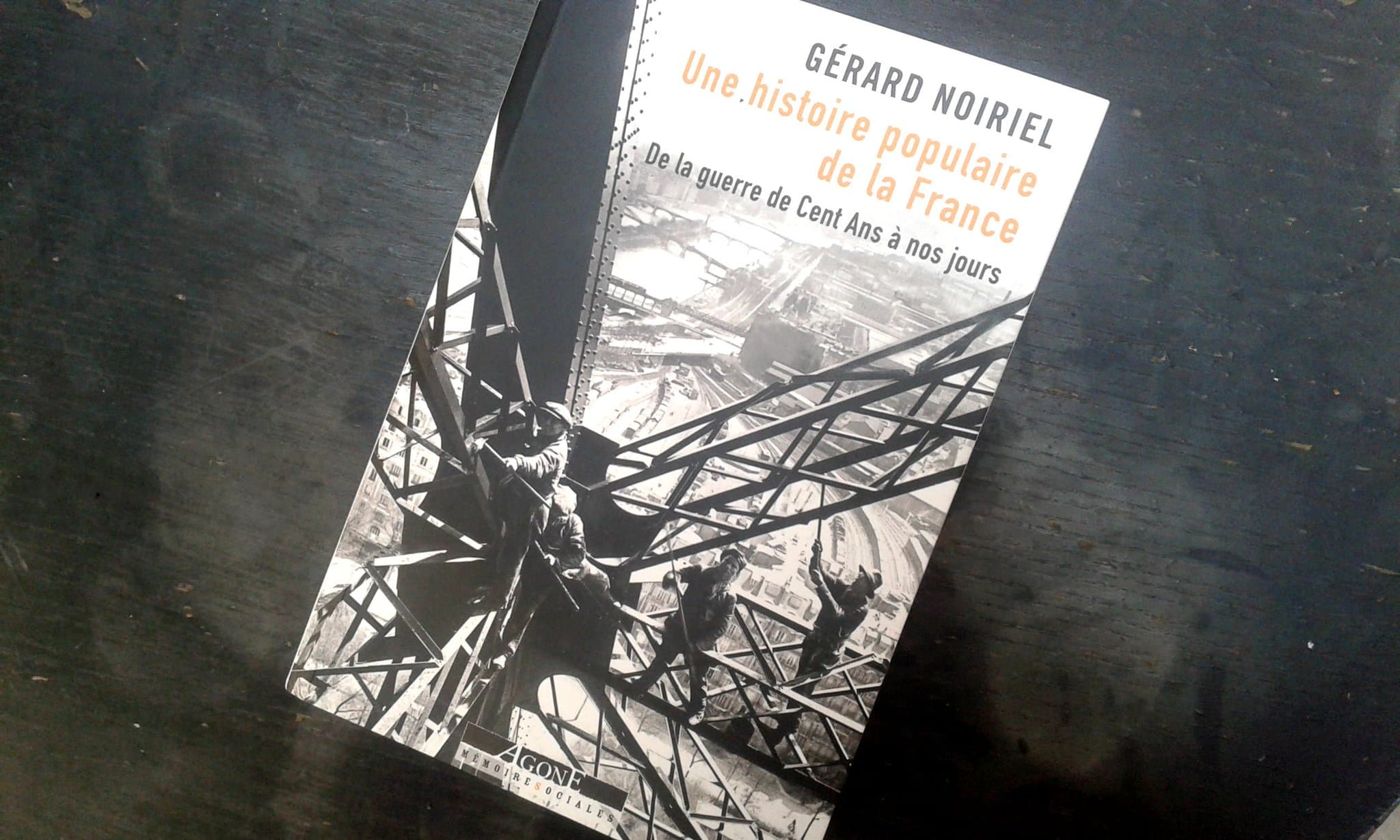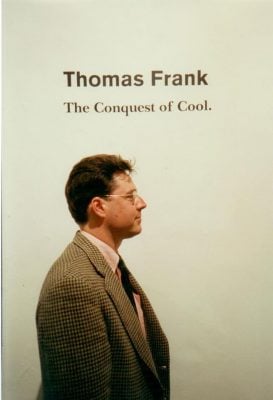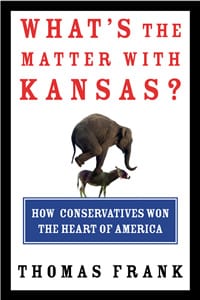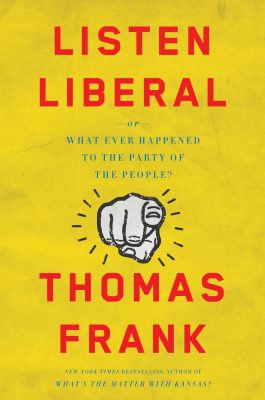Spécialiste des gauches dans les pays germanophones et en France, des marxismes et de la Révolution française, Jean-Numa Ducange est maître de conférences à l’Université de Rouen. Auteur de Jules Guesde, l’anti Jaurès ?, il présente la biographie d’un homme passé aujourd’hui au second plan. Nous sommes revenus avec lui sur des figures marquantes de gauche, l’héritage du marxisme ainsi que sa perception des gilets jaunes en tant qu’historien.
LVSL – Vos travaux mettent en avant la figure de Jules Guesde. Pouvez-vous revenir sur son itinéraire, les controverses autour de sa personne notamment sa position pendant l’affaire Dreyfus ?
Jean-Numa Ducange – Jules Guesde est un des principaux représentants du socialisme français à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. C’est l’autre figure qui, après Jean Jaurès, a beaucoup compté dans la création du Parti socialiste en 1905. Le fait qu’il ait introduit le marxisme par le biais de contacts tant personnels que directs en France le distingue des autres membres du parti.
Ce n’est pas un théoricien, ce n’est pas quelqu’un qui a une pensée stratégique et politique très élaborée. Par contre, il a pris son bâton de pèlerin et a parcouru les quatre coins de la France pour expliquer ce qu’est la lutte des classes, la plus-value, le tout en quelques mots simples et accessibles à un large public de travailleurs. Il a introduit le socialisme dans un certain nombre de lieux, notamment dans le Nord où il demeurera longtemps très influent et deviendra député.
Pour comprendre la longue tradition du socialisme et même du communisme dans le Nord (une des régions parmi les plus denses en termes de militants de gauche), il faut avoir en tête cette figure de Jules Guesde. Parmi les points qui sont importants, soulignons que dans les années 1860, Jules Guesde est un républicain. Au moment de la Commune de Paris en 1871, il n’est pas encore socialiste ; il est alors journaliste à Montpellier et prend parti pour la Commune. C’est important car il passera plusieurs séjours en prison du fait de ce soutien (et pour toute une série de prises de position ensuite). En ce sens, il est différent d’autres dirigeants socialistes comme Jean Jaurès qui ont une carrière plus « lisse » dans le cadre de la République.
“Guesde est le représentant d’une forme d’intransigeance.”
Il est essentiel de rappeler cela car Guesde est quelqu’un qui entretient un rapport conflictuel avec l’État. Cela explique pour partie le fait qu’il se retrouve davantage dans l’idéologie marxiste. Il est également passé par l’anarchisme. Guesde est le représentant d’une forme d’intransigeance. Cela n’est pas connoté négativement : c’est quelqu’un qui représente l’aile gauche du mouvement socialiste, influencée par le marxisme.
Il joue aussi un rôle important au moment de l’affaire Dreyfus. Il n’est pas resté positivement dans l’histoire de la gauche : contrairement à Jean Jaurès il n’a finalement pas pris part à la défense du capitaine Dreyfus. Pour rappel, le capitaine Dreyfus est condamné pour des raisons liées au fait qu’il soit juif, ce qui est lié à l’antisémitisme très fort dans la France du XIXème siècle.
Initialement, les socialistes ne se mobilisent pas plus que les autres. Seulement, certains socialistes vont finir par prendre position pour défendre Dreyfus en tant qu’homme, en tant qu’individu, au-delà des classes sociales. Jules Guesde et quelques autres voient cela d’un œil négatif. Cependant, Jules Guesde n’est pas antisémite, même s’il est incontestable que dans les milieux socialistes et plus largement de gauche de l’époque, il y a des réflexes et des propos antisémites. Cela se décèle notamment quand on regarde la presse locale.
Mais si Guesde prend parti contre la défense de Dreyfus, c’est parce qu’il pense que le socialisme doit rester un socialisme de classes, un socialisme indépendant du monde bourgeois et de l’État. Pour pouvoir conserver cette indépendance, il ne faut pas se mêler à la défense d’un militaire. Ce sont ces militaires qui fusillent les ouvriers, ceux sont eux qui tirent dans les manifestations ; pour eux, il est inconcevable de le défendre. Cela ne justifie pas tout mais cela permet de comprendre. Je le disais auparavant, Guesde avait été marqué par la Commune de Paris et par une certaine hostilité vis-à-vis de l’État. C’est essentiel parce qu’au moins à cette période, d’autres sont davantage intégrés à la République tandis que lui pense qu’il faut s’y opposer frontalement.
Il ne faut pas oublier que Guesde a aussi fait le choix de ne pas défendre Dreyfus pour des raisons d’opportunité politique. La CGT a été créée en 1895. Il y a une sorte de créneau qui consiste à être sur la position suivante : défendre la singularité du mouvement ouvrier qui ne soit pas uniquement républicain (et pas uniquement « de gauche », car être « de gauche » cela revient à se situer sur l’arc républicain, ce que refuse justement une partie du mouvement ouvrier).
“On ne peut pas dissocier l’histoire de la gauche et celle du socialisme de la figure de Guesde.”
Cela ne lui permettra pas de remporter la victoire au sein du mouvement socialiste, mais lui y donnera néanmoins une place assez importante. Ensuite, alors que l’affaire Dreyfus sera sur le point de se terminer, il deviendra après Jean Jaurès le deuxième personnage du socialisme. Il faut savoir que dans un premier temps, lorsque le Parti socialiste est crée en 1905, les formules employées par le parti sont plutôt marxistes et marquées par la lutte des classes, plus que d’autres partis sociaux-démocrates européens. Cela montre l’empreinte de Guesde. Mais en même temps, Jaurès essaye d’effectuer une synthèse entre socialisme, républicanisme et marxisme et va prendre à terme plus d’importance par rapport à Guesde.
Dans tous les cas, on ne peut pas dissocier l’histoire de la gauche et celle du socialisme de la figure de Guesde : c’est quelqu’un de connu et populaire, même s’il est très critiqué par d’autres. Il se trouve qu’il ne va pas être assassiné le 31 juillet 1914 et qu’il va en plus être ministre de l’Union sacrée en août 1914. Cela ne va pas favoriser sa bonne réputation auprès de certains, notamment auprès de ceux qui deviendront communistes. Au congrès de Tours en 1920, vieillissant et malade, il va faire le choix de rester, comme le dit Léon Blum, « à la vieille maison », au Parti socialiste et ne pas rejoindre ceux qui sont au Parti communiste.
Parmi les partisans de Guesde, certains iront du côté socialiste, d’autres du côté communiste. Il va être de ce fait une des sources du communisme et du socialisme. On peut dire que grâce à lui, le marxisme a eu une première influence politique en France. Il ne s’agit pas d’une influence intellectuelle, car je le rappelle, il n’est pas théoricien. Il a cependant contribué à greffer ce qui constituait une idéologie étrangère, en provenance d’Allemagne, sur le terreau du socialisme français.
LVSL – Cela fait cette année un siècle que Rosa Luxemburg a été assassinée avec son camarade Karl Liebknecht. Pourriez-vous revenir sur la doctrine, la conception qu’avait Luxemburg de la révolution et l’héritage qu’elle a laissé derrière elle ?
Jean-Numa Ducange – Il est au préalable important de préciser que Rosa Luxemburg est une femme, juive polonaise, qui a fait le choix d’être naturalisée allemande à la toute fin du XIXème siècle. Elle pensait que l’avenir du socialisme se jouait à l’époque en Allemagne. C’est là qu’il y avait le parti socialiste le plus puissant d’Europe. L’Allemagne était devenue depuis Bismarck le premier pays industrialisé du continent, entraînant un grand nombre d’ouvriers, de grandes concentrations industrielles.

Le parti politique qu’était la social-démocratie allemande était fondamentalement, tant idéologiquement qu’en terme d’implantation, le plus puissant. C’est pour cela que Rosa Luxemburg fait le choix de se battre en son sein. Une des premières grandes controverses qu’elle mène concerne la question de la révolution. Elle va rapidement incarner l’aile gauche de la social-démocratie allemande. C’est une incarnation paradoxale. Ce n’est pas quelqu’un qui vient d’Allemagne, mais elle va trouver sur son chemin d’autres représentants de l’aile gauche comme Clara Zetkin ou Karl Liebknecht.
Ces personnes-là vont travailler avec elle. Elle va contribuer à maintenir l’idée que même s’il y a des changements dans le système capitaliste, même si le niveau de vie des ouvriers augmente, la rupture révolutionnaire reste nécessaire. Où ? Quand ? Comment ? Cela se discute mais il ne s’agit pas pour elle d’adopter une réforme graduelle. Là est l’enjeu de sa controverse avec Bernstein.
On peut noter deux autres grands moments dans sa vie. Tout d’abord, 1905 : la date de la première révolution russe. C’est l’époque à laquelle, à la suite des mouvements, elle écrit une brochure intitulée Grève de masse, parti et syndicat. Dedans, elle avance notamment l’idée que tout en restant dans le parti social-démocrate et dans les syndicats qui lui sont liés, pour en quelque sorte « régénérer » le parti qui a tendance à s’enfermer dans une routine bureaucratique, à s’intégrer aux institutions, il est nécessaire de faire intervenir ce qu’elle appelle la « grève de masse ». La « grève de masse », ce n’est pas la « grève générale ». Elle n’emploie pas le terme de grève générale parce que ce sont les syndicalistes révolutionnaires français qui l’emploient et Luxemburg est pour maintenir le lien entre le syndicat et le parti, ce que refuse la CGT en France.
La grève de masse, c’est l’idée selon laquelle, en lien avec les syndicats ou dans les syndicats, à l’extérieur des partis ou dans les partis, les masses doivent être en mouvement, se mobiliser régulièrement pour régénérer les organisations. C’est quelque chose de primordial qui la distingue d’autres sociaux-démocrates de son époque. L’autre question qui est importante pour elle et qui marque beaucoup sa conception de la rupture révolutionnaire, c’est la conception de la nation.
Elle défend un internationalisme intransigeant, qui ne veut absolument pas jouer la carte de l’intégration à la nation du socialisme (comme le fait Jean Jaurès en France). Il y a des polémiques très fortes avec Jean Jaurès sur cette question. Ce rejet du patriotisme la distingue des autres. Le troisième moment qui pourrait être retenu dans sa vie (et qui est le dernier étant donné qu’elle s’est faite assassiner en janvier 1919), c’est sa controverse, ses positions par rapport aux bolcheviks et à la révolution russe.
Il est admis que Rosa Luxemburg a été une révolutionnaire de premier plan et qu’elle a beaucoup compté sur l’action de masses pour faire la révolution. Elle a compté sur les conseils ouvriers, une forme de démocratie par en bas apparue une première fois pendant la révolution de 1905 et qui a resurgi en Allemagne, en Russie, et dans quelques autres pays en 1918. En même temps, ce n’était pas une activiste dans le mauvais sens du terme puisqu’elle s’est ralliée à l’insurrection qui lui a coûté sa vie parce que la majorité de ses camarades en avait décidé ainsi. Elle la trouvait pourtant prématurée, et jugeait dangereux de s’y engager. Elle avait bien mesuré la situation.
Peu avant son décès, un débat important fût sa controverse avec les bolcheviks, qui pourrait être résumée en trois points (à noter que le texte qu’elle a écrit sur la révolution russe a été publié après sa mort, elle n’a pas rendu ses critiques publiques). La première chose avec laquelle elle est en désaccord, c’est l’idée qu’il faut donner la terre aux paysans. Cela peut sembler paradoxal mais elle pensait que tout ce qui consistait à distribuer la propriété à telle ou telle personne, à des petits artisans, à des petits paysans, retarderait l’émergence d’une grande propriété collective.
Le socialisme devait se fonder sur l’extension de la propriété. Elle était donc en désaccord avec Lénine. Elle était en désaccord également pour les raisons déjà évoquées sur la question de la nation et s’oppose au mot d’ordre du droit des nations à disposer d’elles-mêmes. Non pas qu’elle soit contre le fait que les gens disposent d’eux-mêmes, mais s’oppose à l’idée qu’il soit nécessaire de constituer des petits États en Europe centrale et orientale. Pour elle, c’est créer des petits États avec de nouvelles barrières, de nouvelles frontières qui empêcheront les ouvriers de s’unir. Lénine joue quant à lui stratégiquement sur ce droit des nations à disposer d’elles-mêmes pour créer de nouvelles nations et désintégrer les empires de l’époque.
Le dernier point, c’est la question de la liberté, de la démocratie dans le processus révolutionnaire. Dans son texte sur la révolution russe, elle a été extrêmement critique à l’égard des bolcheviks qui ont pris des mesures répressives assez tôt, dès 1917 et 1918, lorsqu’ils arrivent au pouvoir. Elle pense que quelles que soient les difficultés historiques, les circonstances, il doit quoi qu’il arrive y avoir une démocratie à l’intérieur du parti, un droit de s’exprimer librement et puis également un droit – même s’il ne doit pas être unique et complet – à la représentation politique.
Elle ne s’oppose pas à tout parlementarisme, elle a en effet milité avant 1914 à toutes les élections pour le Reichstag en Allemagne, pour que le SPD ait des représentants. Elle pensait aussi que la représentation devait certes passer par les conseils ouvriers, par une démocratie directe sans pour autant être hostile à l’idée qu’il faille combiner différents types de représentation. Cela me paraît important car elle se distingue des sociaux-démocrates modérés réformistes de l’époque et des plus radicaux comme les bolcheviks.
Plusieurs éléments expliquent sa postérité. Quand on est historien, il faut être un minimum honnête sur la façon dont cela se passe après la mort des personnalités de premier plan. Comme Jean Jaurès, elle est morte en martyre, ni l’un ni l’autre n’ont pris le pouvoir : ce sont des personnalités plus facile à s’approprier que ceux qui accèdent au pouvoir. Aussi parce qu’elle était une femme défendant des conceptions politiques qui n’étaient ni trop modérées pour une toute partie de la gauche ni non plus trop directement rattachées au bolchevisme.
Ainsi, lorsqu’il y a eu des critiques du stalinisme et de la social-démocratie, elle est apparue comme une voix alternative tout en ayant été officiellement condamnée par Staline en 1931. Cela explique qu’elle soit apparue comme une figure assez populaire dans les années 1970. C’était quelqu’un de charismatique, avec un grand pouvoir d’attraction. De même que pour Guesde, ces gens étaient d’immenses orateurs. Même si on ne conserve peu ou pas d’enregistrements (surtout pour ceux du XIXème siècle), ils laissent aussi une trace dans les mémoires collectives : les gens qui ont pu les entendre ont transmis de génération en génération la mémoire de leurs combats.
LVSL – Nous venons d’évoquer plusieurs piliers du socialisme allemand et français. Qu’est-ce qui distingue ces deux socialismes et en quoi ont-ils influé sur les trajectoires politiques de leurs pays respectifs ?
Jean-Numa Ducange – Tout dépend d’où on part. Si on part d’aujourd’hui, il apparaît que la tradition allemande de la social-démocratie est une tradition beaucoup plus consensuelle, gestionnaire que la tradition française, dans laquelle il y a eu davantage l’influence pendant longtemps d’un parti socialiste et d’un parti communiste plus radical que la social-démocratie allemande. C’est un paradoxe car le marxisme est initialement né dans la social-démocratie allemande. Pour résumer, comment en est-on arrivé à cette tradition de la cogestion entre syndicat et patronat en Allemagne ?
Avant la Première Guerre mondiale, il y avait une tradition marxiste extrêmement forte dans la social-démocratie allemande. Elle s’est progressivement estompée. Il y a un siècle, lors de la révolution allemande, des choses extrêmement importantes se sont jouées pour la suite de l’Allemagne. Je ne pense pas uniquement à la tragédie qui est celle de 1933 mais plus largement à l’histoire des relations sociales dans ce pays. Juste après la proclamation de la République en 1918, le patronat et le principal syndicat social-démocrate ont signé un accord dans lequel ils s’accordent sur un certain nombre de points. Pour le dire rapidement, c’est l’origine de la cogestion entre patronat et syndicat. En France, le syndicalisme a été plus longtemps réprimé.
Il s’est défini de façon plus radicale et a longtemps voulu garder une certaine distance à l’égard des partis politiques. Quand la CGT a été créée en 1895, elle a été fondée sur une base qu’on va ensuite qualifier de syndicalisme révolutionnaire. D’où vient cette base syndicaliste révolutionnaire ? De façon générale, il y a une tradition révolutionnaire (1789, 1830, 1848, 1871), un long cycle des révolutions, une tradition à la fois plus glorieuse et victorieuse qui fait qu’il y a, au moins dans les mots, une plus grande radicalité dans le socialisme français. Il ne faut pas oublier que les révolutions allemandes ont échoué : 1848 a été un échec qui a pesé durablement.
Cela compte également en France mais demeure dans les mémoires de manière plus tragique en Allemagne encore car cette révolution n’a pas permis d’unifier le pays. En 1919, c’est une révolution qui s’est aussi mal terminée avec l’assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Si on pense sur le long terme, ces assassinats ont créé une fracture au sein de la gauche qui a contribué à la victoire du nazisme en 1933.
La tradition de consensus, qui vient donc de loin, s’est d’autant plus solidifiée après la Seconde Guerre mondiale pour ce qui est de l’Allemagne, qu’il y a eu l’expérience nazie. L’idée selon laquelle il fallait une grève générale est par exemple devenue impopulaire (et illégale) car cela risquait de déstabiliser le pays. A cela s’ajoute l’Allemagne de l’Est, qui a renforcé l’anticommunisme à l’Ouest. A contrario du côté français, la force de la tradition révolutionnaire se maintient.
Mais il y a autre chose. Le républicanisme tel qu’il est conçu en France, la République consolidée depuis les années 1870 (si on met à part le cas de Vichy), aussi légaliste et étatiste soit-elle au bout d’un moment, tout cet héritage provient d’une révolution. Cela induit que les socialistes ont un double héritage : républicain et révolutionnaire. Ils n’ont aucun mal à assumer le lien entre les deux. Cela induit que même lorsqu’ils sont très républicains, très légalistes, dans leur « logiciel » ils conservent longtemps un grand respect pour la Révolution française : elle demeure présente car c’est une perspective positive, glorieuse et victorieuse.
En Allemagne, la tradition révolutionnaire c’est 1848, 1918. Ce sont des échecs donc il est plus dur de les intégrer. Il y a aussi des raisons sociales et politiques profondes aux différences entre l’Allemagne et la France ; mais le rôle de la tradition révolutionnaire a selon moi joué un grand rôle même s’il ne faut pas caricaturer : ce n’est pas la glorieuse France révolutionnaire face à l’Allemagne bismarckienne et étatiste.
La tradition allemande est également intéressante en termes d’élaboration théorique et d’expériences concrètes (notamment les conseils ouvriers en 1918-1919). Ce sont des chemins différents pour les raisons que j’ai évoquées et qui ne se sont malheureusement pas croisés suffisamment pour empêcher le pire : ni pour empêcher 1914, ni pour empêcher le fascisme. Malgré tout, dans l’imaginaire subsistent des couples franco-allemands comme Jaurès et Bebel. Il y a aussi la social-démocratie à la Willy Brandt, certes modérée, mais beaucoup de militants de gauche trouveraient cela tout à fait acceptable !
LVSL – Dans Marx, une passion française, vous défendez l’idée selon laquelle malgré l’effondrement de l’URSS, du PCF et l’avènement des démocraties libérales, la figure de Marx continue à hanter l’imaginaire français. Comment expliquer cela aujourd’hui ?
Jean-Numa Ducange – La spécificité de la France c’est qu’il y a une longue tradition d’influence du marxisme. Marx a initialement beaucoup été influencé par la France, les socialistes utopiques et la tradition socialiste française avec Fourrier, Proudhon, Saint Simon, etc.
D’une certaine manière, le socialisme français n’avait pas besoin d’aller chercher une référence extérieure pour continuer à se développer. Pourtant l’introduction du marxisme a eu lieu pour plusieurs raisons. D’abord parce que Marx est apparu à certaines grandes figures du socialisme français comme quelqu’un de tout à fait complémentaire au dispositif français (révolution, république, ce qui a été au préalable expliqué).
Prenons l’exemple de Jean Jaurès qui, certes, n’est pas marxiste à la manière de Jules Guesde. C’est un normalien, agrégé, universitaire, qui a un parcours républicain au départ assez classique, et qui se rapproche progressivement du socialisme. Ce qui est intéressant quand il se rapproche du socialisme c’est qu’il trouve des éléments décisifs dans Marx : l’idée de la lutte des classes (à l’échelle historique, il trouve que la lutte des classes est très pertinente pour comprendre la Révolution française par exemple), l’idée qu’il y a un affrontement entre la bourgeoisie, le prolétariat, etc.
Cela explique le fait qu’assez tôt dans le socialisme français, introduire Marx a tout de même été nécessaire pour pouvoir changer l’ordre politique et social. Dès le début, à la fin du XIXe siècle puis quand le parti socialiste se crée en 1905, il y a une influence du marxisme. Cette influence dans le parti socialiste s’installe dans la durée au moins jusqu’aux années 1970, voire 1980. Le parti socialiste est alors marqué par un discours empreint de marxisme, de lutte de classes.
Ensuite, l’autre spécificité de la France qui sera le seul pays dans ce cas-là en Europe de l’Ouest (avec l’Italie) c’est qu’il y aura un Parti communiste extrêmement puissant qui fera une quinzaine de pourcents à partir des années 1930 et qui va ensuite devenir le premier parti de gauche jusque dans les années 1970. Ce Parti communiste français est très marqué par le marxisme. Il s’agit certes d’un marxisme assez fossilisé voire stalinien pendant tout une période. Mais c’est un marxisme qui se voulait également propagandiste, éducateur, avec l’idée que le marxisme était quelque chose que la classe ouvrière et les classes populaires devaient s’approprier pour changer le monde avec toute une série d’écoles de formation, de brochures simples, etc.
Tout cela a été travaillé profondément pendant des dizaines d’années, poursuivant de ce point de vue la tâche que s’était fixée Jules Guesde. Une des raisons qui explique la forte référence à Marx, c’est ce travail politique qui a pendant longtemps été fait par le Parti communiste. Vous allez me dire que le Parti communiste a décliné. Je l’ai remarqué… Il faut voir aussi qu’il existait également toute une extrême gauche assez forte, notamment trotskyste, avec des bataillons militants non négligeables et des intellectuels de premier plan. Il faut souligner que tous ces courants avaient amené le marxisme à un niveau très élevé dans l’espace public dans les années 1970.
Ensuite, le marxisme a presque disparu, spectaculairement dans les années 1980 et 1990, proportionnellement en quelque sorte à l’influence qu’il avait eu auparavant. Puis cela est revenu dans les années 2000. Cela s’explique par plusieurs facteurs. Il y a tout d’abord un substrat qui vient de loin et que je viens d’expliquer : de génération en génération les choses se sont transmises. Il y a eu de nombreuses éditions de Marx, on en trouve, retrouve continuellement. Cela n’a jamais disparu.
Le fait que le modèle soviétique ait maintenant disparu depuis un certain temps joue également. Si beaucoup de gens ne voulaient plus se référer au marxisme c’était à cause du modèle soviétique, qui leur paraissait négatif ; or on peut maintenant lire Marx indépendamment du stalinisme. A cela s’ajoute (ce n’est pas propre à la France) la crise récente du système : après la crise des subprimes de 2008, la possibilité d’une crise profonde du capitalisme a de nouveau été envisagée. Ce regain d’intérêt pour Marx s’est fait presque indépendamment des partis politiques : on a vu des émissions, des journaux de nouveau s’intéresser à Marx. Tout simplement, les gens se sont demandés pourquoi ne pas relire Marx au regard du contexte et l’état du capitalisme.
Même Jacques Attali qui est peu suspect de critique du capitalisme a fait en 2005 une biographie de Marx en disant que Marx était très bien pour analyser le capitalisme mais… surtout pas pour la partie politique. On a là une ambiance, des références qui font qu’il est un peu redevenu « à la mode ». Et dans les courants politiques de gauche, il demeure lu et cité. Ce qui est difficile à estimer (difficulté méthodologique majeure pour les historiens !) c’est que les gens ne lisent pas forcément les textes. La forte présence à la référence sur le long terme est en rapport avec une culture politique marxisante qui a beaucoup essaimé, du travailleur à l’intellectuel, dans différents domaines. La France est un des pays où incontestablement, la référence à Marx a eu et a encore du sens.
Je parlais de crise économique, j’ajouterai la crise de la représentation et des institutions, même si cela est moins facile à connecter directement au marxisme : Marx est quelqu’un qui a vécu cela de son vivant. Il a connu des révolutions, des changements de régime, des aspirations nouvelles via des révolutions. Il trouvait initialement que la Commune de Paris était folklorique, il ne pensait pas que cela pouvait avoir lieu. Puis il a changé d’avis.
“La plupart des textes que Marx a écrits, ses grands textes d’histoire immédiate portent sur la France.”
C’est quelqu’un qui, quand on le relit dans son contexte, réagit en fonction des bouleversements politiques. Sur la politique précisément, notamment sur le poids de la tradition bonapartiste, Marx a écrit des choses qui peuvent continuer à nourrir notre réflexion sur la Vème République et la tradition révolutionnaire française (à propos de laquelle il est parfois très sévère).
Nul hasard à tout cela: la plupart des textes que Marx a écrits, ses grands textes d’histoire immédiate portent sur la France. Il y a un dialogue constant entre la France et Marx. Il s’est beaucoup inspiré de la France pour concevoir sa doctrine et, quand il observe la vie politique européenne, la France a eu à plusieurs reprises un intérêt particulier pour lui. C’est une sorte d’amour-haine qui s’est prolongée durant presque toute sa vie.
LVSL – Certains commentateurs ou personnalités politiques voient dans les gilets jaunes l’émergence d’un processus révolutionnaire. En tant que spécialiste de la révolution française et auteur de nombre de textes sur les révolutions, comment envisagez-vous ce mouvement social ?
Jean-Numa Ducange – Comme le suggère la question, je l’envisage comme un mouvement social en premier lieu. Certes un certain nombre de revendications qui ont émergé peuvent faire penser à d’autres périodes révolutionnaires. On a parfois rapproché les gilets jaunes des sans-culottes ou d’autres catégories populaires qui contestent l’ordre existant à travers un certain nombre de revendications. C’est quelque chose qu’il faut avoir en tête.
“Une révolution quand on en parle avec un minimum de distance, c’est un processus qui a remis en cause l’ordre au sens d’une déstabilisation structurelle, politiquement, économiquement et socialement.”
On peut aussi dire, pour prolonger ce que nous avons déjà souligné que, comme la France est un pays où structurellement il existe une tradition contestataire nourrie de l’expérience révolutionnaire, de différentes idéologies dont le marxisme, il existe un niveau de conflictualité assez fort, structurellement plus fort que dans d’autres pays. Ce mouvement des gilets jaunes en est une expression. Quand il y a des périodes d’accalmie on demande si la France est un pays normalisé, si on va finir par avoir un syndicalisme à l’allemande avec moins de grèves, etc. On voit bien que ce n’est pas le cas.
Cela étant dit, en termes strictes de définition je serai plus prudent. Si on compare le mouvement à la Révolution française ou à d’autres mouvements comme les révolutions russes (ou même à des échecs comme 1848 et je pourrais prendre d’autres révolutions à l’échelle internationale comme la Chine en 1949), je pense qu’il faut faire très attention. Une révolution – quand on en parle avec un minimum de distance – c’est un processus qui a remis en cause l’ordre au sens d’une déstabilisation structurelle, politiquement, économiquement et socialement.
Si on parle de Révolution française, ce n’est pas uniquement du fait des sans-culottes et des fortes contestations, c’est aussi parce qu’ont eu lieu d’importants transferts de propriété, des changements constitutionnels considérables. Je ne dis pas que cela ne va pas arriver mais au stade où nous en sommes, si le mouvement devait décliner sans traduction politique immédiate, il serait difficile de le classer comme une « révolution ». Il peut même arriver que des mouvements de la sorte renforcent le pouvoir existant. Le « parti de l’ordre » peut se renforcer quand il a des mouvements contestataires en face de lui même s’il a été initialement déstabilisé.
C’est ma réserve sur la définition de révolution : la Révolution française a mis à bas la monarchie absolue, proclamé une République, mis en place une nouvelle constitution. Les processus révolutionnaires russes ou chinois (on pourrait en prendre d’autres) ont mis à bas un régime et entraîné un changement de personnel politique et des changements économiques décisifs. Nous n’en sommes absolument pas là et il est important de le dire, sinon, on ne comprend plus les comparaisons. Il faut faire attention aux parallèles avec 1789 et 1792.
Cela est à prendre avec précaution : le mouvement des gilets jaunes est fortement hétérogène selon les endroits et sa traduction politique n’ira pas nécessairement dans le sens que certains espèrent. Tout cela est d’autant plus à analyser subtilement que le mouvement peut certes traduire concrètement l’idée selon laquelle le référent gauche / droite ne fait plus vraiment sens pour une partie de la population ; mais d’autres franges y restent attachées, même s’il s’agit de catégories particulières. Comment tout cela va se combiner à terme ? Il n’y a aucune réponse évidente.
En définitive, on ne peut pas considérer de manière mécanique que tout le processus peut être pensé comme « révolutionnaire » même s’il traduit quelque chose de profond dans la société actuelle.