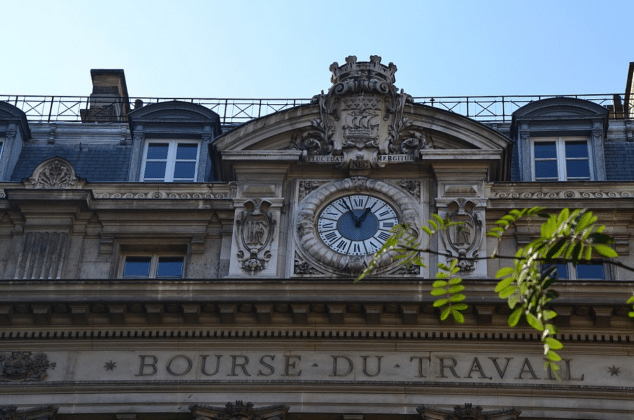Nombre de dirigeants politiques, particulièrement en temps de crise, vantent les bienfaits du système de sécurité sociale à la française. Dans leurs bouches, il ne se résume cependant qu’à un moyen de financer la protection sociale. C’est nier au système français de sécurité sociale son caractère le plus spécifique : la mise à l’abri des travailleurs hospitaliers et l’imperméabilité aux logiques de marché, établies avant l’ère néolibérale. Comprendre l’inquiétante « réalité dans nos hôpitaux », qui semble préoccuper Olivier Véran, implique alors de renouer avec les principes fondateurs du régime général de sécurité sociale.
Le désastre hospitalier français
En dépit des conséquences sociales, psychologiques et économiques déplorables qu’elles entraînent, les mesures de confinement sont prises dans une perspective simple : éviter la surcharge des hôpitaux français. Il importe dès lors de poser la question centrale dont découlent toutes les autres : quelle est la cause de la crise de l’hôpital public ?
L’ensemble des soignants déplore le manque de moyens en général dans nos hôpitaux : personnels, blouses, masques, gants, lits [1], médicaments… C’est bien ce manque de moyens qui engendre d’une part la saturation des patients – qu’on ne sait plus comment recevoir –, et d’autre part les scènes surréalistes de soignants équipés de sacs poubelles en guise de surblouses pour se protéger.
Ce manque de moyens accordés à l’hôpital est légitimé par un hypothétique « trou de la sécu » : déficitaire, la sécurité sociale nécessiterait des coupes budgétaires d’envergure pour éviter de crouler sous sa dette et disparaître. Depuis plus de trente ans et sans relâche, toutes les politiques autour de la sécurité sociale vont dans ce sens, et ont légitimé la fermeture de lits qui s’est faite systématiquement contre l’avis du personnel hospitalier, et qui se révèle particulièrement néfaste aujourd’hui.
En plus du manque de moyens dont il dispose, le personnel soignant se plaint régulièrement d’être débordé. Le fait que l’hôpital ne recrute pas suffisamment n’y est pas étranger. La soumission du personnel hospitalier à l’agenda des Agences régionales de santé (ARS) [2] et des directeurs d’hôpitaux, qui relaient des injonctions administratives hors-sol, lesquelles déresponsabilisent et dessaisissent le personnel hospitalier des grandes questions qui le regardent en premier lieu, joue également un rôle important. Si les soignants sont parvenus à jouer leur rôle lors de la première vague contre vents en marées, c’est en grande partie parce qu’ils étaient libérés de certaines des innombrables injonctions administratives et financières qui les contraignent en temps normal.

À l’origine de la crise : la déresponsabilisation du personnel hospitalier
Les discours visant notamment à promouvoir l’action des ARS « au plus près du terrain » méritent à tout le moins un examen critique. Bras armé de l’administration étatique dans la gestion de l’hôpital, les ARS habilitent des bureaucrates et un personnel de direction étranger au corps soignant à décider du sort de l’hôpital public. Ces décisions se prennent à la place du personnel qui y travaille au quotidien.
S’enquérir de la triste réalité des hôpitaux tout en œuvrant à la dépossession des soignants de tout pouvoir sur leur outil de travail semble pour le moins contradictoire. L’ignorance des mécanismes du régime général n’y est pas pour rien.
Toutes les orientations désastreuses auraient ainsi pu être évitées si le personnel hospitalier avait lui-même décidé collectivement du cap à suivre, comme c’était le cas avant que le régime général de sécurité sociale ne soit la cible de contre-réformes. S’enquérir de la triste réalité des hôpitaux français tout en œuvrant quotidiennement à la dépossession des soignants de tout pouvoir sur leur outil de travail semble pour le moins contradictoire. L’ignorance des mécanismes du régime général n’y est pas pour rien.
Un demi-siècle de rupture avec l’esprit du régime général de sécurité sociale
Dans le contexte des années 1960, le « déficit de la Sécu » catalyse progressivement les débats. Elle est ainsi accusée d’être un frein pour la compétitivité du pays, de telle sorte que les finalités initiales du système, qu’elles soient sociales ou politiques, s’effacent au profit d’un débat gestionnaire.
Dès 1958, le général de Gaulle instaure le contrôle des budgets des caisses par l’État, ainsi que la nomination et non plus l’élection des directeurs de caisses. Le décret du 12 mai 1960 marque quant à lui le retour de l’État dans la gestion des caisses, en renforçant le pouvoir des directeurs au détriment des Conseils d’administration élus. Dans une logique semblable, il crée l’École nationale supérieure de la sécurité sociale, qui a l’ambition de former les directeurs de caisse, alors qu’auparavant, ces administrateurs étaient élus par les travailleurs eux-mêmes, à travers des élections sociales qui opposaient les différents syndicats entre eux.
Cette prise de contrôle de l’hôpital public par l’État et ses administrations éloignées des réalités se renforce encore davantage en 1967, avec la décision du général de Gaulle d’instaurer le paritarisme dans les conseils d’administration des caisses du régime général.
La réduction progressive de la part des cotisations au profit d’impôts dans le financement du régime général – la création de la CSG par Michel Rocard en 1990 en est un parfait exemple – a aussi pour conséquence de favoriser une étatisation de la Sécurité sociale, avec notamment à termes des Projets de Loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) votés chaque année par le Parlement, de telle sorte qu’il revient de façon croissante aux administrations étatiques de décider des orientations de la Sécurité sociale sans prendre en compte l’avis des travailleurs.
Enfin, le refus de voir dans la subvention un moyen d’investir sans s’endetter – dont la création de la Caisse d’amortissement de la dette sociale mise en place en 1996 par le gouvernement Juppé est une manifestation paradigmatique – constitue un autre leitmotiv caractéristique des politiques qui se succèdent depuis plus de trente ans en France.
Déplorer l’absence de planification étatique lors de la crise du Covid manque donc une partie du problème : cette critique ne donne pas à voir les causes du désastre hospitalier et les principes du régime général de sécurité sociale qui ont été maintes fois bafoués.
Les principes du régime général
À plusieurs égards, le régime général apparaît comme une rupture profonde avec le consensus qui prévalait auparavant. D’abord en ce qu’il amorce un changement dans la définition du travail – décrit notamment par les travaux de Bernard Friot – puisqu’il permet, grâce aux cotisations qui alimentent ses caisses originellement gérées par des travailleurs élus, d’attribuer une qualification aux personnels soignants, retraités et autres parents [3] ; les travailleurs sont ainsi reconnus comme tels hors du champ de la seule mise en valeur de capital.
Surtout, le régime général ouvre la voie à un mode de financement alternatif de l’activité économique : la subvention. Permise par la cotisation, elle est le mécanisme qui permet de changer le régime de propriété de l’outil de travail, ici l’hôpital, afin que le droit du personnel hospitalier à décider des fins et des outils de son travail soit véritablement effectif.
Le régime général, dans sa philosophie, permet donc une émancipation à la fois du travail et de l’investissement des logiques de marché et de rentabilité.
Il existe deux moyens capitalistes de financer l’investissement : le recours au crédit bancaire d’une part, et aux marchés de capitaux d’autre part. Dans les deux cas, cela produit toujours un enrichissement d’agents économiques qui ne contribuent pas directement à la création de valeur par le travail – les prêteurs et les actionnaires.
Le régime général subvertit ces deux logiques en proposant une voie alternative. En socialisant une part de la valeur économique, grâce à la cotisation qui alimente les caisses du régime général, celles-ci sont à-mêmes de subventionner l’investissement sans s’endetter et sans ouvrir la possibilité aux actionnaires de décider des orientations de la production. En d’autres termes, au-delà d’ouvrir la voie à un investissement à plus faible coût – pas d’intérêts à payer ni de dividendes à verser –, la subvention permet d’instituer à grande échelle la copropriété d’usage, conférant aux travailleurs le pouvoir de décider de l’investissement qui les concerne.
Les investissements subventionnés par les Caisses d’assurance maladie à partir des années 1950 ayant rendu possible la construction d’hôpitaux et de CHU en France ont suivi cette dynamique. Ces financements par les cotisations des travailleurs ont permis de marginaliser la propriété lucrative et de poser le personnel hospitalier comme copropriétaire d’usage de l’hôpital.
Renouer avec l’esprit initial de la Sécurité sociale
Au-delà des enjeux de responsabilisation des travailleurs et de libération d’un régime de propriété lucrative qui les dessaisit des fins et des moyens de leur propre travail, le régime général ouvre aussi la voie à ce que les décideurs – devenus les travailleurs – n’agissent et ne décident avec d’autre intérêt que celui de soigner dans de bonnes conditions. Le régime général, dans sa philosophie, permet donc une émancipation du travail et de l’investissement des logiques de marché et de profit.
L’origine de l’inquiétante « réalité dans nos hôpitaux » est donc à chercher dans la succession de réformes qui s’attaquent aux fondements du régime général, par le biais de la fiscalisation de son financement et de la bureaucratisation de sa gestion. Là où les soignants travaillaient, depuis 1946 et avant la succession de réformes libérales, sans la chape de plomb d’une direction éloignée de leurs réalités[4], ils œuvrent désormais pour rembourser un endettement – pourtant évitable grâce à la subvention –, supervisés par une bureaucratie qui n’est que le relais de diktats budgétaires régis par des logiques court-termistes de rentabilité.
Le supposé « trou de la sécu », agité en permanence pour légitimer les coupes budgétaires, n’est que le résultat parfaitement prévisible des politiques qui refusent de voir dans la subvention par les caisses du régime général un moyen alternatif de financer et de produire libérés des impératifs propres à l’endettement et à la finance actionnariale.
La critique des politiques de santé menées par les gouvernements successifs ne prend donc toute sa force que lorsqu’elle donne à voir que le régime général est bien plus qu’un moyen de financer la protection sociale. Le simple fait que l’hôpital n’ait pas à dégager de profits pour faire vivre des actionnaires permet, à n’en pas douter, que l’offre de soins soit accessible au plus grand nombre. Mais là où le régime général émancipe plus encore le travail et l’investissement, c’est en instaurant – grâce à la cotisation qui socialise la valeur et n’habilite pas l’État à décider à la place des travailleurs du quotidien – une copropriété d’usage sur l’outil de production de soins qu’est l’hôpital.
Sans ce retour à l’esprit initial de la Sécurité sociale, les hôpitaux français demeureront soumis à des injonctions de rentabilité contradictoires avec leurs impératifs sanitaires.
Notes :
[1] Les résultats de la Statistique annuelle des établissements de santé de 2019 (SAE : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1164.pdf) , de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) révèlent que l’hôpital public a perdu environ 20 000 lits d’hospitalisation complète depuis 2013. Sur la seule année 2019, ce sont 3 400 de ces lits d’hospitalisation complète qui ont été fermés, malgré l’avis défavorable des personnels hospitaliers dessaisis de ces questions par le fonctionnement étatisé et bureaucratique du système de soins.
[2] Créées par Alain Juppé en 1996, les « Agences régionales d’hospitalisation » sont devenues en 2010, par la loi dite HPST – Hôpitaux Patients Santé et Territoires, proposée par Roselyne Bachelot, les « Agences régionales de santé ».
[3] De même que le personnel soignant ne met en valeur aucun capital en travaillant dans l’hôpital public ou que les retraités touchent un salaire pour leur travail hors de l’emploi, la justification originelle des allocations familiales n’est en aucun cas la reconnaissance du coût que représenterait le fait d’avoir plusieurs enfants, mais bien plutôt le fait que les éduquer est un travail, qui implique une qualification et donc un salaire hors de l’emploi.
[4] Sous l’impulsion d’Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail et de la Sécurité Sociale, et de Pierre Laroque, directeur de la Sécurité sociale.