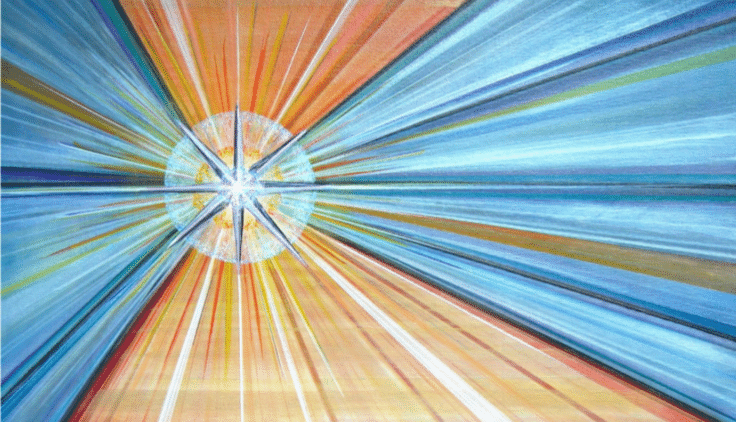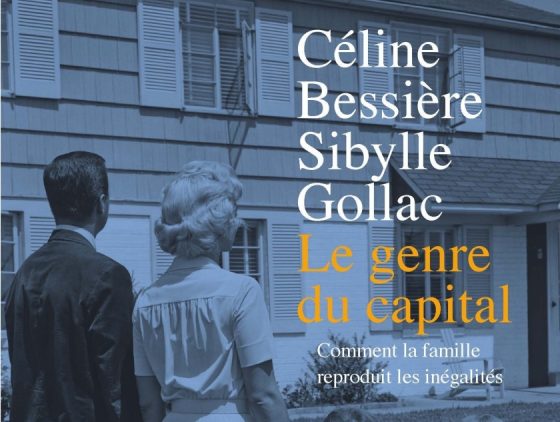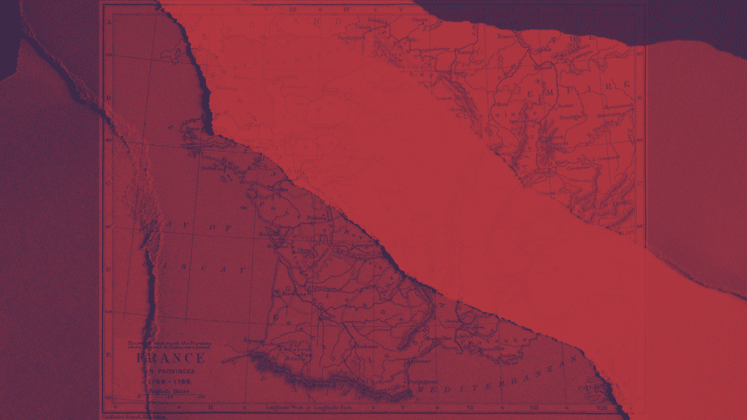« Bien souvent, ce qui s’affirme sous le mot “intersectionnalité” dit le contraire de ce que le terme signifie : non pas la multiplicité et l’imbrication mais la domination d’une variable et la hiérarchie des luttes. » C’est la thèse que défend Florian Gulli, auteur de L’antiracisme trahi (Presses universitaires de France, 2022). Selon lui, la proclamation de l’« intersectionnalité » a fréquemment pour effet de consacrer la prévalence des catégories du genre et de la « race » – et d’imposer celle-ci comme une évidence. Il analyse ce dernier phénomène dans cet article (issu de son ouvrage), et revient sur l’anti-racisme dominant tel qu’il s’est imposé aux États-Unis et a percolé en Europe. Il rappelle qu’il s’est construit par « le refoulement massif de la voix de nombreux intellectuels américains et afro-américains qui contestent la pertinence de la catégorie de “race” ».
« Race » et intersectionnalité
Ce qu’on appelle aujourd’hui « intersectionnalité » n’est-il pas un rempart contre cette tendance à privilégier de façon unilatérale une seule variable d’analyse ? L’intersectionnalité refuse en effet les « perspectives monistes », celles « postulant l’existence d’une domination fondamentale dont découleraient les autres dominations »1. Néanmoins, si le programme intersectionnel est clairement pluraliste, certaines analyses s’en réclamant posent problème en ce qu’elles sont elles-mêmes victimes de l’hégémonie de la catégorie de « race ».
Dans son livre Marxism and Intersectionnality, Ashel J. Bohrer défend le paradigme de l’intersectionnalité tout en dénonçant certaines de ses appropriations frauduleuses qui privilégient implicitement et de façon injustifiée certaines variables, en particulier la « race ». Ainsi par exemple, note-t-elle, « dans de nombreux usages et appropriations contemporains de l’intersectionnalité, celle-ci est utilisée pour désigner le racisme sexiste […] d’une manière qui occulte l’engagement de l’intersectionnalité envers une matrice de domination beaucoup plus large et nuancée »2. Les variables « sexe » et « race » sont privilégiées au détriment des nombreuses autres qu’une analyse intersectionnelle devrait pourtant prendre en charge : la classe et la nationalité par exemple.
Un exemple parmi d’autres : dans un entretien pour la revue Le Portique, Maboula Soumahoro, universitaire et militante, affirme que « les aspirations à l’intersectionnalité dans l’engagement féministe, LGBT ou antiraciste nous viennent aussi d’un débat de campus et d’intellectuel(le)s étasuniens autour d’une intrication des questions culturelles avec les problèmes de la race, du sexe (gender) et des minorités sexuelles »3. Les questions de classe ou de nationalité ne sont pas mentionnées. Elles ne le sont pas davantage dans cette autre interview : « L’intersectionnalité permet enfin de mettre en avant la complexité. Toutes les catégories raciales, de genre, d’orientation sexuelle, de validisme s’imbriquent entre elles4. »
En France notamment, et depuis des années, se développent des réflexions croisant « race » et genre, mais sans la classe ou la nation. Un « féminisme décolonial » apparaît par exemple sous la plume de Françoise Vergès ou de Houria Bentouhami. De même, le « féminisme intersectionnel » veut répondre aux instrumentalisations du féminisme par l’extrême droite. Mais nul n’a vu l’émergence d’un féminisme « lutte de classe », dont on a pu constater au contraire l’histoire oubliée5. Aucun « antiracisme de classe », aucun « classisme décolonial » ou « décolonialisme de classe » n’a, semble-t-il, vu le jour.
Il en est de même sur le terrain des pratiques militantes qui gravitent autour de la thématique intersectionnelle. Lorsqu’il est notamment question d’espaces non-mixtes (réunion, manifestation), c’est de non-mixité raciale dont il s’agit. Par exemple, lors de la marche des fiertés de 2021, il était question de cortèges « racisés » et jamais de cortèges de classe.
Rigoureusement parlant, on ne saurait écrire que la catégorie de « race » est « admise » dans les sciences sociales aux États-Unis. C’est ignorer tout une partie du champ académique […] Racecraft ou l’esprit de l’inégalité aux États-Unis (2012) propose une vive critique de l’usage de ce concept
Dans un article de 2011, la sociologue et féministe Danièle Kergoat constate cet effacement de la classe au profit de la « race » : « L’impasse sur les classes sociales continue dans la période actuelle alors même qu’en France (et ailleurs), les rapports de classe vont en s’exacerbant. Certes, les études féministes invoquent régulièrement le croisement nécessaire entre genre, « race » et classe. Mais le croisement privilégié est celui entre race et genre tandis que la classe sociale ne reste le plus souvent qu’une citation obligée. Et il est intéressant de noter que cette euphémisation se vérifie, dans les mêmes formes, aux États-Unis. En témoigne cette interview récente de Toni Morrison, peu suspecte d’indifférence aux problèmes de “race” et de genre, où elle explique que “derrière les tensions raciales aux États-Unis, se cache, en réalité, un conflit entre classes sociales. Et [que] c’est un tabou beaucoup plus grand que le racisme”6. »
Ainsi, si le modèle théorique de l’intersectionnalité peut être utile pour lutter contre la tendance d’une variable à devenir hégémonique, il est nécessaire cependant de bien garder à l’esprit que « ce qui fait qu’une analyse est intersectionnelle n’est pas son utilisation du terme “intersectionnalité” »7. Bien souvent, ce qui s’affirme sous le mot d’« intersectionnalité » dit paradoxalement le contraire de ce que le terme signifie : non pas la multiplicité et l’imbrication mais la domination d’une variable et la hiérarchie des luttes.
Ces quelques mots ne sont pas une remise en question de la notion d’intersectionnalité en tant que telle, mais une critique de perspectives focalisées sur l’idée de « race » avançant sous le masque de l’intersectionnalité, une critique de l’instrumentalisation de l’intersectionnalité par un projet politique de construction d’un sujet politique de type racial.
Prendre le mot « race » ?
Il faut passer maintenant de l’analyse de certains usages de la catégorie à la catégorie elle-même. Le débat consiste à savoir si la « race » est un terme dont les sciences sociales doivent s’emparer pour comprendre le réel ou si elles doivent au contraire s’en démarquer absolument. Comment les chercheurs voulant mobiliser la catégorie justifient-ils son emploi ? Le premier argument qu’ils mobilisent n’est pas véritablement un argument. Le refus d’utiliser le mot « race » serait le symptôme d’un retard français en matière de théorie. Retard par rapport à quoi ? Par rapport aux États-Unis. « Par contraste avec les États-Unis, écrit Pap Ndiaye, la notion de “race” est encore mal admise dans les sciences sociales françaises8. »
Sauf à considérer que les productions théoriques américaines, par le fait même qu’elles sont américaines, entretiennent un rapport particulier à la vérité, sauf à postuler que le progrès consiste nécessairement à s’aligner sur les productions américaines, pointer des différences d’approches théoriques entre deux pays ne prouve absolument rien. En outre, l’argument ne mentionne pas le fait que la « race » aux États-Unis n’est pas seulement un concept des sciences sociales ; elle est d’abord, et depuis 1790 – ce qui n’est pas rien – une catégorie administrative, un indicateur du Bureau du recensement.
À intervalle régulier, les citoyens du pays sont interpellés par l’État. Hier, ce dernier définissait la « race » à laquelle les individus appartenaient, aujourd’hui, l’injonction étatique s’est déplacée : les individus peuvent désormais déclarer la « race » de leur choix, même s’ils demeurent sommés de se définir en terme racial. On peut raisonnablement estimer qu’une telle institutionnalisation administrative de la « race » aux États-Unis – à côté des multiples formes institutionnalisées de ségrégation au cours du siècle – explique que les chercheurs américains (mais pas tous) aient ressenti le besoin de mobiliser une telle catégorie. On peut comprendre qu’elle fasse moins sens, ailleurs, pour cette raison.
Mais surtout, cet argument repose sur le refoulement massif de la voix de nombreux intellectuels américains et afro-américains qui contestent la pertinence de la catégorie de « race ». Rigoureusement parlant, on ne saurait écrire que cette catégorie est « admise » dans les sciences sociales aux États-Unis9. C’est ignorer tout une partie du champ académique et notamment par exemple le livre Racecraft ou l’esprit de l’inégalité aux États-Unis (2012) écrit par Barbara J. Fields et Karen E. Fields, livre qui propose une vive critique de l’usage du concept de « race ».
Barbara J. Fields est pourtant une historienne renommée : « Première femme afro-américaine nommée professeure à Columbia, elle a reçu de nombreux prix pour ses travaux sur l’histoire de l’esclavage et des Afro-Américains, notamment le prix John H. Dunning de l’American Historical Association (1986) et le Lincoln Prize attribué par le Lincoln and Soldiers Institute du Gettysburg College (1994), en passant par le prix des fondateurs de la Confederate Memorial Literary Society, et le prix Thomas Jefferson de la Society for the History of the Federal Government10 ». Pourquoi ses travaux sont-ils si peu discutés en France ?
En Angleterre, le sociologue Paul Gilroy11, figure centrale de la réflexion sur le racisme, renonce lui-aussi, à partir des années 2000, à l’emploi du terme « race », qu’il juge finalement irrécupérable. De même, Robert Miles et Annie Phizacklea, dont toute l’œuvre et toutes les enquêtes sont consacrées aux travailleurs immigrés et au racisme ; ils refusent le mot au motif qu’il ne profiterait en dernière instance qu’à l’extrême droite12. Ces Américains, ces Britanniques sont-ils, eux aussi, victime du retard français ou du modèle républicain ? À moins qu’il ne faille se résoudre à reconnaître que nulle part l’usage de la notion de « race » en sciences humaines ne fait consensus.
« L’ethnocentrisme scolastique » consiste ici à croire que l’usage savant du mot « race » présenté dans un colloque, lorsqu’il va se diffuser hors du monde académique, va pouvoir imposer sa signification contre le sens commun du mot « race ».
Le second argument est négatif. Il ne justifie pas l’adoption du mot « race » mais affirme que le refus du mot est problématique. Car à la source de ce refus, il ne pourrait y avoir que deux, et seulement deux choses : le racisme ou une forme de naïveté idéaliste. Au pire, donc, ne pas vouloir employer le mot serait le fait d’une volonté de masquer la réalité des discriminations. Le refus du mot serait déni raciste de la réalité du racisme. Mais la portée de cet argument est en fait très limitée. Il n’atteint pas un discours antiraciste qui refuse de faire circuler la catégorie de « race », mais qui reconnaît volontiers la réalité des processus de catégorisation raciale.
Mais un tel antiracisme saurait-il être autre chose qu’une forme de naïveté ? Pap Ndiaye écrit par exemple : « Il s’agit de dire à nos amis antiracistes que le rejet de la catégorie de “race” n’a pas éradiqué le racisme13. » Sarah Mazouz va dans le même sens : « On souligne alors l’idéalisme qu’il y a à croire que le problème peut être réglé par la seule suppression du mot et le déni qui consiste à considérer l’évitement comme la solution14. » Le refus du mot serait une forme de pensée magique, la croyance en la toute-puissance du langage.
On pourrait souligner d’abord que si, en effet, la suppression du mot ne supprime pas le racisme, l’utilisation du mot ne le fait pas davantage reculer. Aux États-Unis, où la catégorie est utilisée par l’État et une partie des sciences humaines, la situation des minorités ne semble pas meilleure qu’ailleurs, qu’on s’intéresse aux interactions avec la police, à la discrimination à l’embauche ou encore à l’accès au logement ou à une école de qualité. Mais, en réalité, personne n’a jamais soutenu l’idée saugrenue qu’il suffi rait de bannir un mot pour supprimer la réalité du racisme. La critique de l’idée de « race » et le refus de l’utiliser sont envisagés comme une condition nécessaire mais non suffisante de la lutte antiraciste. La critique des idéologies n’est jamais le tout d’un combat, mais elle en est toujours un moment essentiel.
Essentialisation, réification
Bien sûr, le théoricien jurera que « blanc » ne désigne pas de réelles couleurs de peau, ni même des individus concrets, qu’il s’agit d’un « rapport social ». Mais ces rappels savants seront vite écrasés par l’usage courant du mot « Blanc » qui renvoie avant tout à des phénotypes et à des individus. Un tel antiracisme, loin de lutter contre les méfaits des catégorisations, ne fait donc que reproduire les simplifications les plus massives des catégorisations raciales.
Les risques précédents – l’essentialisation et la réification – ne sont pas propres à la catégorie de « race », mais sont des écueils de la catégorisation en général. Il n’en reste pas moins que la catégorie de « race » soulève une difficulté supplémentaire, plus gênante que les précédentes. Paul Gilroy, après avoir longtemps été l’avocat d’une appropriation progressiste du mot « race », a fini par y renoncer, pour la raison suivante : le mot « race » « ne peut pas être facilement re-signifié ou dé-signifié, et imaginer que ses significations dangereuses peuvent être facilement réarticulées dans des formes bénignes et démocratiques serait exagérer le pouvoir des intérêts critiques et oppositionnels ».
Le mot « race » est pris dans une histoire longue – celle de la raciologie, de l’anthropologie raciale et des disciplines afférentes –, il est encastré, qu’on le veuille ou non, dans des réseaux de signifiants dont on ne peut l’abstraire à volonté. Sur la question de l’usage du mot « race », nous sommes manifestement confrontés à l’ignorance ou au refoulement « de la différence entre le monde commun et les mondes savants15 ».
Il s’agit de ce que Bourdieu nomme « l’ethnocentrisme scolastique » et qui consiste en « l’universalisation inconsciente de la vision du monde associée à la condition scolastique16 ». Sans s’en rendre compte, le chercheur prête aux agents du monde social son propre rapport au monde. Il imagine par exemple que des formules théoriques bien définies, où les mots sont pesés avec soin, sont entendues dans toute leur complexité, sans perte, lorsqu’elles se diffusent dans le monde social. Appliqué à notre question, l’ethnocentrisme scolastique consiste à croire que l’usage savant du mot « race » présenté dans un colloque, lorsqu’il va se diffuser hors du monde académique, va pouvoir imposer sa signification contre le sens commun du mot « race ».
Il consiste à croire que l’ajout savant de guillemets autour du mot ou la précision « la race est une construction sociale » seront en mesure de contrebalancer efficacement la compréhension spontanée du terme. Les précisions développées dans les articles et les colloques risquent en réalité de se perdre dès lors que le mot circulera dans le monde ordinaire. Dans la lutte pour l’hégémonie culturelle, il est préférable de travailler les ambiguïtés du sens commun plutôt que de vouloir y introduire de façon forcée des mots savants forgés dans le monde académique. […]
« La “race” ne doit pas être entendue comme une réalité biologique, mais comme une construction sociale. » […] Mais ici, l’idée de « construction sociale » ne conduit pas à souligner la contingence des catégories héritées d’une histoire ; elle sert bien souvent à réaffirmer des nécessités lourdes, transformant la Société en une seconde Nature
Aucun sociologue, aucun militant, n’est donc coupable de naturaliser les faits sociaux. Mais ce qu’on peut leur reprocher, à l’instar de Gilroy, c’est leur optimisme, quant à la réception de leur discours, leur certitude que la répétition rituelle de la formule « la race est une construction sociale » suffi ra à empêcher le mot « race » de revenir à ses affinités conceptuelles premières, sitôt passés les murs de l’université ou des milieux les plus militants. […]
Il ne suffit pas de répéter que la « race » est une « construction sociale »
Pour justifier l’emploi de la catégorie de « race » en sciences humaines, la proposition suivante est souvent mise en avant : « La “race” ne doit pas être entendue comme une réalité biologique, mais comme une construction sociale. » Pourtant, ceux qui usent de la catégorie de « race » aujourd’hui reproduisent bien souvent l’un des schèmes centraux de l’idée de race biologique : la croyance en la « fatalité de la race17 ». De la « race biologique », disait hier le discours raciste, on ne peut s’échapper : l’éducation des Noirs ne changera rien à leur infériorité, la conversion des Juifs ne protégera pas de leur malignité. La Nature, comme destin, pesait sur les épaules des hommes, déterminant en profondeur leur existence quoiqu’ils fassent.
Or il semble qu’une telle « fatalité de la race », mais visant cette fois les Blancs, imprègne désormais une partie du discours antiraciste. De nombreux textes expliquent en effet que le racisme est inconscient, qu’il est invisible, qu’il régit donc l’action des Blancs à leur insu, y compris de ceux qui se déclarent antiracistes. Difficile, voire impossible, dans ces conditions, d’échapper au racisme : l’engagement antiraciste pouvant aisément être interprété comme un moyen égoïste de soulager sa conscience ou comme la volonté paternaliste de sauver les Non-Blancs.
Le Blanc semble donc soumis à la « fatalité de la race », à un déterminisme, qui n’est certes plus celui de la Nature, mais celui de la Société. L’idée de « construction sociale » ne conduit donc pas, comme on aurait pu s’y attendre, à souligner la contingence des catégories héritées d’une histoire ; elle sert bien souvent à réaffirmer des nécessités lourdes, transformant la Société en une seconde Nature, dont le déterminisme est tout aussi implacable. On n’échappe pas à la naturalisation en se contentant de parler de « construction ».
Mais revenons à la formule : « la “race” ne doit pas être entendue comme une réalité biologique, mais comme une construction sociale. » Cette formule ne permet absolument pas de justifier la pertinence théorique de la catégorie de « race » en sciences humaines. L’ouvrage de Barbara J. Fields et Karen E. Fields ne cesse de rappeler, non sans ironie, le caractère confus d’une telle expression. « Le métro londonien et les États-Unis d’Amérique, écrivent les deux auteurs, sont des constructions sociales ; c’est également le cas du mauvais œil et des appels lancés aux esprits de l’au-delà ; mais aussi du génocide et du meurtre18. » D’une certaine façon, tout est construction sociale dans le monde humain (y compris le berger allemand et le golden retriever19).
Ainsi, on peut dire que le mauvais œil, la sorcellerie ou encore le géocentrisme sont des constructions sociales. Or personne n’irait en conclure qu’il s’agit de concepts pertinents pour comprendre les mécanismes du réel : expliquera-t-on une mauvaise récolte en invoquant le mauvais œil ? Étudier comment les hommes en sont venus à penser l’existence d’un « mauvais œil » est une chose ; s’imaginer que le mauvais œil est un facteur explicatif, c’en est une autre, qui n’a rien de scientifique. Ainsi, dire que la « race » est une « construction sociale », c’est s’arrêter au milieu du gué ; cela ne signifie pas que nous avons affaire à un concept opératoire en sciences humaines.
La seule manière de justifier l’usage théorique de la catégorie de « race » serait de montrer qu’elle apporte quelque chose de plus que les catégories de « racialisation » ou de « racisme ». Or, loin d’éclairer mieux la réalité, elle introduit de la confusion.
« Race » ou racisme ?
Lorsque Colette Guillaumin écrit : « La race n’existe pas. Mais elle tue des gens », il faut entendre en toute rigueur ceci : « La race n’existe pas. Mais le racisme tue des gens ». Un concept en effet n’a jamais tué personne. Celui de « race » ne tue pas, pas plus que le concept de « chien » n’aboie ni ne mord. Passer de racisme à « race », non seulement ne procure aucun gain de compréhension, mais contribue à obscurcir les choses. En passant de « racisme » à « race », on transforme magiquement « ce qu’un agresseur fait en ce que la victime est20 ».
Dans une interview, Barbara J. Fields et Karen E. Fields écrivent : « La noyade ou le bûcher de personnes accusées d’être des sorcières n’était pas la conséquence de la sorcellerie, mais de la persécution – tout comme le lynchage de Noirs résulte d’actions de foules de lyncheurs et de fonctionnaires en connivence avec ces derniers, et non de la race des victimes. En d’autres termes, on n’utilise pas une fiction – la race – pour combattre un fait21. » Il convient donc, si l’on suit cette ligne argumentative, de ne pas passer du racisme à la « race ».
La notion de « race » peut donc aisément, et sans perte théorique, être partout remplacée par celle de « racisme ». Par exemple, le champ d’étude consacré au racisme n’a aucune raison de se nommer « théorie critique de la race », sauf à vouloir imiter à tout prix la formule américaine Critical Race Theory. Si l’on tient à nommer ce champ d’études par son objet, « théorie critique du racisme » est une expression parfaitement adéquate.
La catégorie de « race » ne présente donc aucun intérêt théorique dès lors que l’on dispose des concepts de « racisme » ou de « catégorisation raciale ». Inutile, la notion de « race » est par ailleurs dangereuse : elle renforce dans le sens commun l’idée que le phénotype est une réalité politique pertinente. Ce danger, « l’ethnocentrisme savant » ne l’aperçoit pas. La parole sociologique croit pouvoir imposer sa loi à la parole populaire. Mais le mot « race » est enserré dans une histoire séculaire d’explications naturalisantes (même quand elles prennent une tournure culturelle) qui écrase toutes les précautions théoriques avancées par les savants. Cette indifférence au sens commun affaiblit la lutte antiraciste. Une partie de la sociologie, à l’opposé de ses intentions, va donc contribue à la mise en circulation d’explications naturalisantes des faits sociaux.
Notes :
1 Sirma Bilge, « De l’analogie à l’articulation : théoriser la différenciation sociale et l’inégalité complexe » , L’Homme & la Société, 2010/2-3 (no 176-177), p. 43-64. p. 51.
2 Ashely J. Bohrer, Marxism and Intersectionality. Race, Gender, Class and Sexuality under Contemporary Capitalism, Transcript Publishing, 2020, p. 99
3 Maboula Soumahoro, « Les nouvelles frontières de la question raciale : de l’Amérique à la France », Le Portique [En ligne], 39-40 | 2017, document 3, mis en ligne le 20 janvier 2019, consulté le 19 mars 2021.
4 Maboula Soumahoro : « Nier ses privilèges blancs, c’est participer au système raciste », interview disponible à cette adresse : https://www.terrafemina. com/article/maboula-soumahoro-nier-ses-privileges-blancs-c-est-participerau-systeme-raciste_a354004/1
5 Josette Trat, « L’Histoire oubliée du courant “féministe luttes de classe” », in Femmes, Genre, Féminisme, Les Cahiers de Critique Communiste, Paris, Syllepse, 2007
6 Danièle Kergoat, « Comprendre les rapports sociaux », Raison présente, année 2011, 178, p. 15.
7 Patricia Hill Collins, Sirma Bilge, Intersectionnality, Cambridge, Polity Press, 2016, p. 4.
8 Pap Ndiaye, La Condition noire. Essai sur une minorité française, Paris, Gallimard, 2011, p. 40.
9 Ibid.
10 Gérard Noiriel, « “Race”, sorcellerie, racisme. Réflexions sur un livre récent », 2022, article disponible à cette adresse : https://noiriel.wordpress. com/2022/02/03/race-sorcellerie-racisme-reflexions-sur-un-livre-recent/
11 Paul Gilroy, Against race. Imagining Political Culture Beyond the Color Line, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2000.
12 Stephen Duncan Ashe et Brendan Francis McGeever, « Marxism, racism and the construction of’race as a social and political relation : an interview with Professor Robert Miles », Ethnic and Racial Studies, Taylor & Francis (Routledge), 2011, 34 (12), p.1.
13 Pap Ndiaye, La Condition noire, op. cit., p. 41.
14 Sarah Mazouz, Race, Paris, Anamosa, 2020, p. 57.
15 Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 2003, p. 76.
16 Ibid.
17 On retrouve cette expression notamment dans l’article « La conception génétique de la race dans l’espèce humaine » de Cyril Darlington, Bulletin international des sciences sociales, II, 4, 1950, p. 501-511.
18 Barbara J. Fields et Karen E. Fields, Racecraft, ou l’esprit de l’inégalité aux États-Unis, op. cit., p. 110.
19 Ibid.
20 Barbara J. Fields et Karen E. Fields, Racecraft ou l’esprit de l’inégalité aux États-Unis, op. cit., p. 38.
21 Barbara J. Fields et Karen E. Fields, « On n’utilise pas une fiction, la race, pour combattre un fait, le racisme », 25/11/2021, article disponible à cette adresse : https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/on-nutilise-pasune-fiction-la-race-pour-combattre-un-fait-le-racisme.

L’antiracisme trahi, défense de l’universel. Florian Giulli, Presses Universitaires de France, 2022.