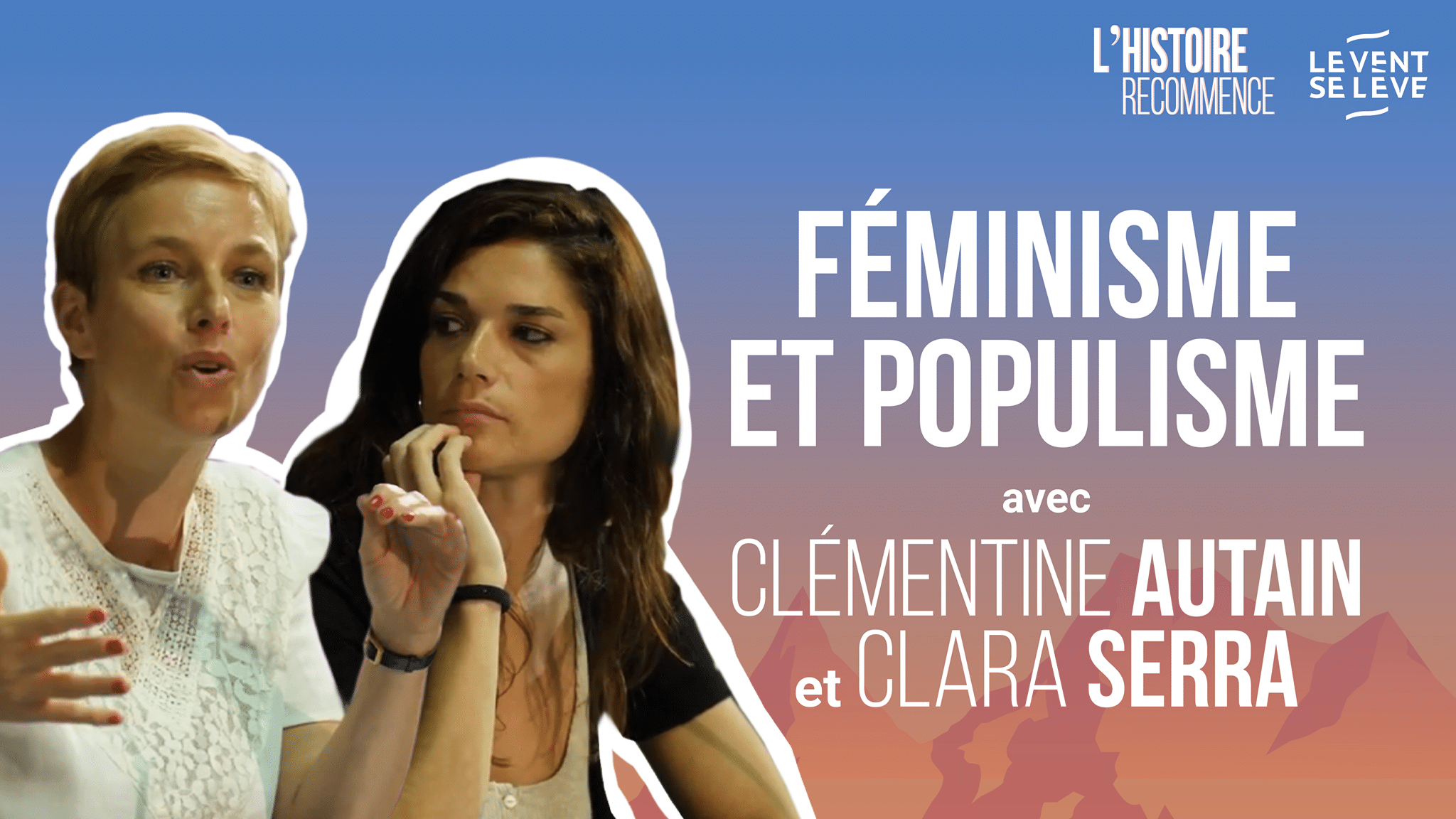La crise sanitaire liée au Covid-19 a révélé et mis en lumière les inégalités d’accès à l’avortement et le fossé considérable entre le droit à l’avortement et la possibilité effective d’y avoir recours. Pendant le confinement, les difficultés d’accès à l’IVG ont été exacerbées, avec une augmentation significative du nombre d’IVG hors délai. Cette situation avait amené médecins, associations et politiques à réclamer un allongement temporaire du délai légal d’IVG de 12 à 14 semaines et avait fait naître la réflexion de réformer l’accès à celui-ci. D’où la proposition de loi, présentée et votée à l’Assemblée le 8 octobre dernier, allongeant le délai d’IVG de 12 à 14 semaines. Cependant, cette loi n’est pas à la hauteur des enjeux d’accessibilité à l’IVG. Par Barbara Calliot et Louise Canaguier.
Le 19 mars, lors des débats sur le projet de loi d’urgence sanitaire, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol propose des amendements pour étendre temporairement les délais de recours à l’IVG. Cela permettrait aux femmes dans des situations compliquées de confinement de ne pas se retrouver hors délais. Les amendements sont rejetés mais Olivier Véran assouplit les règles pour le recours aux IMG (Interruption médicale de grossesse) par aspiration, les médecins pouvant mettre en avant la « détresse psycho-sociale » comme motif. Cependant, il n’aborde pas la question de la composition du collège des médecins. Or, cela constitue un obstacle majeur à son recours (la procédure de recours à l’IMG est dépendante de l’approbation de quatre médecins, dont un étant spécialiste de médecine fœtale). Le 14 avril, le gouvernement autorise une prolongation du délai des IVG médicamenteuses, lequel s’étend jusqu’à sept semaines de grossesse. La demande d’allonger de quinze jours le délai de recours à l’IVG est alors largement relayée par les associations. Une tribune, soutenue par une soixantaine de députés, est publiée dans Libération le 12 mai[1].
Dans un rapport adopté le 16 septembre, la Délégation aux droits des femmes à l’Assemblée Nationale recommande de porter de douze à quatorze semaines de grossesse la limite légale pour pratiquer l’IVG. Ce rapport avait pour objectif d’identifier les freins au droit à l’avortement et d’en proposer une réponse législative, à la lumière des inégalités territoriales en matière d’l’IVG et des refus des prises en charges tardives. Ces éléments avaient été à la source des revendications des militantes des droits des femmes. Les co-rapporteuses du rapport (Marie-Noelle Ballistel et Cécile Muschotti) avaient plaidé pour une protection de la santé des femmes souvent obligées, pour celles qui en ont les moyens, de fuir à l’étranger dans des pays où la législation est plus progressiste en la matière comme aux Pays-Bas ou en Espagne, où le délai de recours à l’IVG est respectivement de 22 semaines et 14 semaines (il s’agirait de 3000 à 5000 femmes par an concernées par ces départs à l’étranger)[2].
Les 25 recommandations présentées dans ce rapport ont abouti à une proposition de loi (n°3375), soutenue par de nombreux élus de la majorité, et votée en première lecture à l’Assemblée le jeudi 8 octobre, avec 86 voix pour et 59 contre[3]. Cette proposition de loi du groupe Écologie démocratie et solidarité, portée par la députée Albane Gaillot, prévoit l’allongement de deux semaines du délai légal de recours à l’IVG (passant donc de 12 à 14 semaines). Elle prévoit également dans son article 3 de supprimer la double clause de conscience en matière d’IVG pour les médecins[4], en modifiant l’article L.2212-8 du Code de la Santé Publique, dont la rédaction est actuellement la suivante : « un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens ou des sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention […] », pour une formulation reposant sur l’obligation d’information et d’orientation des patientes[5].
Afin de renforcer l’offre médicale en matière d’IVG, l’article 2 du texte propose de modifier l’article 2213-1 du Code de la Santé Publique, qui, en l’état ne permet aux sages-femmes que de pratiquer l’IVG médicamenteuse. Il étendrait leurs compétences en leur permettant de réaliser les IVG chirurgicales jusqu’à la dixième semaine de grossesse. L’article 4[6], quant à lui, prévoit « le gage des dépenses éventuellement occasionnées par ces mesures pour les organismes de sécurité sociale ». [7]
La proposition est soutenue par l’ensemble de la gauche, et particulièrement par la France Insoumise. À droite, des critiques se sont fait entendre en matière de suppression de la clause de conscience spécifique qui serait, selon eux, un point important de la loi Veil de 1975. La volonté de suppression du délai de réflexion de deux jours pour confirmer l’IVG après l’entretien psycho-social pose également problème. Depuis 2016 et la suppression du temps de réflexion minimal entre la consultation d’information et le recueil du consentement de la femme, c’est le seul délai qui subsiste dans le droit français.
Si la proposition a reçu le soutien de la majorité LREM, le gouvernement s’est montré plus réservé à son sujet. Le Comité national consultatif d’éthique a été saisi par Olivier Véran pour rendre un avis avant le passage de la proposition de loi au Sénat [8]. Par ailleurs, l’Académie nationale de médecine s’est opposée dans un communiqué à l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG, en soulignant le risque d’une augmentation du « recours à des manœuvres chirurgicales qui peuvent être dangereuses pour les femmes », avec une « augmentation significatives des complications à court ou à long termes ». Ils s’opposent également au fait de déléguer des compétences supérieures aux sages-femmes en raison de leur « absence actuelle de qualification chirurgicale ».
L’Ordre des médecins s’est quant à lui opposé à la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG, prévue par l’article 3 de la proposition de loi. Il met en avant le fait que celle-ci ne « permettra pas de répondre aux difficultés qui peuvent se poser à nos concitoyennes souhaitant avoir recours à une IVG »[9]. Le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France (GNGOF), le professeur Israël Nisand, s’est également opposé à l’allongement du délai de recours à l’IVG. Dans un entretien accordé au Monde, il affirme que le véritable problème réside dans le délai d’obtention du rendez-vous qui, en raison de services hospitaliers débordés, place de nombreuses IVG hors-délais (le manque de moyens est en effet un obstacle considérable à l’application effective du droit à l’IVG). Il se montre dans ce sens favorable à l’idée de fixer un délai d’obtention de rendez-vous de cinq jours maximum. Il avance également le fait que cet allongement de deux semaines, qui change la technique d’extraction du fœtus, pourrait poser un problème de ressources humaines, avec des praticiens refusant de pratiquer l’IVG. Cela aurait pour effet de réduire encore plus l’accès à celui-ci. En effet, à douze semaines le fœtus mesure environ 85 millimètres contre 120 millimètres à 14 semaines ce qui exige de « couper le fœtus en morceaux et écraser sa tête pour le sortir du ventre » ce qui, selon le professeur, peut-être « assez difficile à réaliser pour beaucoup de professionnels »[10].
Ces réticences à l’égard de la proposition de loi, qui fait l’objet de nombreux débats éthiques et politiques, témoignent d’une hostilité et d’une méfiance structurelle par rapport aux avortements, et questionne sur leur accessibilité effective.
La loi Veil : acte fondateur du droit à l’avortement
En effet, le droit à l’avortement est le fruit d’une histoire de mobilisations et de luttes acharnées menées pour le droit à disposer de son corps, qui s’est heurté et se heurte encore aux réticences, aux blocages de nombreuses institutions, notamment religieuses, et au sexisme.
C’est avec l’adoption de la loi du 17 janvier 1975 que les femmes en France peuvent, pour la première fois, interrompre leur grossesse pour des motifs qui ne sont pas thérapeutiques.
C’est avec l’adoption de la loi du 17 janvier 1975 que les femmes en France peuvent pour la première fois interrompre leur grossesse pour des motifs qui ne sont pas thérapeutiques. Cette loi sera très médiatisée et suscitera la polémique, ainsi qu’une multitude d’actions des groupes anti-IVG. Elle fait suite à de nombreuses manifestations publiques, visant à défendre un meilleur accès à la contraception et à dépénaliser l’avortement, parmi celles-ci certaines représentent “un défi à l’ordre social comme l’emblématique ‘Manifeste des 343’”[11].
Selon Nathalie Bajos et Michèle Ferrand, l’analyse des arguments avancés lors des débats sur la loi Veil “permet de saisir le sens social que va prendre l’IVG en France et de mettre au jour la construction normative qui en découle” [12]. Effectivement, ce texte est le fruit d’un compromis qui arrive après l’échec de plusieurs propositions de lois (dont le projet Messmer-Poniatowski de 1973). Elle ne crée pas de véritable droit des femmes à avorter (comme le montrent l’autorisation obligatoire des parents pour les mineures, ou le non-remboursement par la Sécurité Sociale), mais permet l’autonomie des femmes en matière d’IVG. Toutefois, l’article 4 section 1 stipule que c’est l’état de détresse qui permet son recours.
À l’instar des propos de Nathalie Bajos et Michèle Ferrand, les débats et les conflits autour de cette loi emblématique signent le sens social du recours à l’avortement : en effet, l’avortement est vu comme une exceptionnalité qui se doit d’être dramatique. Simone Veil déclare d’ailleurs le 26 novembre 1974 lors du débat introductif à l’Assemblée Nationale que : “l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours pour des situations sans issues […] c’est un drame et cela restera toujours un drame“. C’est l’argument de la santé publique, socialement plus recevable, qui est avancé pour défendre le projet (ce qui a instauré un dispositif de médicalisation permettant le contrôle social de la procréation). Associé aux différentes lois sur la contraception, l’objectif, était qu’il n’y ait plus, à terme, besoin de faire d’IVG. Par la suite, la limitation de la clause de conscience est introduite lors du renouvellement de la loi Veil le 1er janvier 1980. Celle-ci acte le remboursement de l’IVG par la Sécurité Sociale (loi Roudy), et le délit d’entrave à l’IVG est créé par la loi du 5 décembre 1992.
La loi Aubry-Guigou du 4 juillet 2001 signe la reconnaissance d’un véritable droit des femmes à l’avortement, qui est considéré comme une liberté physique et corporelle protégée par le droit : la consultation psycho-sociale reste obligatoirement proposée mais devient facultative, le consentement parental n’est plus nécessaire pour les mineures, et le délai légal d’interruption de grossesse est porté de dix à douze semaines. En 2004, l’IVG médicamenteuse est autorisée en médecine de ville. Le 27 septembre 2013, Najat Vallaud-Belkacem lance un site dédié (ivg.gouv.fr), car de nombreux sites internet anti-IVG cherchant à dissuader les femmes par le biais de la désinformation ont fleuri sur le net. En 2014, la loi Vallaud-Belkacem supprime la condition de détresse avérée, présente dans la loi de 1975 : c’est un symbole fort. Le 1er décembre 2016 est présentée à l’Assemblée la proposition de loi sur le délit d’entrave numérique à l’IVG, votée définitivement le 16 février 2017.
Cette nouvelle proposition de loi apporte certaines avancées en faveur d’une meilleure accessibilité à l’IVG. Néanmoins, les problèmes persistent encore. Ces mesures insuffisantes ne tendent qu’à estomper partiellement les difficultés d’accès à l’IVG, et posent la question du différentiel entre le droit à l’IVG formulé par la loi, et son accessibilité pratique pour les femmes.
Pour reprendre les termes de Sophie Divay, sociologue, le droit à l’avortement est indéniablement et malgré cette loi un « droit concédé, encore à conquérir ».
En effet, si cette loi demeure insuffisante, c’est parce que les facteurs contraignant à l’IVG sont extérieurs et structurels. Entre le poids culpabilisateur de la société, appuyé par les institutions médicales, juridiques et les lobbies anti-avortement, ainsi que les difficultés d’accès matérielles et temporelles, faire le choix d’avorter demande encore aux femmes beaucoup de force, quand cela ne se transforme pas en parcours du combattant.
Un accès restreint par les contraintes sociales
La liberté des femmes en matière d’IVG en France est, selon Lucile Olier, encore une liberté “sous contrainte” [14], largement dépendante du corps médical. Selon l’article L. 2212-2 du Code de santé publique [15], ancien article L.162-1 de la Loi Veil, « L’interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ». La légitimité de l’IVG fut donc entièrement rattachée à la santé, sous l’influence du corps médical, cela afin d’éviter une banalisation de l’acte. Par la loi de 1975, le corps médical a ainsi pris possession du contrôle social de l’IVG. La « clause de conscience » adoptée place les valeurs morales du médecin au-dessus de toute urgence, même sanitaire. L’avortement n’est plus interdit, il est un droit, mais sous influence et sous contrôle du médical. Cela a transformé l’IVG en un acte de désespoir, de dernier recours.
Par la loi de 1975, le corps médical a ainsi pris possession du contrôle social de l’IVG.
Avec la massification des moyens de contraception, se met en place ce que Nathalie Bajos et Michèle Ferrand appellent la “norme contraceptive“. Elle place, intégralement et de façon très culpabilisatrice, la responsabilité de la contraception sur les femmes, dans la continuité de la norme patriarcale en matière de sexualité[16]. D’après l’enquête « Contexte de la Sexualité en France » de 2006, la très grande majorité des femmes (91 %) et des hommes (91 % également) entre 18 et 69 ans considèrent « qu’avec toutes les méthodes de contraception qui existent, les femmes devraient être capables d’éviter une grossesse dont elles ne veulent pas »[17], constituant de ce fait un déni des difficultés des femmes pour obtenir une contraception efficace et sans danger.
La crainte d’une culpabilisation crée un véritable malaise psychologique. L’enquête de Sophie Divay, retraçant ses consultations psycho-sociales post-IVG, pour la revue Travail, Genre et sociétés, explicite le tabou qu’est cet acte pour un bon nombre de demandeuses. La peur du jugement social est récurrente durant les consultations, faisant de cet acte un non-dit, dans un but de protéger une relation amoureuse, familiale, ou encore une situation professionnelle, pour laquelle une IVG est un vrai frein à la carrière[18]. Pourtant, Nathalie Bajos et Michèle Ferrand montrent que 40% des femmes y ont recours une fois dans leur vie[19]. Il y a donc un véritable paradoxe entre la récurrence du recours à l’acte et sa perception sociale.
La culpabilisation vient aussi parfois du regard très variable des médecins, allant d’une attitude réconfortante à celle “d’entrepreneur de morale“, pour reprendre l’expression de Becker. Sophie Divay raconte ainsi comment une étudiante lui rapporta la pression psychologique exercée par son gynécologue pour qu’elle garde l’enfant. “En sortant de la visite, j’étais contente, parce qu’il avait accepté de faire l’IVG !“, raconte celle-ci, confirmant le pouvoir des médecins sur le choix des femmes[20]. Ce regard culpabilisateur rend l’IVG encore plus difficile mentalement. La suppression de la double clause de morale ne va pas changer ce poids psychologique, puisque les médecins peuvent toujours refuser de pratiquer l’IVG.
Pour Danielle Gaudry, gynécologue et militante au Planning familial : “Il existe encore, 45 ans après la loi Veil, des freins idéologiques et aussi de fonctionnement dans l’accès à l’IVG en France”.
De plus, l’article 4 de la loi Veil donne l’obligation au spécialiste d’ “informer celle-ci (la femme enceinte) des risques médicaux graves qu’elle encourt pour elle-même et ses maternités futures, et de la gravité biologique de l’interruption qu’elle sollicite” [22], ce sur quoi les médecins insistent plus que pour toute autre opération médicale[23]. Or, l’article de Danielle Hassoun intitulé Les conditions de l’interruption de grossesse en France, de 1997, montre que la médicalisation de l’IVG a mis fin aux risques pour la santé de la personne enceinte, importants avant 1975[24]. Aujourd’hui, l’accent est mis d’avantage sur les traumatismes psychologiques possibles, créant l’idée que les personnes recourant à l’IVG ont forcément des problèmes postérieurs à l’acte. Les études scientifiques remettent pourtant cela fortement en question, notamment celle de Robinson G.E. et al. : “Is there an ‘abortion trauma syndrome’? Critiquing the evidence”, parue en 2009 dans la revue Harvard Review of Psychiatry[25]. Cela replace l’IVG comme un acte de désespoir, et non comme un choix. Sophie Divay met également en lumière le rôle du regard des conseillers. De nombreux récits entendus révélaient la psychologisation constante de l’IVG, appréhendée comme le traumatisme de la perte d’un enfant. Pour Nathalie Bajos et Michèle Ferrand, le fait que l’IVG continue d’être rattachée aux centres médicaux dans le domaine de la grossesse et de la maternité, au lieu d’être pris en charge dans les structures traitant de la sexualité et de ses risques, est un poids symbolique fort et culpabilisateur[26].
Ainsi, le placement de l’IVG sous autorité médicale a cadenassé cette pratique autour de l’avis médical, en lui donnant une signification sociale particulière. La décision d’une IVG reste ainsi un choix stigmatisant. Un sondage de l’IFOP du 7 octobre 2020 affirme que pour 51% des répondants, avoir recours à l’IVG est une “situation préoccupante car avorter reste un acte que l’on préférerait éviter” [27]. Cet acte reste donc socialement et moralement condamné. Si le droit à l’IVG est reconnu, son usage, fréquent ou pas, est critiqué.
Le fait que l’IVG continue d’être rattaché aux centres médicaux dans le domaine de la grossesse et de la maternité, au lieu d’être pris en charge dans les structures traitant de la sexualité et de ses risques, est un poids symbolique fort et culpabilisateur.
Cette affirmation peut être imagée par la perpétuation des lobbies anti-avortement, agissant par l’action directe ou auprès du gouvernement. L’article “L’IVG, quarante ans après“, paru dans la revue Vacarme, met en avant les nouvelles techniques de ces groupes. Leur site “ivg.net” est le second résultat quand on tape “IVG” dans la barre de recherche. Il conduit vers un numéro vert menant à « un centre national d’écoute anonyme et gratuit ». Bien évidemment, tout est fait, du site aux conseillères au téléphone, pour dissuader explicitement l’IVG, reprenant les arguments d’une culpabilisation parfaitement intégrée socialement. À une autre échelle, les lobbies anti-avortement vont tenter d’influencer la Cour Européenne des droits de l’Homme. Au Parlement européen, le rapport Estrela, sur la santé et les droits sexuels, demandait le renforcement du droit à l’IVG, en lui donnant un cadre européen, mais il a été rejeté[28].
De plus, bien que l’IVG soit totalement soumise au corps médical, ce n’est pas une activité médicale comme les autres, et elle manque de reconnaissance dans le milieu médical. Ce problème vient du fonctionnement de l’hôpital français, contraignant indirectement le parcours vers l’IVG.
L’avortement soumis à des enjeux économiques
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, de 2002, confirme que, s’il y a du progrès dans l’acceptation sociétale de l’IVG, nombre de difficultés demeurent dans les délais, dans l’information, et l’accueil fait aux personnes souhaitant avorter[29]. Pour les médecins du centre dédié à l’IVG, de Colombes, cités dans l’article “l’IVG, quarante ans après” : « tous les centres se font grignoter lentement mais sûrement »[30]. La loi Bachelot de juillet 2009 a laissé pour trace une logique de rentabilité qui complique d’autant plus l’accès à l’IVG. Les budgets déficitaires de cette activité relèvent ainsi d’un régime spécifique, contribuant à sa mise à l’écart, loin de la logique des gouvernements depuis 1975.
Laurence Duchêne, Marie Fontana, Adèle Ponticelli, Anaïs Vaugelade, Lise Wajeman, et Aude Lalande affirment que l’IVG est “dévalorisée de toutes les manières imaginables, elle est jugée par les médecins « techniciens » comme inintéressante, aussi bien techniquement que financièrement, et sans prestige“[31].
La faible tarification de l’acte et, plus globalement, le problème du recrutement des médecins, ainsi que les moyens réduits affectés aux centres d’IVG posent d’ailleurs des problèmes récurrents, comme le montre l’Évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse, suite à la loi du 4 juillet 2001, par l’IGAS[32].
De plus, le rapport suivant de l’IGAS, en 2009, critique la spécialisation forcée des établissements, dans un but de rentabilité, limitant le choix des femmes dans la méthode souhaitée[33]. Marc Collet montre que la cause est la subordination de l’IVG aux service des maternités, le rendant dépendant à ce secteur. L’évolution de l’accessibilité à l’IVG dépend de l’évolution de l’accès aux maternités.
Entre 1996 et 2007, le nombre d’établissements réalisant des IVG en France métropolitaine est ainsi passé de 747 à 588 tandis que le nombre de maternités diminuait de 814 à 572.
Le secteur privé, notamment lucratif, se désengage aussi de cette activité à cause du manque de rentabilité de celle-ci : “Depuis 2003, on assiste à un retrait du privé de cette activité de plus en plus marqué, avec une diminution de 25 % du nombre d’IVG réalisées“. La concentration et la diminution des centres pratiquant l’IVG rallonge les délais de prise en charge. De plus l’accompagnement psychologique proposé dépend du statut de l’établissement[34]. Agnès Buzyn est resté sourde à l’état des lieux qu’elle avait commandé en septembre 2018, qui alarmait sur la fermeture de 8% des centres pratiquant l’IVG en 10 ans[35].
En conséquence, le personnel médical se sent très peu valorisé par cette activité, que ce soit moralement, par le poids des académies médicales, ou financièrement, à cause des coupes budgétaires dans les services de santé publique.
Israël Nisand, dans son interview pour Le Monde, explique sa position contre l’allongement du délai: “Il y a un problème de mauvaise santé de l’hôpital. On manque de personnels et donc cela joue sur tout : l’accès aux césariennes, à l’accouchement et à l’avortement.”[36]
La dévalorisation de cette activité et le poids des institutions médicales, comme l’académie de médecine, défavorable aux allongements de délais, pèse inconsciemment sur les choix des médecins, nombreux à refuser de pratiquer les IVG. L’allongement de la période d’IVG a entraîné chez certains médecins un retrait total de cette activité. Le problème est que, derrière les valeurs idéologiques des médecins, le temps est compté pour les personnes en demande.
Avec un taux de 200 000 IVG pratiquées en France chaque année, le nombre d’IVG reste stable depuis les années 2000[37]. Dorothée Bourgault-Coudevylle, dans l’article “L’interruption volontaire de grossesse en 2011. Réflexions sur un acte médical aux implications controversées“, soutient que la suppression du recours à l’IVG reste impensable, niant les inégalités et les problématiques liées à la contraception[38].
De plus, aucune politique publique ne pourrait permettre une maîtrise parfaite de la contraception[39]. Ainsi selon l’enquête de l’IGAS, l’IVG serait « un comportement structurel de la vie sexuelle et reproductrice de la femme devant être pris en compte en tant que tel »[40]. L’accessibilité de cette pratique est donc un enjeu sanitaire fondamental, afin d’éviter tout danger physique et moral aux personnes détentrices d’un utérus, ce au nom de quoi les gouvernements successifs ont légiféré depuis 1975. Ainsi, la nouvelle loi est un progrès, mais demeurant insuffisant face à des contraintes d’accessibilité, conséquences doubles des effets du sexisme et du capitalisme.
[1] Solène, C., Olivier, F., Mariama, D. (2020, 07 octobre). Les députés examinent l’allongement du délai pour avorter Le Monde.
[2] Le Monde avec AFP. (2020, 16 septembre). Un rapport de l’Assemblée nationale recommande d’allonger la limite légale d’une IVG Le Monde.
[3] Le Monde avec AFP. (2020, 8 octobre). L’allongement du délai légal pour une IVG voté, en première lecture, à l’Assemblée Le Monde.
[4] Selon le texte de présentation de la loi sur le site de l’Assemblée nationale : “Instauré par la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, le système de « double clause de conscience » correspond à la superposition d’une clause de conscience générale, de nature réglementaire, inscrite à l’article R. 4127‑328 du code de la santé publique, qui autorise les médecins à s’abstenir de pratiquer un acte médical et d’une clause spécifique à l’IVG, de nature législative, inscrite à l’article L. 2212‑8 du même code. La rédaction de cet article visait à rassurer les praticiens et à offrir une garantie aux patientes, en rappelant cette faculté en matière d’IVG et en conditionnant l’exercice de cette clause de conscience à une obligation d’information et d’orientation des patientes”.
[5] Selon le texte de proposition de loi n° 3375 : “cette proposition de loi prévoit de substituer à la rédaction actuelle de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, redondante, une rédaction reposant sur l’obligation d’information et d’orientation des patientes. La rédaction proposée ne doublonne ni ne contredit la clause de conscience prévue à l’article R. 4127‑328 du même code mais elle en tire les conséquences.”
[6] site assemblée nationale
[7] article 4 de la proposition de loi n°3375 : “La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts”.
[8] Le Monde avec AFP. (2020, 8 octobre). L’allongement du délai légal pour une IVG voté, en première lecture, à l’Assemblée Le Monde.
[9] Marlène, T. (2020, 12 octobre). Projet de loi sur l’IVG : l’Académie de médecin et l’Ordre des médecins défavorables Libération.
[10] Propos recueillis par Solène Cordier. (2020, 07 octobre). Délai pour avorter : “Effectuer une IVG à quatorze semaines de grossesse n’a rien d’anodin” Le Monde.
[11] Bajos, N. & Ferrand, M. (2011). De l’interdiction au contrôle : les enjeux contemporains de la légalisation de l’avortement. Revue française des affaires sociales, , 42-60.
[12] Ibid.
[13] Divay, S. (2003). L’ivg : un droit concédé encore à conquérir. Travail, genre et sociétés, 9(1), 197-222.
[14] Olier, L. (2011). Présentation du dossier. La prise en charge de l’IVG en France : évolution du droit et réalités d’aujourd’hui. Revue française des affaires sociales, , 5-15.
[15] Article L2212-2 du Code de la santé publique : “L’interruption volontaire d’une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme.Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d’une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d’éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
[16] Bajos, N. & Ferrand, M. (2011). De l’interdiction au contrôle : les enjeux contemporains de la légalisation de l’avortement. Revue française des affaires sociales, , 42-60.
[17] Enquête sur le contexte de la sexualité en France (CSF), conduite en 2006 auprès d’un échantillon aléatoire de 12384 femmes et hommes de 18-69 ans (Bajos et Bozon, 2008)Bajos N., Bozon M. (dir.) (2008), Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé, Paris, Éditions La Découverte.
[18] Divay, S. (2003). L’ivg : un droit concédé encore à conquérir. Travail, genre et sociétés, 9(1), 197-222.
[19] Bajos, N. & Ferrand, M. (2011). De l’interdiction au contrôle : les enjeux contemporains de la légalisation de l’avortement. Revue française des affaires sociales, , 42-60.
[20] Divay, S. (2003). L’ivg : un droit concédé encore à conquérir. Travail, genre et sociétés, 9(1), 197-222.
[21] Solène, C., Olivier, F., Mariama, D. (2020, 07 octobre). Les députés examinent l’allongement du délai pour avorter Le Monde.
[22] Loi de 1975 sur le droit à l’avortement, 1975, art.4 – L162.3
[23] Divay, S. (2003). L’ivg : un droit concédé encore à conquérir. Travail, genre et sociétés, 9(1), 197-222.
[24] Hassoun, D. (2011). [Témoignage]. L’interruption volontaire de grossesse en Europe. Revue française des affaires sociales, , 213-221.
[25] Robinson G.E., Stotland N.L., Russo N.F., Lanf J.A. (2009), “Is there an ‘abortion trauma syndrome’ ? Critiquing the evidence”, Harvard Review of Psychiatry, 17 (4): 268-90.
[26] Bajos, N. & Ferrand, M. (2011). De l’interdiction au contrôle : les enjeux contemporains de la légalisation de l’avortement. Revue française des affaires sociales, , 42-60.
[27] IFOP. (2020). Les Français et l’IVG.
[28] Duchêne, L., Fontana, M., Ponticelli, A., Vaugelade, A., Wajeman, L. & Lalande, A. (2014). L’IVG, quarante ans après. Vacarme, 67(2), 1-23.
[29] E. Jeandet-Mengual (2002), Rapport d’activité du Groupe national d’appui à la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, Inspection générale des Affaires sociales.
[30] Duchêne, L., Fontana, M., Ponticelli, A., Vaugelade, A., Wajeman, L. & Lalande, A. (2014). L’IVG, quarante ans après. Vacarme, 67(2), 1-23.
[31] Ibid
[32] E. Jeandet-Mengual (2002), Rapport d’activité du Groupe national d’appui à la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, Inspection générale des Affaires sociales.
[33]Aubin C., Jourdain-Menninger D., Chambaud L. (2009a), Évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001, Inspection générale des Affaires sociales.[34]Collet, M. (2011). Un panorama de l’offre en matière de prise en charge des IVG : caractéristiques, évolutions et apport de la médecine de ville. Revue française des affaires sociales, , 86-115.
[35] Annick Vilain (DREES), 2019, « 224 300 interruptions volontaires de grossesse en 2018 », Études et Résultats, n°1125, Drees, septembre.
[36] Solène, C., Olivier, F., Mariama, D. (2020, 07 octobre). Les députés examinent l’allongement du délai pour avorter Le Monde.
[37] Annick Vilain (DREES), 2019, « 224 300 interruptions volontaires de grossesse en 2018 », Études et Résultats, n°1125, Drees, septembre.
[38] Bourgault-Coudevylle, D. (2011). L’interruption volontaire de grossesse en 2011. Réflexions sur un acte médical aux implications controversées. Revue française des affaires sociales, , 22-41.
[39] Bajos, N. & Ferrand, M. (2011). De l’interdiction au contrôle : les enjeux contemporains de la légalisation de l’avortement. Revue française des affaires sociales, , 42-60.
[40] Aubin C., Jourdain-Menninger D., Chambaud L. (2009a), Évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001, Inspection générale des Affaires sociales.