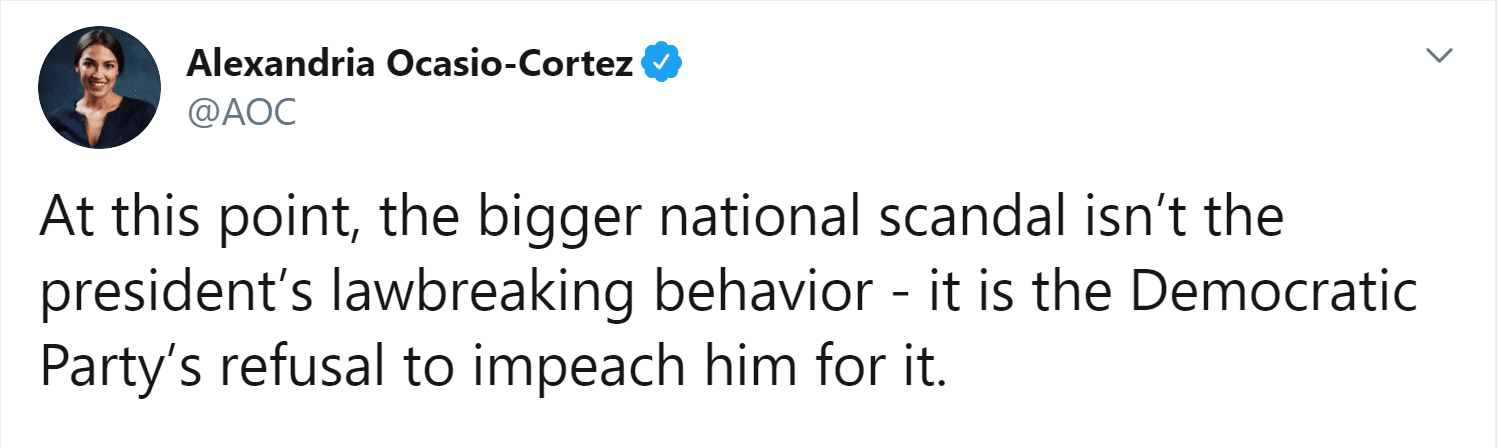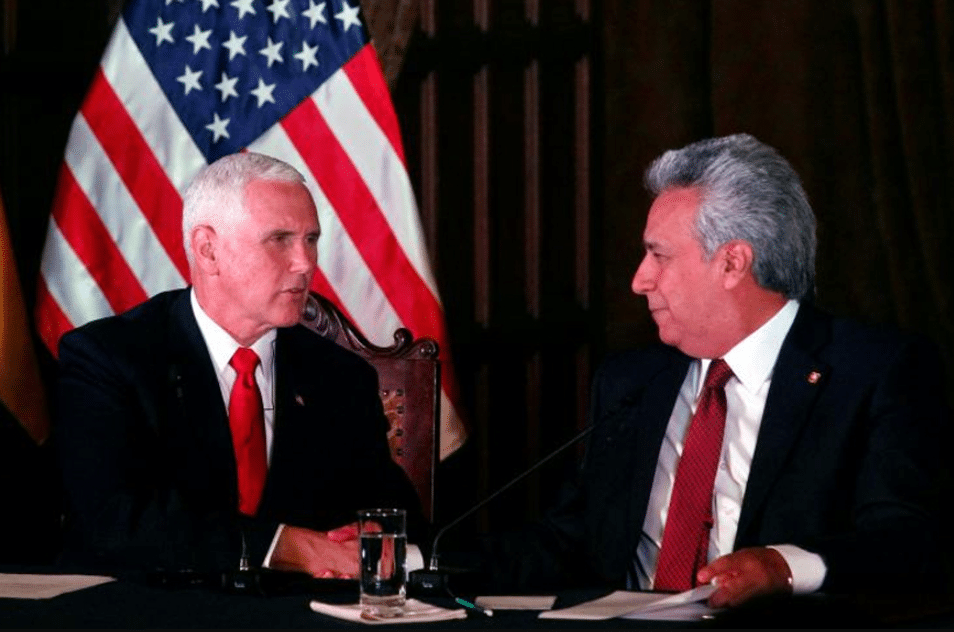Après Lula, après l’ex-chef d’État équatorien Rafael Correa (condamné à huit ans de prison), c’est la vice-présidente argentine Cristina Kirchner qui écope d’une sentence de six ans de prison – pour attribution illicite de marchés publics. Si sa fonction lui confère l’immunité, le retentissement est considérable dans la vie politique du pays. L’opposition menée par l’ex-président Mauricio Macri crie au scandale de corruption. Les partisans de Cristina Kirchner – soutenus par une grande partie de la gauche latino-américaine – dénoncent de multiples vices de procédure et la dimension politique de la justice argentine. Au-delà de la rupture de la présomption d’innocence et de la partialité des juges, ils cherchent à mettre en lumière des liens incestueux entre le pouvoir judiciaire, le monde médiatique, les élites économiques et l’entourage de l’ex-chef d’État Mauricio Macri.
C’est pour « administration frauduleuse » que la vice-présidente Cristina Kirchner a été condamnée à six ans de prison. Elle est accusée d’avoir organisé une vaste affaire de surfacturations et d’allocation illicite de fonds durant sa présidence (2007-2015) en faveur de l’homme d’affaires Lázaro Baez. C’est plus d’un milliard de dollars que celui-ci aurait perçu par l’entremise de marchés publics, à l’issue de 51 contrats conclus avec les autorités argentines. Protégée par sa fonction de vice-présidente, Cristina Kirchner échappe pour le moment à la prison. Elle peut également recourir en appel à des instances supérieures : la Chambre de cassation, puis la Cour suprême. Il n’en demeure pas moins que sa condamnation porte un coup significatif au gouvernement de coalition qu’elle dirige aux côtés du président Alberto Fernandez.
Pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire
La temporalité du jugement interroge. Depuis son élection en 2007, Cristina Kirchner a fait l’objet de nombreuses demandes de mise en examen. La grande majorité d’entre elles n’ont pas été retenues, faute d’éléments probants. Les choses changent en 2015 lorsqu’elle termine son mandat et que le candidat qu’elle soutenait perd l’élection face à Mauricio Macri – partisan d’une libéralisation à marche forcée de l’économie et d’un rapprochement diplomatique avec les États-Unis. Les autorités judiciaires multiplient alors les procédures contre Cristina Kirchner.
Elle est notamment mise en cause dans le cas « Mémorandum contre Iran » et « Vialidad ». Le premier concerne un sordide attentat terroriste perpétré contre la communauté juive de Buenos Aires en 1994 supposément commandité par la République islamique d’Iran – ce que celle-ci a toujours nié et alors que d’autres pistes existent concernant cette attaque-, que la présidente Kirchner aurait protégée à dessein pour conserver ses bonnes relations diplomatiques avec le pays1. Le second concerne les surfacturations supposément effectuées en faveur de Lázaro Baez.
La nature des éléments avancés contre Cristina Kirchner pose question. Certains ont été obtenus grâce à des écoutes illégales de l’ancienne présidente – ses défenseurs avancent qu’elles proviennent des services argentins, dont l’opacité a été renforcée durant la présidence Macri
Ces procès coïncident avec des nominations de personnalités politiquement alignées sur le chef d’État Mauricio Macri à la tête de plusieurs organes judiciaires, au prix de nombreuses entorses à la légalité et de modifications législatives a posteriori. Cinq jours seulement après son élection, Mauricio Macri désigne par décret deux juges à la tête de la Cour suprême et court-circuite le Sénat – dont l’approbation aurait été requise s’il avait suivi une procédure ordinaire.
L’Unité d’information financière (UIF) et l’Officine anti-corruption (OA), deux organes qui possèdent des pouvoirs étendus en termes d’investigation et de saisine des autorités judiciaires, voient leur direction renouvelée. L’UIF est confiée à Mariano Federici, ancien conseiller au Fonds monétaire international (FMI), tandis que l’OA est remise à Laura Alonso, une députée membre du parti de Mauricio Macri. Elle était alors l’une des principales figures publiques réclamant la mise en accusation de l’ex-présidente dans l’affaire « Mémorandum contre Iran »2. Puisqu’elle n’était pas avocate, condition nécessaire pour prendre la tête de l’OA, Mauricio Macri a du modifier les statuts de l’organe par décret3.
La nomination de ces personnalités – notoirement et violemment hostiles à Cristina Kirchner – a fait craindre une « politisation » d’organes censés demeurer indépendants de l’orientation idéologique de l’exécutif. L’UIF et l’OA deviennent rapidement partie prenante dans les divers procès initiés contre l’ex-présidente. Il leur est reproché de rouvrir des dossiers déjà clos par les institutions judiciaires.
À l’inverse, plusieurs personnalités qui ont pris la défense de Cristina Kirchner sont limogées par le président Macri4. Le cas de la procureure générale Alejandra Gils Carbó est emblématique. Celle-ci fait l’objet d’une campagne d’intimidation médiatique, tandis que l’exécutif cherche à la démettre. Le média conservateur Clarín va jusqu’à publier le numéro de téléphone portable de sa fille de 26 ans…
Loin de déplorer ce climat de tensions, le président Macri lui-même déclare publiquement que la procureure générale ne détient pas « l’autorité morale » nécessaire pour exercer cette fonction. Acculée, elle finit par démissionner en décembre 2017.
Eduardo Casal, qui partage les vues de Mauricio Macri, est alors nommé par ce dernier – au prix d’une entorse légale : le Sénat, dont deux tiers des membres doit approuver la nomination, n’est pas convoqué5. L’autonomie de cet organe est alors fortement réduite par rapport au pouvoir exécutif. Il possède des prérogatives étendues en termes d’investigation – et récoltera des informations à charge qui seront brandies contre les partisans de Cristina Kirchner durant les procès.
Une autre réforme significative renforce la capacité de l’exécutif à recueillir des informations confidentielles. En mai 2016, Mauricio Macri initie une refonte de l’Agence fédérale des renseignements intérieurs (Agencia federal de inteligencia, AFI)6, qui consacre le secret de l’allocation de certains fonds. En a-t-il profité pour mettre sur écoute l’ancienne présidente, à présent cheffe de file de l’opposition ? C’est ce dont ses partisans accuseront Mauricio Macri, des années plus tard, dans le cadre de l’affaire « Vialidad », lorsqu’il a été découvert que les accusateurs possédaient des enregistrements illégaux de celle-ci…
Collusion entre l’exécutif et les instances judiciaires ? Les défenseurs de Cristina Kirchner pointent également le rôle des organes de presse – pour la plupart propriété de grandes fortunes nationales. « Des juges et procureurs bien identifiés ont réenclenché des procédures à des moments politiques clefs, cherchant à trouver un écho auprès des principaux médias », dénonce la chercheuse Silvina Romano7. Ils dénoncent un « harcèlement judiciaire » : sur les 650 demandes de mise en examen de l’ex-présidente, six personnes en ont effectuées entre 20 et 70. « Cette dynamique destinée à générer un consensus médiatique à l’encontre de Cristina Kirchner s’est fortement radicalisée l’année qui a précédé les élections présidentielles [de novembre 2019 NDLR] ».
Une affaire a récemment fait les choux gras des partisans de Kirchner. Elle concerne un séjour dans une villa luxueuse financé par le groupe médiatique Clarín, d’obédience conservatrice. On y trouve des hauts-fonctionnaires proches de l’ancien président Macri, des hommes de média ou des figures juridiques clefs de l’opposition à Cristina Kirchner
Ils pointent du doigt une presse borgne, qui scrute par le menu chacune des rumeurs touchant Cristina Kirchner, mais ignorent les nombreux cas de corruption qui éclaboussent Mauricio Macri. Le nom de ce dernier apparaît au sein des Panamá papers, dans la comptabilité d’une société offshore siégeant aux Bahamas7. Il est à l’origine du scandale « correo argentino » : une fois élu président, Macri aurait tenté d’effacer une dette contractée par sa famille envers l’État argentin. Mais le procureur en charge de cette affaire, Juan Pedro Zoni, a été démis en 2018 par le procureur général Eduardo Casal lui-même nommé par Macri… Il est également compromis dans l’affaire Odebrecht, la fameuse multinationale brésilienne du BTP ayant arrosé de nombreux politiciens latino-américains. Si au Brésil ce scandale est à l’origine de l’emprisonnement de Lula, si en Équateur il a conduit à une peine de prison de huit ans pour Rafael Correa, en Argentine la presse est demeurée relativement silencieuse concernant Mauricio Macri, et les autorités judiciaires n’ont jamais inquiété le président…
Vices de procédure
Dans l’affaire « Vialidad », c’est d’abord sur l’aspect juridique que les défenseurs de Cristina Kirchner interpellent. « Il y a de multiples vices de procédure. En aucun cas il ne s’agit d’un procès ordinaire. Plusieurs garanties ont été violées », tranche Elizabeth Gomez Acorta, ex-ministre des femmes d’Argentine.
C’est d’abord le manque d’impartialité des juges qui est déplorée. La Constitution argentine précise qu’en aucun cas un juge ne peut prononcer une sentence s’il existe un « soupçon ou une crainte de partialité » à l’encontre de l’accusé. Or Rodrigo Giménez Uriburu, l’un des trois juges à avoir prononcé la sentence contre Cristina Kirchner, a été aperçu jouant au football dans l’une des résidences personnelles de l’ex-président Mauricio Macri…
La nature des éléments avancés contre Cristina Kirchner pose également question. Certains ont été obtenus grâce à des écoutes illégales de l’ancienne présidente – ses défenseurs avancent qu’elles proviennent des services argentins, dont l’opacité a été renforcée durant la présidence Macri. D’autres l’ont été par l’entremise de témoignages non pas prononcés devant les juges, comme le veut la procédure, mais lus par des intermédiaires – ce qui contrevient au code pénal argentin8.
Enfin, la défense de Cristina Kirchner déplore la violation de sa présomption d’innocence, et l’inversion de la charge de la preuve. Les multiples contrats supposément surfacturés en faveur de Lázaro Baez lui ont été attribués dans le cadre des budgets nationaux, qui ont tous été approuvés par l’Assemblée et vérifiés par des organes de contrôle autonomes. L’accusation avance que les parlementaires et les membres de ces organes auraient reçu des pots-de-vin et cédé à des entreprises de manipulation. De ceux-ci, aucune trace matérielle n’a pu être trouvée ; simplement des témoignages, dont certains n’ont pas même été prononcés par leur auteur dans l’enceinte du tribunal…
Si l’accusation de « participation à une organisation criminelle » n’a pas été retenue par les juges, Cristina Kirchner a en revanche été reconnue comme « cheffe d’association illicite ». Ce n’est pas la première fois qu’un ex-chef d’État, en Amérique latine, est condamné à une peine significative sur la base de preuves aussi faibles. Lula, alors qu’il était membre de l’opposition, avait été emprisonné, alors même que le juge Sergio Moro, pièce maîtresse de son procès, avait admis dans un échange privé ne pas détenir de preuve de sa culpabilité. De la même manière, Rafael Correa avait été condamné à huit ans de prison pour « corruption » dans le cadre de l’affaire Odebrecht ; en l’absence de preuves matérielles concernant les liens supposés entre l’ancien président et des corrupteurs affiliés à la multinationale brésilienne, les accusateurs en avaient conclu à une « influence psychique » du premier sur les seconds…
Juges et médias
C’est ainsi que Cristina Kirchner, soutenue par l’ensemble de la gauche latino-américaine, se déclare victime d’une entreprise de lawfare – une guerre judiciaire que les élites argentines mèneraient contre elle. Juges, médias, pouvoirs économiques et organes proches de l’exécutif auraient-ils concouru pour persécuter ses partisans et renforcer le pouvoir néolibéral de Mauricio Macri ?
Une affaire, révélée par les journalistes Raúl Kollman et Irina Hauser, a récemment fait les choux gras des partisans de Kirchner. Elle concerne un séjour dans une villa luxueuse propriété du milliardaire Joe Lewis, proche de Mauricio Macri, financé par le groupe médiatique Clarín, d’obédience conservatrice. On y trouve des hauts-fonctionnaires proches de l’ancien président Mauricio Macri, comme Leo Bergroth, ancien chef des affaires juridiques de l’Agence fédérale de renseignement (AFI) – celle-là même qui est soupçonnée d’avoir mis sur écoute Cristina Kirchner. Des hommes de média, comme le spécialiste de campagnes électorales en médias numériques Tomás Reinke. Ou des figures juridiques clefs de l’opposition à Cristina Kirchner, comme Julián Ercolini, juge chargé de procès contre celle-ci à trois reprises.
Le groupe Clarín lui-même, propriété de grandes fortunes argentines, possédait quelques griefs à l’égard de l’ex-présidente. Celle-ci avait fait voter une « loi sur le secteur audiovisuel » qui visait à limiter la collusion entre secteur privé et médias. Malgré son adoption, une décision de justice – rendue par le magistrat Pablo Gabriel Cayssials, lui aussi présent à cette réunion – avait permis au groupe Clarín d’y échapper.
Les journalistes révèlent que les protagonistes ont édité de fausses factures pour faire croire qu’ils avaient payé leur déplacement – et non le groupe Clarín. Voir son déplacement défrayé par un groupe médiatique qui ne cache pas son orientation idéologique aurait en effet contrevenu à l’impératif d’impartialité des juges.
Si donc la gauche latino-américaine exagère parfois l’importance des collusions entre élites judiciaires, médiatiques et économiques ; s’il lui arrive de crier au « lawfare » pour éviter d’avoir à traiter les affaires de corruption en son sein ; si enfin elle surestime souvent le degré de coordination des juges et des médias lors des procès dont elle est régulièrement l’objet, est-elle uniquement paranoïaque ou de mauvaise foi lorsqu’elle dénonce ceux-ci comme « politiques » ?
Notes :
1 Une partie de l’opposition accusait Cristina Kirchner de cacher à dessein des éléments compromettants pour la République islamique d’Iran. Le décès du procureur Alberto Nisman, qui souhaitait l’inculpation de l’ex-présidente, a conféré à l’affaire une portée médiatique sans précédent. Retrouvé sans vie dans sa salle de bains en 2015, il a été érigé en martyr par l’opposition.
2 Amie personnelle du procureur Nisman, Laura Alonso a témoigné devant tribunaux et médias pour accréditer la thèse d’un meurtre par des partisans de Cristina Kirchner. La thèse d’un suicide – Alberto Nisman n’était parvenu à recueillir aucun élément probant contre l’ex-présidente – est aujourd’hui privilégiée.
3 Décret 226/15.
4 Comme le magistrat Eduardo Freiler et le juge Daniel Rafecas. Ce dernier s’opposait notamment à Alberto Nisman, à qui il reprochait de porter des accusations infondées contre Cristina Kirchner dans le cadre de l’affaire « Mémorandum contre Iran ».
5 Loi 24.946, art. 5.
6 Décret 656/2016.
7 Il s’agit de Fleg Trading : https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15002701
8 Art. 393.