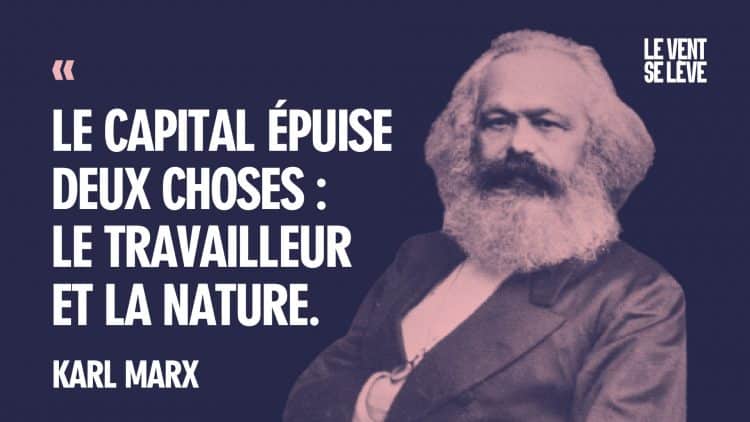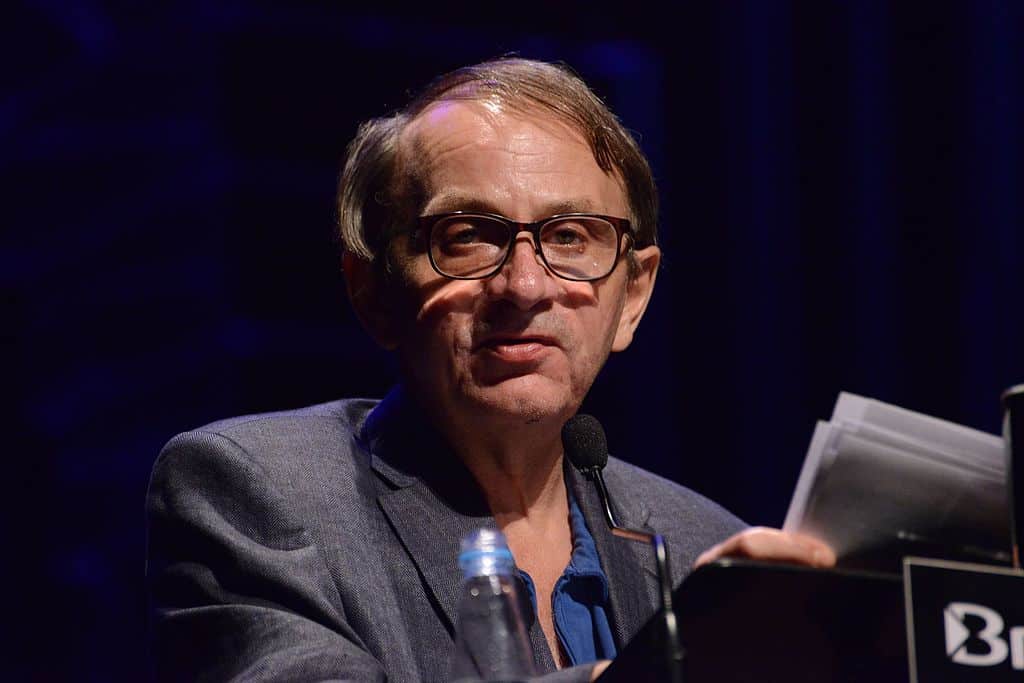Alors que l’eau devient une marchandise comme une autre au Chili, les employeurs européens ne fournissent plus de vélos aux livreurs des plateformes. Tandis que Jeff Bezos s’envole dans l’espace, la planète brûle de l’Australie à la Californie… Le point commun entre ces faits ? La quête du profit. Si cette obsession pour l’appât du gain est critiquée pour ses abus, beaucoup n’y voient que la marque d’une cupidité excessive de certains entrepreneurs. Or, cette quête du profit maximum est intrinsèque au mode de production capitaliste. C’est du moins le postulat fondamental de la notion marxiste de baisse tendancielle du taux de profit. Elle permet de penser des phénomènes en apparence aussi divers que la concurrence oligopolistique, la plateformisation de l’économie, la financiarisation, ou encore la prédation exercée sur l’environnement, comme l’émanation d’un même mécanisme fondamental.
Comment expliquer la valeur que prennent les biens dans la société ? Pour Karl Marx, la valeur d’un bien est constituée par sa valeur d’usage, c’est-à-dire la valeur procurée par son utilisation, et sa valeur d’échange, qui correspond à la quantité de travail moyen nécessaire à sa fabrication. Si toute la richesse est produite par les travailleurs, elle ne leur revient pas entièrement, loin s’en faut : les détenteurs des moyens de production s’accaparent une part de la valeur produite par les travailleurs via les revenus du capital. Le taux de profit est défini comme étant le rapport de la survaleur (l’excédent récupéré après les ventes de marchandises et le paiement des salaires) sur la somme du capital constant (les machines et matières premières) et du capital variable (la masse salariale ). Ainsi, en vue de maintenir ou d’augmenter son profit, les détenteurs de capital ont trois options :
1 – Augmenter la survaleur ;
2 – Diminuer la part de capital constant ;
3 – Diminuer la part de travail rémunéré.
Une des clés pour augmenter les taux de profit est l’innovation technique, qui permet de produire avec plus de machines – que Marx identifie comme étant une accumulation de travail vivant passé – et moins de force de travail vivante. En réduisant la part de la rémunération du travail vivant dans la production, les détenteurs de capital espèrent ainsi soit conquérir de nouvelles parts de marché en diminuant les prix de vente, soit, à prix de vente constants, augmenter leurs marges. Ce mode de production repose cependant sur une contradiction inhérente : c’est en cherchant à diminuer la part de ce qui permet pourtant leur plus-value (le travail vivant de leurs employés, seuls producteurs) que les employeurs entendent augmenter leur profit.
Face à la menace permanente d’une baisse du taux de profit, l’une des stratégies fondamentales des employeurs est de chercher à s’implanter sur de nouveaux marchés. À ce titre, l’État joue un rôle fondamental.
En effet, les entreprises rivales sur un même marché ne tardent jamais à s’imiter mutuellement et l’avantage compétitif obtenu grâce aux innovations techniques devient caduc. C’est bien cette dynamique que l’on identifie comme étant la baisse tendancielle du taux de profit : celle qui pousse les employeurs à recourir à moins de travail vivant pour bénéficier d’un avantage sur leurs concurrents… alors même que cet avantage n’est que temporaire puisqu’ils seront bien vite imités. Ce nivellement par le bas de l’usage de la force de travail est une contradiction interne du système capitaliste qui le rend instable, puisque c’est sur l’exploitation de cette force de travail que les employeurs fondent leur pouvoir économique.
Si le concept de baisse tendancielle du taux de profit fait l’objet de nombreuses controverses, il demeure pertinent pour comprendre certaines dynamiques actuelles du capitalisme. D’une part, cette grille de lecture permet de comprendre l’extension permanente des sphères lucratives, la déresponsabilisation des entrepreneurs vis-à-vis de l’appareil productif, et le suicide environnemental dans une même logique. D’autre part, elle permet de saisir la nécessité d’adopter un mode de production alternatif pour contrevenir à ce futur.
Comment les accumulateurs de capital s’y prennent-ils pour enrayer cette pente spontanée vers la diminution de leur taux de profit ? Bien des phénomènes qui caractérisent l’économie contemporaine – la concurrence entre groupes oligopolistiques pour la conquête de nouveaux marchés, le développement des plateformes, la financiarisation, la marchandisation des biens naturels, etc. – peuvent être lus à l’aune de cet objectif.
L’État au service de l’accumulation de capital
Face à la menace permanente d’une baisse du taux de profit, l’une des stratégies fondamentales des employeurs est de chercher à s’implanter sur de nouveaux marchés. À ce titre, l’État joue un rôle fondamental. L’idée selon laquelle les politiques néolibérales conduisent à moins d’État, souvent entendue chez une partie de la gauche, est partiellement incorrecte. Les grandes entreprises ont en réalité un besoin éperdu d’État afin de maintenir leur domination sur l’économie et, par ce biais, leur taux de profit. La création de nouveaux marchés par l’État s’effectue par le biais de sa puissance de coercition, ainsi que par l’instauration d’un cadre juridique qui leur est propice – comme le suggérait Marx et l’analysait de manière détaillée Karl Polanyi.
NDLR : Pour une analyse de l’État comme cadre instituant du libéralisme, lire sur LVSL l’article de Marin Lagny : « Polanyi, La grande transformation : de l’économie à la société (néo)libérale »
À mesure que l’autonomie de l’État décroît par rapport aux détenteurs de capital, celui-ci devient une machine à accroître leurs marges. Au sein des dépenses dédiées au service public, une part croissante tend à rémunérer les prestataires des délégations de services publics – ces derniers perdant alors leur caractère socialisé. Les partenariats public-privé, dans lesquels les entrepreneurs financent les infrastructures pour ensuite exiger des loyers exorbitants à l’État et aux collectivités s’inscrivent dans la même logique. La part croissante que l’État consacre aux aides aux entreprises, en particulier aux grands groupes, s’inscrit dans cette logique. Récemment, le travail d’information d’Allô Bercy détaillait la manière dont des milliards d’euros ont été versés aux multinationales sans contrepartie pendant la crise sanitaire, permettant le versement de dividendes indécents aux actionnaires. Cet épisode est loin de relever de l’exception. D’après la Cour des comptes, près de 140 milliards d’euros y sont dédiées chaque année, soit autant que les salaires versés aux fonctionnaires.
Le capitalisme de plateforme au secours de la classe dominante
De la même manière, la plateformisation de l’économie peut être lue à l’aune de cette volonté de lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit.
NDLR : Pour une analyse marxiste du capitalisme de plateformes, lire sur LVSL l’article d’Evgeny Morozov : « « Extraction des données par les GAFAM : aller au-delà de l’indignation »
Il rejoint l’enjeu du travail effectué de façon invisible – et gratuite. La question du travail domestique, encore très largement effectué par les femmes, est un exemple bien connu. Quand une employée de maison exerce les tâches domestiques chez un particulier qui l’emploie, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un travail dans tous les aspects qu’on lui donne. Dès que cette même femme effectue les mêmes tâches effectuées chez elle, celles-ci ne sont plus qualifiées de travail.
Une dynamique semblable peut être observée dans les domaines où l’économie est numérisée – par d’ingénieux artifices, les travaux salariés disparaissent et sont confiés à des travailleurs non payés. Il n’est que de considérer l’exemple de la bascule des démarches administratives vers la numérisation – à l’image de la déclaration des revenus en ligne – pour s’en convaincre. Par le passé, cet exercice était accompli par les agents des impôts et représentait un travail considérable de saisie informatique. Ce travail a subi une forme de privatisation à l’échelle individuelle : l’exécution de la tâche de saisie informatique est directement effectuée par le contribuable derrière son écran. Bien qu’il y ait des vertus à exempter les agents publics d’une telle tâche pénible et répétitive, son élimination a surtout été stimulée par la suppression de postes et l’accroissement de la charge de travail dans ces services. Comme l’analyse avec brio Frédéric Lordon, la délégation à l’individu du tri des déchets s’inscrit dans la même logique : déléguer un travail auparavant effectué par des salariés qualifiés à des citoyens-usagers, non qualifiés, qui le font gratuitement.
Analyser l’ubérisation au travers de la baisse tendancielle des taux de profit permet de comprendre pourquoi les plateformes représentent l’avenir rêvé par les investisseurs. En effet, si les employeurs sont amenés à gagner moins, à part égale de capital constant, ils ont trouvé dans l’ubérisation un moyen de contourner ce problème – n’ayant plus à supporter le « coût » de la production.
Si la classe dirigeante, attachée à la propriété lucrative source de ses profits, cherche donc à investir de nouvelles sphères d’activité pour étendre ses profits, elle semble en parallèle se lancer dans une large dynamique de désinvestissement de l’appareil productif. Il s’agit ici d’une évolution importante. Historiquement, les classes dominantes utilisaient en effet leur propriété de l’outil de travail des travailleurs comme légitimation de la ponction qu’elles réalisaient sur la valeur créée par le travail de ces derniers. Le capitalisme de plateforme rebat les cartes de cet état de fait et offre désormais la possibilité aux possédants de ne même plus avoir à investir dans l’appareil productif : ils peuvent s’en déresponsabiliser en laissant aux travailleurs eux-mêmes le soin d’acquérir leur propre outil de travail. Ainsi, le chauffeur Uber conduit sa propre voiture, le livreur Deliveroo achète lui-même son vélo, etc. Dans cette perspective, « l’apport » du propriétaire lucratif se retrouve réduit à peau de chagrin : il se contente de proposer une intermédiation entre offreurs et demandeurs, sans assumer aucune autre responsabilité, mais continue de ponctionner une part très importante de la valeur économique créée par les travailleurs de plateforme.
NDLR : Pour une analyse des implications sociales et juridiques de l’ubérisation, à lire sur LVSL : « auto-entrepreneuriat : les chaînes de l’indépendance »
Si l’on sait combien cette intermédiation par le capitalisme de plateforme est à la fois mauvaise pour les travailleurs et évitable, l’analyser au travers de la baisse tendancielle des taux de profit permet de comprendre pourquoi les plateformes représentent l’avenir rêvé par les investisseurs. En effet, si les employeurs sont amenés à gagner moins, à part égale de capital constant, ils ont trouvé dans l’ubérisation un moyen de contourner ce problème – n’ayant plus à supporter le « coût » de la production. En définitive, non seulement le capitalisme de plateforme contourne le droit du travail, endette les travailleurs et les rémunère mal, mais il est aussi un moyen pour les possédants de ne plus avoir à s’encombrer de l’appareil productif dans certains secteurs d’activité, tout en continuant à y exercer une ponction. Le fort développement du télétravail à la faveur de la crise sanitaire peut aussi être lu à l’aune de cette dynamique d’abandon, par la classe possédante, de certains coûts intrinsèquement liés à l’activité réelle. Concrètement, généraliser le télétravail est l’opportunité, pour l’employeur, non seulement de casser la cohésion entre salariés, mais aussi de se débarrasser de certains frais inhérents à l’entretien de l’outil de travail : bureaux, matériel informatique, etc.
La financiarisation comme compensation de la baisse des taux de profit
Un autre secteur d’activité permet de générer beaucoup des profits en supportant un faible coût de production : la finance. Si les détenteurs de capitaux jugent encore insuffisante la ponction qu’ils réalisent sur le travail vivant effectué dans l’économie réelle, ils peut choisir d’utiliser leur patrimoine financier comme un levier de profitabilité démultiplié ou, pour reprendre une expression courante (mais passablement erronée), « faire travailler son argent ». Historiquement, la finance passe principalement par les prêts bancaires, qui permettent de recevoir des intérêts pour avoir mis à disposition des fonds servant aux prêts. Dans le capitalisme contemporain, cette logique s’étend aujourd’hui à des entreprises au départ bien éloignées des métiers de la banque. Il est désormais très courant de pouvoir acheter un produit à crédit sans passer par sa banque.
Le concept de baisse tendancielle du taux de profit permet d’aborder avec moins de naïveté la critique du « productivisme » portée par l’écologisme mainstream et médiatique.
Ainsi, les activités bancaires elles-mêmes sont aujourd’hui dépassées en termes de taux de profit par les activités dites « de marchés », c’est-à-dire les paris en Bourse. Rien de plus simple, en effet, que de spéculer sur la hausse ou la baisse d’une valeur, qu’il s’agisse d’une part d’entreprise (action), d’une dette (obligation), du prix des matières premières, d’une monnaie, d’un indice boursier etc. Les plus-values à la clé peuvent être considérables, tandis que les coûts de production sont ridicules, les traders étant d’ailleurs de plus en plus remplacés par des algorithmes.
La finance, monstre froid déconnecté de l’économie réelle ? Les crises financières révèlent au contraire à quel point elle est imbriquée dans celle-ci. Lorsque les détenteurs de capitaux entrent au capital d’une entreprise, c’est parfois pour spéculer, mais aussi pour acquérir un pouvoir décisionnaire sur les orientations de la production et toucher des dividendes. Généralement indifférents à ce que produit l’entreprise et aux conditions environnementales et sociales dans lesquelles s’exercent cette production, les actionnaires sont en revanche particulièrement attentifs à la rente qu’ils vont pouvoir en obtenir. En exacerbant l’obsession du profit déjà présente dans une entreprise indépendante des marchés financiers, en l’indexant sur une logique de spéculation financière, la finance bouleverse donc le régime d’accumulation capitaliste traditionnel, et porte à un degré supérieur l’obsession de maximisation du taux de profit.
Un capitalisme prédateur
L’impact de la rapacité des détenteurs du capitaux sur les travailleurs, mais aussi sur l’environnement, est un leitmotiv majeur de la théorie marxiste. « Le capital épuise deux choses : le travailleur et la nature », écrivait Karl Marx. Dans la théorie marxiste, le capitalisme élimine toutes les restrictions à l’appropriation de la nature – appropriation, car ce processus conduit à tirer des bénéfices du « travail impayé » extra-humain (accumulation géologique, biodiversité…) en les sortant des bilans des entreprises [5]. Les lentes évolutions géologiques et physiques, étalées sur des millions d’années, ayant permis de constituer les réserves d’hydrocarbures, sont ainsi gratuitement accaparées – on peut en dire autant de la surpêche ou de l’utilisation abusive des sols par l’agriculture intensive, qui détruit la biodiversité sans payer un centime, alors que tout le système de production alimentaire repose sur cette ressource si fragile.
La théorie libérale a bien pris en compte le caractère problématique de cette course vers l’accaparement des ressources, pour le recoder dans la grammaire de la théorie coûts / bénéfices [6]. Il s’agit de mettre en balance l’avantage à polluer obtenu par une entreprise, avec les désavantages pour le reste de la société, traduites en langage libéral comme des « externalités négatives ». Bien évidemment, réussir à évaluer précisément les impacts d’un acte polluant, que cela soit par des études statistiques d’augmentation de risques de cancer ou des effets cumulatifs des multiples dégâts environnementaux, se révèle impossible. Sans compter que cette approche ne prend aucunement en compte la disparition progressive des ressources qui n’ont pas une valeur marchande immédiate – autrement dit, tant que le coût de la disparition d’une ressource naturelle n’a pas été comptabilisé et chiffré, il n’existe tout simplement pas.
Le concept de baisse tendancielle du taux de profit permet d’aborder avec moins de naïveté la critique du « productivisme » portée par l’écologisme mainstream et médiatique. Il profit permet en effet de comprendre pourquoi le productivisme est inhérent au mode de production capitaliste : puisque le taux de profit baisse sur chaque unité produite, il faut produire plus en quantité – ce qui est écologiquement préjudiciable. De même, elle permet de comprendre la cause de la frénésie à l’innovation technique de la part des détenteurs de capital : confrontés à une pression de tous les instants pour améliorer le rendement de leur capital fixe, ils se lancent dans une course sans le luxe de se soucier de son impact environnemental.
Lutte pour l’accaparement de nouveaux marchés, plateformisation, financiarisation, prédation sur les ressources naturelles : ces phénomènes peuvent être compris comme une manière de répondre à la baisse tendancielle du taux de profit. Se pose alors la question du dépassement du système économique dominant à l’ère néolibérale. Il est courant d’opposer, dans les cercles hétérodoxes, un capitalisme fordiste-keynésien à un capitalisme néolibéral et financiarisé – pour vanter les vertus du premier et critiquer les effets néfastes du second. Une analyse en termes marxistes conduirait pourtant à considérer que le second est le produit logique du premier : la transition de l’ère fordiste-keynésienne à l’ère néolibérale peut en effet être lue comme une manière parfaitement rationnelle d’enrayer la baisse tendancielle du taux de profit. Est-ce à dire que la critique du néolibéralisme demeure superficielle, tant qu’elle ne prend pas en compte le mécanisme fondamental qui a conduit à l’apparition du néolibéralisme ?
Notes :
[1] Concernant les niches fiscales, les comptes du budget de l’État en 2020 par la Cour des comptes, page 162. Consultable ici.
[2] Concernant les exonérations de cotisations sociales, Les Comptes de la Sécurité Sociale, Résultats 2019 et prévisions 2020, page 58. Consultable ici.
[3] Par-delà Nature et Culture, Philippe Descola.
[4] Manières d’être vivant, Baptiste Morizot.
[5] La Nature dans les limites du Capital, Jason Moore.
[6] La société ingouvernable, Grégoire Chamayou.
[7] En outre, produire en régime capitaliste implique des coûts mathématiquement plus élevés puisqu’il est nécessaire, en plus des dépenses publicitaires et de marketing, de dégager une marge pour le profit, alors même que la production en est exemptée.