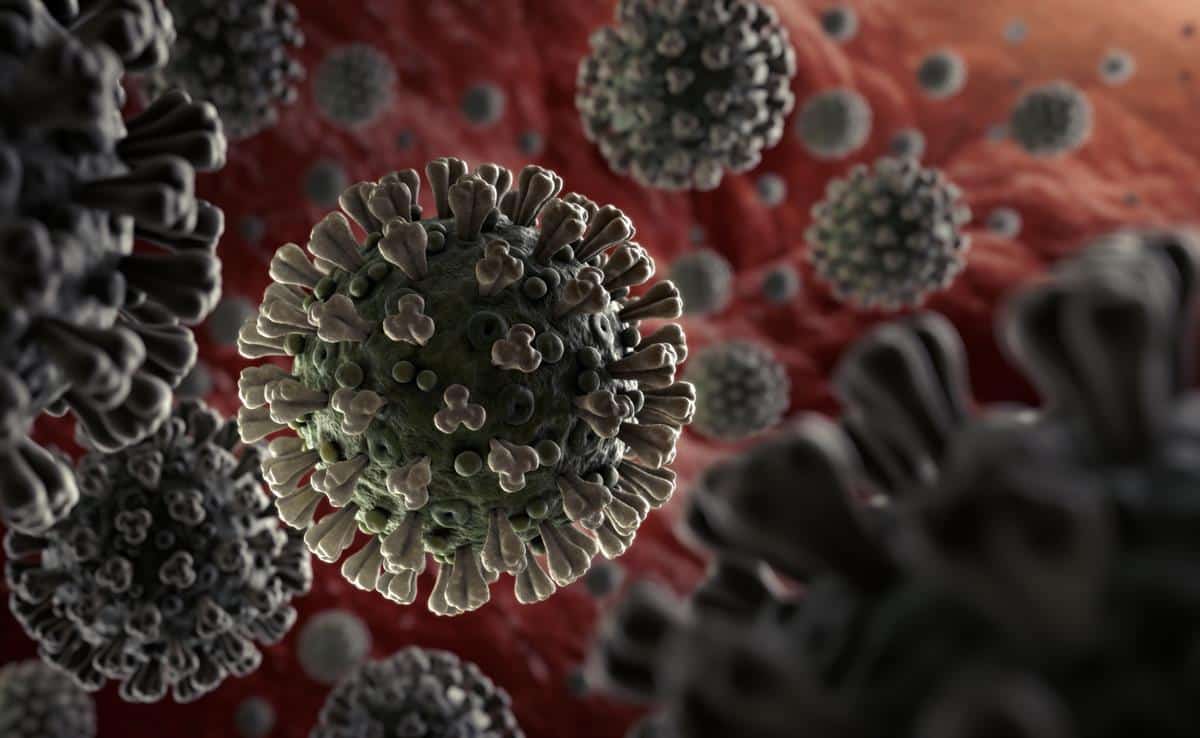« Objet magique, qui permet en quelques décimètres carrés, de voir, de posséder un pays… » écrivait Julien Gracq. À la Renaissance, la carte n’est pas seulement un outil permettant de s’orienter sur un territoire donné, elle est aussi une manière de se représenter le monde et de s’approprier ce dernier en participant à la construction d’un nouvel imaginaire. Dans Le Nord de la Renaissance. La carte, l’humanisme suédois et la genèse de l’Arctique, publié aux éditions Classiques Garnier, Pierre-Ange Salvadori retrace toute l’ampleur de la réforme cartographique opérée à cette période. Décentrement du monde, redéfinition des confins et constructions, ou reconstructions mythologiques septentrionales, tels sont les enjeux auxquels se confronte Pierre-Ange Salvadori afin de mieux comprendre ce qu’était véritablement le Nord de la Renaissance. Les lignes suivantes sont extraites de son ouvrage.
Restons dans la Venise virtuelle de mars 1539, dans l’échoppe où la Carta Marina d’Olaus Magnus, tout juste sortie des presses, est étendue sur un mur, ou peut-être repliée dans un coffre, attendant qu’on la saisisse pour la déplier et l’admirer. Découvrant que la Scandinavie s’étendait sur une immense lande de terre jusqu’aux confins inexplorés de l’Arctique à proximité immédiate du pôle Nord, et que celle-ci pouvait contenir dix fois la Britannia, visualisant, dans le cartouche droit, l’origine scandinave de nombreux peuples d’Europe – et d’au-delà – réunis par une même ascendance gothique, l’observateur attentif pouvait prendre conscience d’une Europe à nouveau septentrionalisée dans son histoire et dans sa géographie. Toute l’œuvre du cartographe et humaniste suédois était là pour montrer que l’humanité antique procédait du Nord, [et que] l’ancienne Rome fut sauvée par le Septentrion après la prise de l’Urbs en l’an 410 par les Goths d’Alaric dont le sac de Rome de 1527 avait ravivé la mémoire en Europe.
Cette carte était bien le témoin du placement de nouvelles espérances au Nord et du déplacement du regard vers ces régions nouvellement cartographiées qui intègrent la culture humaniste de la Renaissance au même moment que le « Nouveau Monde » américain. Une fois déchiffrée et restituée sa grammaire complexe et sacrée, la Carta Marina apparaissait comme une entreprise humaniste de résurrection, sur l’espace cartographique, d’un âge d’or antique, projection sur la carte d’une énergie de renouement, renaissance d’un passé gothique qui devait parler à la place d’un présent maculé de tous les symptômes d’une déliquescence et de l’imminence de la fin des temps, précipitée, selon l’Église de Rome, par l’arrivée de Luther. À l’angoisse eschatologique, la Carta Marina, et avec elle la Renaissance suédoise […] oppose la perspective d’un salut de l’humanité par le Nord, point cardinal investi de connotations et de significations renouvelées par la réforme cartographique d’un espace rendu vivant et mobilisable, en tant que tel, comme ressource spirituelle. […] Le Nord pourrait bien indiquer sur la carte la voie à suivre, comme la boussole pointait au Nord pour guider les navigateurs à la surface de l’océan. Joignant la boussole matérielle à la boussole spirituelle, la Carta Marina septentrionalisait l’Europe et le monde auxquels elle offrait pour sa rédemption un espace et un temps réformés. […]
L’humanisme cartographique nordique joua un rôle cardinal dans ce processus d’expansion géographique au Nord et de déplacement, dans la même direction, du récit des origines et du centre de gravité culturel depuis l’Orient et le Sud, dépassant même, il nous semble, les efforts en ce sens de l’humanisme allemand. Il n’en constitua pourtant qu’une étape sur laquelle on aurait tort de clôturer notre enquête. Le parachèvement de la septentrionalisation de l’Europe, contemporain du déplacement du centre de gravité économique du sud au nord du continent, se trouve probablement dans la fixation du Nord en haut des cartes, acté dans la seconde moitié du XVIe siècle, sanctionné par l’autorité des plus célèbres cartographes de la Renaissance, d’Abraham Ortelius à Gerhard Mercator. Cette dés-orientation de la carte nourrit autant qu’elle documente un renouvellement de la géographie sacrée par une réforme cartographique totale. Celle-ci substitue à l’axe de projection Est-Ouest, dynamique du mythe de croisade et expression d’une espérance sotériologique fixée sur le retour aux origines en Terre Sainte à proximité du paradis terrestre situé en Orient, un axe Nord-Sud, trajectoire du peuplement de l’Europe par les anciens Goths venus du Nord – selon un récit gothiciste alors de plus en plus envahissant – et nouvelle ligne verticale au sommet de laquelle un passage maritime s’ouvre vers l’Asie à travers l’Arctique nouvellement cartographié, espace, chez certains savants, d’un paradis terrestre relocalisé, et en tout cas lieu d’une possible connexion du monde entre ses parties, condition de son « englobement ».
Duisbourg, Rhénanie, petite cité tranquille à la frontière germano-flamande, 1569. Gerhard Kremer, cinquante-sept ans, fils d’un cordonnier de basse extraction, vient de faire imprimer un immense planisphère, qu’il signe du surnom humaniste de Mercator, « marchand ». La nouvelle et géniale projection géographique qui organise l’espace mondial nous est restée sous le nom de « projection de Mercator » ; elle sous-tend encore aujourd’hui notre façon de concevoir le globe, avec l’étirement caractéristique des surfaces terrestres aux extrêmes nord et sud de la carte. Là n’est pas, pourtant, ce qui nous intéresse et qui n’a guère intéressé les savants avant la toute fin du XVIe siècle. C’est ailleurs que notre œil doit se porter s’il veut tenter de reproduire le cheminement probable des premiers regards posés à la surface du planisphère mercatorien. L’œil est en effet spécifiquement attiré vers le médaillon en bas à gauche de la carte, qui met en valeur un espace géographique en particulier. Au centre d’un cadre circulaire domine une montagne immense sous laquelle, au pôle Nord géographique exactement, s’enfouissent les eaux du globe, reliée également par le méridien-origine à un second sommet, lieu du pôle Nord magnétique. Cet espace inspira à n’en pas douter l’île de la Reine de Jules Verne, île du bout du monde, ultima Thule contemporaine et cible enivrante du voyage du capitaine Hatteras. Entourée, dans le cartouche du planisphère mercatorien, de quatre grandes îles séparées par quatre bras de mers agités et dont les littoraux extérieurs sont tous obstrués par des reliefs, cette « montagne noire et très haute » a bien tous les atours du toit du monde. Le regard s’y concentre, comme aidé par la force d’attraction magnétique du pôle. Reproduisant la carte dans l’Atlas publié en 1595 à Duisbourg par son fils Rumold, Gerhard Mercator y ouvre cependant l’entrée de l’île la plus proche de l’Europe, signalant un espace arctique habité et bel et bien accessible, et septentrionalisant l’Europe jusqu’au pôle Nord.

À l’intérieur d’un ensemble de soixante-treize cartes sélectionnées et dessinées avec le plus grand soin et pendant toute une vie passée à colliger les multiples témoignages contradictoires des savants et des explorateurs, cette carte du pôle Nord se fondait pourtant d’abord sur un très mystérieux récit de voyage des années 1360, rédigé par un prêtre dont le périple lui fit parcourir l’Asie, l’Afrique et le « Nord », atteignant les latitudes les plus septentrionales grâce aux « arts magiques », comme l’indique le médaillon explicatif au-dessus du cartouche du planisphère de 1569. À la fin du XVIe siècle, l’Arctique constituait bien un nouvel horizon majeur pour la conscience géographique européenne, un espace inconnu mais nourrissant d’heureuses espérances. C’est par l’Arctique qu’allait peut-être pouvoir se poursuivre l’« englobement du monde », la connexion de ses différentes parties entre elles grâce à la découverte anticipée des passages du Nord-Est et du Nord-Ouest reliant plus rapidement l’Europe, l’Asie et l’Amérique. L’expectative de cette découverte dessinait un puissant horizon d’attente et investissait le Nord arctique d’un rôle sotériologique essentiel et déjà attribué plus en amont dans le siècle au Nord scandinave. La fascination mythique pour le « Passage » prenait à défaut la prudence traditionnelle du cartographe de Duisbourg dans le choix de sa documentation, qui plaçait sans sourciller cet unique récit du XIVe siècle sous les auspices providentiels de la vérité géographique. […] C’était peut-être parce que cet espace arctique prenait parfaitement place dans son schéma cosmologique général, où il venait recoller les pièces d’une Terre en miettes, archipel global dispersé que le pôle venait réagencer dans une nouvelle cartographie signifiante.
La fascination mercatorienne pour le Nord, en lien et sans doute inséparable de sa fascination pour un magnétisme dont il avait fait descendre l’origine du Ciel sur la Terre en la localisant avec précision au pôle Nord, serait à lire comme la pierre de touche d’une œuvre de géographie sacrée renouvelée, par rapport à sa formulation médiévale, par les croyances hétérodoxes du cartographe germano-flamand. Longtemps, la cartographie sacrée avait placé le paradis terrestre en Orient et, partant, l’Est en haut des cartes, afin que le regard de l’observateur pût se concentrer sur un axe partant de Jérusalem au centre de la mappemonde et se dirigeant vers le haut jusqu’au toit du monde édénique et au Christ au sommet de la carte. Le savant orientaliste Guillaume Postel avait entrepris, au mitan du XVIe siècle, une réforme cartographique qui déplaçait le paradis terrestre des Moluques orientales au pôle Nord. Se pourrait-il que Mercator ait suivi son homologue français et investi également la région polaire d’un rôle sotériologique majeur, encryptant cela dit, comme son séjour en prison pour « lutherye » en 1544 l’y incita, ses conceptions religieuses hétérodoxes sur ses cartes ?
Sans qu’il y ait nécessairement à placer le paradis terrestre au pôle Nord, l’herméneutique du monde naturel comme « Livre de la Providence » suffisait bien, à elle seule, à sacraliser le Septentrion, dès lors qu’il devenait, avec l’expectative anticipatoire d’un passage maritime arctique, l’espace par lequel Dieu pourrait faire « converser » entre elles les différentes parties du monde par l’établissement d’une connexion plus rapide que les longs détours transocéaniques. La septentrionalisation de l’Europe deviendrait une nécessité providentielle : par la réorientation des cartes et des axes de projection, l’« englobement du monde » serait facilité, pour le plus grand profit de la couronne découvrant ce passage et pouvant prétendre ainsi à une monarchie universelle.
C’est donc de l’histoire d’une anticipation qu’il s’agira ici. Celle-ci est symptomatique des nouvelles espérances placées dans un point cardinal jusqu’ici méconnu et dédaigné, traditionnellement siège du démon, et progressivement investi, au cours du XVIe siècle, d’un rôle providentiel et salvateur. Lieu du pôle Nord magnétique, l’Arctique attire alors les regards et concentre sur lui une somme d’investigations savantes concernant sa géographie et son histoire, depuis les hautes époques édéniques et arthuriennes et jusqu’au placement contemporain d’un paradis sous ses latitudes. Se jouerait là un épisode du renouvellement de la géographie sacrée par l’hétérodoxie religieuse qui animait nombre des plus célèbres cartographes de la Renaissance et motivait l’invention de nouvelles techniques de projection cartographique : celles-ci permettaient de mettre en valeur la nouvelle dignité acquise par le point cardinal septentrional, qu’il prenne place en haut des cartes ou, parfois, tout à fait au centre, organisant en tout cas de manière inédite l’espace global et contribuant même à son englobement.
[…]
Avec la variété des modèles anthropologiques et des récits mémoriels contenus en elle et dont l’étude de la Scandinavie permet de prendre particulièrement conscience, avec son originalité historique et ses mythes d’originarité, il faut donc voir ici l’Europe signifiée, dans toute sa diversité, « non pas comme une fin, mais comme le premier pallier d’une anthropologie humaniste de la globalité permettant d’aller dans un second mouvement vers la certitude d’une universalité1 ». Entre les apories d’une accumulation d’histoires nationales autosuffisantes et, parfois, les insuffisances consenties d’une histoire globale automotrice ou réduite à une somme d’histoires parallèles, il faudrait considérer les vertus heuristiques d’une échelle d’analyse intermédiaire européenne dans la compréhension de phénomènes historiques globaux. Aux prémisses de ce jeu d’échelles est l’impossibilité de donner sens à de tels phénomènes sans les inscrire dans un cadre de compréhension qui doit parfois d’abord être celui de l’Europe avant de pouvoir trouver celui du monde, et qui en tout cas n’est pas celui de la nation : comme l’expriment Martin Lewis et Kären Wigen, « transcender l’eurocentrisme requiert initialement de se confronter étroitement à la pensée européenne2 ». La condition et le préalable de l’Europe provincialisée de Dipesh Chakrabarty seraient ainsi une Europe préalablement détourée géographiquement et, autant que possible, circonscrite herméneutiquement – sinon de quelle province parle-t-on3 ? Et c’est parce que l’Europe est par nature une succession de contingences historiques qu’elle est d’ailleurs une image même de l’opération historiographique et de ses achoppements incessants, prenant la forme d’une certaine idée de l’Europe qui, en tant qu’elle est incertaine, mériterait de sortir du refoulé4. C’est parce qu’à rebours de toute téléologie l’Europe est non hypostase mais hypothèse qu’elle éclaire peut-être si bien le passé. Elle permettrait de réévaluer à la hausse les mérites d’une histoire qui, sans être utilitariste – parce qu’« une histoire qui sert, c’est une histoire serve5 » –, refuserait en tout cas de définir son objet comme l’impératif catégorique d’une connaissance historique conçue comme certitude, et viserait plutôt l’hypothétique, condition d’une pensée libre et vivante6. Une histoire magistra vitæ serait donc en fait possible, entendu qu’en empruntant ce chemin de sortie de la plus sèche neutralité axiologique et du plus strict positivisme, on ne débouche pas sur l’impasse d’une essentialisation civilisationnelle mais sur une ligne de crête historiographique où remonte et résonne, depuis la vallée de l’histoire, l’écho de la quête, depuis le XVIe siècle et l’éclatement de la chrétienté, d’une unité et d’une totalité d’être.
Ce qui nous intéresse est donc la naissance d’une certaine idée du Nord dont doivent être rendues et laissées apparentes les intrications avec une certaine idée de l’Europe et une certaine idée du monde, toutes nées au XVIe siècle. Nous pourrions dire : savoirs du Nord, savoirs de l’Europe, savoirs du monde ; mais nous suspectons que ce qui nous préoccupe est un reste, parcellaire, conservé mais occulté, qui ne recoupe pas l’entièreté des savoirs sur ces espaces emboîtés, qui est moins un objet de savoir qu’une fonction, celle qui permet précisément de passer d’une catégorie à l’autre, […] du nord de la Scandinavie au nord de l’Europe puis au nord du monde. L’idée même du Nord, qu’il soit scandinave, arctique, plus largement européen ou cardinal et, partant, universel, aurait donc joué en Europe une place centrale dans la genèse d’une pensée globale telle qu’elle s’exprimait sur les cartes de la fin du XVIe siècle qui anticipaient la découverte d’un passage maritime au Nord vers l’Asie. Celui-ci permettrait virtuellement et visuellement de réaliser, à la fin de la Renaissance, l’« englobement du monde » dont parle Antonella Romano, processus qui se comprend peut-être encore plus clairement dans la traduction anglaise « encompassing the world7 » : se représenter et rendre pensable un monde dont les parties sont connectées, égalisées ou commensurables. Lorsque le Nord sur la boussole géographique (compass) indique le lieu d’une possible connexion maritime écourtée entre des parties égalisables du monde, les points cardinaux (compass points) se rapprochent les uns des autres et le Nord vient à relier entre eux l’Est et l’Ouest, comme Gerhard Mercator l’ambitionne, dans la légende de sa carte du pôle Nord intégrée à son Atlas de 1595 :
Par une carte générale, bienveillant lecteur, de toute la terre et des quatre parties reproduites et énoncées méthodiquement selon l’ordre de la nature, j’ai décidé, à l’imitation du premier des cosmographes, Ptolémée, de commencer par le pôle lui-même et les régions sises à son entour, en une géographie de chacune des petites parties successivement, de manière qu’en descendant du haut vers le bas et en progressant de la gauche vers la droite, j’amène peu à peu le Septentrion et l’Auster à se rejoindre, ainsi que l’Occident et l’Orient ; je prie et conjure Dieu très bon et très grand pour que cette entreprise soit heureuse et favorable pour moi et pour la république chrétienne8.
[…]
L’idée d’un rôle salvifique du Septentrion était donc bien disponible et appelée à être investie politiquement. Mise essentiellement au service des princes protestants qui prétendaient apporter à la chrétienté son salut tant espéré, elle fut aussi à l’occasion mobilisée dans le monde catholique, lorsque les développements politiques pouvaient trouver une résonance dans les savoirs réformés du Nord. Ainsi de l’accueil qui fut fait à la reine de Suède Kristina à Rome en 1655, cent ans tout juste après la publication dans la même ville de l’Historia d’Olaus Magnus : après avoir renoncé au trône de Suède et abjuré sa foi luthérienne, la « Minerve du Nord », fille du « Lion du Septentrion » Gustav Adolf, devait prendre possession de ses appartements du Vatican ; le nouveau pape Alexandre VII inspecta personnellement les huit chambres avec fresques murales dévolues à l’ancien « roi de Suède » et remarqua une inscription vexante pour son hôte. C’est ainsi qu’il ordonna que soient effacés d’un mur les mots « Omne malum ab Aquilone », « tout le mal provient du Nord » ; une épaisse couche de peinture fut déposée sur l’inscription, comme pour laver à grande eau un honneur que la force d’inertie de la géographie biblique avait contrarié trop longtemps9. Le grand bien en provenance du Nord prophétisé d’abord par Olaus Magnus, valorisant un passage de Job (« Ab Aquilone aurum venit », 37,22), trouva ici sa matérialisation. Le Lion du Septentrion et la Minerve du Nord du XVIIe siècle auraient été ainsi les héritiers d’un mouvement historique de « septentrionalisation de l’Europe ». À la « fiction maîtresse10 » du gothicisme seraient venus se greffer, à l’échelle européenne, d’autres rêves de grandeurs septentrionales, des rêves britanniques, néerlandais, germaniques, écossais, hongrois, polonais, partout où se diffusèrent des déclinaisons locales du nordicisme, qu’elles aient célébré les Goths, les Bataves, les Cimbres, les Celtes, les Huns ou les Sarmates, toutes anciennes peuplades glorifiées dans le passé pour autoriser des ambitions au présent.
De l’« ex Septentrione Lux » au son duquel fut accueilli Gustav Adolf dans l’Allemagne luthérienne, à la Suède comme Éden et Atlantide chez Olof Rudbeck (1679-1702), le thème même de l’origine nordique de l’humanité fut appelé à une longue reformulation onirique au xviie siècle, autant qu’à de trop célèbres reconfigurations racialistes à l’époque contemporaine11. […] Nous n’avons pas cherché à préciser la part qui fut transférée du discours gothiciste de la Renaissance aux essentialisations racistes du xxe siècle […], ou même simplement les liens entre le gothicisme et d’autres mouvements identitaires nord-européens comme le celticisme12. C’est pourtant bien que le prolongement de ces recherches impliquerait de replacer cette réforme savante du Nord cardinal dans une septentrionalisation de l’Europe envisagée sur le temps long. Entendu à la fois comme vagina gentium, c’est-à-dire lieu d’origine, et comme lieu de projection et de destinée, le Nord devrait ainsi être considéré en tant qu’espace discursif mobilisé par une histoire des idées au sens élargi par Alphonse Dupront, pour qui « l’histoire des idées ne peut correspondre à sa matière que si elle devient histoire de la circulation des idées, des implantations, des incarnations successives ; autrement dit, l’histoire des mythes, ou des notions créatrices, explicatrices, énergétiques13 ».
De l’Esprit des lois fut ainsi l’occasion pour Montesquieu d’élargir le noyau culturel du gothicisme aux dimensions d’un système philosophico-politique général attribuant les fondations politiques de l’Europe moderne aux migrations de populations venues du Nord pour supplanter l’Empire romain et en quelque sorte le sauver. Telle fut toute la force de la charte mythique du gothicisme que d’être livrée avec tant de souplesse discursive qu’elle devint répertoire métaphorique, synecdochique et prophétique, permettant de relire le sauvetage antique de Rome par le Nord comme le sauvetage à venir de toute l’Europe par le Septentrion.
1 Historiens d’Europe, historiens de l’Europe, éd. Denis Crouzet, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2017,p. 21.
2 Martin W. Lewis, Kären Wigen, The Myth of Continents. A Critique of Metageography, Berkeley, University of California Press, 1997, p. 16.
3 Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, Paris, Éd. Amsterdam, 2009 (éd. originale : 2000).
4 Une certaine idée de l’Europe en tant, précisément, qu’idée incertaine, deviendrait ainsi éclairante : voir Patrick Boucheron, « Ce qui a manqué à l’Europe », dans Une certaine idée de l’Europe, éd. Groupe d’études géopolitiques, Paris, Flammarion, 2019, p. 11-47.
5 Lucien Febvre, « L’Histoire dans un monde en ruines », Revue de synthèse historique, vol. 30, 1920, p. 4.
6 Voir Denis Crouzet, « Avant-propos », art. cit., p. 7-21.
7 Antonella Romano, « Rome and its Indies: A Global System of Knowledge at the End of the Sixteenth Century », dans Sites of Mediation. Connected Histories of Places, Processes, and Objects in Europe and Beyond, 1450-1650, éd. Susanna Burghartz, Lucas Burkart, Christine Göttler, Leyde, Brill, 2016, p. 43 ; Ead., Impressions de Chine. L’Europe et l’englobement du monde (XVIe-XVIIe siècle), Paris, Fayard, 2016.
8 Gerardus Mercator, « Polus Arcticus ac terrarum circumiacentium descriptio », dans son Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, Duisbourg, 1595, trad. dansLouis Edmond Hamelin et al., L’Apparition du Nord selon Gérard Mercator, Québec, Septentrion, 2013, p. 17, notre italique.
9 L’épisode est mentionné dans Oskar Garstein, Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia, vol. 4, The Age of Gustavus Adolphus and Queen Christina of Sweden, 1622-1656, Leyde, Brill, 1992, p. 758.
10 Clifford Geertz, Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, Paris, PUF, 1986, p. 182.
11 Pour une vue d’ensemble sur le persistance de cette tradition dans les milieux identitaires, voir Stéphane François, Au-delà des vents du Nord. L’extrême-droite française, le pôle Nord et les Indo-Européens, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2014.
12 Johann Chapoutot, « Le discours des origines : ex septentrione lux », dans son Le Nazisme et l’Antiquité, Paris, PUF, 2012, p. 19-67 ; Ingo Wiwjorra, « “Ex oriente lux” – “Ex septentrione lux”. Über den Widerstreit zweier Identitätsmythen », dans Prähistorie und Nationalsozialismus. Die mittel- und osteuropäische Ur- und Frühgeschichtsforschung in den Jahren 1933-1945, éd. Achim Leube, Heidelberg, Synchron, 2002, p. 73-106 ; Nathaniël Kunkeler, « Sven Olof Lindholm and the Literary Inspirations of Swedish Fascism », Scandinavian Journal of History, 44/1, 2019, p. 77-102 ; Ian Stewart, « The Mother Tongue: Historical Study of the Celts and their Language(s) in Eighteenth-Century Britain and Ireland », Past & Present, 243/1, 2019, p. 71-107.
13 Alphonse Dupront, Le Mythe de croisade, Paris, Gallimard, 1997, t. 1, p. 30.