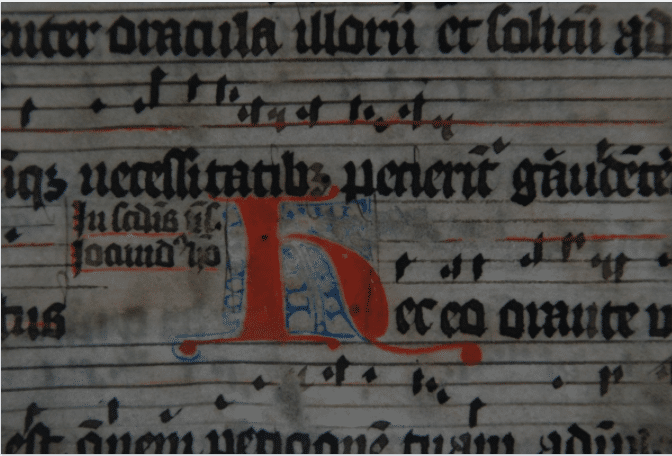Les professeurs le savent : si l’enseignement de la philosophie est censé couronner le parcours lycéen, nombreux sont les élèves qui l’abordent avec appréhension, voire suspicion. Ce n’est pas sans raison : tant qu’on ne réformera pas en profondeur les programmes et les modalités de l’évaluation de la philosophie, cette matière continuera à perdre de son prestige en cherchant à le conserver.
Par Margaux Merand, professeur de philosophie ; en thèse de psychologie clinique et de philosophie ; rédactrice en chef adjointe de la revue Implications Philosophiques ; avec la participation d’Antoine Dumont, professeur de philosophie.
En effet, ce n’est pas la philosophie qu’on défend en l’état actuel des choses, mais une certaine conception de la culture, fondée sur une habileté rhétorique mortifère pour la pensée ; sur une généralité qui rime souvent avec la superficialité d’extraits survolés en classe, ce qui est d’emblée discriminant à l’encontre des élèves qui ne peuvent pas approfondir, par la lecture, le corpus des textes étudiés ; sur des critères d’évaluation de plus en plus vagues qui privilégient l’esbroufe à la maîtrise de connaissances précises au service d’une pensée vivante.

Certes, la crise que connaît la dissertation n’est pas sans lien avec celle que connaît l’enseignement dans son ensemble. La maîtrise fondamentale de la langue française étant loin d’être acquise pour bon nombre d’élèves en Terminale, il devient de plus en plus difficile de prétendre enseigner le même exercice que celui que l’on désignait, au temps de Jules Ferry, comme la « composition de philosophie ».
Plutôt que de prolonger l’hypocrisie qui consiste à enseigner un exercice qu’on n’évalue plus à l’aune de ses véritables critères, je propose de mettre purement un terme à l’épreuve de la dissertation, ce qui permettrait non seulement de refonder l’enseignement de la philosophie sur un contenu substantiel, mais permettrait en outre au monde académique de se débarrasser d’un tour d’esprit foncièrement nuisible à la recherche.
Supprimer la dissertation
Cet exercice, impossible à réaliser par la majorité des élèves, serait à la limite défendable s’il était réellement vertueux du point de vue de l’organisation de la réflexion. La question n’est pas de renoncer à un exercice jugé trop exigeant intellectuellement par rapport à ce que les élèves de Terminale, dans l’ensemble, sont désormais en mesure de produire, mais d’abandonner un exercice qui, même s’ils étaient au niveau, n’en serait pas moins inintéressant.
Autrement dit la question était déjà légitime quand les élèves étaient au niveau, elle l’est seulement d’autant plus qu’ils s’apparentent à des collégiens. Il y a une certaine urgence, en réalité, à soulever ces questions, au lieu de se concentrer exclusivement sur le primaire et la seule analyse des réformes gouvernementales. Dans une double visée réaliste et philosophique.
La dissertation ne profite ni aux élèves qui présentent des facilités avec la philosophie, ni à ceux qui doivent tout en apprendre.
Un exercice artificiel
Un esprit authentiquement philosophique ne raisonne pas sous une forme aussi rhétorique et toujours la même. Le mouvement naturel de la pensée ne procède pas par une construction de “problèmes”, de tensions entre des définitions ou thèses également intuitives mais mutuellement exclusives à propos d’un objet donné qui justifieraient que l’on fasse un effort définitionnel raisonné en examinant successivement plusieurs axes censés se dépasser logiquement par des opérations de renversement nécessaires.
Il relève bien davantage d’une capacité à ne pas considérer le donné comme évident et éternellement vrai, mais à en rechercher les raisons et les causes. L’esprit philosophique est d’abord celui qui considère que toute chose a une cause, nécessaire ou contingente, naturelle ou socialement construite, qu’il est possible de déterminer rationnellement en remontant progressivement les étapes de sa formation, au lieu de la croire là de tout temps et se suffisant à elle-même, comme si sa simple existence en était une justification et un modèle d’intelligibilité satisfaisants. Il est donc celui qui cherche à saisir pourquoi les choses sont telles qu’elles sont, si elles sont devenues, et dans le même mouvement si elles peuvent être différemment ou n’être pas.
Il n’est pas de tension qui ramasse si bien la tournure de ce type d’esprit que celle qui est sensible à l’écart entre ce qui est et ce qui devrait être : le philosophe ne se contente pas de voir ce qui est à ses pieds, mais sent qu’un autre état est possible, qui ne peut être adéquatement conçu qu’une fois déterminée la genèse de l’état existant. On ne demande certes pas aux élèves d’adopter cette disposition intellectuelle, qui n’est jamais le propre que de quelques individus marginaux à cet âge, mais de renoncer à l’idée enthousiaste et infondée que la dissertation éduquerait à ce type de raisonnement, alors qu’elle lui est fondamentalement étrangère.
Toute pensée est méthode
Un esprit authentiquement philosophique ne saurait s’accommoder d’une méthode déterminée extérieurement. Il n’en va pas ici comme de la poésie et personne ne développe une pensée philosophique dans et par des contraintes formelles reçues du dehors, comme si la réflexion allait magiquement advenir en respectant la règle du jeu. La pensée, à titre de tendance, est nécessairement antérieure à l’apprentissage de la règle ou elle n’est pas, et la question est à la limite de savoir si le respect de la règle en autorise une expression rigoureuse et un parachèvement, ou si une telle règle, encore une fois déterminée extérieurement, n’en est pas un appauvrissement et n’y constitue pas obstacle inutile.
Il est faux de penser qu’une pensée philosophique pourrait exister indépendamment de toute méthode, et qu’il serait bon dans cette perspective d’en fixer une qui soit opératoire pour tous les esprits. Tout esprit qui pense fait preuve de méthode et d’organisation, toute pensée qui cherche à s’exprimer fait œuvre de logique et d’agencement. Quand la pensée s’arrache à la pure intériorité de la conscience, où elle se trouvait à l’état nébuleux et confus, elle a pour but de s’extérioriser selon un ordonnancement précis, celui des différentes étapes et idées qui la composent et lui donnent la forme d’une démonstration logique de thèse.
Il n’est pas d’esprit philosophique qui ne s’efforce pas de restituer logiquement les différents moments et basculements par lesquels une thèse lui est apparue vraie. L’aspect potentiellement “décousu” auquel on chercherait donc à remédier en imposant la forme de la dissertation n’existe pas, car aucune pensée ne s’exprime sans déterminer en même temps sa méthode. La forme suit spontanément du fond, elle en est même constitutive.
Au-delà du lycée, les effets mortifères de la dissertation
Pour tout esprit non philosophique, c’est-à-dire pour la majorité des élèves, on peut considérer qu’il est légitime de pallier le manque de distance critique et analytique par d’autres moyens que la dissertation. L’essentiel n’est pas que les élèves saisissent une règle formelle et soient capables de l’appliquer indifféremment à toutes sortes de sujets. Il ne doit pas relever d’un apprentissage rhétorique et d’un automatisme de langage et de pensée plus ou moins érudit et brillant selon les connaissances acquises dans les autres disciplines et le milieu social d’origine.
L’objectif est de faire en sorte que les élèves soient capables de s’élever au-dessus de la seule opinion, souvent héritée sans réserve de l’entourage et des discours environnants, en les soumettant au respect de principes logiques en vertu desquels un raisonnement plus rigoureux et approfondi est possible. C’est à l’illogisme naturel de nombreux élèves, et leur tendance à tout considérer comme une évidence indépassable, qu’il s’agit de remédier, par un enseignement des outils logiques, et non pas sophistiques, de la pensée.
La dissertation est un frein pour les esprits philosophiques, qui les dénature bien regrettablement là où ils sont indépendants ; elle n’est pas une propédeutique pour tous les autres, mais un exercice de style qui prend toujours plus de place à mesure que les élèves du secondaire y sont moins préparés en amont, anticipant qui plus est sur l’enseignement de la philosophie dans les classes préparatoires dont on observe les conséquences jusqu’à l’ENS où de nombreux élèves conçoivent le mémoire de M2 comme “une longue dissertation”. Ce dont ils peinent toujours à s’extirper à l’échelle de la thèse.
Je ne veux pas faire peser sur cet exercice trop de responsabilités, ce serait clairement un excès, mais je ne crois pas qu’il soit sans lien avec l’incapacité foncière de nombreux chercheurs à produire de réels savoirs. Et je crois même qu’il détourne les plus naturellement philosophiques d’entre eux pour en faire, au mieux, des généralistes et des professeurs auxquels il serait bon de n’accorder que le titre de préparateurs aux concours ou d’historiens des idées.
Conservation ou fuite en avant ?
Il semble que l’on rencontre une opposition vigoureuse à la suppression de cet exercice en raison de deux croyances délétères :
– que la dissertation fait advenir une pensée philosophique : chose dont j’ai montré, quoique d’une manière non définitive et partiale je l’admets, en quoi elle était à mes yeux un non-sens et une contre-vérité ;
– que la dissertation fait le prestige de l’enseignement de la philosophie, et que tout l’édifice menace de s’effondrer si l’on renonce à cette “ultime” exigence, comme si c’était, dans le contexte, la dernière chose à laquelle il fallait s’accrocher comme une moule à son rocher pour que l’école ait encore un sens.
La deuxième n’est pas très difficile à contrer, puisqu’elle dépend étroitement de la première. Deux autres points finissent de la rendre obsolète :
L’école s’est déjà effondrée, et ce n’est pas le maintien de la dissertation qui y change quelque chose. On peut même aller jusqu’à dire que la dissertation, dans les faits, n’existe plus et n’est gênante que pour les professeurs qui, comme moi, s’évertuent à continuer à l’enseigner par conscience professionnelle. En toute logique, la philosophie doit sa place exclusive en Terminale au fait qu’on considère qu’elle requiert des acquis préalables dans d’autres disciplines. Or, comment quelque chose qui doit censément sa possibilité même au reste de l’édifice pourrait-il le faire tenir en dernier ressort, quand tout le reste serait perdu ?
Si le cours d’histoire ne fait plus l’objet de l’apprentissage d’une “composition”, si les professeurs de lettres eux-mêmes, comme je l’ai constaté dans quasiment toutes mes classes l’année dernière et la précédente, ne préparent plus les élèves à l’épreuve de la dissertation littéraire en vue des épreuves anticipées du baccalauréat, car ils jugent l’année trop courte et les élèves inaptes à un tel type de rédaction, comment les profs de philo pourraient-ils magiquement maintenir je ne sais quelle exigence de rigueur en quelques mois ?
On a déjà renoncé à tout prestige dans les autres disciplines, et croire qu’il reviendrait à la philosophie le pouvoir de tout réparer, en quelques ridicules heures par semaine en séries ES / S / STMG relève, au mieux, de la superstition, au pire, de l’hypocrisie la plus cynique.
Je raconterai à cet effet la dernière réunion d’harmonisation dont je fus témoin, où je me suis excitée comme à mon habitude au moment où certains collègues disaient se moquer de l’absence d’une troisième partie. J’ai expliqué qu’il importait de s’entendre sur ce qu’était une dissertation, sur une méthode valable pour tous les enseignants. On m’a rétorqué qu’il ne fallait pas pinailler, que la notice de l’inspection générale destinée à la correction du baccalauréat était de toute manière devenue trop lâche pour que l’on puisse s’offusquer des différences de conceptions des uns et des autres : en effet, on ne demande déjà plus aux élèves de produire une dissertation (il faut une “trace” de raisonnement…). Et cependant on maintient abstraitement l’exercice, on garde le mot, pour ne pas susciter le scandale, non seulement dans l’opinion, mais aussi et surtout dans le corps des professeurs.
Les mêmes qui prennent leurs libertés toute l’année avec l’exercice, le réduisant à quelque chose qui n’a de réalité que son nom, s’offusquent dès qu’il est question de le supprimer ! On se retrouve dans une situation ubuesque où moi, qui suis la plus viscéralement opposée à cet exercice depuis des années, suis souvent aussi l’un des rares profs à y préparer encore efficacement les élèves, parce que je ne considère pas comme une option de m’en dispenser quand c’est l’épreuve principale sur laquelle ils sont évalués le jour du bac.
Nouvelles évaluations, nouveaux programmes
Par conséquent, l’objectif n’est pas de maintenir une exigence illusoire et qui n’existe déjà plus dans la majorité des établissements, en raison de l’absence de pré-requis chez les élèves et de l’incapacité des professeurs à s’entendre sur ce qu’elle est, mais bien de rétablir une exigence à la fois adaptée à la réalité des élèves et jugée plus utile à leur formation intellectuelle. Cela serait l’occasion pour tous les profs de se mettre d’accord. L’argument classique dès que quelqu’un critique la dissertation est de lui retourner : “oui oui je suis bien d’accord, mais que va-t-on mettre à la place ?”. Comme s’il s’agissait là d’un problème insoluble alors qu’il ne se pose qu’en France.
Pour une évaluation plus exigeante et plus équitable
Si l’on commence à y réfléchir, on trouve rapidement des éléments de réponse :
a) un contrôle des connaissances. Les élèves doivent maîtriser des auteurs, des concepts, des repères, des œuvres. Ce serait 50% de la note, et ce n’est déjà pas rien que de demander aux élèves de restituer – bêtement ? – des raisonnements philosophiques complexes. Il ne peut s’agir de pure mémorisation ici car la gymnastique mnésique est en l’espèce indissociable de l’intériorisation logique d’un raisonnement. Il y a donc déjà là un effort intellectuel non négligeable, et qui profiterait à l’ensemble de la classe, car les élèves les plus faibles et ceux issus des milieux les plus défavorisés ont besoin de ce genre d’apprentissage, au lieu d’avoir à briller par des références qu’ils ne sauraient tenir de leurs parents.
b) un exercice plus réflexif, qui ferait l’autre moitié de la note, et où l’on demanderait aux élèves soit d’expliquer un texte, ce qui consiste à restituer le mouvement d’une pensée non de mémoire, mais sur place, et qui se justifie pour les mêmes raisons énoncées précédemment, soit de proposer un essai sur une question donnée, en s’efforçant d’argumenter logiquement et de structurer le propos. J’ai déjà entendu, par un ami en contrat doctoral, que l’essai à l’anglaise donnait de “bonnes et de très mauvaises choses”. Je réponds assez simplement qu’il en va de même de la dissertation, et que cela n’autoriserait pas les élèves à se soustraire à l’exigence de rigueur formelle de l’écrit, qui serait évaluée en vertu, je l’ai déjà dit, de critères logiques (cohérence interne, pertinence de l’ordre d’apparition des idées, absence de contradiction, etc.) davantage que stylistiques.
c) bien des exercices intermédiaires sont possibles et fonctionnent parfaitement au cours de l’année, comme le fait, pour ne donner qu’un exemple, de demander aux élèves de mettre en lien un extrait de film, un texte littéraire, d’histoire, etc., en rapport avec un texte philosophique pour en rendre raison avec un appui “sensible”.
Ces nouvelles modalités d’évaluation, loin de faire s’effondrer l’édifice, obligeraient les élèves à apprendre le cours par cœur bien plus régulièrement, et donc à quitter le lycée avec des connaissances plus durablement acquises ; elles dégageraient du temps, pour les professeurs comme moi qui se sentent parasités par l’impossible enseignement de la dissertation, pour faire des choses plus intéressantes avec les quelques élèves capables de pousser leur réflexion plus loin. Il ne s’agirait de freiner personne, car au contraire tous les élèves y trouveraient leur compte, alors que le cours de philosophie est actuellement une farce qui ne profite ni aux élèves à l’aise dans le raisonnement, ni à ceux qui sont largués et dont les connaissances sont lacunaires.
Des programmes plus précis et plus approfondis
Il s’agirait dès lors d’établir un programme pour les épreuves du baccalauréat, qui changerait chaque année. Le programme notionnel ne fonctionne pas, ou à tout le moins devrait-il être enseigné différemment. Ce système dans lequel les professeurs sont libres de piocher, au cours de l’année, dans une liste d’auteurs, sans les étudier de manière exhaustive, et où le jour du bac peut tomber un auteur complètement inconnu des élèves selon les choix du professeur est absurde.
Certes, “la connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise”, comme l’indique la règle du sujet 3 (l’explication de texte). Mais c’est purement et simplement faux : les élèves qui connaissent la terminologie et l’arsenal conceptuel de l’auteur sont techniquement avantagés par rapport à ceux qui le découvrent, qu’on le veuille ou non. Rappelons-nous le texte de Machiavel tombé il y a deux ans, où certains savaient ce que “virtù” signifiait, et où tous les autres ont fait un contresens.
On gagnerait à déterminer une œuvre précise, dont le professeur effectuerait une lecture suivie, en y intégrant les notions quand elles se présentent. Et à poser des extraits d’une telle œuvre au baccalauréat. Cela permettrait de réduire, non seulement l’iniquité du troisième sujet, mais également l’aspect contre-productif de la culture par l’extrait. Des dizaines de textes coupés de leur contexte, survolés dans l’année, ne sont aucunement préférables à la connaissance sérieuse d’une œuvre donnée. Qu’on ne rétorque pas que cela appauvrirait le contenu des cours et la variété des connaissances : il suffit de songer à La République de Platon, par exemple, pour savoir que quasiment tous les problèmes qui irriguent l’histoire de la philosophie y sont posés, explicitement ou implicitement.

Il y a aussi toutes les connaissances historiques, à la périphérie de l’œuvre, qui s’ajoutent à la compréhension des arguments. Je pense honnêtement que n’importe quel élève serait infiniment plus reconnaissant de connaître, à l’issue de sa Terminale, La République de manière solide et en détail, que d’avoir superficiellement abordé Lucrèce, Deleuze, Alain, Vico et j’en passe. Du reste, la culture par l’extrait n’étant valable que dans la perspective de la dissertation, qui est par excellence l’art de tronquer la pensée et de manipuler les auteurs pour leur faire dire ce qu’ils ne disent généralement pas (certains élèves excellents parviennent certes à ne pas tomber dans ce travers), on voit assez facilement que cette deuxième mesure suit naturellement la première.
Conclusion : élargir l’enseignement de la philosophie
J’ajoute enfin qu’il faut faire une distinction fondamentale entre la philosophie, historiquement pratiquée par quelques esprits hors du commun, et qui n’est pas généralisable dans cette acception à l’ensemble des élèves, et l’enseignement de la philosophie en Terminale, qui relève d’un choix politique et qui est avant tout partie prenante de la formation à la citoyenneté. La distinction peut paraître évidente mais elle fait en réalité l’objet d’une confusion constante, dont procèdent tous les écueils mentionnés.
C’est du reste parce qu’on croit plus ou moins consciemment enseigner la philosophie proprement dite, faire des élèves de véritables philosophes, qu’on justifie que l’enseignement n’en soit pas envisageable avant la Terminale. Or il ne s’agit évidemment pas de cela, mais d’une éducation au jugement, et au discernement critique. Ici, comme tout à l’heure, c’est en surestimant le prestige de la discipline qu’on en gâche l’enseignement, qui devrait être réalisable dès la Seconde sous la forme d’une initiation à quelques notions de syllogistique, d’exercices de rédaction personnels, etc.
De même, les disciplines telles que les lettres, l’histoire et les sciences devraient avoir une consistance philosophique au lieu d’attendre que tout cela arrive, comme un cheveu sur la soupe, en Terminale. On s’accroche à l’excellence et à l’incommensurable complexité de la sacro-sainte philosophie pour justifier que l’enseignement soit en réalité extrêmement indigent et frustrant intellectuellement dans toutes les autres disciplines de la seconde à la Terminale, alors qu’il faudrait y préparer les élèves dans l’ensemble de ces matières de manière diffuse, ainsi que par des cours d’initiation plus spécifiques.
Crédits photo :