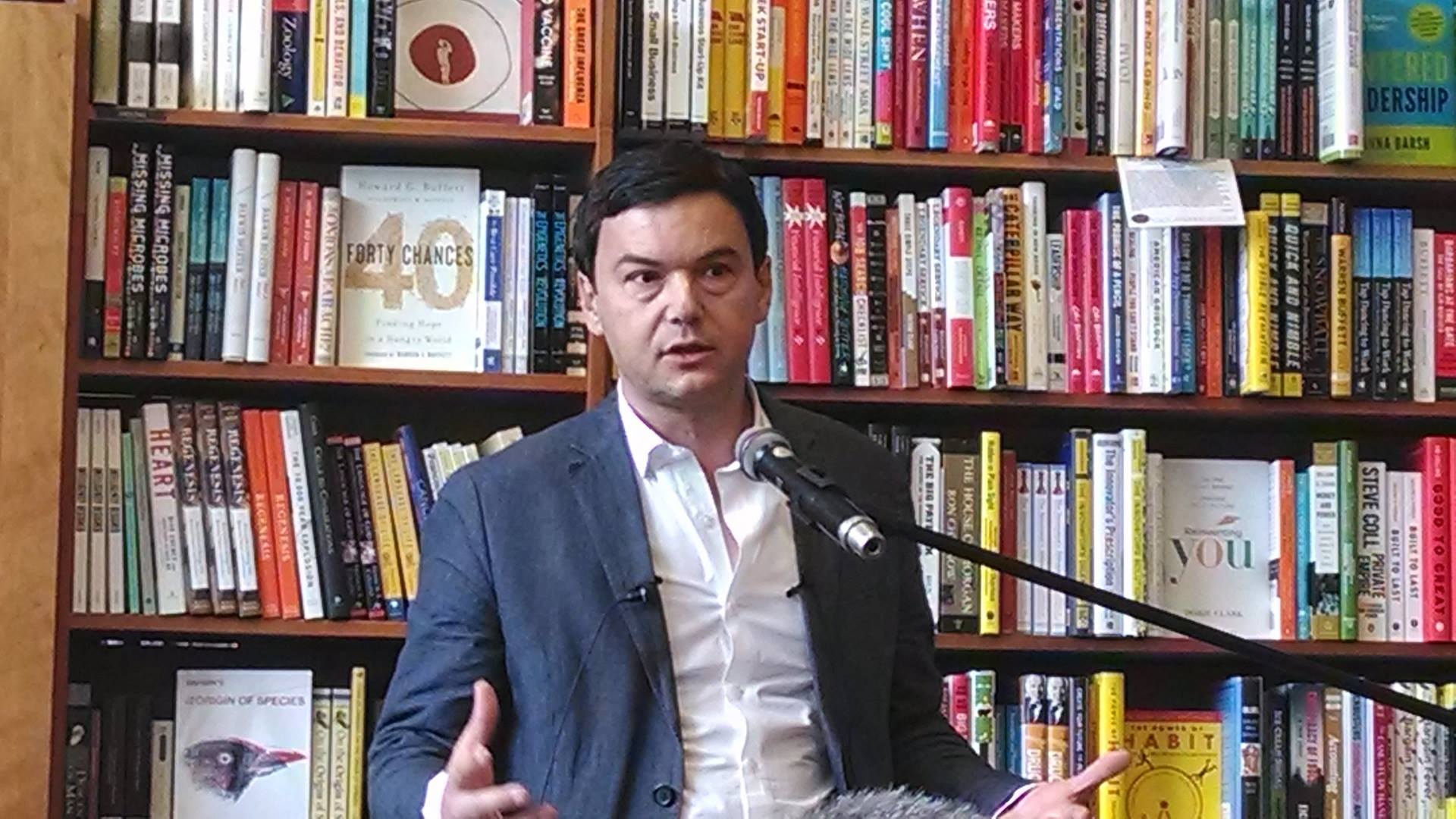Si l’avortement est légal en France depuis 1975, rappelons que c’est loin d’être le cas dans de nombreux pays et que ce droit ne cesse d’être remis en cause. Retour sur les victoires et les revers de cette lutte au cœur de l’émancipation des femmes.
Droit à l’IVG : des victoires et des défaites
De nombreux pays interdisent encore strictement cette pratique, comme les Philippines, le Sénégal, le Nicaragua, le Gabon ou encore Malte pour ne citer qu’eux. D’autres pays, comme la Côte d’Ivoire, la Somalie ou le Soudan ont adopté des législations plus souples qui l’autorise aux personnes dont la vie serait mise en danger par la grossesse. D’autres pays, comme Chypre, donnent accès à l’avortement en cas de problèmes médicaux graves, de viol ou de malformations du fœtus.

En 2016, le gouvernement polonais a souhaité restreindre ce droit, mais les nombreuses manifestations ont contraint le gouvernement à abandonner le projet. Parallèlement, en mai de cette année, l’Irlande a été le théâtre d’une de ses plus belles victoires, puisque les électeurs ont massivement répondu « oui » à l’abrogation du 8ème amendement de la Constitution, qui interdisait jusqu’alors tout avortement. Ainsi, la loi devrait maintenant permettre que l’IVG soit pratiquée sans justification pendant les douze premières semaines de grossesses et jusqu’à vingt semaines en cas de risque grave pour la santé de la mère.
Le mois suivant, c’est en Argentine que le débat a repris une place importante. La Chambre des députés a adopté un projet de loi visant à légaliser l’avortement dans les mêmes conditions. Malheureusement, les sénateurs l’ont rejeté en août, ne laissant la possibilité d’avorter qu’aux femmes ayant des problèmes médicaux ou ayant été victimes de viol. Un choix incompréhensible, étant donné les situations terribles dans lesquelles se retrouvent souvent les patientes qui souhaitent avorter. Notons qu’en Argentine, une cinquantaine de femmes meurent chaque années à la suite d’un avortement clandestin ayant entraîné des complications.**
En France : un droit remis en cause
Face à ces pays où l’avortement reste une question épineuse, on pourrait penser que la situation en France est beaucoup plus avantageuse. Pourtant, bien que notre législation autorise un accès libre et gratuit à l’IVG, ce droit n’est toujours pas inscrit dans la Constitution, restant donc fragile, et est d’ailleurs régulièrement remis en question par des discours conservateurs. De plus, il n’est pas rare que les personnes souhaitant avorter soient confrontées à des paroles culpabilisantes et autres comportements sexistes ou transphobes.
“Il y a une véritable régression en France depuis quinze ans. Le planning familial est de plus en plus dysfonctionnel, faute de fonds.”
Aussi, le remplacement du Ministère du droit des femmes par un simple secrétariat d’État, sous le gouvernement Philippe, et la baisse importante du budget qui lui est consacré, ne peut en aucun cas soutenir l’application de la législation. D’ailleurs, des plannings familiaux sont menacés de fermeture. Ils subissent une baisse de subventions, de telle sorte que le planning familial de Toulouse a dû réduire ses permanences, n’en tenant plus que deux par semaines, faute de moyens.
Ce 28 septembre, Place de la Bastille, devant l’Opéra, une poignée de manifestantes étaient venues manifester. Rachel, 61 ans, souligne : « Il y a une véritable régression en France depuis déjà quinze ans. Le planning familial est de plus en plus dysfonctionnel, faute de fonds. On se fait grignoter depuis des années et certaines femmes peuvent difficilement avorter en France en 2018 ! Il ne suffit pas de dire “je suis pour l’avortement”, il faut le financer ! »
On pourrait également imaginer qu’en France, l’accès à la contraception ne fasse plus débat. Néanmoins, l’Autre JT démontrait dans un reportage de 2016 que certains pharmaciens refusaient encore de délivrer des pilules du lendemain ou parfois même des préservatifs, invoquant une « clause de conscience » qui n’existe pourtant dans aucun texte de loi. L’Ordre National des pharmaciens avait bien essayé, la même année, de proposer un texte leur en permettant une, qui avait rapidement été abandonné. Il est donc nécessaire de rappeler que lorsqu’ils refusent de délivrer un moyen de contraception, ils le font en toute illégalité.
La “clause de conscience” en question
Dernièrement, le Dr de Rochambeau, gynécologue et Président du Syngof (Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France) a tenu devant les caméras de Quotidien un discours qui a suscité l’indignation de nombreuses associations féministes. Ce dernier, se fondant sur la « clause de conscience » établie par l’article R4127-18 du code de la santé publique, explique qu’il refuse de pratiquer des avortements car il n’est « pas là pour retirer des vies ». Après avoir affirmé que l’avortement était un homicide, il finit par déclarer, non sans fierté, que la loi le protège.
Béatrice, 64 ans, présente au rassemblement à Paris, s’indigne : « C’est un droit menacé en permanence, même en France actuellement, mais de façon vicieuse ! Comment peut-on représenter les gynécologues et déclarer que l’avortement est un homicide ? » Pour ces vétérantes de la lutte pour le droit à l’IVG, les propos du Dr de Rochambeau sont “une insulte aux combats passés”.
S’il s’agit d’un médecin qui exerce de façon libérale, on peut tout de même s’interroger sur le Syngof qui a choisi comme président quelqu’un d’aussi réactionnaire. Ironiquement, cette clause est régulièrement invoquée par certains gynécologues qui refusent de pratiquer des stérilisations définitives. Ainsi, non seulement ils privent leurs patientes de la contraception qu’elles ont demandé, mais leur refusent également l’accès à l’IVG.
“À l’hôpital, en Sarthe, trois médecins sur quatre refusent de pratiquer des IVG”
Cette « clause de conscience » dispose que les praticiens sont autorisés à ne pas pratiquer une IVG si cela est contraire à leurs convictions personnelles, mais qu’ils doivent rediriger leurs patientes vers des gynécologues qui la pratiquent. Cependant, l’article L.2212-1 du Code de la Santé publique précise que toute femme enceinte, peu importe son âge, peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse.
De multiples impacts sur les patientes
De prime abord, la clause de conscience et la loi relative à l’IVG libre et gratuite ressemblent plus à une forme de compromis qu’à un obstacle au droit des femmes à disposer de leur corps. Mais quels sont les enjeux d’une telle clause et comment impacte-t-elle la vie des femmes concernées ?
A l’hôpital du Bailleul, en Sarthe, trois médecins sur quatre refusent de pratiquer des IVG. Évidemment, l’accès aux soins étant considérablement réduit, les patientes sont redirigées vers les hôpitaux du Mans ou d’Angers.
D’autres hôpitaux, comme celui de Fougères où Olonne-sur-Mer connaissent ou on connu récemment des situations similaires. L’accès à l’avortement est donc incontestablement entravé. On peut facilement imaginer, dans le cas d’une adolescente ne souhaitant pas en parler à ses parents, d’une personne en situation de précarité, ou n’ayant pas le permis, ou de n’importe quelle femme voulant garder secret son IVG – pour des raisons qui lui appartiennent – que devoir se déplacer jusque dans une autre ville puisse être une difficulté importante.
Le bien-fondé de cette clause de conscience reste à interroger. Si un médecin peut juger qu’il est contre ses convictions de pratiquer une IVG, alors pourquoi ne pourrait-il pas également refuser de pratiquer des soins à des personnes noires, homosexuelles, transgenres, invoquant encore une divergence d’opinion ? L’avortement n’est pas une pratique indépendante des autres, mais un acte médical. Il ne s’agit pas alors d’opinion, mais d’accès aux soins.
La législation avait déjà fait quelques efforts dernièrement, en pénalisant les sites de fausses informations ou en supprimant le délai de réflexion de sept jours. Mais d’après Marlène Schiappa, aucune remise en question de la clause de conscience concernant les IVG n’est prévue à ce jour. Pourtant, il s’agit bien d’une menace pour les femmes. Les médecins préfèrent valoriser leur droit à ne pratiquer des actes médicaux que lorsqu’ils sont en accord avec leur conviction, plutôt que de garantir aux femmes un accès aux soins et une possibilité de disposer de leur corps, comme le prévoit la loi.
En 2018, même en France, les femmes n’ont donc toujours pas le droit de disposer de leur corps comme elles l’entendent, puisque leur propre décision dépend toujours du consentement de médecins, protégés par la loi en cas de refus. Le combat pour le droit à l’IVG reste donc toujours d’actualité.
Crédits :
www.flickr.com/photos/alter1fo/25528262041/in/album-72157662174460801