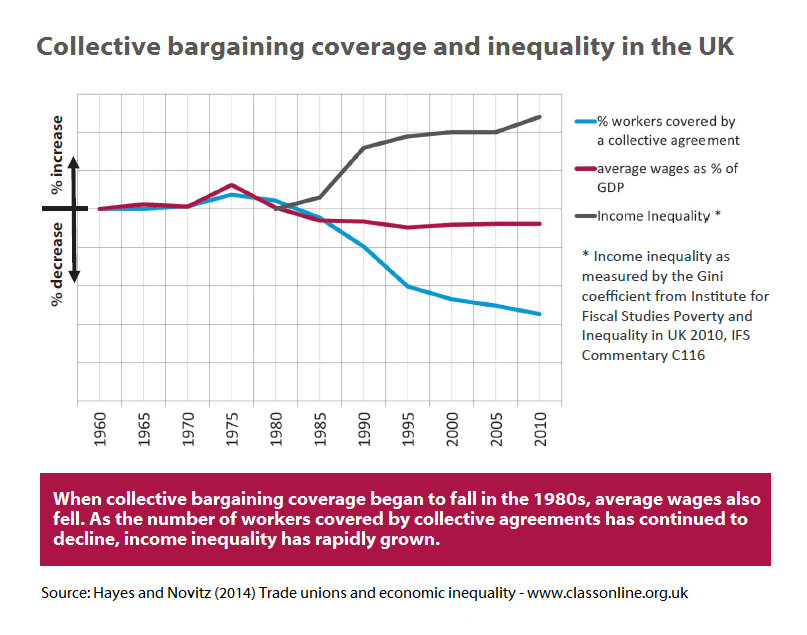Jon Trickett est député travailliste de la circonscription de Hemsworth, qui regroupe d’anciennes villes minières du Nord de l’Angleterre, depuis 1996. Son profil détonne face aux autres députés travaillistes issus de la classe moyenne : ayant arrêté l’école à 15 ans puis repris des études dans le supérieur, il deviendra, entres autres, plombier et arrivera en bleu de travail au conseil de la ville de Leeds après sa première élection en 1984. Opposé à la guerre d’Irak et au renouvellement de l’arsenal nucléaire, Trickett s’impose en une vingtaine d’années comme une des figures de l’aile gauche du Labour, à contre-courant du blairisme.
Membre du cercle proche de Jeremy Corbyn, il fait partie du shadow cabinet [NDLR, gouvernement fantôme] depuis l’élection de ce dernier à la tête du parti en 2015 et s’occupe notamment des questions de stratégie électorale et de réforme constitutionnelle. Se présentant dans un très bon français, il nous a reçus en septembre 2018 à Liverpool, en marge du congrès annuel du Labour.
LSVL – Commençons par la grande question du moment : le Brexit. En 1975 déjà, vous aviez participé à la campagne du Non au maintien du Royaume-Uni dans la CEE. Comment a évolué votre opinion sur ce sujet au fil des années ? Et que pensez-vous de la stratégie actuelle du Labour à propos du Brexit, notamment sur la question du maintien dans le marché unique ?
Jon Trickett – J’ai été très actif politiquement dès 1967. À partir de la moitié des années 1970, il était devenu clair que ce que nous pouvions appeler « l’ordre d’après-guerre » s’effondrait. Il y avait une crise du capitalisme britannique et une crise fiscale de l’État. Il m’a semblé que deux possibilités s’offraient alors aux Britanniques : la première était de s’orienter vers une politique socialiste, mais le gouvernement Labour de James Callaghan était alors intellectuellement et, de manière générale, épuisé. L’autre choix qui était possible, c’était de répondre à la chute du taux de profit en intégrant ce qu’on appelait à l’époque le « marché commun ». Cela signifiait remodeler nos relations avec le reste du monde, surtout avec le Commonwealth, nos anciennes colonies, et d’en construire de nouvelles. Cela me semblait insensé. Non seulement car ce n’était pas la solution aux faiblesses sous-jacentes du capitalisme britannique, mais aussi, me semblait-il à l’époque, parce que ceci signifiait l’abolition de la capacité d’un gouvernement élu à changer de politique économique pour aller vers un socialisme démocratique.
Quant à mon opinion politique, elle n’a pas beaucoup changé durant toutes ces années. Pour nous, à gauche, cette campagne était très importante car elle avait pour but de proposer une alternative à la manière de gouverner le pays. Rejoindre le marché unique, c’était renoncer à la démocratie à plusieurs niveaux, en adoptant de nouvelles bases au niveau des relations internationales qui ne rejoignaient pas notre vision des choses. Aucun d’entre nous n’a jamais été contre l’Europe, nous sommes européens et internationalistes. Au fil du temps, lorsque le marché commun est devenu l’Union européenne, notre économie s’est de plus en plus intégrée au projet européen jusqu’à ce qu’il devienne très difficile de s’en défaire, comme nous l’avons vu dans le débat sur le Brexit. Pendant ce temps, évidemment, a émergé le Parlement européen. Et d’autres institutions, comme la Commission et la Cour de Justice de l’Union européenne ont pris de plus en plus de pouvoir. Ces dernières se sont imprégnées d’une dimension néolibérale. Le Parlement fut quant à lui une sorte de branche démocratique.
LVSL – Mais ce Parlement a aussi ses limites…
Jon Trickett – Oui. La caractéristique principale d’une démocratie libérale est qu’il y a une alternance entre un gouvernement et une opposition, qui ensuite remplace le gouvernement. Cela n’existe pas dans l’Union européenne. Il n’y a pas de souveraineté populaire et c’est bien ça le problème. Un autre aspect de tout cela est ce que j’appelle les « périphéries géographiques ». Par exemple le Nord de l’Angleterre, où je suis né, l’Écosse et le Pays de Galles, qui sont géographiquement périphériques par rapport au noyau central du projet européen. Vous savez comment marche un centrifuge ? Les forces centrifuges éjectent ceux qui se situent à la périphérie, elles les poussent toujours plus en dehors. Le Sud-Est de l’Angleterre, dont Londres, s’est donc beaucoup plus développé que le reste du pays et a rejoint le croissant doré du cœur de l’Union européenne.
Certes, il y a eu des raisons internes au Royaume-Uni qui l’expliquent, tout n’est pas dû à l’Union Européenne. Mais dans le Nord de l’Angleterre et ailleurs, cette périphéricité est devenue un problème. Le projet de Jacques Delors était en partie centré sur des fonds sociaux, dont une certaine partie serait réservée au développement des périphéries. Un des objectifs de ces fonds sociaux était d’essayer de contrebalancer la centralisation économique déjà existante. Mais lorsque l’Europe s’est ouverte à l’Est, beaucoup de ces fonds furent investis dans les zones les plus pauvres. En tant que socialiste, je ne peux m’y opposer, mais les zones que je représente sont restées en retard du fait d’un système qui ne leur était pas favorable. Pourtant, tous ces problèmes très compliqués et insolubles sont maintenant profondément ancrés dans l’économie européenne. Je pense que cela explique pour beaucoup que les électeurs de ma circonscription [Hemsworth, Yorkshire de l’Ouest] aient voté pour le Brexit.
LVSL – Oui, ils l’ont fait à plus de 65%…
Jon Tricket – Peut-être même 70 à 75%. Souvenez-vous, plus de deux tiers des sièges représentés par le Labour ont obtenu une grande majorité en faveur du Brexit. Et pourtant, la campagne du Brexit avait un leadership politique globalement de droite réactionnaire.
LVSL – Donc, pour vous, le « Lexit » [sortie de l’UE défendue par la “gauche”] n’a pas existé pendant la campagne?
Jon Trickett –Il n’y a pas eu de réel Lexit non, pour diverses raisons que nous ne pouvons pas évoquer sous peine que je me fasse taper sur les doigts [rires]. Les militants du Labour ont vu émerger un Brexit mené par une droite radicale, xénophobe et semi-raciste. Ils ont réagi face à ça. C’est ça être membre du Labour. Mais les zones de vote en faveur du Labour – où les gens nous élisent mais ne sont pas membres du parti – ont été en partie séduites par la promesse d’un monde nouveau si nous sortions de l’Union européenne.
LVSL – Que pensez-vous de la position actuelle du Labour qui consiste à vouloir rester au sein du marché unique même en cas de sortie de l’Union européenne ? Est-ce la seule option ?
Jon Trickett – C’est la solution que nous avons choisie. Au sein du leadership, nous avons eu de très nombreux débats sur ce sujet. En définitive, nous avons adopté cette solution. C’est une question très compliquée, et il y a de nombreuses forces sociales qui entrent en ligne de compte. Le pays s’est désuni et ceci a, en partie, reflété les impacts inégaux du capitalisme mondialisé sur différentes zones géographiques. J’utilise souvent cette métaphore pour décrire la situation : un train fou sans conducteur, s’élance avec les forces économiques mondiales dans une seule et même direction mais des wagons se détachent et prennent une tout autre direction, ralentissant en chemin. C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Je pense que la gauche doit proposer une synthèse entre, d’une part, ces personnes, internationalistes et intégrées dans la mondialisation, en leur réaffirmant que nous ne sommes certainement pas anti-étrangers, et d’autre part ceux qui font partie de ces communautés dites « laissées pour compte » en leur disant que nous avons des solutions les concernant, à l’aide d’interventions de l’État dans l’économie et en réformant notre démocratie afin que leurs voix soient entendues. Il s’agit de trouver un compromis entre ces deux pôles.
Nous parlions tout à l’heure du populisme, qui suppose un clivage au sein de la société. La droite théorise comme clivage principal celui entre d’une part les étrangers et les pauvres, et d’autre part le reste de la population. En fait, c’est une une stratégie assez classique de la droite que de dire : « vous voyez cette personne ayant une couleur de peau différente de la vôtre ? Qui parle et s’habille d’une manière différente ? Ce sont ces personnes, vivant sous le seuil de pauvreté grâce aux allocations, qui sont le problème ! ». C’est exactement ce que raconte le Front National en France. C’est la même stratégie partout. Nous devons construire un discours nouveau et proposer une véritable explication des clivages sociaux. C’est en tout cas ce que nous essayons de faire.
LVSL – Ne pensez vous pas qu’il peut être problématique de rester au sein du marché unique ? Par exemple si l’Union européenne décide de passer des accords commerciaux avec d’autres pays, le Royaume-Uni ne serait pas nécessairement pris en compte durant la négociation.
Jon Trickett – Je n’ai pas dis que nous souhaitions rester au sein du marché unique. J’espère être clair lorsque je dis que nous aspirons à “une” Union douanière, avec laquelle nous voulons un rapport aussi proche que possible. Pour autant nous ne souhaitons pas faire partie de la structure actuelle. La raison en est limpide et vous l’avez donnée. Nous voulons entretenir des rapports avec le bloc commercial européen, mais il faut y réfléchir deux minutes. Aujourd’hui nous avons plus ou moins une place à la table des négociations et nous avons des représentants élus au Parlement européen. Si nous partons et que nous continuons à faire partie de l’Union douanière ou du marché unique, alors les règles seront créées par d’autres et nous aurons l’obligation de nous y conformer. Tout ça alors que beaucoup de personnes ont voté contre l’Europe parce qu’elles se sentaient déjà sous-représentées ! Nous ne pouvons pas dire “Nous sommes contents d’obéir à ces règles” alors que nous avons abandonné notre place à la table des négociations, c’est là le cœur du débat selon moi, et c’est un débat très intéressant.
LVSL – Le sujet phare de la conférence de cette année, assez absent les années précédentes, est l’hypothèse d’un second référendum. Quelle est votre perspective sur le sujet ? Ne craignez-vous pas, en cas de second référendum, soit un résultat identique au premier, soit un résultat différent qui ferait que ceux ayant voté « Leave» au premier référendum se sentent trahis ?
Jon Trickett – Je pense qu’il y a un risque, oui. Nous avons vu ce qu’il s’est passé dans d’autres pays lorsque des référendums ont été gagnés contre les positions défendues par l’Union européenne. Que s’est-il passé ? Ils ont fait un deuxième référendum pour faire adopter la position défendue par l’UE !
LVSL – Oui ce fut également le cas en Irlande…
Jon Trickett – Exact. Il y a un effondrement de la confiance accordée à la classe dirigeante britannique. Vous devez décider, en tant que parti, en tant que socialiste, où vous positionner par rapport à ce clivage : du côté des masses ou du côté des millionnaires ? Il est dans l’intérêt des millionnaires de continuer au sein de l’Union européenne. Et peut-être est-ce aussi dans l’intérêt des masses, mais les masses ont voté, de façon clairement majoritaire, pour en sortir. Le Labour peut facilement être mis en porte-à-faux et être accusé d’avoir trahi le vote de la majorité de son électorat. Par conséquent, un second référendum est difficile à cautionner, bien que je connaisse des personnalités au sein du Labour qui pensent qu’un second référendum est inévitable… Ils doivent s’en expliquer. Disons que nous ne sommes pas nécessairement fermés à ce sujet, mais ils doivent tenir compte du fait que nous avions promis de respecter le résultat du référendum.
LVSL – Oui, toute la classe politique l’a dit…
Jon Trickett – Oui, ils l’ont tous dit. Mais ce qu’ils essayent de faire, c’est de persuader les gens de voter pour rester dans l’Union en usant de la peur. Les gens n’écoutent plus ces sempiternels vieux discours. Dire aux gens comment voter n’est plus possible aujourd’hui. Je pense qu’il est maintenant assez difficile pour nous d’inverser le Brexit. Nous préférons donc focaliser nos forces contre Theresa May, pour la battre à la Chambre des Communes. Il n’est pas impossible qu’elle tombe car son parti est très divisé. Ceci entraînerait une élection générale.
Pour toutes ces personnes laissées pour compte depuis deux ou trois décennies, l’Union européenne est responsable de leur situation actuelle. C’est un vaste sujet, et il est loin d’être limité au Royaume-Uni. Je pense que c’est pour cela que Mélenchon parle d’une nouvelle République, parce que c’est la même chose en France. C’est intéressant : Bernie Sanders parle lui aussi d’une nouvelle politique aux Etats-Unis et l’on observe cela ailleurs. Les gauches dénoncent ce que l’on appelle le « state capture »… Comme je l’ai dit plus tôt, l’État est « capturé » par les intérêts d’un petit nombre d’individus, et pas dans l’intérêt de la majorité de la population.
Je ne sais donc pas comment tout ça va se terminer mais nous préférons des élections générales, et nous pensons que nous avons une chance de les gagner parce que nous élargirions le débat au-delà du Brexit et parce que nous présenterions une vision nouvelle de la société, comme nous l’avons fait l’année dernière lors des élections. Évidemment les Tories détestent cette idée et vont tout mettre en œuvre pour nous empêcher de la réaliser, je ne sais donc pas bien comment tout cela va fonctionner.
LVSL – Qu’il s’agisse du vote sur le Brexit il y a deux ans ou de l’élection générale de l’an dernier, nous avons pu constater qu’il y a un immense clivage entre les générations : les jeunes qui ont voté [NDLR, beaucoup se sont abstenus] ont massivement préféré rester au sein de l’UE et soutiennent le Labour, plutôt que les Conservateurs. Bien sûr, cela est aussi lié au fait que beaucoup de jeunes veulent mettre fin aux frais très élevés de l’enseignement supérieur, du logement, etc. Pourquoi pensez vous que la plupart des personnes âgées votent contre le Labour ou, en tout cas, en a peur ?
Jon Trickett – Je pense que dès qu’un parti en progression propose un changement, il y a de la peur. Le changement renvoie à l’idée que quelque chose n’est pas familier et je pense que, peut-être, plus on est âgé, plus on est attaché à ce qui est familier. C’est une différence difficile à expliquer. Aux alentours de 50 ans [hésitation], le vote conservateur devient soudainement majoritaire. Or, les personnes âgées votent plus que les jeunes. Mais s’il y a une élection dans trois ans alors cette limite passera de 50 à 53. Car nous pensons que cette cohorte de personnes qui ont voté Labour continuera de voter pour nous. C’est en tout cas ce que l’on prévoit.
Notre travail est de proposer une alternative aux conditions actuelles, une alternative qui fait suffisamment autorité pour être crédible, mais aussi une autorité rassurante. C’est en partie mon travail d’essayer, avec notre gouvernement fantôme, de créer un programme plus complet, pour pouvoir le proposer à la population. Nous voulons exposer nos propositions à l’avance pour que le public soit au courant, ou au moins familier, du genre d’idées sur la base desquelles nous voulons transformer le Royaume-Uni. J’espère que cela suffira à rassurer la population. Mais oui, dans tous les cas, il est important de retenir que dès qu’un changement radical est proposé, le peuple se divise. Je pense que pour le moment nous sommes bloqués à 50/50, à trois ou quatre points près.
LVSL – On l’a vu lors des élections locales cette année. Il n’y avait pas de vainqueur, vous étiez à égalité…
Jon Trickett – Oui, et nous y sommes toujours. Donc nous devons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de remporter une nouvelle élection, mais ça sera sûrement très serré. Il est possible que les forces progressistes et les forces réactionnaires s’équilibrent au sein de la société pour l’instant et qu’il faudra attendre d’être au pouvoir pour que nous puissions briser les codes et montrer qu’il existe une autre manière de diriger un pays. Nous n’en sommes pas là mais notre tâche est d’essayer de construire une importante majorité.
LVSL – On en parle un peu moins ces derniers temps, mais pensez-vous que des membres du PLP [Parliamentary Labour Party, qui regroupe les élus travaillistes de Westminster], disons ceux de centre-droit, pourraient quitter votre parti pour en former un plus « centriste » ?
Jon Trickett – Je ne pense pas que cela arrivera maintenant, non. Vous savez, le monde dans lequel on vit peut paraître assez confortable, et puis tout d’un coup tout change autour de vous, l’environnement n’est plus celui que vous connaissiez et vous vous retrouvez dans un nouveau train qui s’en va vers une direction qui vous est inconnue.
Pour ma part, je pense qu’il y a eu une bonne part d’exagération des médias dans toute cette histoire. La plupart des médias dans votre pays et dans le mien sont de droite et font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues afin que nous ne soyons pas élus. Mais il est indéniable que certains membres du Parlement ne se reconnaissent plus dans le parti et ont décidé de changer de direction. Je ne peux leur dire que ceci : rejoignez-nous, car nous sommes engagés dans une aventure passionnante, nous allons changer le Royaume-Uni, nous allons nous attaquer sérieusement à la pauvreté, à la croissance inéquitable, et nous voulons travailler avec vous. Peu importe ce que mon opinion privée puisse être là-dessus. [rires]
LVSL – Nous aimerions en savoir plus sur les réformes constitutionnelles que vous supervisez. Quels genres de pouvoirs le Labour serait-il prêt à transférer aux régions, aux localités, aux métropoles ? Pourrions-nous assister à la fin de la monarchie sous un gouvernement Corbyn ?
Jon Trickett – Je ne pense pas que ce soit notre priorité [rires]. On ne peut pas tout régler en même temps. Vous devez consulter les gens, donc les choses prennent du temps… Ce n’est pas exactement pareil en France mais c’est une situation similaire : une grande partie de l’activité économique se concentre dans la capitale et autour de celle-ci. Le reste du pays, quant à lui, est en retrait. La différence entre nos deux pays, c’est que nous avons une domination du capital financier, avec la City de Londres. Il est non seulement géographiquement réparti de manière très précise, mais il a aussi un caractère particulier car il produit un taux de profit plus élevé que le capital industriel. Et il entraîne autour de lui toutes sortes de services qui se développent, comme les avocats et d’autres professions.
Si vous avez quelques millions de livres à dépenser, il est plus probable que vous les placiez dans la City de Londres que dans une usine de ma circonscription, car l’industrie manufacturière n’obtient pas le même taux de profit que celle de la finance. Et de toute façon, il est difficile de trouver des financements dans le Nord de l’Angleterre. Par conséquent, la productivité, en termes de capitaux, d’un travailleur du Nord de l’Angleterre est moitié plus faible que celle de quelqu’un à Londres, peut-être même plus !
LVSL – Peut être aussi à cause de décennies de maigres investissements ?
Jon Trickett – Tout à fait. C’est à cause d’une pénurie d’investissements publics et privés. Comme vous le savez probablement, nous allons avoir une banque nationale d’investissement, basée à la Royal Bank of Scotland [NDLR, nationalisée durant la crise, toujours détenue majoritairement par l’État], qui investira dans l’économie locale. Nous la diviserons en plus petites entités, ce qui aidera clairement l’économie régionale de ma circonscription, par exemple. C’est quelque chose que nous allons réaliser dès le début de notre futur mandat. Des opérations financières de ce genre, beaucoup plus actives et interventionnistes, seront dirigées vers un développement régional. Ce que je dis tout le temps aux gens, c’est que l’inégalité est à la fois hiérarchique en soi mais aussi, au Royaume-Uni, géographique et spatiale. Dans le Nord de l’Angleterre et ailleurs, au Sud-Ouest, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord, l’inégalité est organisée spatialement à cause de la domination financière capitaliste. Nous devons commencer à réinvestir. Et quand vous regardez attentivement les cartes superposées de l’économie et des votes pour le Brexit, il y a une corrélation évidente entre les deux. Donc les gens sont mécontents, malheureux et aliénés. Ils s’expriment au travers du vote pour le Brexit, qui veut dire : « nous n’aimons pas la manière dont le pays est gouverné ». Je pense que c’était la première fois que la plupart d’entre eux ont eu l’occasion d’exprimer cette sensation d’aliénation.
Entretien réalisé par William Bouchardon pour LVSL.