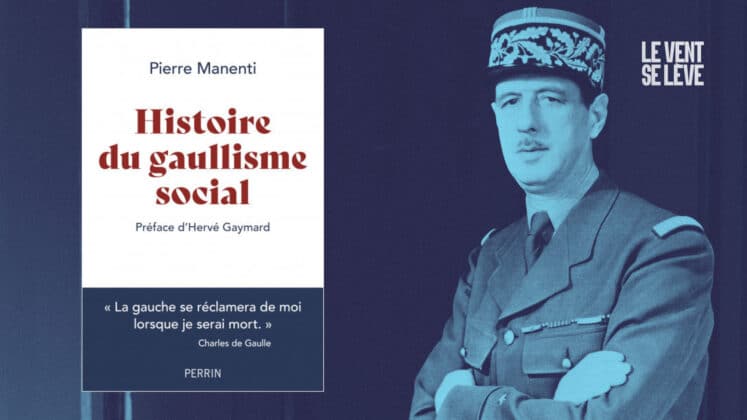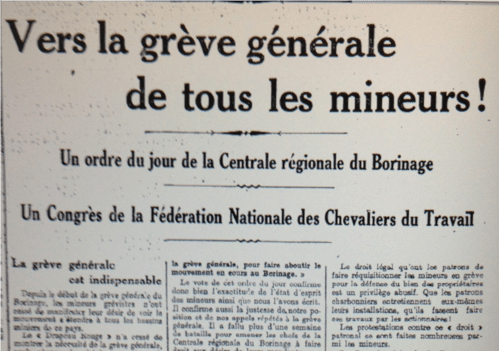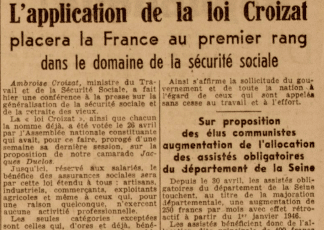Alors que l’actualité sociale est marquée par une opposition massive à la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, nous nous sommes entretenus avec Nicolas Da Silva, auteur de La bataille de la Sécu. Une histoire du système de santé (La Fabrique, 2022). Maître de conférences en sciences économiques à l’université Sorbonne Paris Nord, spécialiste de la médecine libérale et du système de santé français, Nicolas Da Silva développe dans cet entretien l’opposition qu’il dresse entre l’État social et la Sociale, à savoir l’auto-organisation des travailleurs. Il insiste sur les moments historiques fondateurs de ces deux traditions de protection sociale, nées du conflit, et sur leurs évolutions récentes, marquées par des réformes politiques et financières qui prouvent que la bataille pour la Sécu n’est pas terminée…
LVSL : Vous faites de la distinction entre l’État social et la Sociale le cœur de votre ouvrage. Comment les définissez-vous et sur quels fondements cette opposition repose-t-elle ?
Nicolas Da Silva : Cette opposition entre les politiques sociales portées par l’État et les politiques sociales portées par les intéressés eux-mêmes – ce que je nomme la Sociale – est le résultat de mon propre parcours intellectuel. En effet, pour comprendre ce qui m’a amené à faire cette distinction, il faut revenir à mon point de départ en tant qu’économiste institutionnaliste. J’ai été formé, à l’université et en tant que citoyen, à cette idée que la Sécurité sociale était un bien commun à défendre, principalement contre le processus de marchandisation. Si elle était à défendre, c’est parce que malheureusement, depuis trente ou quarante ans, des politiciens conduisaient une mauvaise politique à la tête de l’État et dès lors, il suffirait de changer de politiciens pour changer de politique.
C’est d’ailleurs dans cette perspective que je fais ma thèse d’économie, à travers laquelle je m’intéresse à des dispositifs particuliers de régulation de la médecine de ville. Je montre que ces dispositifs ne fonctionnent pas, ou très mal, et que pourtant, les gouvernements s’entêtent à les mettre en place. À ce moment-là, je pense que le rôle de l’économiste critique est d’avertir sur les risques de la marchandisation, de redonner de la légitimité à l’intervention de l’État et de montrer quels dispositifs peuvent permettre au système de santé de relever les défis contemporains. Ce n’est que progressivement que je commence à renouveler ma façon de penser mon objet de recherche. Je ne me demande plus « est-ce que ça marche ? » mais « quelles ont été les conditions pour imposer une institution qui marche – la Sécu – et pourquoi ce qui était possible autrefois ne l’est plus aujourd’hui ? ». L’enjeu pour moi devient la genèse des institutions et non leur efficacité.
« Pourquoi ne serions-nous pas capables, aujourd’hui, d’étendre la Sécu, alors qu’elle a été créée et développée à des périodes bien plus critiques et de pauvreté extrême ? »
De là vient ma curiosité historique. Bien que je ne sois pas historien de formation et que je n’utilise pas la méthode historique de façon aussi rigoureuse que mes collègues de cette discipline, je me pose la question de l’histoire parce que je me rends bien compte que dans le contexte actuel, nous sommes face à un grand paradoxe : pourquoi ne serions-nous pas capables, aujourd’hui, d’étendre la Sécu, alors qu’elle a été créée et développée à des périodes bien plus critiques et de pauvreté extrême ?
Au fil de mes recherches et de mes lectures de l’historiographie, je me rends compte qu’il y a deux grandes façons de raconter cette histoire. La première, relativement traditionnelle, insiste sur l’idée d’une croissance du rôle de l’État dans la vie publique à partir de la Révolution française, qui va s’opposer au marché et essayer de réguler les conflits entre travail et capital. Je tiens d’emblée à signaler que cette vision est à mon avis tout à fait légitime, du point de vue académique et historique. Néanmoins, je n’adhère plus à cette vision car j’observe que c’est que ce n’est pas en conquérant l’État que les politiques sociales progressistes commencent à naître. C’est au contraire en contestant deux rapports sociaux de domination que sont le capital et l’État que naissent ces politiques sociales. Plutôt que d’opposer marché et État comme on le fait traditionnellement en sciences sociales, je pose l’hypothèse que ce sont des alliés irréductibles l’un à l’autre.
Pourquoi opposer l’État social et la Sociale ? Car ce que j’observe, à différents moments de l’histoire, c’est que très tôt se pose la question de l’intervention de l’État dans le champ de la politique sociale et très tôt s’exprime un refus des élites politiques d’investir ce champ. Évidemment, de leur côté, les élites économiques, le capital en particulier, refusent aussi de mettre en place des politiques sociales, alors que les conditions de travail, dans le contexte de l’industrialisation, sont de plus en plus difficiles et de plus en plus dangereuses. Face à ce double refus, que font les travailleurs urbains et ruraux ? Ils ne se résignent pas, ils ne demandent gentiment la permission de créer des politiques sociales et des institutions de protection sociale, ils le font par eux-mêmes. C’est sans doute ce que j’ai trouvé le plus incroyable, notamment à travers la création des premières mutuelles ouvrières.
LVSL : Justement, vous accordez à la mutualité une place d’autant plus importante dans votre ouvrage qu’elle est selon vous révélatrice de la lutte entre la Sociale et l’État social. Ce dernier va tout faire pour se réapproprier l’esprit mutualiste dans un but de maintien de l’ordre établi. Dans sa préface, Bernard Friot la qualifie même de « cheval de Troie particulièrement efficace du couple État social/capital ». Comment cette évolution des mutuelles, d’un outil de subversion à un outil d’intégration à l’ordre social, s’opère-t-elle ?
N. D. S. : À la suite de la Révolution française, la mutualité est une institution qui démontre toute l’originalité et la détermination du mouvement ouvrier. Les travailleurs s’auto-organisent contre les entreprises capitalistes qui les exploitent et contre l’État qui leur interdit de se réunir, à la suite des lois d’Allarde et Le Chapelier de 1791 et d’une série de dispositions empêchant les classes populaires de s’organiser politiquement. Ces dernières sont même fortement réprimées lorsqu’elles dérogent à cette interdiction.
Les sociétés de secours mutuel sont très ambivalentes parce qu’il y a cette dimension subversive de l’ordre établi, mais il n’y a pas que cela. Comme le montre par exemple l’historien Bernard Gibaud, il y a aussi une dimension davantage liée à la pratique du pouvoir des dominants. C’est-à-dire qu’on va utiliser des sociétés de secours mutuels pour calmer les revendications ouvrières. C’est le cas par exemple dans les mines, où les accidents du travail sont très importants et suscitent de nombreuses agitations ouvrières. Le préfet ou bien le patron peuvent décider de mettre en place une société de secours mutuel qui va prendre en charge les travailleurs blessés, avec pour objectif de calmer les revendications qui pourraient menacer l’ordre social. Suivant les pas de Bernard Gibaud ou de Michel Dreyfus, j’accorde également beaucoup d’importance au décret napoléonien de 1852 qui entame une réappropriation par l’État de la mutualité subversive. C’est progressivement que la mutualité va être donc vidée de sa subversion.
Dès ses origines, la mutualité peut donc à la fois être subversive de l’ordre établi ou bien chercher à le reproduire. Ses évolutions ont été telles qu’aujourd’hui, l’esprit subversif de la mutualité a complètement disparu. La Fédération nationale de la Mutualité française qui représente la grande majorité des mutuelles en France, n’a plus aucun objectif politique. Elle avance deux arguments principaux pour justifier son existence et sa singularité par rapport aux sociétés d’assurance capitalistes : elle ne fait pas de profit et est gouvernée de façon démocratique. Ces deux éléments seraient au cœur de son identité, de son originalité. Or, quand on regarde dans le détail ce qui se passe aujourd’hui, pour plusieurs raisons liées principalement à la mise en concurrence des complémentaires santé, la Mutualité française est contrainte à se comporter comme des assureurs privés à but lucratif. Aujourd’hui, la mutualité sert simplement d’excuse pour ne pas remettre en cause les complémentaires santé.
« Il y a une histoire glorieuse de la mutualité. Mais elle ne doit pas être instrumentalisée pour nous aveugler sur le présent. »
Je répète que je ne pense pas pour autant qu’il faille rejeter en bloc toute la mutualité. Même après la création du régime général de la sécurité sociale en 1945-1946, donc après l’épisode vichyste où la mutualité, au niveau national, validait complètement le régime, il y avait encore des mutuelles ouvrières faisant des choses extraordinaires. Je pense notamment aux travaux de Benoît Carini-Belloni, qui montrent à quel point, par exemple, la Mutualité ouvrière des Bouches-du-Rhône a construit tout un réseau de centres de santé pour faire de la médecine autrement. Ces militants ont construit une alternative crédible à la médecine libérale et à ses défauts les plus insupportables. Il y a une histoire glorieuse de la mutualité. Mais elle ne doit pas être instrumentalisée pour nous aveugler sur le présent.
Pour en revenir à l’opposition entre l’État social et la Sociale, en matière de santé, ce qui compte n’est pas simplement la quantité d’argent que l’on y met. Il faut aussi se demander qui détient et exerce le pouvoir de décision. La distinction que j’opère est essentiellement sur cet aspect-là. Avec la Sociale, nous sommes dans le champ de l’auto-gouvernement, dans le sens où ce sont les intéressés eux-mêmes, qui décident à des niveaux différents, quitte à se fédérer. Le régime général de la sécurité sociale se fonde dans cet esprit, puisque ce sont avant tout les intéressés eux-mêmes qui gèrent les caisses et qui détiennent ainsi un pouvoir de décision sur la politique de santé et d’accès aux droits. Pour ce qui est de l’État social, le centre de décision réside dans les mains du gouvernement et des institutions traditionnelles de l’État.
« C’est parce que l’État se réapproprie le pouvoir sur la Sécurité sociale progressivement après 1945 qu’il peut plus facilement en organiser la réforme d’un point de vue économique. »
Évidemment, tout l’enjeu de la distinction entre l’État social et la Sociale est que celui qui détient le pouvoir va pouvoir orienter la politique publique. C’est parce que l’État se réapproprie le pouvoir sur la Sécurité sociale progressivement après 1945 qu’il peut plus facilement en organiser la réforme d’un point de vue économique. L’instauration du régime général de la Sécurité sociale avait imposé à l’État une situation de double pouvoir, où il devait négocier avec les ouvriers. Grâce au contrôle et à la gestion par les intéressés eux-mêmes des caisses, l’État ne pouvait pas faire ce qu’il voulait.
Ainsi, on comprend mieux pourquoi l’État a rapidement fait de la liquidation de ce double pouvoir l’une de ses priorités. Les premières réformes de la Sécurité sociale ne sont pas économiques, elles ne concernent pas son financement mais son organisation. Elles visent à se réapproprier le pouvoir, notamment à travers les ordonnances Jeanneney en 1967, qui suppriment les élections des administrateurs de caisses par les salariés et instaure le paritarisme, de telle sorte que les représentants des salariés, qui pesaient pour 75% des membres des caisses, ne sont plus que 50%, à égalité avec ceux du patronat. Ce dernier peut désormais imposer ses vues en s’alliant au syndicat le plus complaisant. De même, c’est le cas avec les ordonnances Juppé en 1995-1996, qui étatisent encore davantage la Sécurité sociale en soumettant son budget à un vote annuel du Parlement avec le Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale (PLFSS).
LVSL : En parallèle de l’opposition entre la Sociale et l’État social, vous en proposez une autre entre public et étatique. Là encore, sur quoi cette opposition repose-t-elle et dans quelle mesure n’est-elle pas potentiellement un piège tendu par les libéraux ?
N. D. S. : L’idée de distinguer le public de l’étatique est totalement liée à l’idée de distinguer la Sociale et l’État social. Le public, dans le livre, est défini d’une façon assez simple : c’est la protection sociale obligatoire. Celle-ci peut être soit contrôlée par l’État, auquel cas, c’est de l’étatique, soit par les intéressés eux-mêmes, auquel cas c’est la Sociale. Mais cette opposition concerne bien plus que la Sécurité sociale en tant que mode de financement des soins de santé. Elle concerne les producteurs eux-mêmes comme l’hôpital ou la médecine de ville. Historiquement, l’hôpital devient public parce que l’Église, qui s’en occupait durant plusieurs siècles, perd progressivement son pouvoir après la Révolution de 1789. L’hôpital est alors mis sous la tutelle des communes, disposant d’un fort pouvoir local – un pouvoir public mais qui n’est pas étatique.
Progressivement, des lois, notamment en 1941, commencent à transférer le pouvoir sur l’hôpital des communes vers le gouvernement, le ministère puis les agences de santé qui en dépendent. On observe là aussi une situation de pouvoirs multiples dans l’hôpital public : le pouvoir de plus en plus faible des communes, face au pouvoir croissant de l’État et, entre les deux, celui des professionnels de santé, qui ont pu jouer par le passé un rôle beaucoup plus important qu’aujourd’hui dans l’organisation des hôpitaux. Le public ne se réduit donc pas à l’étatique. Au contraire, avec la Sociale, on peut désirer plus de public et, simultanément, moins d’étatique.
LVSL : Pour autant, ne semble-t-il pas compliqué voire illusoire de concevoir un hôpital public sans aucune intervention de l’État, et plus largement un secteur public obligatoire, pour reprendre la Sécu, sans garantie de cette obligation par l’État et par la force de la loi ?
N. D. S. : Je ne conteste pas du tout le fait historique qu’il y a un État en France, qu’il est fort et que, par l’usage ou la menace de l’usage de la violence, il permet de faire respecter la loi. En revanche, j’essaie de mettre en évidence que les lois écrites et votées par le gouvernement et le Parlement ont souvent pour origine le mouvement social – la Sociale. Évidemment, le cadre légal est validé par l’État, mais cela ne signifie pas que ce dernier en soit forcément à l’origine et qu’il le dirige.
« Ce n’est pas l’État qui se charge de la mise en œuvre des ordonnances, mais bien les milliers de personnes issues de la CGT qui vont constituer ces fameuses caisses du régime général de la sécurité sociale, au niveau local, régional et national. Ce sont ces militants qui le font, et non l’État. »
Les ordonnances d’octobre 1945, qui portent création de la Sécurité sociale, ne sont que de l’encre sur du papier. Elles font suite au contexte de la guerre totale, avec un mouvement de résistance à l’État collaborateur important. Des projets de réforme des assurances sociales de 1928-1930 circulent dans les ministères à la veille de la guerre et des discussions avancées se déroulent sous Vichy. Là aussi, ce n’est que de l’encre sur du papier. Les ordonnances doivent leur naissance non pas tant à une volonté étatique ou bureaucratique qu’à un contexte politique et social nouveau. De plus, ce n’est pas l’État qui se charge de la mise en œuvre des ordonnances, mais bien les milliers de personnes issues de la CGT qui vont constituer ces fameuses caisses du régime général de la Sécurité sociale, au niveau local, régional et national. Ce sont ces militants qui le font, et non l’État.
Enfin, l’idée selon laquelle on ne fait rien sans l’État est selon moi une idée qui nous mutile du point de vue de la pensée et de l’action. Au contraire, il faut penser l’existence d’une pluralité de pouvoirs, y compris des pouvoirs qui peuvent s’exercer contre l’État. Le public, c’est-à-dire le fait qu’on puisse organiser des choses obligatoires comme la Sécurité sociale, comme l’existence d’un hôpital, n’implique pas nécessairement que le pouvoir de décision soit centralisé au niveau de l’appareil étatique. On le voit dans les hôpitaux ou dans les caisses de Sécurité sociale.
LVSL : La conception de l’État qui apparaît dans votre livre le réduit tout de même régulièrement à un outil de domination. Or, l’État est le résultat d’un long processus de construction historique, qui évolue au fil des périodes et qui est aussi le lieu d’expression de rapports de force entre des valeurs et des intérêts divergents. Dès lors, ne concevez-vous pas la possibilité d’un État émancipateur, véritable garant de l’intérêt général et en même temps de transformations sociales qui seraient souhaitables ?
N. D. S. : Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’un livre théorique, ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas réfléchi aux questions théoriques en amont. Mon arrière-plan théorique s’oppose justement à la coutume qu’on a en sciences sociales de considérer que l’État est un champ de bataille. C’est une conception partagée par de nombreux courant progressistes, qui considèrent l’État comme le lieu de cristallisation de différents intérêts, dont la conquête est possible par le camp du travail. D’ailleurs, je trouve que les collègues qui mobilisent ce cadre théorique pour penser leurs objets de recherche font un travail très souvent remarquable. Je n’ai aucune intention d’entrer dans des querelles théoriques qui n’intéressent personne. Je propose un autre regard et le soumets au jugement.
Je pose une hypothèse peu habituelle lorsqu’elle concerne l’État mais très traditionnelle lorsqu’elle concerne d’autres rapports sociaux. Elle consiste à dire que l’État est un rapport de domination, une modalité de l’exercice du pouvoir politique, mais qu’il y en a d’autres, potentiellement meilleures. Je ne formule pas une théorie de l’État. Je conserve simplement cette hypothèse en arrière-fond, et je la pose de la même façon qu’on pose souvent l’hypothèse selon laquelle le capital est un rapport d’exploitation qui est problématique et dont il faut se débarrasser sans développer pour autant toute une théorie du capital. Dans le livre, je m’intéresse en particulier à deux rapports sociaux de domination, l’un étant l’État, l’autre le capital, et je pose l’hypothèse que ce sont deux rapports sociaux de domination qu’il peut être utile de dépasser.
« L’enjeu est de sans cesse dépasser le progrès d’hier, en pensant de nouvelles formes politiques encore plus avancées. »
Quand le capital, lien de dépendance impersonnelle, a remplacé le servage, lien de dépendance personnelle, ce fut un progrès. Les théories socialistes, communistes ou encore anarchistes considèrent cette évolution comme un progrès, tout en imaginant d’autres rapports sociaux de production, encore plus émancipateurs. C’est sur cette base que se fondent toutes les critiques radicales du capitalisme, qui ne cherchent pas tant à le changer, à le réguler, qu’à en sortir. Je procède de la même façon pour l’État que pour le capital. Évidemment, l’État moderne est un progrès par rapport à l’absolutisme, puisqu’il instaure un pouvoir politique impersonnel qui n’est pas lié à la personne du Roi. L’État né de la Révolution française est un progrès par rapport à l’État absolutiste. L’enjeu est de sans cesse dépasser le progrès d’hier, en pensant de nouvelles formes politiques encore plus avancées.
J’observe dans le champ de la protection sociale que les travailleurs auto-organisés peuvent produire des institutions publiques non-étatiques qui, sous beaucoup d’aspects, sont un progrès par rapport à l’État. J’ai bien sûr conscience qu’avoir ce type de discours, à une époque où se multiplient les prises de position libertarienne, peut sembler peu stratégique. Néanmoins, si je le tiens malgré tout, c’est parce que les politiques sociales progressistes, dans le champ de la santé notamment, n’ont jamais été le produit de la conquête de l’appareil d’État ou d’un État social bienveillant.
« Heureusement que l’État social existe encore et que le capital n’a pas tout emporté. […] S’il est indéniable que l’État est une institution de la prédation, il a développé au cours du temps des logiques de protection. Paradoxalement, la protection est la meilleure technologie de prédation. »
Dire que la Sociale est supérieure à l’État social n’implique pas de nier l’importance des politiques sociales portée par l’État. Heureusement que l’État social existe encore et que le capital n’a pas tout emporté. Je m’inscris dans l’approche théorique développée par Mehrdad Vahabi sur l’État prédateur. S’il est indéniable que l’État est une institution de la prédation, il a développé au cours du temps des logiques de protection. Paradoxalement, la protection est la meilleure technologie de prédation. Comme l’éleveur de bétail qui prend soin de son cheptel pour ensuite mieux l’exploiter, l’État développe des politiques sociales généreuses pour que son action prédatrice soit plus facilement acceptée. On ne peut pas séparer la main droite de la main gauche de l’État. Pendant le confinement de 2020, le gouvernement a largement étendu les droits sociaux mais c’était pour éviter toute remise en cause de son pouvoir. Il fallait protéger l’ordre social de la rébellion.
LVSL : Dans votre ouvrage, vous insistez à juste titre sur le fait que l’histoire de la protection sociale, et en particulier celle du régime général de la sécurité sociale mis en place en 1945-1946, est une histoire de conflits. Qui cette histoire opposait-elle et sur quels éléments principaux ces conflits portaient-ils ?
N. D. S. : Le livre entreprend de distinguer deux grands types de conflits : les conflits sociaux d’une part, au sens classique de la lutte des classes ; les conflits armés d’autre part. Loin de l’idée courante selon laquelle la Sécu et plus largement les institutions de la protection sociale sont le produit du consensus, j’insiste sur le fait que les grands moments de l’histoire de la protection sociale sont des moments très conflictuels. La création des mutuelles intervient à la suite de la Révolution. Le fameux décret de 1852 fait suite à la Révolution de 1848. En réalité, comme le montre le sociologue Numa Murard, en France, avant 1914, l’État social n’existe que dans les débats. Au niveau économique, la part des dépenses publiques accordée à la protection sociale est identique en 1914 à celle de la Révolution de 1789 (environ 10%).
Il faut des moments de grande conflictualité pour observer des changements significatifs dans l’ordre de la protection sociale. En m’appuyant sur des travaux en sciences sociales, notamment de politistes et d’historiens, je montre que l’État social naît véritablement en France avec les guerres mondiales. Que ce soit dans le cadre de la préparation de ces guerres, dans la conduite de ces guerres ou encore du fait de leurs conséquences, la place de l’État dans l’économie change, de telle sorte que ce qui était autrefois impossible devient possible.
« Après la guerre, la création d’une assurance publique obligatoire pour couvrir les risques santé et vieillesse ne fait plus débat. Le consensus ne vient pas de la qualité de l’argumentation des députés mais des conditions politiques et sociales créées par le conflit mondial. »
Alors que l’idée d’une politique de santé étatique est en débat depuis la Révolution française, il faut attendre la fin de la Grande guerre pour que les paroles laissent place aux actes. Après la guerre, la création d’une assurance publique obligatoire pour couvrir les risques santé et vieillesse ne fait plus débat. Le consensus ne vient pas de la qualité de l’argumentation des députés mais des conditions politiques et sociales créées par le conflit mondial. S’il faut attendre 1928-1930 pour que les lois d’assurance sociales soient votées, ce n’est pas en raison d’une opposition de l’État mais à cause de l’opposition des médecins et des mutualistes supposés mettre en œuvre la loi. En résumé, les guerres changent la place de l’État dans l’économie et rendent légitime son intervention là où auparavant elle ne semblait ni légitime ni nécessaire.
Pour ce qui est de la naissance du régime général de la sécurité sociale en 1945-1946, les historiens montrent qu’il n’y a aucune opposition au fait de donner plus d’argent pour les politiques sociales après la guerre. Le débat public actuel donne l’impression que les historiens sont d’accord pour dire que la Sécu est née d’un grand consensus national. En fait, quand on lit leurs travaux dans le détail, notamment Bruno Valat et son Histoire de la Sécurité sociale, on se rend compte que dès le début, il y a un grand désaccord sur la question du pouvoir : est-ce que cette organisation va être laissée aux mains des maîtres d’antan, qui géraient les institutions de protection sociale d’avant 1945 ? Est-ce qu’on donne plus de pouvoir à l’État ? Ou bien, est-ce qu’on va faire ce qu’on a finalement fait, à savoir donner le pouvoir aux intéressés directement ?
L’enjeu du conflit social se situe donc à ce niveau-là en 1945. Tout le monde est d’accord pour réformer le système de sécurité sociale d’avant-guerre et pour lui attribuer plus d’argent, mais personne n’est d’accord pour savoir qui va diriger la nouvelle institution. La CGT, comme avant-guerre, veut diriger elle-même, en tant qu’organisation représentative des travailleurs. Son mot d’ordre est alors « un homme une voix ». En face, les anciens maîtres des institutions sociales veulent garder leur pouvoir, et maintenir des formes de paternalisme social. Qui veut d’un régime général aux mains des intéressés ? Le patronat ne veut pas du pouvoir des ouvriers, donc il s’oppose. La mutualité veut garder son pouvoir sur les assurances sociales, donc elle s’y oppose. Le clergé veut lui aussi conserver son pouvoir, notamment sur les caisses d’allocations familiales, donc il s’y oppose. Les assureurs privés perdent le bénéfice de la gestion des accidents du travail, donc ils s’y opposent. Même les médecins libéraux, qui tiennent à leurs libertés d’exercice et ne veulent pas être gouvernés par la CGT, s’y opposent.
Du point de vue des organisations politiques, le MRP chrétien-démocrate cherche à sauver ce qu’il peut de la mutualité, tout comme la SFIO socialiste, notamment avec le vote de la loi Morice en 1947. Finalement, l’existence de la mutualité aujourd’hui est le produit d’une résistance opiniâtre au régime général. Cela montre donc bien les enjeux du conflit. Que ce soit Colette Bec, Bernard Friot ou Bruno Valat, tous disent que dès le début, il y a des victoires, des concessions ou des défaites. Le conflit est le maître mot.
LVSL : Par rapport à la question du pouvoir, et en parallèle des mobilisations sociales, pensez-vous que le régime général de la Sécurité sociale aurait pu être réalisé de cette façon sans la présence d’un personnage comme Ambroise Croizat au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et plus largement sans la présence de dirigeants cégétistes et communistes dans les instances étatiques ? N’est-ce pas une réalisation à mettre au crédit de la stratégie de neutralisation et de subversion de l’appareil d’État employée à l’époque par les communistes ?
N. D. S. : C’est une question piège. J’aurais envie d’y répondre en disant que c’était important, mais pas décisif. Je le dis sans minorer le rôle de Croizat et d’autres militants ou dirigeants du mouvement ouvrier qui étaient dans les instances décisionnaires officielles, ou même à l’Assemblée. Ce sont des gens incroyables. Quand on regarde à quel point ils se battent dès le début, alors qu’il n’y a aucune unanimité, aucune union nationale, pour défendre le régime général avant même qu’il n’existe, on ne peut être qu’admiratif de ces combats. Cependant, ce qu’ils font, ils peuvent le faire car un mouvement social déterminé à changer la société met le feu aux poudres.
De toute façon, je suis incapable de dire que si cela aurait été différent avec ou sans la présence de communistes dans les instances étatiques. Je ne suis pas voyant. Ce que j’observe néanmoins est que leur enjeu à l’époque n’est pas d’abord la conquête du pouvoir d’État, parce qu’ils savent qu’ils ne peuvent l’obtenir. L’un des aspects historiques que j’ai appris en faisant ces recherches est qu’évidemment, le contexte d’après 1945 est plus favorable qu’en 1939, mais qu’il n’y a pas du tout de grande majorité ouvrière capable de conquérir l’appareil d’État. L’enjeu est donc de prendre ce qu’il y a à prendre.
Toujours est-il que cette attitude est à replacer dans un cadre stratégique plus général du Parti communiste, de la CGT et d’une grande partie du mouvement social qui est moins souvent citée dans l’ouvrage mais qui reste attachée à des formes de mobilisations anciennes, à tendance anarchiste, dont l’enjeu principal n’est pas la conquête du pouvoir d’État pour le pouvoir État, mais de changer la société. Là encore, il me semble qu’il faut distinguer la conquête de l’appareil d’État de la conquête du pouvoir politique, qui ne se réduit pas à l’appareil d’État. Cela signifie tout simplement que le but du mouvement social n’est pas de « gérer » les institutions de la domination mais de les détruire.
« La prise de pouvoir d’État peut être au mieux un moyen, mais en aucun cas un objectif en soi. L’enjeu n’est pas de diriger l’État et de discipliner les capitalistes, il est de construire des formes politiques et économiques alternatives. »
Dans le livre, je ne discute pas de l’hétérogénéité du mouvement social notamment quant à son rapport à l’État. Faut-il le conquérir ou le dépasser ? Par l’usage des moyens légaux ou par la force ? Je regroupe cette hétérogénéité sous le concept d’auto-organisation. C’est bien entendu une simplification critiquable mais elle prend son sens lorsque l’on compare le mouvement social d’alors avec le nôtre. Dans le contexte actuel, les forces politiques qui se disent progressistes n’ont pour seul horizon que la prise du pouvoir de l’appareil d’État pour réguler le capitalisme. Cela tranche nettement avec les pratiques des organisations politiques et syndicales qui naissent à la fin du XIXe siècle dont le but est d’en finir avec le capitalisme et pour qui l’appareil d’État est au mieux un moyen pour y parvenir mais certainement pas une fin en soi. C’est ce sur quoi je souhaite insister avec cette opposition entre l’État et la Sociale : la prise de pouvoir d’État peut être au mieux un moyen, mais en aucun cas un objectif en soi. L’enjeu n’est pas de diriger l’État et de discipliner les capitalistes, il est de construire des formes politiques et économiques alternatives. C’est comme cela que sont nées les institutions que nous chérissons.
LVSL : Dans ce cadre-là, ne faut-il pas voir davantage la Sociale et l’État social tels que vous les définissez comme les deux pôles d’un continuum de prise en charge de la protection sociale par le public ?
N. D. S. : Je comprends que cela puisse sembler binaire. Évidemment, je présente cette opposition de façon idéale-typique, pour penser la réalité concrète et les tendances historiques. Croizat, qui pour moi représente la Sociale, est au gouvernement, il y a donc bien des passerelles, des aspérités. J’imagine que cette présence au gouvernement puisse être prise comme un argument à l’encontre de ma thèse centrale qui est de dire que l’État social et la Sociale ne sont pas la même chose, et que justement on peut conquérir l’État. Mais, comme je l’ai déjà dit, la présence au gouvernement ne parait pas l’élément le plus important permettant d’expliquer l’avènement du régime général. D’ailleurs, des personnages politiques bien intentionnés, communistes ou non, il y en a eu beaucoup dans les gouvernements. Cela n’a jamais été suffisant ou nécessaire pour insuffler le progrès social.
Pour prendre un autre exemple, les élites du Welfare, qui travaillent actuellement dans les institutions de la protection sociale à des niveaux hiérarchiques élevés, doivent appliquer la politique anti-sociale désastreuse du gouvernement, alors qu’elles sont souvent contre ces dynamiques à l’œuvre. Un jour ou l’autre, elles pourraient sans doute faire leur métier différemment, si toutefois le contexte politique venait à changer. À l’instar de Pierre Laroque, impliqué dans la mise en œuvre des assurances sociales avant-guerre, membre du cabinet du ministre du Travail du premier gouvernement de Vichy avant d’en être révoqué pour ses origines juives, et qui joue un rôle important à la Libération en tant que premier directeur de la Sécurité sociale.
On trouve des personnes formidables dans l’État à toutes les époques et elles réalisent toujours un travail utile lors des périodes de progrès. Mais ce n’est pas leur présence dans l’État qui explique le changement institutionnel. C’est beaucoup plus la contestation de l’État par la Sociale qui leur permet de jouer un nouveau rôle.
LVSL : Votre ouvrage s’intéresse enfin aux évolutions récentes des politiques publiques de santé. Vous analysez notamment le nouveau management public comme un produit à part entière de l’État social, et non pas tant comme un outil du néolibéralisme, notamment à travers le recours à une forme de capitalisme sanitaire…
N. D. S. : Je n’utilise pas le mot néolibéralisme dans mon ouvrage, de telle sorte qu’il n’y apparaît que lorsque je mobilise certaines références bibliographiques. Si je ne l’utilise pas, c’est parce qu’il y a une tendance à résumer beaucoup d’analyses académiques au « tournant des années 1980 », alors que ce que montrent les spécialistes du sujet c’est qu’il y a une archéologie du néolibéralisme qui commence en fait bien avant ces fameuses années 1980. Ce qui me gêne le plus dans le concept de néolibéralisme n’est pas les analyses des auteurs qui le mobilisent mais certains usages militants. Tout se passe comme si le monde d’avant le néolibéralisme était un monde désirable, fait de consensus et de prospérité, un monde tragiquement évanoui du fait des crises pétrolières des années 1970. Tout cela est bien entendu une fable : l’après-guerre est une période très conflictuelle et l’exploitation d’alors n’a rien à envier à la situation actuelle.
« Il faut en finir avec l’idée d’une période des « Trente Glorieuses » et d’un régime fordiste qui aurait été une ère de concorde sociale relative ayant permis le développement d’institutions auxquelles nous sommes tous très attachés. »
Si je n’utilise pas ce concept, ce n’est pas parce que je le trouverais mauvais, mais parce qu’en fait, je n’en ai pas besoin. Je souhaite avant tout montrer que l’opposition aux politiques sociales portées par le régime général est inscrite dès la naissance-même du régime général. Il n’y a pas de grand tournant idéologique à partir des années 1970 ou 1980, par lequel on se serait rendu compte que la Sécurité sociale coûte trop cher. Tout cela n’existe pas et comporte un aspect mythologique, puisque dès le début, de nombreuses forces politiques, idéologiques et sociales s’y sont fortement opposées. Il faut en finir avec l’idée d’une période des « Trente Glorieuses » et d’un régime fordiste qui aurait été une ère de concorde sociale relative ayant permis le développement d’institutions auxquelles nous sommes tous très attachés.
Je ne pense pas qu’il soit pertinent d’être nostalgique de cette période. Ce qui pose problème à ce moment-là comme aujourd’hui n’est pas tant le type de capitalisme (fordiste ou néolibéral) mais le capitalisme. Cela n’enlève rien à l’importance des travaux sur les différentes formes du capitalisme. Je les trouve essentiels. Il s’agit simplement de changer la focale et de parler du capitalisme plutôt que des variétés du capitalisme. À quoi servirait une lutte victorieuse contre le néolibéralisme si elle conduisait à une autre forme de capitalisme ?
Que se passe-t-il après 1945 ? À partir du moment où l’État se réapproprie le régime général de la sécurité sociale, alors il a les mains libres pour faire ce qu’il veut. Le pouvoir politique sur le système de santé permet de changer son économie. On observe que dès 1945-1946, il n’y a pas de la part de l’État une volonté claire de privilégier la production publique de soins par rapport à la production capitaliste. Un bon exemple de cette ambiguïté est le cas des cliniques. À partir de 1945, il est beaucoup plus facile par la législation de construire des cliniques privées à but lucratif que de construire des hôpitaux.
Aujourd’hui, si la sphère du capitalisme sanitaire se développe aussi rapidement et efficacement, c’est parce que l’État a réussi à se réapproprier politiquement la Sécu et que se réappropriant complètement la Sécu, il a les mains libres et peut faire ce qu’il veut (sans parler des multiples conflits d’intérêts régulièrement révélés). L’État social est aux manettes, c’est lui qui décide de la politique, et la politique qu’il mène aujourd’hui repose sur l’acceptation qu’il faut une sphère publique importante. La sphère publique, même si elle est en train de reculer sur divers aspects, existe encore, car du point de vue statistique, l’État social existe encore. En revanche, il a complètement changé de principe d’organisation.
« Au fond, l’État social cherche à favoriser ses alliés politiques. Au XIXe siècle, cela pouvait être le clergé, les médecins ou encore les mutuelles. Aujourd’hui, c’est davantage le capital. »
Par rapport à la santé, ce discours se traduit par l’idée qu’il faut une politique de santé publique généreuse, mais pour les plus pauvres seulement, ou les plus malades, ou là où ça n’est pas rentable. Et on va développer le capital ailleurs, avec des complémentaires santé et des cliniques privés, ou avec des dépassements d’honoraires. Au fond, l’État social cherche à favoriser ses alliés politiques. Au XIXe siècle, cela pouvait être le clergé, les médecins ou encore les mutuelles. Aujourd’hui, c’est davantage le capital. Et c’est vrai dans plusieurs secteurs, autres que la santé.
LVSL : Vous écrivez également que la crise actuelle du système de santé n’est pas tant une crise financière qu’une crise politique. En quoi cette crise politique consiste-t-elle et quelles seraient vos préconisations pour y remédier ?
N. D. S. : Il est évident qu’une production publique de santé satisfaisante demande beaucoup de moyens financiers, et que ceux-ci peuvent venir à manquer. Néanmoins, pour toutes les raisons évoquées dans le livre, le premier problème n’est pas financier mais politique. La politique sanitaire de l’État social produit des gabegies terrifiantes de telle sorte que l’on pourrait économiser des sommes conséquentes. Il serait contre-productif de dire qu’il n’y a aucune économie à faire. Il faut regarder qui produit quoi, dans quelles conditions. C’est en ce sens-là que je dis que la crise est politique.
Par exemple, les complémentaires santé sont un véritable gouffre financier. Un rapport rendu en 2022 par le Haut Comité sur l’Avenir de l’Assurance Maladie estime les économies réalisées si la Sécurité sociale prenait en charge le ticket modérateur à la place des complémentaires. Pour rappel, le ticket modérateur est la part du prix administré qui n’est pas remboursée par la Sécurité sociale. Sur les 25 euros de votre consultation, la Sécurité sociale vous rembourse 70%, et les 30% restants qui constituent le ticket modérateur sont en général pris en charge par les complémentaires (sans compter un euro qui reste à votre charge). Selon ce rapport, les économies annuelles seraient de l’ordre de 5 milliards d’euros par an. Pour donner un ordre de grandeur, le Ségur de la santé sur son volet investissement pour l’hôpital proposait 13 milliards sur dix ans. Une telle mesure permettrait donc de faire un Ségur de la santé tous les deux ans et demi.
« Les complémentaires santé ne reposent sur aucune rationalité économique. »
Comment l’expliquer ? Tout simplement parce que les complémentaires santé sont beaucoup moins efficaces que la Sécurité sociale. Ce sont des ordres de grandeur qu’il faut avoir en tête car ils permettent de démontrer que le problème n’est pas d’abord financier. Tout le monde sait que cela coûte un « pognon de dingue », pour reprendre une expression devenue populaire. Des hauts-fonctionnaires, qui ne sont pas du tout connus pour être des radicaux, signent régulièrement des tribunes pour dire que cette politique sanitaire n’est pas rationnelle. Je pense notamment à une tribune citée dans l’ouvrage, dans laquelle Martin Hirsch et Didier Tabuteau prennent position publiquement pour dire que les complémentaires santé ne reposent sur aucune rationalité économique.
Mais dans le champ politique, les complémentaires santé sont aussi des soutiens. Les liens entre les élites politiques et les assurances privées à but lucratif, les mutuelles et les instituts de prévoyance sont nombreux. Il est donc délicat politiquement d’ôter à tous ces soutiens leur part du gâteau. Le secteur des complémentaires santé est une économie de rente à l’abri de la concurrence et de la critique démocratique… le tout au détriment du plus grand nombre.
Cette économie de rente, ou ce capitalisme politique comme je l’appelle dans le livre, se donne aussi à voir avec l’industrie pharmaceutique et la financiarisation de la Sécurité sociale. Nous pourrions faire des économies très importantes, mais on le refuse pour des raisons politiques. Bien entendu, il faut des investissements massifs dans l’hôpital public, dans les centres de santé, dans les maternités, etc. Mais le premier problème n’est pas l’argent, c’est le pouvoir de décision. Parce que si l’on a plus d’argent, mais que cela sert à enrichir l’industrie pharmaceutique sur le dos des patients et de la Sécu, cela ne sert à rien.
LVSL : Pour gagner cette bataille de la Sécu, pour regagner ce pouvoir de décision que vous venez d’évoquer, quel rôle jouent les imaginaires liés à la Sociale, les représentations que l’on se fait de cette histoire populaire ? Que ce soit dans des productions culturelles, par l’éducation populaire ou encore dans les médias, quelle est, selon vous, l’importance de mener cette bataille dans le champ culturel et quelles pistes souhaiteriez-vous peut-être partager, pour atteindre ce but ?
N. D. S. : Indépendamment des conflits d’interprétation qu’on peut avoir, sur l’utilité de conquérir le pouvoir d’État ou non, le gros enjeu est de mettre en évidence le fait que ce n’est pas en attendant la bienveillance des classes dominantes que les classes dominées ont réussi à imposer des politiques sociales progressistes. Le conflit est un moteur du changement institutionnel bien plus puissant que le débat parlementaire ou l’expertise.
Ce n’est pas en quémandant, en suscitant la pitié ou la bienveillance d’autrui, que la situation matérielle des classes dominées s’est améliorée. Les institutions sociales les plus populaires proviennent d’un conflit extrêmement violent. Le conflit est un moteur du changement institutionnel bien plus puissant que le débat parlementaire ou l’expertise. Diffuser cette idée-là peut faire réfléchir beaucoup de gens et amener à faire évoluer les stratégies militantes.
En termes de productions culturelles permettant de diffuser les imaginaires liés à la Sociale, il y a évidemment le film de Gilles Perret qui porte ce titre de La Sociale, un film extraordinaire, qui joue d’ailleurs sur cette ambivalence entre le conflit et le consensus. Des films et autres productions de ce type peuvent diffuser beaucoup plus facilement et efficacement ces représentations positives de la lutte des classes que des ouvrages souvent moins accessibles. Si ce livre et plus largement les travaux sur lesquels ils s’appuient peuvent nourrir ce type d’initiatives j’en serai forcément heureux.