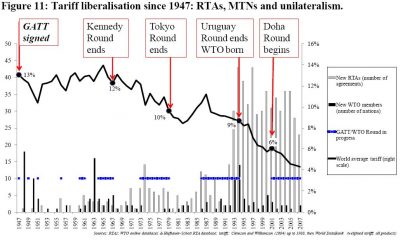L’historien Thomas Frank analyse la lente conquête des classes populaires par la droite radicale aux États-Unis. Son dernier livre, Pourquoi les riches votent à gauche, paru en anglais juste avant l’élection de 2016, sonne comme une alarme. Sa traduction en français chez Agone, avec une préface de Serge Halimi, peut nous donner les clefs pour comprendre cette évolution et inverser la tendance.
En Europe comme en Amérique, les anciens grands partis de gauche semblent suivre une trajectoire similaire qui les pousse toujours plus vers un consensus centriste et libéral. Cette stratégie conduit pourtant systématiquement à un effondrement électoral, ou même à une « pasokisation », en référence à l’ancien grand parti de la gauche grecque, aujourd’hui réduit à un groupuscule parlementaire. En réaction, les partis et les mouvements de droite connaissent cependant un mouvement inverse qui les pousse vers des positions toujours plus radicales. Quelles sont les raisons derrière ce glissement politique ? La question a déjà été posée à de nombreuses reprises mais bien peu nombreux, finalement, sont les intellectuels à avoir vraiment analysé la situation. La sortie en français de l’ouvrage Pourquoi les riches votent à gauche chez Agone (Titre original : Listen, Liberal: or Whatever Happened to the Party of the People?, Scribe, 2016) nous donne l’occasion de parler de l’un d’eux. Thomas Frank n’est pourtant pas facile à cerner. On a pu le lire dans le Harper’s Magazine, sur Salon.com, dans le Financial Times, le Guardian et le Monde diplomatique, mais il est aussi l’auteur de plusieurs livres. Selon les endroits où il s’exprime, il peut être à la fois un auteur, un analyste politique, un historien, un journaliste, un critique culturel ou même un « culture war author ». Ce qui est certain, c’est qu’il aussi un visionnaire.
Pour comprendre son importance, il faut revenir sur sa carrière. Thomas C. Frank est né en 1965 et a grandi à Mission Hills, Kansas, une banlieue dans l’aire urbaine de Kansas City, Missouri. Il étudie à l’Université du Kansas puis à l’Université de Virginie, et reçoit un doctorat en Histoire de l’Université de Chicago après une thèse consacrée à la publicité aux États-Unis dans les années 1960. Il fonde en 1988 un magazine de critique culturelle : The Baffler. La revue, qui deviendra notamment célèbre pour avoir éventé la supercherie du « Grunge speak » dans le New York Times(1), se vante de critiquer « la culture business et le business de la culture ».
-
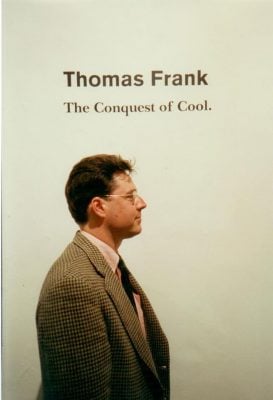
Thomas Frank à Graz, en Autriche, en 1998. © Thomas Frank
Les deux premiers ouvrages de Thomas Frank (Commodify Your Dissent(2), composé d’articles qu’il a écrit pour The Baffler, et The Conquest of Cool(3), tiré de sa thèse) ont pour sujet la cooptation de la dissidence par la culture publicitaire, c’est-à-dire la marchandisation de la langue et du symbolisme non-conformiste et contestataire, en particulier celui de la jeunesse. Il s’agit d’un sujet dont l’actualité est frappante, et qui est tout-à-fait éclairant sur le rôle que tient la publicité dans la société contemporaine, les liens entre capitalisme, culture populaire et médias de masse et les relations sociales de pouvoir dans l’espace médiatique.
À l’occasion de la parution de The Conquest of Cool, Gerald Marzorati écrit dans The New York Times Book Review le 30 novembre 1997(4) :
« [Thomas Frank est] peut-être le jeune critique culturel le plus provocateur du moment, et certainement le plus mécontent. […] Sa pensée ainsi que sa prose nous renvoient à une époque où la gauche radicale représentait, en Amérique, plus que des conférences et des séminaires suivis par des professeurs foucaldiens. Frank s’est débarrassé du jargon de mandarin ; pour lui, il est question de richesse et de pouvoir, de possédants et de dépossédés, et c’est clair et net. »
Le troisième ouvrage de Thomas Frank, publié en 2000 et intitulé One Market Under God(5), examine la confrontation entre démocratie traditionnelle et libéralisme de marché, et s’attaque en particulier à ceux qui considèrent que « les marchés sont une forme d’organisation plus démocratique que les gouvernements élus ». Ici encore, l’actualité de l’analyse est brûlante et démontre que Thomas Frank avait parfaitement compris les enjeux politico-économiques qui ouvraient le nouveau millénaire.
La conquête conservatrice des classes populaires
L’ouvrage qui va le rendre célèbre aux États-Unis sera publié en 2004, peu avant l’élection présidentielle que George W. Bush remportera face au Démocrate John Kerry, sous le titre What’s the Matter with Kansas?(6). Présent 18 mois sur la liste des best-sellers du New York Times, il sera traduit en français sous le titre Pourquoi les pauvres votent à droite. Ce livre est en grande partie tirée de l’expérience de Thomas Frank avec les évolutions politiques de son État d’origine, le Kansas, et représente une analyse politique magistrale qui est encore souvent reprise aujourd’hui.
Thomas Frank part d’un constat : les régions rurales des États-Unis, et en particulier dans le Midwest, font partie des zones les plus pauvres du pays. Alors que ces endroits furent le foyer d’un populisme agrarien de gauche radicale à la fin du XIXe siècle et qu’elles souffrent énormément des politiques libérales depuis les années 1970, comment se fait-il que ces régions soient autant acquises aux Républicains ? Ainsi, le comté le plus pauvre des États-Unis à l’époque (hors réserves indiennes) se trouvait à la frontière entre le Nebraska et le Kansas : ce comté de fermiers et de ranchers déshérités votait pour les candidats Républicains avec des marges de plus de 60 points. Comment, se demande Thomas Frank dans ce livre, peut-on autant voter contre ses intérêts ?
-
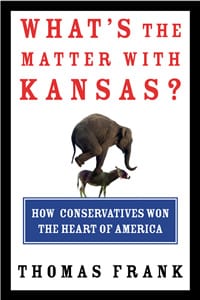
Pourquoi les pauvres votent à droite ? © Thomas Frank
La réponse se trouve aussi, en écho avec son travail sur la publicité, dans une appropriation de la contestation. Cette fois, c’est la droite qui a coopté le ressentiment contre l’establishment et l’a retourné à son profit. Thomas Frank montre que les Républicains conservateurs du Kansas qui étaient les plus radicaux au sein du parti se sont présentés comme les ennemis des « élites » : les politiciens du Congrès mais aussi les producteurs d’Hollywood ou les journalistes de la « Beltway », cette région urbanisée allant de Boston à Washington, D. C. En jouant sur le ressentiment des classes populaires blanches rurales et suburbaines, ils ont rapidement marginalisés les Républicains modérés et se sont assurés une domination presque totale sur la politique de l’État. Cependant, leur critique de l’élite se fait surtout sur un terrain culturel ; une fois au pouvoir, les Républicains conservateurs mettent en place une politique néolibérale qui nuit fondamentalement à l’électorat populaire. Malgré cela, au Kansas, les électeurs continuent à voter de plus en plus à droite. Ce phénomène, que l’on retrouve à travers l’entièreté du Midwest et du Sud, est appelé le « backlash » (contrecoup) conservateur par Thomas Frank. Le backlash se construit surtout sur des questions culturelles comme l’avortement, le port d’armes et le mariage gay. Dans le monde du backlash, les « libéraux » (au sens américain, c’est-à-dire la gauche) sont unis dans leur désir de détruire ces symboles de l’Amérique traditionnelle ; ils méprisent les « vrais Américains » qui vivent dans le « Heartland », le centre rural du pays. En opposition, on parle volontiers de « libéraux côtiers » pour qualifier les habitants de New York ou de San Francisco.
Le porte-étendard du backlash conservateur dans le Kansas est Sam Brownback, qui était à l’époque l’un des deux sénateurs de l’État. Il en sera par la suite le gouverneur, de 2011 à 2018, période pendant laquelle sa politique de baisse massive d’impôts ruinera totalement le budget étatique. L’entièreté de sa carrière se construira sur cette thématique anti-establishment.
« Ici, la gravité du mécontentement ne pousse que dans une seule direction : à droite, à droite, toujours plus à droite. »
Ce backlash conservateur n’est pas un phénomène récent aux États-Unis ; selon Thomas Frank, on peut retrouver ses origines à l’époque de Richard Nixon. Ce backlash vit une accélération avec l’ère Reagan mais surtout avec la « révolution conservatrice » menée par Newt Gingrich, qui fut élu Speaker de la Chambre des Représentants après la large victoire des Républicains aux élections de mi-mandat de 1994, sur un programme très conservateur (« The Contract with America »). Le repli identitaire sur des valeurs culturelles, au premier chef l’avortement, se cristallise vraiment à cette époque. Ce que Thomas Frank souligne avec justesse, cependant, est qu’il ne s’agit pas d’un banal mouvement réactionnaire et que l’on ne peut pas se contenter de l’expliquer par le racisme de la société américaine, comme beaucoup le font. Il montre au contraire que les militants anti-avortement, les plus radicaux et les plus nombreux au sein du backlash, s’identifient énormément aux militants abolitionnistes de la période précédant la guerre de Sécession. Le Kansas lui-même a été fondé par des abolitionnistes venus de Nouvelle-Angleterre cherchant à empêcher les habitants du Missouri voisin, esclavagistes, de s’établir sur ces terres. Le conflit, parfois très violent, qui opposa abolitionnistes et esclavagistes dans les années antebellum fait évidemment écho, pour ces militants, à celui qu’ils mènent contre l’avortement. Ils s’identifient également aux populistes agrariens de la fin du XIXe siècle qui secouèrent la politique américaine. Emmenés par William Jennings Bryan, un natif du Nebraska trois fois candidat à la présidentielle pour le parti Démocrate, ces populistes (comme ils s’appelaient eux-mêmes) militaient contre les monopoles et les grands banquiers qui dominaient l’économie. Ces deux mouvements populaires étaient sous-tendus par de forts sentiments religieux évangéliques, comme l’est aujourd’hui le mouvement « pro-life ». Ces activistes mettent leur lutte en parallèle avec leurs prédécesseurs comme une dissidence contre le pouvoir en place et son hégémonie culturelle. En ce sens-là, le backlash dans le Midwest est à dissocier de celui du Sud profond (Louisiane, Alabama, Mississippi, Géorgie) qui a plus à voir de son côté avec un maintien ou un renforcement de la suprématie blanche et se berce souvent de nostalgie confédérée. Mais malgré tous les beaux sentiments des conservateurs du Midwest, ce backlash les amène tout de même à voter avec constance contre leurs intérêts économiques. Contrairement à l’époque de William Jennings Bryan, le ressentiment populaires ne se tourne plus contre les élites économiques. « Ici, la gravité du mécontentement ne pousse que dans une seule direction : à droite, à droite, toujours plus à droite », écrit Thomas Frank.
Quand il écrit What’s the Matter with Kansas, il ne pouvait pas prévoir le « Tea Party », ce mouvement né en 2009 qui pousse le backlash encore plus loin, ni Donald Trump. Ces événements donnent pourtant à son livre une teneur presque prémonitoire ; ce qui se passait dans le Kansas en 2004 s’est étendu à toute la nation.
Gardant toujours un œil sur la droite américaine, il publie dans les années suivantes deux livres décortiquant le pillage systématique des services publics par les conservateurs (The Wrecking Crew(7)) et la façon dont la crise économique fut utilisée pour justifier le néolibéralisme par la droite (Pity the Billionaire(8)). Son dernier livre est publié sous le titre Listen, Liberal(9) en 2016, six mois avant l’élection qui a fait de Donald Trump l’homme le plus puissant du monde. Il s’agit en quelque sorte d’une continuation de What’s the Matter with Kansas, en ce qu’il reprend là où s’était arrêté son dernier chapitre : quelle est la responsabilité des Démocrates dans ce fiasco ?
L’ère Obama : autopsie d’un échec
Alors qu’elle avait tout gagné en 2008, la gauche étasunienne a perdu la Chambre et le Sénat, un millier de sièges dans les assemblées étatiques, n’a réussi à imposer qu’une timide réforme de l’assurance-maladie et n’a qu’à peine régulé l’industrie des services financiers. En 2016, Wall Street fonctionne comme avant, et si la reprise est là sur le papier, les trois-quarts des Américains estiment que la récession est toujours en cours. Le chômage baisse mais la grande majorité des nouveaux profits ont été captés par les actionnaires, et les jeunes diplômés arrivent sur le marché du travail et de l’immobilier écrasés par la dette étudiante.
Thomas Frank explique dans Listen, Liberal que ceci n’est pas simplement dû à la malchance ou aux aléas de l’économie. Le parti Démocrate est en fait devenu un parti d’élites, ceux qu’il appelle la « classe professionnelle », ou « classe créative » : les médecins, les ingénieurs, les avocats, éditorialistes, fondateurs de start-ups et cadres de la Silicon Valley. Cette classe était celle qui était la plus acquise au Parti Républicain dans les années 1960 – aujourd’hui, elle est devenue la plus Démocrate. De fait, le niveau d’éducation et le vote démocrate sont parfaitement corrélés dans la population blanche, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas du revenu (les très riches continuent à voter Républicain). C’est cette classe professionnelle qui contrôle le Parti Démocrate aujourd’hui, et elle impose son programme libéral en matière d’économie.
-
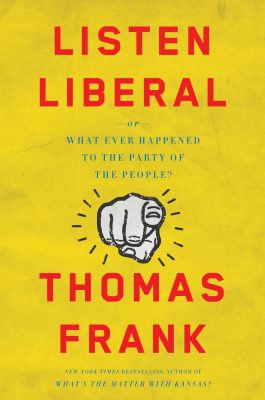
Pourquoi les riches votent à gauche ? © Thomas Frank
En termes politiques, les éléments-clefs mis en avant par les Démocrates centristes qui représentent cette catégorie d’intérêts sont la méritocratie, l’expertise, le consensus, la politique bipartisane. Ce genre de discours délaisse complètement les thèmes démocrates traditionnels qui s’adressaient aux travailleurs, aux syndicats, aux habitants des zones rurales, qui promettaient de défendre les Américains moyens contre les intérêts monopolistiques ; en bref, défendre le « small guy ». Selon Thomas Frank, c’est ce changement chez les Démocrates qui pousse l’électorat populaire dans les bras des Républicains. Ce changement a commencé avec Bill Clinton, dont le mandat a été marqué par la signature de l’ALENA, le plus grand accord de libre-échange de l’histoire des États-Unis. Ce projet avait pourtant été rédigé par l’administration de George H. W. Bush, mais c’est Bill Clinton qui lui a permis d’entrer en vigueur : il aura un effet destructeur sur l’industrie du Midwest. C’est aussi sous Bill Clinton que la loi Glass-Steagall, qui régulait Wall Street depuis 1933, a été abrogée. Cette politique, à l’opposé de ce que défendaient les Démocrates depuis Franklin D. Roosevelt, était justifiée par des arguments rationnels : c’est-à-dire sur l’avis d’économistes et de banquiers, de techniciens de la politique et de l’économie. Ainsi, le secrétaire du Trésor de 1995 à 1999, Robert Rubin, était un ancien membre du conseil d’administration de Goldman Sachs. Avoir un diplôme d’une université de l’Ivy League est une condition sine qua non pour être accepté au sein de cette élite, de même que croire dur comme fer à la loi du marché, à la dérégulation et au libre-échange.
La présidence de Barack Obama n’échappa pas à cette tendance. Les Démocrates se trouvaient, en 2008, dans une situation parfaite pour réformer l’économie en profondeur : ils contrôlaient le Congrès et la crise financière appelait à punir les responsables. Mais plutôt que d’appliquer les lois anti-trusts et d’imposer des politiques de régulation à Wall Street, ils n’ont mis en place que de timides réformes. Selon Thomas Frank, cela s’explique par le fait que l’agenda démocrate était fixé par la “classe professionnelle” qu’il décrit, qui voit les régulations d’un mauvais œil et préfère appliquer les recommandations d’économistes : la présidence Obama a marqué l’avènement de la technocratie aux États-Unis. Pour les élites démocrates, les banquiers de Wall Street sont des personnes tout à fait recommandables : elles possèdent un diplôme prestigieux, donc elles savent ce qu’elles font, et se comportent de manière rationnelle. Thomas Frank rejoint ici la critique faite par Elizabeth Warren, sénatrice Démocrate du Massachusetts, ancienne professeure de droit à Harvard et figure de l’aile gauche du parti : selon elle, l’administration Obama avait le pouvoir et la légitimité pour punir lourdement les responsables de la crise, mais cela n’a pas été fait(10).
« Bernie Sanders n’est rien de plus qu’un Démocrate classique : son programme reprend presque exactement là où Harry Truman s’est arrêté. »
Malgré l’espoir historique qu’a suscité Barack Obama, la situation ne s’est pas vraiment améliorée sous sa présidence pour l’électorat populaire, qui avait majoritairement voté pour lui hors du Sud. Les banques « too big to fail » sont sauvées, les traités de libre-échange continuent d’être signés, la logique du marché continue de triompher. Ce faisant, les élites démocrates, se parant de responsabilité morale, sont persuadées de mettre en place les politiques les plus efficaces et les plus rationnelles. Après tout, elles font consensus parmi les spécialistes, et les objectifs traditionnels du parti Démocrate (justice sociale, égalité des chances, partage des richesses) ne peuvent plus permettre à la gauche de gagner à leurs yeux. Le reproche d’inéligibilité fait à Bernie Sanders rappelle l’identique rengaine contre Jeremy Corbyn. Pourtant, Bernie Sanders n’est rien de plus qu’un Démocrate classique : son programme reprend presque exactement là où Harry Truman s’est arrêté en 1952 et ne ferait pas rougir un Kennedy. Que Sanders soit devenu marginal illustre parfaitement comment le Parti Démocrate a pu perdre les cols bleu du Midwest américain. À travers le pays, les électeurs blancs sans diplôme sont devenus un groupe solidement républicain, ce qui aurait été impensable il y a vingt ans.
Bien avant l’élection de Trump, tous les éléments étaient donc déjà présents pour sa victoire. De fait, c’est bien l’Amérique qui a cru en Obama qui a élu Trump. L’Iowa, État agricole du Midwest, avait été gagné par Obama en 2008 avec neuf points d’avance ; en 2016, Trump l’a remporté avec une marge de dix points. Difficile d’accuser des personnes qui ont voté deux fois pour Obama d’avoir voté Trump par racisme ; et ce sont précisément ces électeurs qui ont voté pour Obama puis pour Trump qui lui ont permis de remporter l’élection, en gagnant des États qui n’avaient pas été remportés par les Républicains depuis 1988 comme le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Mais plutôt que de remettre en question leur stratégie, dont ils sont persuadés qu’elle est la seule rationnelle, les élites Démocrates, comme le montrait déjà Thomas Frank six mois avant l’élection, préfèrent analyser ce backlash comme une expression bêtement raciste. Quand Hillary Clinton se vante d’avoir gagné des districts représentant les deux-tiers du PIB étasunien avant de qualifier ses électeurs d’« optimistes, divers, dynamiques, allant vers l’avant », en opposition à ceux de Trump décrits comme simplement racistes et misogynes, elle représente parfaitement la vision qu’a l’élite démocrate de la situation électorale actuelle. Incapables de remettre en question leur vision technocratique de la politique, ils préfèrent analyser en termes manichéens tout ce qui ne va pas dans leur sens : les électeurs de Trump doivent être racistes et l’élection n’a pu qu’être truquée par la Russie. Même si ces sujets ne peuvent être ignorés, les élites du Parti Démocrate réduisent leur analyse de l’élection de 2016 à ces deux facteurs explicatifs. Pourtant, l’œuvre de Thomas Frank donne une vision très claire de ce qui a mal tourné dans la politique américaine. Depuis 1992, les Démocrates pensent qu’ils peuvent ignorer les classes populaires, acquises depuis des générations au parti ; l’idée qu’ils puissent changer de camp paraissait impensable. Pourtant, les classes populaires blanches votent aujourd’hui en masse pour les Républicains. La résistible ascension de Donald Trump et des Républicains était tout à fait prévisible et est la conséquence de problèmes qui ne risquent pas de disparaître subitement.
Ce bref aperçu de la carrière de Thomas Frank montre clairement qu’il a parfaitement compris son époque. La progressive conquête des classes populaires par les Républicains est un phénomène de longue durée, mais les signes avant-coureurs étaient déjà sous les yeux des Démocrates en 2004. What’s the Matter with Kansas? pourrait presque décrire l’élection de 2016 : Steve Bannon, le directeur de campagne de Trump, a fait du ressentiment économique son cheval de bataille principal. Donald Trump fut élu en promettant la fin du libre-échange et de la domination des élites. Il n’en fut rien(11), bien entendu, comme cela avait été le cas dans le Kansas et ailleurs par le passé.
« C’est bien l’Amérique qui a cru en Obama qui a élu Trump. »
La traduction française de What’s the Matter with Kansas? s’intitule Pourquoi les pauvres votent à droite (Agone, 2013). La traduction de Listen, Liberal sous le titre Pourquoi les riches votent à gauche montre bien le rôle complémentaire des deux ouvrages, chacun donnant une des clefs pour résoudre l’énigme de l’échec de la gauche américaine.
Thomas Frank a commencé sa carrière en montrant comment la publicité s’appropriait la contestation et la contre-culture, et il est devenu un des auteurs politiques les plus connus au sein de la gauche américaine en montrant comment les conservateurs s’appropriaient le mécontentement et le populisme. Sa compréhension des enjeux politiques de son époque est soutenue par sa formation d’historien de la culture et des idées : il associe l’analyse socio-économique et l’analyse culturelle des phénomènes politiques.
Aucun règne ne peut durer éternellement, cependant, et celui du rationalisme centriste pas plus que les autres. La résurgence au sein du parti Démocrate d’un mouvement cherchant à le ramener à ses racines constitue une réponse au consensus libéral qui domine le parti depuis Bill Clinton, et pourrait bien renverser le paradigme politique. Comme Thomas Frank le dit dans Listen, Liberal, la gauche avait par le passé la capacité d’apporter des réponses au mécontentement populaire, et c’est là qu’elle trouvait sa véritable force. Bernie Sanders a réussi à obtenir 43 % des voix avec une campagne fondée uniquement sur des contributions individuelles, une performance historique qui signifie que quelque chose a changé au sein du parti. Si les Démocrates arrivent à redevenir un parti populaire, ils pourront inverser la tendance historique à laquelle ils font face et qui a amené Donald Trump à la Maison Blanche.
Ce type de changement ne peut venir que de l’intérieur du Parti Démocrate. Mais l’analyse éclairée de Thomas Frank donne un examen de long terme se reposant sur l’histoire politique, culturelle et sociale des États-Unis qui permet à tous les observateurs d’élargir leur champ de vision et de mettre en perspective la situation politique actuelle. L’analyse rigoureuse de Thomas Frank a mis en évidence les sources du backlash conservateur qui se développe aux États-Unis dès le début des années 2000 et qui a directement mené à la présidence Trump. À l’heure où ce contrecoup commence à se faire sentir en Europe, la lecture de Thomas Frank devient nécessaire.
Illustration : Photo prise par Thomas Frank pour illustrer la quatrième de couverture de son prochain livre. ©Thomas Frank
2 Frank, Thomas : Commodify Your Dissent: Salvos from the Baffler, W. W. Norton & Company, 1997.
3 Frank, Thomas : The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism, University of Chicago Press, 1997.
5 Frank, Thomas : One Market Under God: Extreme Capitalism, Market Populism, and the End of Economic Democracy, Anchor Books, 2000.
6 Frank, Thomas : What’s the Matter with Kansas?: How Conservatives Won the Heart of America, Picador, 2004.
7 Frank, Thomas : The Wrecking Crew: How Conservatives Ruined Government, Enriched Themselves, and Beggared the Nation, Metropolitan Books, 2008.
8 Frank, Thomas : Pity the Billionaire: The Hard-Times Swindle and the Unlikely Comeback of the Right, Metropolitan Books, 2012.
9 Frank, Thomas : Listen, Liberal: or Whatever Happened to the Party of the People?, Scribe, 2016.