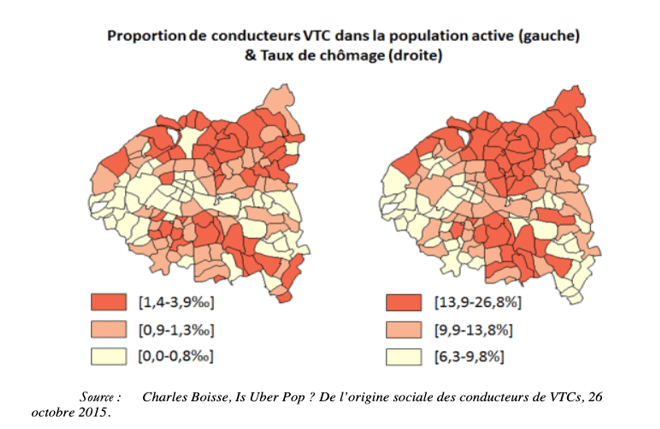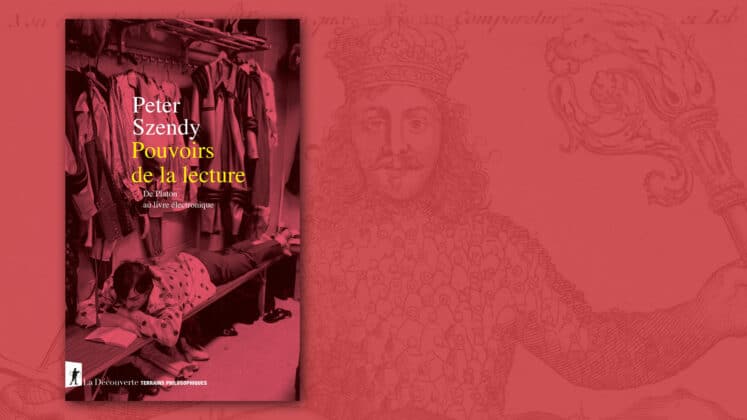Édouard Bernasse est secrétaire général du CLAP, le Collectif des livreurs autonomes de Paris. En pleine épidémie de coronavirus, tandis que de nombreux Français sont invités à demeurer chez eux, les livreurs qui travaillent auprès de plateformes continuent leurs courses. Cette situation tant étonnante que scandaleuse illustre la grande précarité de ces livreurs : du statut à l’absence de considération politique, au laisser-faire des plateformes… Entretien pour mettre en lumière celles et ceux qui demeurent exposés.
LVSL – Pouvez-vous au préalable présenter l’origine du Collectif des livreurs autonomes de Paris à nos lecteurs ?
Édouard Bernasse – Le CLAP (Collectif des livreurs autonomes de Paris) est un collectif réuni sous forme d’association (loi 1901) qui a vu le jour début 2017. Sa création est une réponse à la chute de Take Eat Easy (une plateforme de mise en relation comme Deliveroo, Uber Eats), c’est-à-dire une plateforme de foodtech, qui a emporté avec elle l’argent qu’elle devait aux coursiers et au restaurateurs. Les livreurs qui travaillaient avec Take Eat Easy à temps plein ou à temps partiel, n’ont jamais été payés pour les derniers mois travaillés avec cette plateforme.
À l’époque, il existait déjà des groupes de coursiers sur les réseaux sociaux, afin d’échanger sur la vie quotidienne, partager des expériences et sourire un peu aussi. Ainsi quand Take Eat Easy a annoncé sa fermeture de manière soudaine, les coursiers de ces groupes ont très vite compris que la liquidation serait prononcée sans que l’argent qu’il leur était dû ne leur soit versé. Le sentiment de colère a vite pris le dessus dans la communauté des coursiers, accentué par le partage des ex-dirigeants de la plateforme de leurs photos de vacances en Toscane sur Instagram.
Les coursiers sont majoritairement allés vers une autre plateforme qui s’était installée à Paris en 2015 : Deliveroo. Celle-ci a profité de cette manne de coursiers pour augmenter sa capacité de livraison et sa flotte de livreurs. Les livreurs ont donc signé un contrat avec une rémunération à l’heure (7,50€), à laquelle s’ajoutait une rémunération par course pouvant aller jusqu’à 4€.
« Résultat de leur communication start-up cool et flexible, elles étaient présentées dans la presse comme un moyen sympa pour les étudiants de gagner un peu d’argent tout en faisant du sport, avec des horaires flexibles, ainsi qu’une liberté qui se traduisait par l’absence de manager sur le dos. »
Et puis petit à petit, les livreurs, qui étaient déjà sur la défensive avec le traumatisme Take Eat Easy, ont pu s’apercevoir que leur méfiance était justifiée puisque Deliveroo commençait à leur supprimer quelques petits euros à gauche à droite, de manière très sournoise.

Par exemple, des minimums garantis qui était promis sur certains soirs ont un peu diminué. C’est ensuite logiquement que sont arrivées les rumeurs concernant les changements de tarification de Deliveroo. Nous avons alors pensé que, plutôt que d’avoir plusieurs groupes d’échanges sur les réseaux sociaux, nous devions passer à l’étape supérieure et créer une structure avec un message fort, des porte-paroles, une identité ; un collectif qui soit un véritable contre-pouvoir aux plateformes, à la fois au niveau médiatique qu’institutionnel.
Il s’agissait de lever le voile sur la réalité des conditions de travail des livreurs de plateformes, qui avaient plutôt bonne presse à cette époque. Résultat de leur communication start-up cool et flexible, elles étaient présentées dans la presse comme un moyen sympa pour les étudiants de gagner un peu d’argent tout en faisant du sport, avec des horaires flexibles ainsi qu’une liberté qui se traduisait par l’absence de manager sur le dos. Sauf qu’on a très vite compris que ce n’était que de la communication, comme souvent avec ces plateformes, qui sont avant tout des boîtes de com’.
Puis, ce qu’on craignait est arrivé : fin 2016, Deliveroo supprime la tarification à l’heure et passe à une tarification à la course. 5,75€ pour tous les nouveaux livreurs. Les anciens, eux, recevaient un avenant pour passer à cette nouvelle tarification. Avenant qu’ils ont bien sûr refusé, car il était moins avantageux, contrairement à ce que la plateforme arguait. En mars 2017, les anciens reçoivent à nouveau cet avenant. Mais cette fois-ci, le choix présenté par Deliveroo était différent : soit ils signaient, soit ils étaient « déconnectés », c’est-à-dire virés. Les masques tombaient. Les primes pluie et les minimums se sont d’ailleurs très vite détériorés, puis ont été supprimés.
C’est ainsi qu’après un rassemblement pour contester ces pratiques, le CLAP est né. L’objectif est de faire exister ces travailleurs pour qu’ils aient leur mot à dire dans les conditions essentielles de leurs contrats, comme ce devrait être naturellement le cas puisqu’ils sont auto-entrepreneurs.
LVSL – À l’heure où chacun est invité à se confiner, quelle est la situation des livreurs concernant leur travail notamment ? Qu’a fait ou n’a pas fait le gouvernement ? Enfin, est-ce que vous avez eu des communications particulières avec les plateformes comme Uber Eats ou Frichti ?
É. B. – Nous n’avons aucunes communications particulières avec les plateformes qui sont de toute façon dans une logique de contournement des travailleurs et de leurs représentants. Pour vous donner un exemple, il y a un mois, le responsable de la communication et des affaires publiques de Deliveroo nous a convié à une réunion pour nous présenter son « forum », une farce d’élection organisée et maîtrisée par la plateforme, et n’est même pas venu à cette réunion. Il a envoyé des collaborateurs qui n’ont bien sûr aucun pouvoir de décision et qui nous ont rabâché pendant une heure que c’était un problème de transparence, de communication et qu’ils avaient « targuetté le feedback ». On a fini par claquer la porte de la réunion.
Quand on voit les mesures d’hygiène qu’a prôné le gouvernement, qui a affirmé s’être concerté avec les les représentants sociaux, déjà, il y a un problème. Les représentants sociaux pour le gouvernement Macron, ce sont les entreprises. Aucun livreur n’a été sollicité pour donner son avis sur une manière de livrer plus hygiénique. Forcément, livreur ou pas, médecin ou pas, une personne raisonnable et responsable vous dira que la meilleure mesure barrière, c’est de fermer les plateformes et d’indemniser les livreurs.
« Il nous faudrait une paire de gant par commande minimum et une dizaine de masques par jour. Impossible en l’état actuel des stocks. »
La plupart des restaurants sont fermés, certains continuent à faire de la livraison de repas exclusivement, mais pour nous c’est irresponsable. Irresponsable au regard du nombre de parties prenantes qu’un livreur est amené à fréquenter pour une seule commande : le restaurateur, le cuisinier, les autres coursiers, le client… C’est irresponsable aussi quand on voit tout ce qu’il est obligé de toucher : digicodes, interphones, portes d’entrée, boutons et portes d’ascenseur. Il nous faudrait une paire de gants par commande minimum et une dizaine de masques par jour. Impossible en l’état actuel des stocks.
De toute manière, il n’y a plus beaucoup de commandes et de nombreux livreurs ont été obligés de s’arrêter. Soit parce qu’ils ont bien constaté cette baisse ou parce qu’ils craignent pour leur santé. Les mesures hygiéniques mises en place, comme la fameuse livraison sans contact, ne sont pas suffisantes.
Les mesures des plateformes, c’est uniquement de la communication, une position, une image : on se doute bien que lorsque vous livrez une commande ce n’est pas parce que vous respectez une distanciation sociale de deux mètres que vous n’êtes pas porteur du virus.
Les livreurs suent, sont dans la pollution, font des efforts, toussent et évidemment, c’est extrêmement dangereux… Il faudrait être cohérent : on est en guerre ou est-ce qu’on se fait livrer des burgers et des pizzas ? Nous préconisons d’arrêter les plateformes car elles ne sont pas essentielles, les gens disposent d’autorisations pour aller faire les courses. Il faut indemniser les travailleurs des plateformes au même titre qu’on indemnise les salariés qui sont au chômage partiel.
« Qu’ils commencent par payer leurs impôts en France s’ils veulent vraiment aider les hôpitaux. Qu’ils ferment leurs plateformes pour ne pas amener plus de malades dans les hôpitaux. »
Les mesures qui ont été annoncées par Bruno Le Maire, notamment celle sur le fond d’aide forfaitaire à 1500 euros, ne sont pas adaptées aux indépendants des plateformes. Les conditions d’éligibilité évincent tous les livreurs qui ont commencé leur activité récemment, car il y a beaucoup de turn-over dans ces boîtes (un indépendant doit prouver qu’il a perdu 50% de son chiffre d’affaire, en comparaison avec le mois de mars 2019), ainsi que ceux qui ne l’exercent pas à titre principal. Lorsqu’on regarde toutes ces conditions, on sait que la majorité des coursiers ne toucheront jamais cette aide. C’est pour cela que les plateformes en profitent pour dire qu’elles instaurent leurs propres aides, palliant ainsi aux mesures du gouvernement, en se réservant le bon rôle. Quand vous êtes atteint du Covid-19, Deliveroo vous indemnise à hauteur de 230€ : c’est dérisoire. C’est aussi cohérent avec la communication visant à se faire passer comme étant les bienfaiteurs et les nouveaux héros du service public français, en livrant les hôpitaux. Qu’ils commencent par payer leurs impôts en France s’ils veulent vraiment aider les hôpitaux. Qu’ils ferment leurs plateformes pour ne pas amener plus de malades dans les hôpitaux.
Le constat c’est que nous sommes non seulement des travailleurs récréatifs, mais récréatifs « sacrifiables » car nous ne sommes pas essentiels, contrairement aux pompiers, infirmières et infirmiers, policiers, médecins… Nous livrons des burgers et des sushis et nous avons besoin de dire que nos vies valent plus que ça.
LVSL – Si on se place du côté des plateformes, outre les questions de l’indemnisation, est-ce qu’aujourd’hui vous disposez de masques ? Quand Édouard Philippe ou Olivier Véran parlent de livraison de masques qui vont être distribués à certaines entreprises qui auront elles-mêmes à les répartir, vous faites partie de ce dispositif ?
É. B. – Même si on nous donne des masques, nous restons le petit personnel qui va au contact pour faire plaisir à la clientèle alors que celle-ci reste confinée. Il faut, à un moment donné, être cohérent.
LVSL – La France n’est pas le seul pays où des mesures de confinement ont été prises, savez-vous s’il y a des endroits dans le monde qui font face à l’épidémie et où des plateformes auraient accompagné différemment les livreurs, ou globalement vous observez les mêmes choses ?
É. B. – On observe à peu près les mêmes mesures partout dans le monde parce que le principe est le même : les plateformes font appel à des travailleurs indépendants et donc qui se débrouillent par eux-mêmes. C’est l’idée mais c’est totalement hypocrite parce que nous sommes clairement subordonnés, la justice l’a d’ailleurs reconnu.
Je pense que les plateformes ont également peur de devoir distribuer ce genre de choses parce que, justement, on pourrait y voir un lien de subordination et c’est vraiment l’élément qui déclenche les sirènes dans les bureaux des plateformes. C’est pareil partout sauf peut-être, je l’ai lu, dans certaines régions d’Italie, où les plateformes ont été obligées de fermer.
LVSL – Dans un premier temps, peut-on revenir sur le lien qu’il peut y avoir ou non entre les travailleurs des plateformes, notamment les livreurs, et les syndicats traditionnels ? Ces derniers se font-ils le relais de votre situation, avez-vous des échanges avec ces structures ?
É. B. – D’abord les gens apprécient le CLAP, car nous sommes un collectif autonome. Quand on voit les différents groupes de discussion des coursiers partout en France, dans lesquels aussi il y a des représentants de la CGT, certains coursiers n’adhèrent pas au discours de la CGT et veulent une structure comme à Paris, qui est autonome.
C’est un choix personnel. Je pense que le CLAP a fait ses preuves et que les livreurs ont pu apprécier nos actions, notre efficacité médiatique et notre gouvernance en dehors des logiques d’apparats syndicalistes. La crise des gilets jaunes démontre bien que les gens ne croient plus vraiment aux syndicats traditionnels et c’est malheureux. Je pense que les livreurs sont également dans cette logique là.
Il reste que nous échangeons tous les jours avec nos collègues qui sont membres de la CGT. Ils ont leur vision et leurs moyens, tandis que nous avons envie de rester autonomes. Nous considérons qu’il incombe au syndicat de s’adapter à sa base. Ce n’est pas la base qui doit s’adapter à la politique que veut mener le syndicat. Et je pense que beaucoup se reconnaissent dans cette logique. C’est très bien qu’il existe aujourd’hui deux fronts. Évidemment, l’entraide et le partage d’informations prédominent avec nos collègues de la CGT.
LVSL – Est-il possible de développer ce point des revendications des syndicats par rapport à vous ? En quoi est-ce que cela ne correspond pas totalement à ce à quoi les livreurs peuvent aspirer ? Quel est ce décalage justement entre les structures classiques et les nouvelles formes de travail ?
É. B. – Les syndicats défendent traditionnellement des salariés et non des indépendants, c’est un premier point. Cela veut dire qu’au niveau statutaire, le syndicat doit changer et aller expliquer dans une confédération qu’elle doit changer de statut pour apporter de l’aide aux livreurs des plateformes, qui en plus sont des travailleurs qui changent tous les six mois donc difficiles à fédérer.
Ce sont des travailleurs qui sont atomisés, qui sont en plus à la fois jeunes et dans une logique de simplicité absolue. Quand on est livreur Deliveroo, on a l’indépendance, ça se fait en deux clics, on travaille avec une plateforme, à la fin de la journée on peut voir combien d’argent on a gagné. Nous n’avons pas le temps de base pour aller voir une union syndicale puisque quand nous ne travaillons pas, nous ne gagnons pas d’argent, donc les livreurs sont dans quelque chose de plus direct et plus autonome, parce qu’ils se considèrent eux-mêmes comme des autonomes.
Et c’est cette autonomie là qu’ils essaient de gagner, parce que dans les statuts de leurs contrats, ils sont censés être indépendants. Mais ils ont bien compris qu’en fait, ils ne l’étaient pas du tout. Les syndicats, qui sont dans la logique du salariat classique, n’ont forcément que peu d’écho auprès de ces jeunes.
« On est travailleur 2.0, alors on sera un collectif de défense 2.0. »
Nous préférons nous organiser nous-mêmes, faire les choses comme on l’entend avec nos éléments de langage, les outils dont nous disposons. On est travailleur 2.0, alors on sera un collectif de défense 2.0. De fait, on ne va pas se mêler de politique, même si ça l’est toujours un peu, parce que nous estimons que notre syndicat doit être avant tout et surtout professionnel, alors qu’intégrer un syndicat existant, c’est intégrer des luttes intestines, des luttes politiques, des luttes d’ego.
Nous connaissons très bien notre métier, de même que nos arguments. Pour être efficaces, nous avons besoin des ressources nécessaires à la bonne et pleine exécution de nos objectifs et que les syndicats ne sont pour l’instant pas disposés à nous offrir. C’est pour cela qu’il nous faut nous adapter.
« À force de ne pas être écoutés, de recevoir toujours les mêmes éléments de langage, les livreurs se rendent compte qu’on les a pris pour des imbéciles pendant deux, trois ou quatre ans et décident de se battre. »
LVSL – Lorsqu’un livreur va jusqu’aux prud’hommes, son contrat est souvent requalifié par les personnes qui instruisent son cas. Aspirez-vous tous à tendre vers le salariat ?
É. B. – Notre travail c’est de relayer la volonté de notre base, donc des livreurs. Et ils ne veulent pas être salariés mais veulent être tout de même respectés et c’est ce respect qui n’existe pas pour l’instant. S’il faut passer par une forme de salariat, mais plus autonome pour avoir la garantie de conditions décentes de travail, tous les livreurs seraient prêts à signer, prêts à faire partie de ce salariat-là, mais pas celui qu’on entend classiquement.
Pourquoi, bien qu’ils veuillent rester indépendants, ils veulent ou sont allés en justice devant les prud’hommes ? Parce qu’il y a un préjudice qui doit être réparé. Un préjudice qui est matériel, on perd de l’argent, mais aussi préjudice moral ; le fait de vous demander tout le temps d’être disponible, notamment les week-ends, je pense aux pics obligatoires chez Deliveroo par exemple, d’être soumis à un agenda très contraignant qui vous empêche de mener à bien votre projet professionnel, familial et autre. Et puis il y a un préjudice politique. À force de ne pas être écoutés, de recevoir toujours les mêmes éléments de langage, les livreurs se rendent compte qu’on les a pris pour des imbéciles pendant deux, trois ou quatre ans et décident de se battre.
Il faut bien comprendre qu’à l’origine nous ne sommes pas pro-salariat dans le sens classique du terme. Toutefois, nous avons travaillé avec le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au Sénat (CRCE), lequel a rendu une proposition de loi relative au statut des travailleurs des plateformes numériques. Dans cette proposition de loi, on se base sur ce qui existe déjà dans le code du travail, notamment le livre sept, qui est très complet et contient beaucoup de bases sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour construire ce salariat que nous appelons « salariat autonome ».
Il permettrait à un livreur qui est salarié de négocier avec les plateformes de manière régulière, annuellement admettons, ses conditions essentielles de travail avec un prix fixe juste et décent de la course, par l’intermédiaire de représentants que lui et ses pairs auraient élus. D’un côté, cela permet de remettre tout le monde autour de la table des négociations afin d’obtenir des garanties sur les conditions de travail, et de l’autre, de rattacher les travailleurs à la protection sociale.