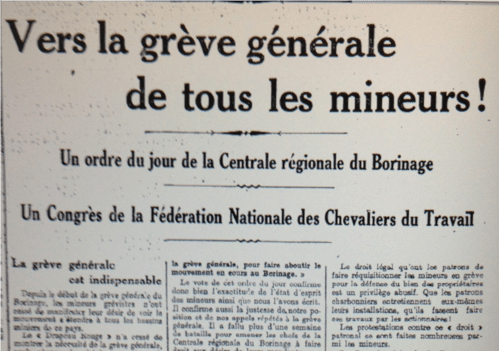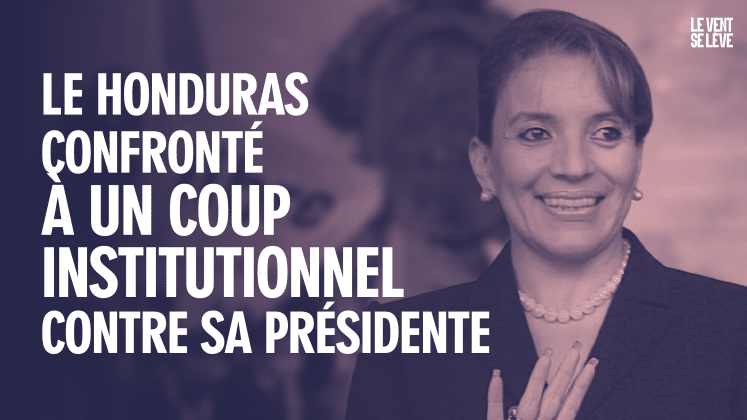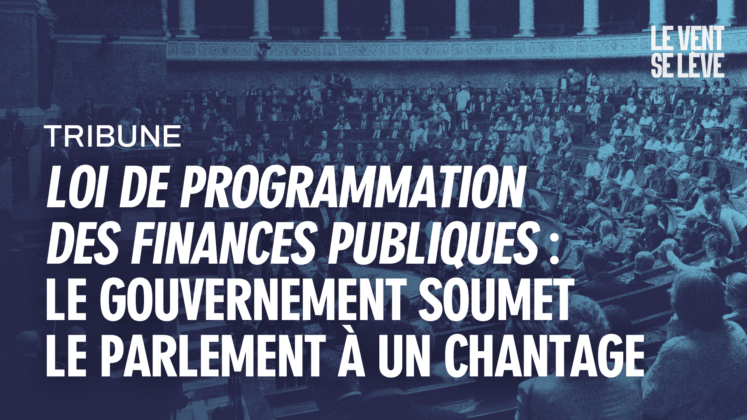À l’occasion d’un débat avec la philosophe Chantal Mouffe, organisé le 25 juin dernier par la rédaction du Vent Se Lève, François Ruffin a souligné à plusieurs reprises les raisons de sa venue : acter la récente victoire de la gauche, pour mieux comprendre là où elle continue d’échouer. À n’en pas douter, en effet, l’alliance NUPES a permis de faire entrer à l’Assemblée une force politique d’opposition majeure, dont les rangs comptent des profils prometteurs. Elle a aussi permis d’éviter la disparition d’un camp, que certains prédisaient pourtant depuis longtemps. Néanmoins, il est indispensable de se demander si cette séquence électorale ne consacre pas une « victoire par le haut » plutôt qu’une « victoire par le bas », creusant encore davantage l’écart entre ceux qui croient qu’un autre monde est possible et ceux qui n’y croient plus.
« On a gagné, mais… »
Les appareils sont saufs, les militants enthousiasmés, les votants rassurés ; les désaffiliés, les indifférents et les abstentionnistes sont en revanche les grands absents des célébrations. Ils ne reviennent qu’à demi-mots dans les conversations, comme si leur silence pesait soudain trop lourd : « On a gagné, mais… » Mais, ce n’est pas gagné. Et pour cause, les résultats électoraux dessinent un bloc qui doit, pour les langues les plus provocatrices, davantage à la réalisation malencontreuse de la stratégie Terra Nova qu’aux succès socialistes et communistes des siècles passés. La note du think tank, datée de 2011, suggérait notamment d’abandonner la majorité historique de la gauche, composée d’ouvriers et d’employés, au profit d’une articulation des électorats acquis aux nouvelles « valeurs culturelles progressistes » : les jeunes, les femmes, les diplômés et les minorités. Dix ans ont coulé sous les ponts depuis lors, et nombreux à gauche ont dénoncé la trahison d’une telle proposition, pour mieux rappeler la nécessité de rester solidaires des classes populaires.
« La situation est telle qu’aujourd’hui les progressistes se demandent comment reconquérir les anti-progressistes. »
Problème, les bonnes intentions ne résolvent pas toujours les divorces culturels : la situation est telle qu’aujourd’hui les progressistes se demandent comment reconquérir les anti-progressistes. Ce qui n’est pas sans provoquer un dialogue de sourds ou, pire, une démonstration de paternalisme politique. Si les aspirations communes décrochent du « progressisme », ce n’est pourtant pas parce qu’elles sont rétrogrades, mais parce qu’elles constatent chaque jour la dégradation des conditions de vie et n’ont plus le coeur aux lendemains qui chantent. « Qu’est-ce qui nous arrive ? » brûle ainsi plus volontiers les lèvres que les traditionnels « Qu’est-ce qui nous attend ? », écrasant l’horizon des possibles sur les inquiétudes du présent. L’erreur est donc de croire que le temps du futur est communément partagé ; il se fabrique, au contraire, depuis des réalités concrètes, que seuls quelques privilégiés ont désormais le loisir d’éprouver.
Un hiatus d’autant plus profond qu’ils recoupent une dissociation sociologique, où les habitus des uns n’ont rien à voir avec les habitudes des autres. Il n’y a, pour s’en convaincre, qu’à s’interroger sur le pourcentage des cadres politiques issus des milieux populaires. Le compte n’est pas très glorieux ; et même lorsqu’ils sont présents, ils occupent les places très convoitées de « transfuges de classe », qui servent à la fois d’alibi aux camarades et d’excuses personnelles pour justifier l’éloignement des périphéries d’origine. Parallèlement, l’élection de quelques députés « populaires » a donné lieu à un enthousiasme mâtiné d’incompréhensions de classes. La fabrication de nouvelles égéries prolétaires, réduites à leur fonction sociale – « femme de ménage », « aide soignante », « ouvrier » – en dit long sur une gauche, qui essaie de se rassurer, en veillant à cocher toutes les cases de la mixité. L’entrée à l’Assemblée de ces nouvelles figures, et la réception médiatique qui en a été donnée, aurait dû à l’inverse signaler l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir.
Mots d’ordre ou diagnostics ?
Si la gauche doit alors retrouver ce qu’elle a perdu, il convient de lui rappeler quoi chercher : sa base sociale, certes, mais avant toute chose sa lucidité. Elle protège contre l’ivresse des victoires – d’autant plus intense que ces dernières tendent à se faire rares – et conduit à troquer les mots d’ordre contre les diagnostics. La « Nouvelle Union Populaire » est à ce jour plus unie que populaire ; près de la moitié des ouvriers et employés s’abstiennent ou votent en faveur du Rassemblement national. Il importe d’en tirer les conséquences pour guider les années de bataille qui s’annoncent, sans déprécier celles qui ont déjà été menées. Deux scénarios semblent se disputer les faveurs des responsables politiques actuels : un retour à l’agenda propre des différents groupes parlementaires (EELV, PS, FI, PCF) composant la NUPES ou un approfondissement de la logique d’union, anticipant les élections intermédiaires et favorisant les futures candidatures uniques. Un air de « déjà-vu » pour qui connaît les dilemmes insolubles d’une gauche, oscillant souvent entre sectarisme stérile ou unionisme béat, selon son expression la plus caricaturale.
Quid cependant d’une troisième option, certes moins attractive et plus laborieuse, qui miserait sur un renouvellement politique organique, capable de retisser les liens entre l’extraordinaire des Assemblées et l’ordinaire des tablées ?
Quid cependant d’une troisième option, certes moins attractive et plus laborieuse, qui miserait sur un renouvellement politique organique, capable de retisser les liens entre l’extraordinaire des Assemblées et l’ordinaire des tablées ? Pour trancher entre l’une ou l’autre direction, le conseil d’un ancien sage politique, auteur d’un Contrat Social qui ne fut pas sans incidence sur les soulèvements révolutionnaires, mérite une oreille attentive : en distinguant la volonté particulière, la volonté de tous et la volonté générale, Jean-Jacques Rousseau nous lègue des concepts pour interpréter différemment les trois chemins qui s’offrent à nous. Ainsi, le jeu partisan n’est-il qu’une émanation de la volonté particulière, favorisant la juxtaposition d’intérêts divergents, tandis que les alliances occasionnelles relèvent de la volonté de tous et s’en remettent à la simple accumulation numérique des forces en présence. Le travail de ré-association ravive quant à lui la quête de la volonté générale et suit la boussole du bien commun afin d’empêcher le dépérissement du corps politique. Réduire l’écart qui s’est creusé entre « la chose publique » et les citoyens apparaît en effet comme un impératif pour empêcher que ne s’installent trop durablement la désillusion et la lassitude. « Sitôt que quelqu’un dit des affaires de l’État, que m’importe ? on doit compter que l’État est perdu » suggère notamment Jean-Jacques Rousseau en 1762, comme un ultime avertissement.
Reste ensuite à déterminer quelle volonté peut l’emporter sur les autres. La philosophie rousseauiste n’est, à cet égard, pas très optimiste gageant que la gradation des volontés s’établit toujours en opposition « à celle qu’exige l’ordre social » et que « la volonté générale est toujours la plus faible ». Il n’est pas sûr que la situation contemporaine autorise davantage de confiance : sans une organisation depuis laquelle concrétiser cet horizon, la promesse de majorité réelle, dépassant l’électoralisme de circonstances, a toutes ses chances de demeurer lettre morte. Les moyens ne sont pourtant pas totalement inexistants, comme en témoigne la réussite de certaines campagnes législatives, parvenus à détrôner des macronistes de premier rang, à l’instar de Christophe Castaner, d’Amélie de Montchalin, de Richard Ferrand ou encore de Roxana Maracineanu. Les énergies mobilisées en vue de ces succès, plutôt que d’être mises en sommeil jusqu’au prochain scrutin, pourraient être autrement investies. C’est qu’il s’agit d’identifier les braises des colères sourdes sur lesquelles souffler afin de préparer le terrain des victoires futures.
Vers une stratégie populaire
Les débats à gauche ne sont pas rares pour imaginer les solutions capables de « reconstruire » le camp de l’émancipation : quelle doctrine après la longue parenthèse social-libérale ? Quels arguments pour rallier le plus grand nombre ? Le travail effectué autour du programme de « L’Avenir en commun » mérite à ce titre d’être salué, tant il promeut un projet de rupture, qui est parvenu à se rendre crédible auprès d’un socle numérique non négligeable (7,7 millions de voix) et à radicaliser un électorat pour qui, par exemple, la « planification écologique » a finalement remplacé les transitions trop timides. Mieux même, il semble avoir inquiété quelques tenants de l’ordre néolibéral qui, lors des soirées présidentielles et législatives, n’ont pas oublié d’agiter l’épouvantail de « la menace rouge » pour discréditer leur adversaire. À nouveau cependant, le plus difficile est encore à faire : les divergences stratégiques traversent la récente union et la diffusion des idées socialistes – si l’on accorde à ce terme abîmé le sens que lui a donné sa tradition politique depuis le dix-neuvième siècle – se heurte à de nombreux malentendus.
À commencer par celui qui explique, peut-être, le plafond de verre idéologique auquel sont confrontées les formations politiques de gauche. Alors qu’elles furent pendant longtemps les alliés de la marche de l’Histoire, contribuant à achever le processus démocratique ouvert par la Révolution française, elles font aujourd’hui face à un nouveau défi : sauver l’héritage du passé et conserver les acquis des grandes avancées sociales face aux offensives libérales et réactionnaires. Selon un bouleversement, dont seule l’histoire politique a le secret, il n’est ainsi pas impossible que les matrices révolutionnaires et conservatrices se soient inversées. Les formations de droite, elles, l’ont bien compris, misant sur l’étiquette « subversive » et déclinant les « révolutions conservatrices » depuis plusieurs décennies pour répondre aux inquiétudes populaires. À gauche, on tarde encore, par devoir de pureté et par peur de compromission, à prendre la mesure, de ce que pourrait être « un conservatisme révolutionnaire ».
Selon un bouleversement, dont seule l’histoire politique a le secret, il n’est ainsi pas impossible que les matrices révolutionnaires et conservatrices se soient inversées.
Il y a néanmoins fort à parier qu’un tel positionnement ait toutes ses chances auprès des classes populaires – plus en tout cas que le mouvementisme généralisé. Pour une raison simple : il s’appuie sur le déjà-là qui, précisément, est en train de disparaître et livre à elle-même une part grandissante de la population. Le retour de l’insécurité généralisée n’est pas le fait de coupables bien désignés, comme la droite s’emploie à l’affirmer, mais le résultat de la destruction de l’héritage socialiste, dont les combats avaient jusqu’à présent garanti la protection collective. Le conservatisme révolutionnaire est en ce sens un protectionnisme, qui ne doit pas craindre de se présenter comme tel. Il ne signifie ni repli sur soi, ni limitation des libertés, mais pose comme priorité la préservation de ce qui fait une société : ses citoyens, ses institutions, son environnement, chaque jour plus absents de l’agenda des décideurs coalisés en élite mondialisée. Que les plus hostiles à cette grammaire se rassurent, le philosophe Günther Anders, peu suspect de fraternisation avec l’ennemi, avait déjà nommé dès 1960 la contradiction qui caractérise notre époque : « Aussi paradoxal que cela puisse sembler, la conservation du monde ne peut réussir que par son changement. Continuer à exister n’est possible que si le monde qui reste est différent du monde actuel. » Voilà en substance un programme qui peut séduire les adeptes du tout fout le camp, dont l’angoisse est à la mesure du siècle.
Selon les lois imprévisibles du devenir, c’est donc parce que la gauche a trop bien gagné hier, qu’elle perd aujourd’hui. Elle poursuit, comme avant, sa fuite en avant, là où la situation lui impose de revenir sur ses pas. On aurait tort d’y voir une paralysie historique. C’est plutôt que le vent de l’Histoire a changé de direction, comme l’avaient diagnostiqué de nombreux intellectuels marxistes pendant l’entre-deux guerres – Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, pour n’en citer que quelques uns –, dont la clairvoyance est rétrospectivement éblouissante. Ils avaient aussi identifié les raisons pour lesquelles ce n’est plus la gauche qui fait l’Histoire, mais l’Histoire qui exige une politique de gauche. Une nuance essentielle, qui oblige à nommer et à affronter l’obscurité de notre temps, sans pessimisme néanmoins – c’est depuis les nuits les plus noires que s’entendent les échos graves d’une formule d’Ernst Bloch dans L’Esprit de l’utopie : « C’est entre nos mains qu’est la vie. » À cette gauche qui vient, il faut par conséquent souhaiter de retrouver l’usage simultané de ses jambes et de ses esprits, afin de rattraper le retard accumulé par prétention au monopole de l’avant-garde. C’est à cette condition, seulement, que l’alternative deviendra crédible.