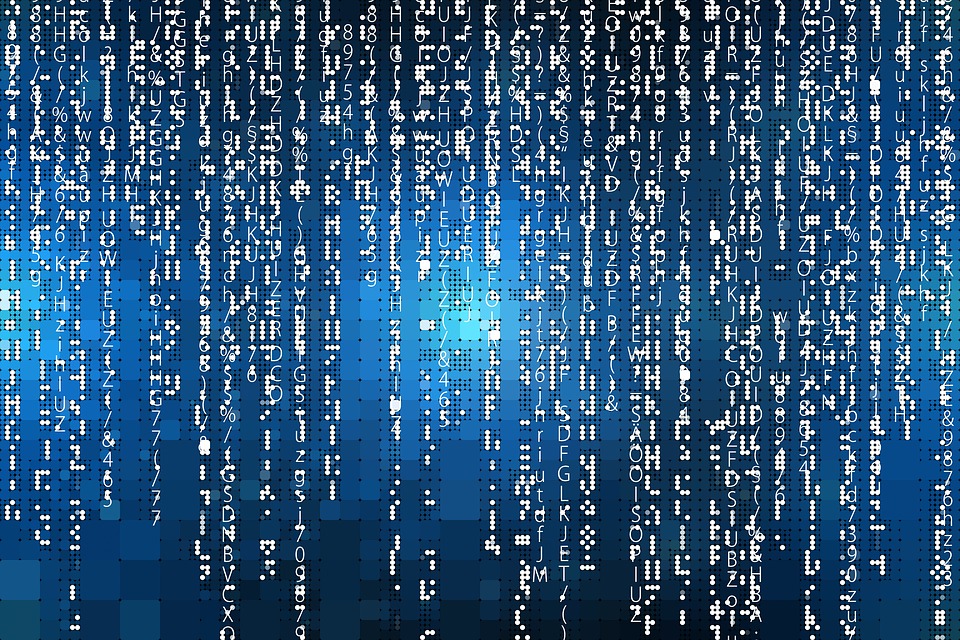À l’occasion du 45ème anniversaire de la Révolution des œillets au Portugal, qui a mis fin à une dictature vieille de près d’un demi-siècle, LVSL a rencontré Yves Léonard, spécialiste français de l’histoire contemporaine du Portugal. Docteur en histoire, il a notamment publié une Histoire du Portugal contemporain – préface de Jorge Sampaio, octobre 2016, ainsi que Le Portugal, vingt ans après la Révolution des œillets (1994), Salazarisme et fascisme (1996), La lusophonie dans le monde (1998) Mário Soares, Fotobiografia, (2006). Entretien réalisé par Sarah De Fgd et Pierre-Alexandre Fernando, retranscrit par Adeline Gros.
Le Vent Se Lève – Dans l’imaginaire collectif, l’intégration européenne du Portugal est associée à la chute de la dictature de Salazar qui est allée de pair avec une démocratisation croissante du pays. Cependant, depuis 2008, l’Union européenne est associée à une politique d’austérité extrêmement dure sur le plan social. Quel regard portent les Portugais sur la construction européenne ? La décennie d’austérité qui vient de s’achever a-t-elle entaché le capital de sympathie dont a pu disposer l’Union européenne à une certaine époque ?
Yves Léonard – Si l’on compare les différentes enquêtes d’opinion, telle que l’Eurobaromètre, réalisée par la Commission européenne, la perception des Portugais est plutôt au-dessus de la moyenne européenne ; le sentiment est moins négatif qu’ailleurs, le Portugal se situant même dans le premier groupe des six pays les plus favorables aux logiques de l’intégration européenne. Cette perception varie néanmoins en fonction des différentes classes sociales et du niveau de qualification, alors que la confiance dans l’Union et l’image de l’Union ont légèrement baissé au Portugal entre le printemps et l’automne 2018 [1]. Les élites portugaises ont toujours considéré depuis le milieu des années 1970 qu’il fallait adhérer, que l’avenir du Portugal était européen, ou devait à tout le moins s’envisager dans le cadre de la construction européenne. Ce sentiment a assez peu évolué en trente ans. En revanche, l’opinion publique a longtemps été relativement peu sensibilisée à la question européenne, hormis par sa dimension financière avec la manne des fonds structurels parsemant routes et infrastructures en construction de drapeaux aux couleurs de l’Europe. L’adhésion s’est faite dans un contexte particulier, comme un prolongement naturel à la transition démocratique et à la décolonisation – « l’Empire est mort, vive l’Europe » selon une formule de Mário Soares (1924-2017) –, malgré une certaine lenteur des négociations (1977-1985). Car si le Portugal était le bienvenu, il a dû néanmoins faire face à des réticences d’autant plus fortes que son adhésion était liée à celle de l’Espagne qui inquiétait ses voisins européens, en raison notamment du poids encore important du secteur agricole. En définitive, l’opinion publique portugaise a vécu l’adhésion dans une relative indifférence. Les partis politiques de gouvernement, européistes, à savoir le Parti socialiste (Partido socialista, PS) et le Parti social-démocrate (Partido Social Democrata, PSD, centre-droit), ont fait peu de pédagogie autour de la question de l’Europe. D’autant qu’ils entendaient « regarder vers l’Atlantique », en développant échanges et dialogue avec les espaces lusophones (plus de 250 millions de locuteurs dans le monde), tant en Amérique du Sud (Brésil), qu’en Afrique (Angola, Mozambique), grâce, notamment, à la création en 1996 de la CPLP (Communauté des pays de langue portugaise). Une partie de l’opinion publique portugaise n’a pris que tardivement la mesure d’un certain nombre de conséquences douloureuses – en termes d’emploi et de restructurations à la hâte des secteurs agricoles et industriels – que pouvait avoir l’adhésion à l’Europe, notamment lors de périodes de crise et de difficultés. Cela fut le cas dans un premier temps au tournant des années 2000, avec le ralentissement de la croissance. Lors de la crise de la fin des années 2000, une grande partie de l’opinion est d’abord restée silencieuse, avant de se réveiller pour formuler avec force ses critiques à l’encontre d’une construction européenne identifiée dès lors à la Troïka. Aujourd’hui, et notamment depuis le virage anti-austérité qui a été pris depuis plus de trois ans [2], cette opinion reste plutôt majoritairement favorable à la construction européenne.
« Une grande partie des classes moyennes qui ont pour l’essentiel été les grandes gagnantes de l’européanisation, de l’après-dictature, s’est trouvée fragilisée ; les classes populaires ont quant à elles vécu le démembrement de secteurs industriels traditionnels avec une extrême violence »
LVSL – Le Portugal fait partie avec des pays comme l’Espagne la Grèce et l’Irlande, qui ont été placés sous tutelle de la Troïka – Commission européenne, BCE, FMI – auxquels on a imposé des réformes structurelles d’inspiration néolibérale. Comment ces réformes et leur mode d’imposition ont-ils été perçus par les Portugais ?
YL – Très mal. D’abord à cause de leur dureté : baisse des salaires, de traitement pour les fonctionnaires, des pensions de retraites. S’en est suivie une contraction énorme, à l’issue de laquelle certaines catégories professionnelles ont perdu jusqu’à un tiers de leurs revenus. À cela s’ajoutent la hausse du chômage et tout un cortège de mesures d’accompagnement, dont la suppression de certains jours fériés. Ces mesures extrêmement dures ont été d’autant plus mal perçues qu’elles ont été imposées de manière brutale à une population déjà fragilisée par des années de politique de rigueur et de croissance atone, dans un contexte où les Portugais ont éprouvé un farouche sentiment de perdre une nouvelle fois leur indépendance. Vous avez parlé de la mise sous tutelle du Portugal par la Troïka ; il y a des précédents dans l’histoire portugaise. C’était le cas à la fin des années 70 et au début des années 80, avec les aides du FMI, alors que le pays connaissait de réels problèmes économiques. Le Portugal est devenu au fil des années – 90 notamment – celui qu’on appelait le « bon élève de l’Europe », donc en quelque sorte un exemple, avec pour apogée l’Expo’98, l’exposition universelle de Lisbonne consacrée à l’été 1998 au thème des Océans, avenir de l’humanité. D’un seul coup, dans les années 2000, le Portugal était devenu un mauvais élève, celui dont on dénonçait la mauvaise gestion. Il y avait en toile de fond tous les symptômes du traumatisme grec. Une grande partie des classes moyennes qui ont pour l’essentiel été les grandes gagnantes de l’européanisation, de l’après-dictature, s’est trouvée fragilisée ; les classes populaires ont quant à elles vécu le démembrement de secteurs industriels traditionnels avec une extrême violence. On parle souvent des Indignés espagnols, mais il faut se souvenir que les manifestations au Portugal ont commencé avant les manifestations espagnoles, dès le mois de mars 2011 – date à laquelle il y a eu spontanément, hors partis, hors syndicats, par les réseaux sociaux pour l’essentiel, des mobilisations très fortes pour dénoncer l’austérité et la prochaine intrusion de la Troïka avec des slogans qui sont passés à la postérité. On a notamment remis au goût du jour une phrase emblématique de « Grândola, vila morena », la chanson de la Révolution des œillets, qui disait « c’est ici que le peuple commande », sous-entendant que l’influence de la Troïka sur le Portugal constituait une ingérence étrangère (« Que se lixe a Troïka » – « Que la Troïka aille se faire foutre »). Le film de Miguel Gomes Les mille et une nuits (2015) le montre bien. Il permet de prendre la mesure de la condescendance, du mépris à peine voilé des représentants de la Troïka à l’égard du Portugal. À l’ère des réseaux sociaux, cette attitude a été très mal perçue. Dans les années 1980, avant l’adhésion à l’Europe, la situation avait été différente. Avec les réseaux sociaux, l’indignation s’est répandue comme une traînée de poudre.
LVSL – Quelle est la nature du « miracle portugais » que décrivent certains médias ? Est-il le produit d’une politique de relance sociale ? Ou d’une stratégie de dumping fiscal mise en place depuis 2008, visant à attirer entreprises et retraités fortunés comme l’affirment certains économistes plus critiques ?
YL – Un peu de tout cela. Les autorités portugaises, qui ont fait preuve de volontarisme, ont également bénéficié d’un alignement des planètes. A l’automne 2015, la volonté de mettre fin à l’austérité coïncide avec une baisse du prix de l’énergie et du pétrole. Je ne parlerai pas de miracle : il y a eu une volonté très forte de modifier radicalement la donne et de s’unir pour s’opposer à des politiques dont on avait vu toute la dureté sur le plan social. La Geringonça est le fruit d’une volonté d’en finir avec la politique des précédents gouvernements qui avait appliqué et amplifié les mesures dictées par la Troïka. Une volonté partagée par toute la gauche de tourner la page.
Plusieurs mesures adoptées au début des années 2010 – flexibilité du marché du travail, synonyme de précarité accrue, dumping fiscal, avec le visa gold, (le visa doré) – n’ont pas été remises en question. La relance par la demande – singulière à l’échelle européenne – a eu lieu dans un contexte favorable, qui a permis à la consommation de repartir à la hausse, grâce notamment à une hausse du salaire minimum, passé de 450 à 600 euros. Il y a eu durant ces années des secteurs entiers de l’économie portugaise qui ont changé de nature, une mutation justifiée par l’idée qu’il fallait monter en gamme, pour reprendre une expression qui renvoie à l’imaginaire néolibéral et managérial. Au fil des années, des secteurs traditionnels, tels que le textile, la chaussure ou le vin, se sont modernisés pour être concurrentiels à l’exportation, principal levier de la croissance avec le tourisme.
Pourtant, si la croissance est supérieure à 2%, le chômage en baisse et le déficit public à son plus bas niveau depuis le rétablissement de la démocratie, si le WebSummit annuel de Lisbonne confère au Portugal une image d’innovation et de Startup nation, précarité, inégalités et pauvreté sont loin d’avoir disparu, alors que l’investissement public reste insuffisant. Le syndrome Airbnb frappe la capitale Lisbonne où, nourris par la spéculation et les visas dorés, les prix de l’immobilier se sont envolés, chassant les habitants des quartiers traditionnels. Si l’on respire mieux au Portugal, difficile de parler d’un miracle économique.
« le cas portugais devrait inciter à beaucoup plus de réflexion à l’échelle européenne que ce n’est le cas actuellement »
LVSL – Peut-on parler d’un modèle portugais comme le font certains partis européens de gauche, qui pourrait être dupliqué ? Y a-t-il une quelconque cohérence dans la coalition qui est au pouvoir, ou est-elle simplement le produit de rapports de force entre un parti communiste – marxiste et eurosceptique – et un parti socialiste – europhile et social-libéral – de l’autre ?
YL – Un modèle est source d’inspiration et reproductible. Tout porte à croire que ce n’est pas le cas du Portugal, dont la coalition fait figure de cas très singulier à échelle européenne. C’est un modèle qui n’est, pour l’heure, ni exporté, ni dupliqué.
Cependant, le cas portugais devrait inciter à beaucoup plus de réflexion à l’échelle européenne que ce n’est le cas actuellement. On a beaucoup commenté ce qui s’est passé en Espagne ces derniers mois, et le cas portugais n’est évoqué – quand il l’est -, comme souvent, que de manière périphérique, voire anecdotique. Or ce qui s’y passe est tout sauf anecdotique parce que c’est l’expression d’une alternative, d’une voie singulière, produit d’un rapport de force politique et d’une volonté de mettre fin à l’austérité. Le « tout sauf ça » a permis des échanges et un rapprochement, qui n’était pourtant le mot d’ordre d’aucun des trois partis membres de la coalition à l’été 2015, lors de la campagne des législatives. La coalition a été le fruit d’une nécessité – tourner la page de l’austérité – et d’un contexte politique inédit permettant à la gauche – majoritaire en voix et en sièges à condition d’unir ses forces – de gouverner.
L’intérêt de cette organisation (la geringonça), c’est son fonctionnement, à première vue de bric et de broc, brinquebalant : vous avez trois formations qui sont obligées de s’écouter et de débattre, en s’opposant parfois, afin d’aboutir à des solutions. En s’efforçant de concilier impératif européen – prôné par le Premier ministre António Costa et le ministre des Finances Mário Centeno, président de l’Eurogroupe -, et impératif social, aiguillonné par le Bloc de Gauche et le Parti communiste. Fort de son solide ancrage local, le Parti socialiste, d’orientation social-libérale sous les gouvernements de José Socrates (2005-2011), défend, avec António Costa qui a pris le contrôle du parti en 2014, une ligne se voulant plus à gauche, plus social-démocrate. Ce sont les primaires de 2014 qui lui ont permis de s’imposer face à un adversaire qui était sur une ligne plus classique à l’échelle de l’Europe, au social-libéralisme affirmé. Sans cette évolution ni la main tendue par le Bloc de Gauche, aucune entente n’aurait été possible et la geringonça n’aurait pu voir le jour, alors que le PC se tenait dans l’opposition depuis 1975.
Des conflits sociaux perdurent (éducation, santé) et des divergences subsistent entre les membres de la geringonça sur un certain nombre de sujets. Mais, jusqu’ici, sans altérer la stabilité politique ni bloquer le système, une fois que le débat a eu lieu et que des opinions contradictoires se sont exprimées, permettant de produire des textes législatifs et des mesures concrètes. Pour ces raisons, c’est un cas intéressant de mise en commun et de réflexion collective. Il reflète aussi un rapport de force singulier entre un Parti socialiste autour de 35% et deux autres forces qui peinent à dépasser les 10%, aucune des trois formations n’ayant eu intérêt à rompre cet attelage brinquebalant. Même si celui-ci profite plus nettement au PS. Bien que le Bloco de Esquerda, qui a obtenu 10% des voix aux dernières législatives d’octobre 2015 reste un parti essentiellement urbain, et le Parti communiste, qui a essuyé un revers aux élections municipales de 2017, plafonnent dans les intentions de vote pour les prochaines élections législatives d’octobre 2019. C’est une configuration très particulière, due au fait qu’il n’y a pas, à échelle européenne, d’autre cas où un parti social-démocrate frôle les 35% et échappe à la pasokisation généralisée. Le cas portugais reste donc très singulier, même comparé à son voisin espagnol.
LVSL – L’une des données marquantes du paysage politique portugais réside dans l’absence d’une extrême droite vraiment significative, alors qu’en Espagne, une extrême-droite franquiste, jusqu’alors contenue dans le parti populaire est en train de renaître via le mouvement Vox qui a eu un franc succès lors des dernières élections en Andalousie. Comment expliquer cette absence de l’extrême droite dans le spectre politique portugais ? Est-ce du fait de l’héritage de la dictature de Salazar qui serait trop récente, et perçue trop négativement par les Portugais ?
YL – Cela tient pour partie à ce poids de la dictature salazariste, mais surtout à la manière dont le Portugal est sorti de la dictature. Si l’on compare avec le voisin espagnol, les deux cas sont antinomiques : d’un côté, en Espagne, il y a eu une transition pactée, négociée, avec le Pacte de l’oubli [3] dont on mesure aujourd’hui toutes les conséquences ; et de l’autre, le cas portugais pour lequel, la transition s’est faite par rupture, avec un coup d’État, la Révolution des œillets qui, en une journée, a renversé une dictature vieille de près d’un demi-siècle. L’héritage de cette transition est très prégnant dans la mémoire collective. En outre, des dispositions interdisant à un parti officiellement fasciste ou se réclamant du fascisme de se présenter à des élections ont été intégrées dans la Constitution de 1976. Il y a également des raisons liées à la singularité du cas portugais, pays traditionnel d’émigration, moins en première ligne que ses voisins sur la question des migrants dans le bassin méditerranéen et moins touché par les crispations identitaires liées à une immigration relativement faible, même si racisme et xénophobie existent au Portugal.
Malgré un taux d’abstention lors des différentes élections assez élevé, qui s’approche de la moyenne européenne, la crise de confiance dans les partis politiques est moins importante au Portugal que dans d’autres démocraties occidentales. On peut parler d’une forme de résilience des partis politiques. Les deux partis dominants, qui alternent au pouvoir depuis la Révolution des œillets, maintiennent des scores importants, entre 30 et 40 % des voix pour le Parti socialiste (PS) et entre 20 et 30 % pour le Parti social-démocrate (PSD). Ces deux seuls partis captent 70 % de l’électorat, ce qui constitue une exception. Il n’y a donc pas eu d’espace laissé pour l’expression autonome d’une droite qualifiée de populiste, radicale. C’est pour cela qu’on dit qu’il n’y a pas de populisme ni d’extrême-droite au Portugal, ce qui se vérifie aujourd’hui : le Parti national rénovateur (Partido Nacional Renovador) a fait un score de 0,5% lors des dernières élections législatives en 2015, ce qui est peu à l’échelle européenne. Cependant, la donne est peut-être en train d’évoluer pour deux raisons : d’une part, l’exemple espagnol a libéré la parole chez certains. Il y a comme un effet de capillarité, de mimétisme qui peut jouer, d’autant que les réseaux sociaux peuvent rapidement l’alimenter. Avec les influences venues d’autres pays, avec des personnalités telles que Steve Bannon et ses émules, le Portugal n’est pas un îlot à l’abri. D’autre part, en raison d’une forme de résurgence du discours nationaliste. Salazar, avec son entêtement obsessionnel à faire du Portugal un grand pays colonial, avec son nationalisme d’empire passéiste et anachronique, avait d’une certaine façon tué le match en invalidant toute forme de discours ultra-nationaliste, cause d’une décolonisation tardive et conflictuelle qui avait provoqué le renversement de la dictature au printemps 1974. Quant au testament salazariste, selon lequel, privé de ses colonies, le Portugal disparaîtrait, il avait lui aussi été rapidement invalidé par l’ancrage européen de la jeune démocratie portugaise. Dans l’actuelle campagne des européennes, chez les deux partis traditionnels de centre-droit et de droite, il existe une certaine porosité, sinon dérive populiste, tant au sein du CDS-Parti Populaire (CDS-Partido Popular), que du Parti social-démocrate (PSD), partis assez éclatés actuellement et en perte de repères. Une partie de leurs élus et une partie de leur électorat sont en attente, tentés par un discours empreint de nostalgie d’une grandeur révolue et de repli obsidional, volontiers contempteurs d’une geringonça brocardée comme mauvaise gestionnaire et clientéliste. Type de discours qui les rapprocherait davantage d’une droite populiste. La situation est donc peut-être en train d’évoluer, même si c’est encore trop tôt pour l’affirmer.
« La singularité de la geringonça et du redressement économique devrait susciter un nouvel engouement pour le Portugal. »
LVSL – En Espagne, la question de la mémoire historique est prégnante. Une loi d’amnistie, le Pacte de l’oubli, a été votée pendant la période de transition démocratique. Elle est d’une actualité brûlante, comment l’a montré le récent documentaire Le silence des autres. Qu’en est-il au Portugal ? Y a-t-il eu un travail sur la mémoire historique, de réparation des crimes commis pendant la dictature de Salazar ? L’héritage de Salazar est-il aujourd’hui un sujet clivant dans la société portugaise comme ça peut l’être en Espagne où des représentants politiques, et des personnes issues de la société civile se revendiquent ouvertement de l’héritage de Franco ?
YL – Pour comprendre cette question de la mémoire historique, il faut revenir à la transition. Nous sommes actuellement en période de commémoration du 45ème anniversaire de la Révolution des œillets du 25 avril 1974, qui a permis le renversement de la dictature. Chaque année, à la même période, les Portugais se souviennent des événements du 25 avril 1974. Comme tout cycle commémoratif, il y a des hauts et des bas, des périodes plus aseptisées où finalement ce ne sont plus que des mots que l’on délivre avec un sens qui se perd, au risque de banaliser l’événement 25 avril présenté, lors de son 30ème anniversaire, plus comme une évolution qu’une révolution. Cependant, au moment du 40ème anniversaire en 2014, en pleine période d’austérité imposée par la Troïka, se sont multipliées les critiques sur le fait que les idéaux de la Révolution des œillets auraient été trahis. Ce cycle commémoratif, qui fait d’un jour de commémoration un jour férié depuis 1976 – le Jour de la Liberté, permet de se remémorer chaque année cet événement clé de la démocratie. C’est d’autant plus important lorsqu’on compare les modes de construction de la démocratie en Espagne et au Portugal. Même si, face à l’horreur des dictatures, il est toujours très difficile de faire des comparaisons et de quantifier l’abjection, la dictature de Salazar a été une dictature très dure, gouvernant par la peur, où, dans la vie quotidienne, la population était épiée par la police politique. Mais il n’y a pas eu au Portugal cette épouvantable guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts, traumatisme majeur de la société espagnole. Soutien du régime franquiste, le Portugal de Salazar n’a pas connu de guerre civile. Et, à la différence de l’Espagne franquiste, la dictature a été renversée le 25 avril par le Mouvement des Capitaines et une révolution à la fois pacifique et populaire. Ce qui change pas mal de choses au regard des pratiques démocratiques, plus inclusives dans le cas portugais [4].
Au Portugal, l’enseignement de l’histoire du temps présent est un peu le parent pauvre des programmes scolaires. Il y a eu néanmoins de nombreuses avancées depuis trente ans, fruits d’une histoire savante développée, entre autres, par l’Institut d’Histoire Contemporaine de l’Université Nouvelle de Lisbonne, l’Institut de Sciences sociales (ICS) de l’Université de Lisbonne et le Centre de Documentation du 25 avril à l’Université de Coimbra, qui ont produit – et qui continuent de produire – d’excellents travaux sur la période de la fin du salazarisme, sur la Révolution des œillets et la transition. Cependant, le problème de la diffusion de cette histoire savante demeure. Une grande partie de la population portugaise – les jeunes notamment – ignorent largement ce que fut la dictature. Et alors que ceux qui l’ont vécue, il y a plus de 45 ans, disparaissent, cette mémoire née de la transmission entre générations ne se fait plus de la même manière. La transmission ne s’est pas toujours très bien faite dans les familles. On ne parlait pas facilement du temps de la dictature parce qu’il y avait une sorte de chape du silence, ainsi qu’une volonté d’oublier, voire de banaliser, chez certains, le temps de la dictature.
Quant au personnage de Salazar, il ne suscite pas de culte de la personnalité, contrairement à l’Espagne où certains se revendiquent ouvertement de Franco. Salazar était lui-même partagé sur ce culte de la personnalité. Comme ces fantômes qui viennent vous visiter sans forcément vous hanter, il continue de susciter auprès d’une certaine partie de la population, vieillissante, qui a vécu au temps du salazarisme, le souvenir non pas d’un dictateur implacable, mais d’un homme honnête et vertueux. Au point d’avoir été désigné en 2007 comme la personnalité majeure de l’histoire du vingtième siècle portugais par un sondage fort peu scientifique réalisée par la chaîne de télévision RTP. Aujourd’hui, alors que la corruption et le clientélisme n’ont pas disparu, on voit bien comment certains pourraient chercher – quand ils ne l’ont déjà fait – à utiliser l’image d’un personnage qui incarnerait une forme de probité. Très récemment a ressurgi l’idée d’un musée qui serait consacré à Salazar dans son village natal près de Santa Comba Dão. Mais cela reste un projet. Il faut rester toujours très attentif parce que la révolution a permis de solder en partie les comptes de la dictature. Il y a eu alors une épuration, avec le jugement et la condamnation d’une partie des équipes dirigeantes de l’État Nouveau [5], souvent exilées au Brésil. Il y a eu un changement de cap et de personnel politique, mais qui ne pouvait pas être complet compte tenu de la taille et des besoins du pays. Une partie de ces élites politiques et économiques s’est d’ailleurs organisée pour réapparaître au bout d’un certain temps. Alors qu’en Espagne, lors de la transition, le Pacte de l’oubli a permis à de nombreuses personnalités de continuer d’exercer leurs fonctions quand bien même elles étaient impliquées dans la gestion de l’ancien régime. Plus que le devoir de mémoire, ce qui importe réellement, c’est le besoin d’histoire. Il y a un besoin de connaître et d’écrire cette histoire. Elle est aujourd’hui largement écrite et connue, même si elle est entachée de quelques tentatives révisionnistes. Avec aussi de belles avancées récentes en matière d’histoire sociale, par en-bas, l’histoire des petites choses. Mais la transmission auprès du grand public reste imparfaite. Une partie de la jeunesse ne sait plus ce que fut le 25 avril.
LVSL – Le Portugal est assez peu évoqué dans les médias français, malgré les liens historiques qui unissent la France et le Portugal du fait de la vague d’émigration massive des années 1960-70. Selon vous, comment peut-on expliquer ce manque d’intérêt de la part des médias français ?
YL – C’est le fruit d’une longue histoire. Le Portugal a longtemps été considéré comme un pays périphérique par les Français, avant tout rivaux de leurs voisins immédiats, Anglais, Allemands ou Espagnols. Le Portugal n’était pas un enjeu majeur, de par l’exiguïté de son territoire et son caractère périphérique à l’échelle du continent européen. Les recherches en France sur le Portugal sont relativement récentes à l’exception de la période des Découvertes, sur l’Infant Henri, le Navigateur, ou Vasco de Gama par exemple. Pour la France, le Portugal était un cas d’autant plus marginal qu’il était méconnu. Il y a eu des moments où la France a plus regardé du côté du Portugal, ainsi quand la République a été proclamée par exemple [6]. Du temps de Salazar, des pans entiers de la droite réactionnaire et conservatrice française ont puisé dans le salazarisme une source d’inspiration. Le régime de Vichy s’est très largement inspiré du modèle incarné par Salazar [7]. Mais le reste des échanges était relativement faible. Le Portugal était avant tout l’allié historique de l’Angleterre. L’arrivée massive des émigrés portugais dans les années 1960 n’a guère changé les choses, l’ignorance restant totale de leur culture, nourrissant au contraire de nombreux stéréotypes empreints de condescendance et de moqueries sur « ce pays de concierges et de maçons », teintés malgré tout d’une forme de respect pour le « bon travailleur portugais », respectueux et dur à la tâche, comme l’a montré le film de Ruben Alves La cage dorée (2013). Les choses ont changé ces dernières années, non pas tant avec l’engouement touristique des Français pour le Portugal, mais par les avancées de la recherche historique qui permettent de faire connaître l’histoire de ce pays, ainsi que sur le plan culturel avec la découverte des grands auteurs portugais tels que Fernando Pessoa (1888-1935), José Saramago (1922-2010), seul Prix Nobel de Littérature portugais à ce jour, ou bien encore António Lobo Antunes.
La Révolution des œillets a constitué un moment charnière au cours duquel une grande partie de l’intelligentsia et des responsables politiques français se sont tournées vers le Portugal, à la fois pour observer et se nourrir de son exemple, mais aussi pour donner des conseils, faisant de ce pays un véritable laboratoire d’expérimentations politiques et sociales, nourrissant une efflorescence d’ouvrages et d’articles. La singularité de la geringonça et du redressement économique devrait de nouveau susciter pareil engouement pour le Portugal.
- Eurobaromètre Standard 90 – Vague EB90.3 – Kantar Public, automne 2018 – terrain : novembre 2018, « L’opinion publique dans l’Union européenne » http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
- Depuis 2015, le gouvernement socialiste est soutenu, sans participation gouvernementale, par le Parti communiste et le « Bloco de esquerda » (Bloc de gauche)
- Pacte de l’oubli : loi d’amnistie générale votée en 1977 en Espagne lors de la période de transition démocratique
- Cf. Robert M. Fishman, Democratic Practice : Origins of the Iberian Divide in Political Inclusion, Oxford University Press, 2019.
- Estado Novo, régime autoritaire de 1933 à 1974, qui survit à Salazar (1889-1970) mais est renversé le 25 avril 1974 par la Révolution des œillets
- 1910
- cf. Patrick Gautrat, Pétain, Salazar, De Gaulle. Affinités, ambiguïtés,illusions (1940-1944), Paris, Editions Chandeigne, 2019.