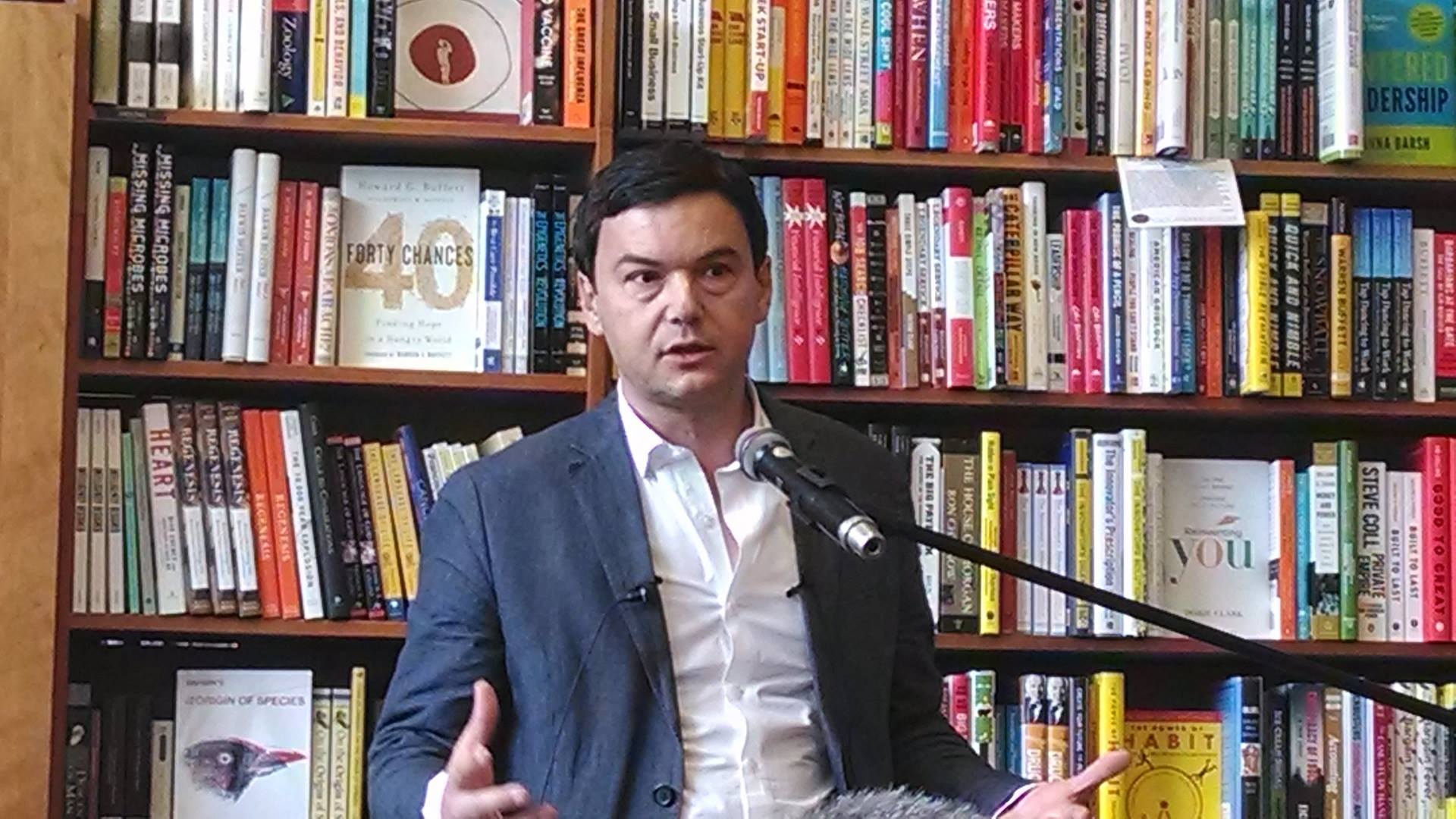Le 5 mars, dans un amphithéâtre bondé de la rue d’Ulm, le philosophe marxiste et homme politique Antonio Negri prononçait la leçon inaugurale d’un cycle de conférence proposé par le Groupe d’études géopolitiques de l’ENS, dont le titre reprend celui d’un petit livre de George Steiner, « Une certaine idée de l’Europe ». « Pour que l’Europe redevienne une idée » : l’ambition affichée par le groupe d’étudiants peut faire sourire, mais elle a le charme de son panache, et le mérite d’encourager un débat transnational nourri de recul par les temps chahutés que nous traversons.
Étayant le constat d’une Europe défaite, Toni Negri a placé son discours sous le signe de la reconstruction. Est interrogée la possibilité d’associer l’idée d’Europe à celle d’un nouvel « internationalisme » : comment transformer la lutte des précaires en discours sur l’Europe ? La solution proposée est celle de la « rupture » : l’Europe devrait être déliée d’un cadre atlantiste libéral « aliénant », pour être mieux reconstruite, en dehors des États, avec l’objectif d’œuvrer à la constitution d’un ordre mondial dénué de toute forme d’impérialisme.
« Nous sommes arrivés au terme de l’Europe que nous connaissons, que nous connaissions » – c’est ainsi que Toni Negri débute une analyse de la recomposition mondiale qui se joue, et qui replace la question des « espaces » comme blocs de puissance au centre de toute considération géopolitique. La mort de « l’Europe que nous connaissions » serait liée à celle de l’ordre mondial atlantiste et libéral issu de la seconde guerre et adoubé par la disparition de l’URSS. En délitement depuis l’incapacité des États-Unis à réguler l’ordre mondial post-2001, cet ancien ordre emporterait avec lui l’Union européenne. Dans ce nouveau monde, l’Union ne pourrait alors plus survivre que comme un zombie de l’ancien. Esseulée, l’Europe ? Pour retrouver notre place au sein d’un ordre mondial « bloqué », Negri voudrait nous rappeler à ce que nous sommes, cette péninsule du continent asiatique, miroir de l’Afrique par la méditerranée. Il nous invite à trouver un autre équilibre, qui entretiendrait à parts égales les deux « penchants » européens : l’un asiatique, l’autre atlantique.
“Dans un ordre mondial « bloqué », l’affrontement entre espaces de dimension continentale se trouve exacerbé par les dynamiques de conservation et de conquête des parts du marché global. Cet ordre aspire les « petits », les met au ban d’empires économiques en construction.”

Le préalable à la reconstruction européenne serait la sortie. Negri incite à sortir d’une Europe devenue espace irrespirable, au sens où il n’y aurait plus de « dehors » à la discipline néo-libérale qui y prévaudrait. L’approfondissement des structures de la gouvernance européenne (i.e, le marché) ferait que le pouvoir politique constituant, lui même, ne serait plus à « l’intérieur » des institutions européennes. La crise grecque et ses détours tragiques sont, là encore, évoqués comme un tournant. L’échec du « printemps grec » et du gouvernement de Tsipras aurait démontré que le fonctionnement « néo-libéral » de l’Union européenne n’avait pas d’alternative, quand bien même certains Etats auraient pu être tentés par la clémence. Pour le peuple grec, la résistance eut été la pire des réponses, en tant qu’elle aurait encore aggravé son désarroi et l’asservissement de ses représentants politiques. Sur l’épisode grec, et sur le Brexit – alors que le vote des britanniques semble contrarié par les difficultés du Royaume-Uni à s’extraire du cadre réglementaire de l’Union européenne – Toni Negri conclut à l’absence de « dehors » européen.
Mais il n’y aurait pas, non plus, de « dehors » mondial. Le cadre mondialisé de la politique et de l’économie est là et il est irréversible : la « dé-mondialisation », par le retour à l’exclusive de l’état-nation, est une vaine perspective. Le politique ne pourrait plus être pensé « en dehors » d’un état des choses mondial. Negri parle ainsi du « mondial » comme du transcendantal épistémique de la politique : ayant acquis une identité propre, il devient le lieu à partir duquel penser les phénomènes politiques aux échelons « inférieurs ». Dans un ordre mondial « bloqué », l’affrontement entre espaces de dimension continentale se trouve exacerbé par les dynamiques de conservation et de conquête des parts du marché global. Cet ordre aspire les « petits », les met au ban d’empires économiques en construction. Il donnerait à voir le néolibéralisme dans toute sa dimension autoritaire et « disciplinaire », reléguant les États au rôle d’« intermédiaires » zélé dans la mise en œuvre de son agenda. Face à cela, Negri invite à jeter une lumière crue sur les « illusions » qui ont conduit à construire l’Europe à travers les Etats. Puisque la démocratie au sein des États-nations n’a pas pu empêcher l’hégémonie néolibérale, il ne peut plus y avoir de salut par la démocratie telle qu’organisée au sein de l’état-nation.
L’Europe devra ainsi être défaite, car la marque ordo-libérale des traités ne saurait être réformée, et reconstruite, dans une logique fédérale assumée, en dehors des Etats. Dans son discours, Negri abandonne deux fois l’État-nation : par l’union fédérale des peuples européens qu’il promeut, et par son rejet de l’État comme lieu d’action et de puissance face au néo-libéralisme. Pour reconstruire l’Europe, Negri s’inspire de la tradition ouvriériste, celle des « forces instituantes » de Castoriadis, pour suggérer de recourir à la constitution d’un réseau transnational de luttes locales, de « villes-rebelles ».
Cette ouverture peine à convaincre car elle s’appuie sur deux hypothèses fortement contestables.

La première voudrait croire en l’existence d’une certaine unité idéologique et politique transnationale en Europe et sur l’idée d’Europe, nécessaire à l’effet réseau des « villes rebelles ». Il existe bien un embryon de trans-nationalité du débat sur l’Europe, mais il ne constitue pas une « communication » au sens d’Habermas, capable de nourrir un projet politique commun. Si des fronts « communs » sont nés en réaction aux crises migratoires et des dettes souveraines, ils ne formulent pas de pensée normative sur l’avenir du continent. Que l’on pense à l’alliance des démocraties dites « illibérales » autour du groupe de Visegraad (Pologne, Hongrie, Slovaquie et République Tchèque) ou au mouvement « Diem25 », porté par l’ancien ministre grec Yanis Varoufakis, et qui entend promouvoir une trans-nationalité alternative ressemblant aux visées proposées par Negri (une ambition fédérale s’appuyant sur une critique de l’Union européenne néolibérale et sur un agenda de relance keynésienne), aucun ne parvient encore à distiller une synthèse européenne crédible. Par ailleurs, bien que les dirigeants politiques européens proposent aujourd’hui une vision de l’Europe comme des axes programmatiques à part entière, ils le font avec des référents qui demeurent essentiellement nationaux (ainsi de l’Allemagne ou de la France, qui œuvrent à penser l’Union comme un prolongement d’eux-mêmes) et sans proprement intégrer les contraintes des pays voisins. L’observation des mouvements populaires récents dont le discours était en partie projeté vers l’Union européenne, comme le mouvement des indignés né à la Puerta del sol de Madrid, montre que leur caractère transnational n’était au mieux qu’évanescent (le mouvement des indignados s’est développé notamment au Portugal, en France, en Allemagne, en Italie et en Angleterre, mais les mobilisations étaient alors moindres qu’en Espagne, et initiées le plus souvent par des Espagnols expatriés en contact avec le mouvement espagnol).
“Alors même qu’il décrit le « mondial » comme le transcendantal épistémique de la politique, comment Negri peut-il privilégier le rôle des villes, qui ne possèdent aucun des leviers d’action, même rabougris, des Etats, pour s’imposer dans un nouvel ordre mondial à nouveau caractérisé par des affrontements de puissance continentale ?”
La deuxième hypothèse sur laquelle s’appuie Negri pour discréditer le rôle des États dans l’entreprise d’une reconstruction européenne implique que ce serait par des communautés infranationales, en l’occurrence les villes, que l’on parviendrait à mener la refondation qu’il appelle de ses vœux. Alors même qu’il décrit le « mondial » comme le transcendantal épistémique de la politique, comment Negri peut-il privilégier le rôle des villes, qui ne possèdent aucun des leviers d’action, même rabougris, des Etats (l’impôt, la violence légitime, la législation) -, pour s’imposer dans un nouvel ordre mondial à nouveau caractérisé par des affrontements de puissance continentale ? L’abandon de l’État-nation préconisé par Negri serait en fait le point de départ d’un nouvel internationalisme, qui détruirait les « empires » politiques comme il scinderait les sociétés multinationales qui véhiculent, elles-aussi, une forme d’impérialisme par leur position monopolistique sur le marché. Il est peu de dire qu’il paraît rapide et orthogonal avec la protection, au moins à court terme, des plus précaires.
Car c’est bien la question du « commun » qui reste au centre du jeu. « Le commun ne peut être fait qu’a travers l’Europe mais l’Europe ne se fera qu’en commun » : c’est par ce beau chiasme que Toni Negri achève son propos d’ensemble et souligne toute la difficulté du projet d’Union européenne. L’idée de l’Europe serait celle d’une vitalité à construire du « commun ». L’on pourrait presque y voir un oxymore (quel est, au juste, le commun européen?), et c’est justement là que réside la grandeur de cette association. A la recherche de la cause commune…