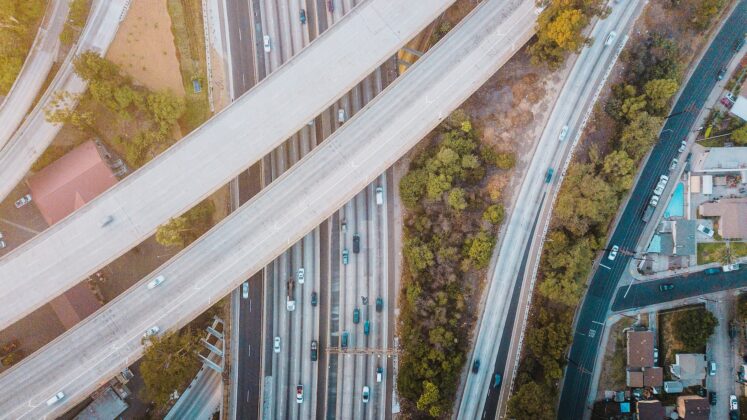Depuis une semaine, les manifestations des agriculteurs secouent la France entière. Celles-ci ont débuté à Carbonne (Haute-Garonne) avec un blocage autoroutier, qui n’a toujours pas été levé. Député de la circonscription, l’insoumis Christophe Bex s’est rendu à plusieurs reprises sur le blocage pour échanger avec les agriculteurs. Il y a observé une colère très profonde, que les récentes mesures annoncées par le gouvernement ne pourront pas calmer. D’après lui, l’incapacité des agriculteurs à vivre dignement de leur travail n’est pas due à des normes ou à des taxes excessives, mais bien au libre-échange et à la dérégulation totale du marché alimentaire, qui risque de tuer le secteur agricole, comme l’industrie auparavant. Pour Christophe Bex, ce mouvement social, qui échappe largement à la FNSEA, offre l’occasion d’arrêter cette destruction avant qu’il ne soit trop tard, à condition de prendre des mesures fortes. Entretien.
Le Vent Se Lève : La vague de mobilisation des agriculteurs a débuté il y a une semaine dans le Sud-Ouest de la France, en partant de votre circonscription, à Carbonne, où vous vous êtes rendus à plusieurs reprises sur l’autoroute A64 bloquée. La France compte pourtant beaucoup d’autres zones agricoles. Pourquoi, d’après vous, ce mouvement a-t-il commencé en Haute-Garonne ?
Christophe Bex : D’abord, je pense que c’est lié aux spécificités de l’agriculture dans le Sud-Ouest. Je suis originaire de Lorraine et j’ai également vécu en Seine-et-Marne, l’agriculture qu’on y trouve est tout à fait différente. A chaque fois, l’agriculture dépend du relief et du climat. En Haute-Garonne, nous sommes proche des Pyrénées et avons des petites parcelles. Ça n’a rien à voir avec les grands céréaliers comme le patron de la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats des Exploitants Agricoles, syndicat majoritaire, ndlr) qui a une propriété de 700 hectares. Or, la FNSEA ne défend pas les petits agriculteurs.
Cette spécificité territoriale a une conséquence politique : le président de la chambre d’agriculture de la Haute-Garonne (organisme départemental chargé d’accompagner les agriculteurs et géré par des élus des syndicats agricoles, ndlr) est le seul en France métropolitaine à ne pas être issu de la FNSEA, mais des Jeunes Agriculteurs. Bien sûr, ils sont proches, mais ils ont tout de même une certaine indépendance vis-à-vis du syndicat dominant et localement, ils travaillent bien avec la Confédération Paysanne (syndicat défendant une agriculture locale et respectueuse de l’environnement, classé à gauche, ndlr). Le Président de la chambre n’a que 33 ans, donc il a une vision de long-terme de l’agriculture : il a intégré que les consommateurs vont manger moins de viande, que le climat va devenir plus chaud, qu’on manque de plus en plus d’eau… On n’est certes pas d’accord sur tout, mais on converge sur beaucoup de points.
« On ne fera la transition agro-écologique qu’avec les agriculteurs. »
Or, on ne fera la transition agro-écologique qu’avec les agriculteurs. Actuellement, on leur impose de changer leurs méthodes de production, tout en dirigeant notre agriculture vers l’exportation, notamment les céréales, les spiritueux et le lait. D’un côté, on leur demande une bifurcation écologique, de l’autre il faut produire toujours plus pour vendre à l’étranger. Pour l’instant, on fait le choix d’exporter massivement certains produits et d’importer tout le reste : on est en déficit sur la viande, sur les fruits et légumes etc. Pourtant, notre pays est riche de la diversité de ses sols et de ses climats et est capable de nourrir sa population. La France était une grande puissance agricole, mais nous sommes en déclassement. C’est un choix politique : certains responsables politiques considèrent que l’agriculture n’est pas nécessaire, qu’on peut tout importer et que notre pays n’a qu’à devenir une grande plateforme logistique, un parc d’attraction pour touristes ou à accueillir les Jeux Olympiques.
LVSL : On a l’impression que l’agriculture française est en train de subir le même destin que l’industrie, qui a largement disparue…
C. B. : Oui, il se passe actuellement dans le monde agricole la même chose que dans l’industrie depuis les années 1980. Je me suis récemment rendu à Tourcoing pour soutenir la lutte des travailleurs de Valdunes, la seule entreprise française qui produit encore des roues de trains, de tramways et de métros. Tout le monde s’accorde sur le fait que la transition écologique implique que les voyageurs et les marchandises prennent davantage le train. Pourtant, l’entreprise est menacée de fermeture car les actionnaires ne la jugent pas assez rentable et veulent la délocaliser. Ces savoir-faire sont pourtant inestimables, il faut les protéger. Si les actionnaires ne veulent plus assurer cette production, nationalisons-là ! Elle est suffisamment importante pour que cela le mérite.
L’agriculture fait face au même dilemme que l’industrie avant elle : que veut-on produire, où, et dans quelles conditions sociales et environnementales ? Soit on se focalise sur quelques secteurs exportateurs et on importe tout le reste, avec un coût humain et environnemental considérable, soit on relocalise, on réindustrialise, on répond aux besoins français en priorité, avec les savoir-faire des travailleurs. Pour l’instant, c’est la première option qui est choisie. En Lorraine par exemple, lorsque la sidérurgie a été liquidée avec l’aide des socialistes au pouvoir, on a remplacé les hauts-fourneaux par un parc d’attractions, le Schtroumpfland, en espérant redynamiser le secteur.
On voit bien que c’est un échec : on ne peut pas remplacer une tradition, une histoire, des emplois syndiqués et correctement payés par des emplois de service, mal payés, sous-traités, voire exercés par des auto-entrepreneurs. C’est toujours la même histoire : le gouvernement se targue d’arriver au plein-emploi, mais la misère ne fait qu’augmenter. Oui, on peut arriver à de belles statistiques en matière de chômage grâce à des emplois à un euro de l’heure, mais les conditions de vie des gens se dégradent d’année en année.
« Qu’on soit ouvrier, paysan ou petit commerçant, c’est le même combat : on veut vivre dignement de notre travail et on est victime du même système capitaliste. »
Cela ne vaut d’ailleurs pas que pour l’industrie et l’agriculture. Il y a deux semaines, j’ai aussi rencontré des petits commerçants, notamment des boulangers et des pizzaïolos, très inquiets de la hausse des prix de l’électricité. Eux aussi font face à une concurrence déloyale : celle des supermarchés et de chaînes comme Marie Blachère, qui ont une force de frappe beaucoup plus forte, qui emploient à des coûts salariaux très bas, qui ouvrent le dimanche et qui peuvent se permettre de vendre une baguette 65 centimes. Qu’on soit ouvrier, paysan ou petit commerçant, c’est la même logique, c’est le même combat : on veut vivre dignement de notre travail et on est victime du même système capitaliste qui ne cherche qu’à maximiser le profit. Ce que je regrette, c’est que les luttes restent cloisonnées, que les ouvriers ne fassent pas grève en soutien aux paysans ou que ces derniers n’aient pas guère pris part aux manifestations contre la réforme des retraites par exemple. En tant que député, j’essaie donc de faire lien entre toutes ces luttes.
LVSL : En effet, le point commun est l’incapacité à vivre correctement de son travail. Mais on entend aussi beaucoup la FNSEA et une grande partie du spectre politique, des macronistes au Rassemblement National en passant par les Républicains, dire que le problème vient avant tout des normes. Lorsque vous vous êtes rendus auprès des agriculteurs, quelles revendications mettent-ils le plus en avant ?
C. B. : Le premier discours que j’ai entendu, c’est « on croule sous la paperasse, on a autre chose à faire ». Mais quand on creuse un peu, on comprend qu’ils ne demandent pas forcément moins de normes. Ils veulent bien respecter des règles, ils ne sont pas nécessairement opposés au bio. Les paysans savent très bien qu’ils sont les premières victimes des pesticides. On parle souvent des deux suicides d’agriculteurs par jour, qui sont extrêmement tragiques, mais on ne doit pas non plus oublier tous les paysans qui sont malades et qui meurent de cancers, de la maladie de Parkinson etc. Il suffit de regarder le scandale du chlordécone dans les Antilles françaises auprès des producteurs de bananes.
Le problème n’est donc pas le bio, mais la concurrence déloyale : les poulets d’Ukraine, les agneaux de Nouvelle-Zélande, les porcs de Pologne sont à des prix défiant toute concurrence car les salaires sont bas et les normes environnementales quasi-inexistantes. Les agriculteurs français sont très attachés au fait de faire des produits de qualité, mais ils ne peuvent pas faire face à ces productions importées. Cette mondialisation a aussi pour conséquence de faire voyager des virus qui affectent les cultures et les animaux. Par exemple en Haute-Garonne, on a actuellement une vague de maladie hémorragique épizootique, qui est probablement venue d’Espagne. Le gouvernement a annoncé que 80% des frais liés à cette maladie seraient pris en charge, mais les agriculteurs demandent que cela soit 100%.
« Le problème n’est pas le bio, mais la concurrence déloyale. »
Mais ces aides impliquent à chaque fois beaucoup de paperasse. Même chose pour les remises sur le « rouge », le gazole non-routier : il existe des déductions fiscales, mais qui supposent là encore des démarches administratives. Les agriculteurs ne veulent pas devenir des fonctionnaires, ils veulent vivre de leur travail. C’est qu’ils mettent tous en avant. Or, ils sont nombreux à ne plus y arriver. Et pour un agriculteur, faire faillite, c’est encore plus traumatisant que pour les autres chefs d’entreprise car ils ont une forte charge familiale et historique. Souvent, ils ont hérité la ferme de leurs parents et grands-parents, qui ont placé tous leurs espoirs en eux. C’est une pression très difficile à gérer quand on est en difficulté, donc beaucoup finissent malheureusement par se suicider, car ils ont l’impression d’avoir trahi leur famille.

Heureusement, le mouvement actuel recrée de la solidarité. Sur les barrages, on voit beaucoup d’agriculteurs à la retraite qui viennent soutenir leurs enfants. Et ça va au-delà des seuls agriculteurs : j’ai aussi rencontré des bouchers et des élagueurs, qui sont venus soutenir ceux avec qui ils travaillent au quotidien. On rappelle souvent que le nombre d’agriculteurs a beaucoup baissé, c’est vrai, mais ils restent tout de même au cœur de la vie des villages, car beaucoup d’activités dans la ruralité sont liées à l’agriculture. En Haute-Garonne, on parle toujours d’Airbus, mais le chiffre d’affaires de l’agriculture et de l’élevage est plus important que celui de l’aéronautique ! N’oublions pas aussi que beaucoup de maires ruraux sont agriculteurs. Donc, le nombre de paysans baisse, mais leur présence sociale, économique, politique et culturelle reste forte.
LVSL : J’en reviens à ma question précédente : vous dites que le problème n’est pas tant un excès de normes, mais plutôt la mauvaise organisation de la bureaucratie et surtout une concurrence déloyale. Mais concrètement, quand vous leur parlez de prix garantis, de quotas de production etc, est-ce qu’ils adhèrent à ces idées ?
C. B. : En fait, ils veulent avant tout des objectifs clairs. Pour l’instant, il n’y en a pas. On leur demande en permanence de produire autre chose qui se vendra mieux en fonction des cours internationaux, alors qu’ils ont souvent fait de gros investissements pour lesquels ils n’ont pas encore remboursé les prêts. Cette logique ne mène nulle part. On voit bien que la marge sur l’alimentaire n’est pas faite par les agriculteurs, mais par la grande distribution et les industriels de l’agro-alimentaire. Ils se gavent des deux côtés : sur le dos des consommateurs et sur celui des paysans. Il faut s’y attaquer, en encadrant les marges et en instaurant des prix plancher, comme nous l’avions proposé dans notre niche parlementaire.
« Il faut encadrer les marges et instaurer des prix plancher, comme nous l’avions proposé dans notre niche parlementaire. »
Pour partager la valeur ajoutée, il faudrait aussi que l’agro-alimentaire soit moins concentré et que la production soit plus locale. Certains paysans parviennent à transformer et vendre eux-mêmes leurs produits, souvent avec l’aide de leur entourage familial. Mais tout cela demande du temps et des savoir-faire : tout le monde ne s’improvise pas boulanger ou vendeur sur un marché. C’est pour ça que je plaide, comme la Confédération Paysanne, pour des unités de production plus locales. Cela éviterait que quelques grands groupes ne captent toute la marge et que les produits voyagent sur des centaines de kilomètres et cela récréerait de l’emploi et du lien dans les territoires ruraux.
LVSL : Vous évoquez la Confédération Paysanne. Ce syndicat a plein de propositions intéressantes, mais reste peu puissant face à l’hégémonie de la FNSEA dans le monde agricole. Pensez-vous que la FNSEA soit actuellement dépassée par sa base ?
C. B. : Oui. Les paysans que j’ai rencontrés ont organisé les blocages eux-mêmes, en dehors des syndicats et notamment de la FNSEA. Ils en ont marre de se faire balader par ce syndicat. Il suffit de voir ce qui s’est passé en Haute-Garonne : il y a deux semaines, les agriculteurs manifestaient à Toulouse en déversant du fumier partout pour se faire entendre. Et puis à 16h, les représentants de la FNSEA arrivent pour leur dire de rentrer chez eux avec leurs tracteurs et qu’ils vont négocier pour eux. Les paysans ont refusé de partir et ont décidé de bloquer l’autoroute à Carbonne. Bien sûr, la FNSEA a ensuite rejoint le blocage avec ses drapeaux. Mais elle ne maîtrise pas ce mouvement.
Les agriculteurs que j’ai rencontrés ne sont pas syndiqués ou sont proches d’autres syndicats, mais en tout cas, ils ne croient pas au discours de la FNSEA. Ils suivent ce qui se passe dans la société, ils voient que le modèle suivi par leurs parents, en produisant et en s’endettant toujours plus, va dans le mur. Ce n’est pas pour autant qu’ils adhèrent au discours d’autres syndicats : le patron de la chambre d’agriculture issu des JA est là, mais il ne fait pas la propagande de son syndicat. Même chose pour la Confédération Paysanne. Les agriculteurs veulent échapper à toute récupération syndicale, mais aussi politique. Moi j’y suis allé humblement, sans volonté de m’approprier quoi que ce soit. Jean Lassalle est également passé, Carole Delga a fait son show, puis Gabriel Attal vendredi, mais ils ont refusé que Jordan Bardella vienne.
LVSL : Gabriel Attal s’est rendu à Carbonne le 26 février, où il fait toute une mise en scène avec des bottes de foin et des agriculteurs triés sur le volet. Il a annoncé quelques mesures, comme le renoncement aux hausses de taxes sur le GNR et un « choc de simplification ». La plupart des agriculteurs rejettent ces mesures cosmétiques et annoncent poursuivre leurs actions. Pensez-vous que le gouvernement soit capable de répondre aux demandes des agriculteurs ?
C. B. : Non. Ce n’est pas avec des effets d’annonce que le gouvernement satisfera les agriculteurs. De toute façon, ils sont dans une logique capitaliste, d’accords de libre-échange, de libéralisme exacerbé… Or, répondre aux demandes des agriculteurs impliquerait des prix planchers, du protectionnisme, des quotas de production, etc. Ils devraient renier toute leur philosophie politique, ce qu’ils ne feront jamais. Donc ils se contentent de faire de la communication : Attal nous refait le même show que Macron il y a sept ans avec les Etats généraux de l’alimentation. On a vu le résultat !
Ils ont annoncé faire respecter les lois Egalim en envoyant 100 inspecteurs. Pour 400.000 exploitants, c’est de la rigolade. Attal espère que les mesurettes qu’il a annoncées suffiront à calmer les agriculteurs grâce à la courroie de transmission qu’est la FNSEA, mais ça ne marchera pas. Les agriculteurs sont à bout, comme d’ailleurs l’ensemble de la société française, qui les soutient largement. La colère qui s’est exprimée durant les gilets jaunes ou la réforme des retraites est toujours là et elle s’est même amplifiée. C’est impossible de prévoir sur quoi cela va déboucher, mais il est possible que ça prenne un tournant violent, même si je ne le souhaite évidemment pas car le pouvoir risque de s’en servir.
LVSL : Justement, on voit que le gouvernement fait pour l’instant le choix de ne pas réprimer le mouvement. Les paroles de Gérald Darmanin, qui parle de « coup de sang légitime » et évoque le recours aux forces de l’ordre seulement « en dernier recours » détonnent par rapport à la répression immédiate des autres mouvements sociaux. Comment analysez-vous cela ?
C. B. : C’est clair qu’il y a un deux poids, deux mesures. Quand les gilets jaunes occupent les ronds-points, quand les syndicalistes occupent des usines ou quand des militants écolos manifestent, les CRS débarquent très vite. Là, à Carbonne, les gendarmes viennent boire le café et manger le sanglier ! Ça change des Robocops qu’on a en ville ! La nature des forces de l’ordre joue d’ailleurs un rôle : les gendarmes côtoient les agriculteurs au quotidien, alors que les CRS sont déconnectés du territoire et ne font pas de sentiment.

Je ne sais pas si ça tiendra longtemps ou non, mais dans tous les cas le gouvernement est mal à l’aise. Car en face, les agriculteurs ont des gros tracteurs et sont souvent aussi chasseurs, donc ils ont des armes. C’est un peu comme avant quand les ouvriers de l’industrie manifestaient avec leurs casques et tout leur matériel. C’est plus dur à réprimer que les gilets jaunes. Dans tous les cas, j’espère vraiment que ça ne prendra pas un tour violent.
LVSL : Vous évoquez le fait que les agriculteurs sont très soutenus parmi la population et que la colère est très forte parmi les Français. Pensez-vous que le mouvement des agriculteurs puisse être rejoint par d’autres ? Croyez-vous à la « convergence des luttes » ?
C. B. : En tout cas, je le souhaite ! Mais pour ça, il faut casser les caricatures des deux côtés : celle de l’agriculteur bourrin, chasseur, viandard et bouffeur d’écolo et celui de la gauche urbaine, donneuse de leçons qui ne comprend rien à rien. La FNSEA fait d’ailleurs tout pour entretenir ces clichés, par exemple quand elle déverse du fumier devant les locaux d’Europe Ecologie Les Verts. Mais pour casser ces clichés, il suffit d’aller sur le terrain et de parler avec les gens. A chaque fois, j’ai été bien accueilli : tout le monde sait que je suis député France Insoumise, mais ça n’a posé aucun problème, on a pu discuter sereinement. Je suis issu de la campagne, ma femme est fille de paysans, donc je connais assez bien les problématiques du monde agricole.
« Il faut casser les caricatures des deux côtés : celle de l’agriculteur bourrin, chasseur, viandard et bouffeur d’écolo et celui de la gauche urbaine, donneuse de leçons qui ne comprend rien à rien. »
Mais ces échanges m’ont permis d’apprendre des choses : par exemple, on m’a expliqué que l’agriculture bio nécessitait souvent plus de gazole car sans herbicide, il faut retourner la terre plus souvent. Il existe bien sûr des possibilités pour en consommer moins, mais cela montre en tout cas la nécessité d’écouter les agriculteurs pour changer les méthodes de production. Il faut que la population s’empare de ces sujets et aille discuter avec eux pour mieux se rendre compte de ce qu’est l’agriculture dans notre pays et de ce qu’elle risque de devenir si on laisse faire. Autour de Carbonne, les exploitations font 50 ou 60 hectares, on est loin du Brésil, de l’Australie ou des Etats-Unis, avec des fermes-usines de dizaines de milliers d’hectares. Mais si on ne fait rien, c’est ce modèle qui s’imposera !
Donc oui, j’espère qu’il y aura une convergence des luttes car nous y avons tous intérêt. J’y travaille à mon échelle, par exemple en préparant un grand plan ruralité avec une vingtaine de mes collègues insoumis. Contrairement au plan ruralité d’Elisabeth Borne, qui va investir quelques millions pour ouvrir à peine quelques commerces, nous allons sillonner la France rurale, parler avec les gens et construire un plan de grande ampleur pour ranimer nos campagnes. Il faut y recréer des services publics, éviter de contraindre les gens à faire 50 kilomètres tous les jours pour aller travailler, redonner accès à la culture… Il y a beaucoup à faire, mais nous sommes déterminés et ce mouvement est une très bonne occasion de se pencher sur les problèmes de nos campagnes et d’y apporter des solutions.