Dans le contexte de cette crise sanitaire et économique inédite, il semblerait finalement que l’argent magique soit une solution. Après 40 ans de « gestion monétaire », le grand public redécouvre petit à petit qu’il serait possible et souhaitable de mettre en œuvre une véritable politique monétaire. De fait, que ce soit pour financer un plan de relance économique à la hauteur de cette crise ou pour financer la reconstruction écologique – les deux pouvant et devant être synonymes – la création monétaire s’avère une solution incontournable. Nicolas Dufrêne est haut fonctionnaire et directeur de l’Institut Rousseau. Alain Grandjean est cofondateur de Carbone 4 et président de la Fondation Nicolas Hulot. Ces deux économistes viennent de faire paraître un ouvrage pionnier en France sur la question du financement de la transition écologique grâce à une politique monétaire entièrement repensée, Une monnaie écologique (Ed. Odile Jacob, février 2020). Dans cet entretien, nous avons voulu comprendre un peu mieux ces mécanismes économiques, avoir leur avis sur des thèmes d’actualité, mais également évoquer leurs propositions. Entretien retranscrit par Dany Meyniel et réalisé par Pierre Gilbert.
LVSL – Vous écrivez dans votre ouvrage : « Neutralité carbone et neutralité monétaire ne sont pas compatibles, il faut choisir ». Pouvez-vous nous expliquer cette phrase ?
Alain Grandjean – La planète atteindra la neutralité carbone quand nous émettrons aussi peu de gaz à effet de serre que la biosphère est capable d’absorber du CO2. Cela suppose un changement radical – une reconstruction écologique – de notre mode de consommation et de production. Ce changement ne peut pas être opéré par la seule logique de marché. Dans cette logique, il y a ce que font les acteurs de marché, mais aussi ce que fait la puissance publique, notamment via la politique monétaire. La neutralité monétaire est un dogme selon lequel la politique monétaire serait « neutre », c’est-à-dire sans effet sur l’économie. Ce qu’on cherche à démontrer dans le livre, c’est que cela n’est pas vrai, de la même que le marché tout seul ne peut pas conduire à la neutralité carbone. Les acteurs de marché ne peuvent pas réduire spontanément leurs émissions de gaz à effet de serre, car ils n’ont pas intérêt à le faire. Une politique monétaire soi-disant neutre ne l’est pas, car elle favorise implicitement le modèle actuel qui est un modèle fossile.
Nicolas Dufrêne – Je rajouterais le fait qu’on peut aussi définir la neutralité comme étant une paresse de l’intelligence : Jean Jaurès disait, à propos de l’éducation, que la neutralité était « un oreiller commode pour le sommeil de l’esprit ». Cette formule est tout à fait adaptée à la politique monétaire suivie depuis plus de trente ans, qui consiste précisément à ne pas faire de « politique » monétaire, mais de la « gestion » monétaire. Celle-ci est toute entière tournée vers la lutte contre l’inflation et vers la préservation de la neutralité de marché, ce qui signifie que la politique monétaire cherche à ne surtout pas influencer les formes existantes du marché. Cette neutralité découle elle-même des principes généraux de l’Union européenne et notamment du principe de concurrence libre et non faussée, qui fait qu’on se refuse la possibilité de faire des choix, d’orienter l’économie. Nous avons donc une politique monétaire qui tend à reproduire la structure économique existante et non pas à en modifier les formes ; et cela est totalement incompatible avec la transition écologique.
LVSL – Selon vous, pourquoi la monnaie doit être un bien commun et pas un bien public ? Quelle est la différence ? Est-ce que vous pouvez nous raconter l’histoire du Conseil national du crédit (CNC) issu du programme du CNR (Conseil national de la Résistance) et fondé en 1946 ?
A.G – La monnaie est devenue un commun pour une raison extrêmement simple : depuis la fin de Bretton Woods, la création monétaire est entièrement déconnectée de toute matérialité. Très concrètement, la monnaie est créée ex nihilo par un simple jeu d’écritures. Or cette monnaie, quand elle est dans votre main, a un pouvoir d’achat : créer de la monnaie, c’est donc créer du pouvoir d’achat. De fait, ce pouvoir d’achat est un droit sur un bien : si j’ai un euro, je vais acheter quelque chose qui vaut un euro. La monnaie n’est donc pas le bien, mais ce dit droit d’acheter le bien : c’est un droit fongible. Si c’est un bien privé, cela veut dire qu’on est en train de donner ce droit à des acteurs privés. Dans la grande histoire monétaire, il y avait des périodes où ce n’était ni des biens privés ni des biens publics ou communs, c’étaient des biens tribaux : au Moyen Âge, les seigneurs avaient le droit de seigneuriage et détenaient, de ce fait, un pouvoir considérable. Notre revendication est de dire que le vrai statut politique de la monnaie, c’est le statut de commun.
N.D – Pour compléter sur le Conseil national du crédit, c’est une idée directement issue du programme du CNR qui se matérialisa en 1946 avec pour ambition de faire de ce conseil un véritable « Parlement du crédit et de la monnaie », c’est-à-dire de se donner les moyens de gérer le crédit et la monnaie comme un bien commun. Nous citons dans le livre une belle formule de l’écrivain et poète Jorge Luis Borges qui dit que : « la monnaie est un répertoire de futures possibilités ». Si cela est vrai, alors il n’est pas anormal que la société, les partenaires sociaux, le gouvernement, les syndicats, mais aussi les citoyens soient associés à sa gestion. En conséquence, nous ne devons pas avoir, comme Alain l’a expliqué, uniquement une décision privée qui oriente le crédit en fonction d’un but uniquement lucratif, mais que le crédit et la monnaie puissent aussi être orientés par des décisions communes au profit de l’intérêt général. Ainsi, ce Parlement du crédit et de la monnaie avait cette ambition d’être un outil au service de l’intérêt général par une gouvernance commune associant différents partenaires sociaux et étatiques. Malheureusement, il est rapidement tombé sous la coupe de la Banque de France et a progressivement disparu des radars. Toute la politique monétaire a été confiée à la Banque de France et au Trésor, puis seulement à la Banque de France après la disparition du circuit du Trésor. Pour rappel, le circuit du Trésor permettait à l’État de décider non seulement du montant des emprunts qu’il faisait auprès des banques privées, mais aussi de leurs taux. Il a persisté jusque dans les années 70 avant d’être démantelé. Je renvoie sur tous ces points à l’excellent livre de Benjamin Lemoine L’Ordre de la dette.

LVSL – Pour opérer une reconstruction écologique à hauteur de nos objectifs climatiques, il faudrait chaque année, selon la Cour des comptes européenne, quelques 1 115 milliards d’euros d’investissement pour l’Europe et environ 75 milliards d’euros pour la France. Vous estimez l’effort plus proche de 100 milliards d’euros, en l’élargissant d’autres secteurs comme l’agroécologie et les efforts de circularisation de l’économie. D’un autre côté, entre 2014 et 2019, la BCE a fourni pour plus de 2 600 milliards d’euros de liquidité aux banques à travers sa politique de quantitative easing. Beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’une politique d’extension monétaire alors qu’en fait cet argent ne va pas à l’économie réelle et encore moins dans la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce malentendu ?
A.G. – Le système monétaire est un système à deux étages : au premier étage, banque centrale vers banques secondaires et au deuxième étage, banques secondaires vers ménages et entreprises. La monnaie dont on se sert dans l’économie est la monnaie du deuxième étage, celle qui est créée par les banques secondaires, par exemple, à l’occasion d’un prêt qu’elle nous accorde. Contrairement à la doctrine erronée du multiplicateur monétaire (à ne pas confondre avec le multiplicateur budgétaire), la quantité de monnaie créée dans l’économie n’est pas mécaniquement le multiple de la monnaie centrale créée par la banque centrale en faveur des grands acteurs financiers. Or, quand on parle des milliers de milliards de dollars créés par la Fed ou la BCE, on parle du premier étage. De fait, cette monnaie non seulement ne va pas dans l’économie réelle de manière automatique, mais en outre, elle ne se multiplie pas par miracle dans l’économie réelle. En fait, elle irrigue le bilan des banques et des acteurs financiers. Elle peut même tourner en rond, quand les banques remettent de l’argent sur leur compte à la banque centrale. Ainsi, il y a une distinction extrêmement claire à faire entre cette circulation monétaire-là et la circulation dans l’économie.
Ce que nous proposons et recommandons, c’est le fait qu’on ait de la « vraie » monnaie, celle qui fait de l’échange dans la vie économique, qui soit créée de manière volontariste en contrepartie d’actions qui sont « décarbonantes », plus exactement favorables à la reconstruction écologique. Comme nous venons de le voir, cela ne se fait pas du tout automatiquement par le quantitative easing, c’est-à-dire l’opération qui consiste à abreuver de liquidités le monde bancaire et financier. Cela ne va pas forcément irriguer l’économie réelle, sauf une partie de cette économie réelle qu’on appelle économie immobilière. Lorsque les banques centrales abreuvent de liquidités les banques, celles-ci se refinancent à « pas cher du tout » et ont donc une capacité à prêter de l’argent à très bas taux, soit pour l’immobilier – ce qui a conduit à des hausses de prix –, soit, dans le monde capitaliste qui repose sur la possibilité de pouvoir emprunter à un taux très bas, pour d’autres opérations comme les opérations à effet de levier. Tout ceci n’irrigue pas directement l’économie réelle et ne favorise pas le développement des projets dont on a besoin dans la vie quotidienne.
N.D – Par construction, la banque centrale ne peut interagir qu’avec les banques commerciales et le Trésor public qui sont les seuls à posséder un compte dans ses livres. Elle ne peut pas agir ni avec les entreprises ni avec les particuliers qui ne possèdent pas de compte à la banque centrale. Mais pour des raisons juridiques – et par conséquent idéologiques –, on a interdit à la banque centrale de financer le Trésor même si celui-ci peut toujours lui verser de l’argent, spécialement en période de quantitative easing, pour rembourser les emprunts rachetés par la BCE auprès des marchés financiers (l’interdiction est donc à sens unique : de la banque centrale vers le Trésor).
Par conséquent, ce système emprisonne la capacité d’action de la banque centrale en la dirigeant uniquement vers les banques et donc vers les marchés financiers. En effet, les grandes banques universelles ont désormais plus de la moitié de leur bilan qui est constituée d’opérations financières et d’actifs financiers. Cela veut dire que leur nouveau champ de jeu est désormais bien plus les opérations financières que le crédit à l’économie. C’est beaucoup moins le cas des banques mutualistes, par exemple, qui continuent d’avoir une majeure partie de leur bilan qui est constituée de crédits.
Ce que nous recommandons, c’est donc un canal qui permettrait de faire en sorte que la monnaie créée par la banque centrale vienne directement financer l’économie. Pierre Larrouturou et Jean Jouzel avaient porté, avec le Pacte Finance-Climat, cette idée en disant qu’il fallait orienter les 2 600 milliards d’euros du quantitative easing vers la transition écologique. Malheureusement le mécanisme proposé n’était pas pertinent : ils souhaitent créer une « banque du climat » qui était une banque publique d’investissement un peu comme BPIFrance ou comme la Banque européenne d’investissement. Or, les banques publiques d’investissement n’ont pas le pouvoir de créer des liquidités, car ce pouvoir extraordinaire est réservé à la banque centrale. Donc si on veut vraiment un effort monétaire à la hauteur, il faut qu’on puisse brancher directement la création monétaire de la banque centrale vers les banques publiques d’investissement, vers des agences d’État ou vers des fonds spécialisés, ce que nous interdit, au moins en partie, les règles juridiques qui encadrent la politique monétaire et restreignent son champ.
A.G – Si je peux me permettre d’insister sur un point qui lie cette question à celle des communs. Il y a une chose très paradoxale : on a interdit aux États le bénéfice de ce qu’on appelle couramment la planche à billets – même si ce ne sont plus des billets, mais de la monnaie scripturale – pour des raisons un peu douteuses selon lesquelles les États en feraient nécessairement mauvais usage. En faisant cela, on a déplacé la décision politique d’un gouvernement élu à une technocratie certes très sérieuse, compétente intellectuellement, qui utilise des modèles mathématiques très développés. Il n’empêche que l’idée selon laquelle un gouvernement élu démocratiquement fait un mauvais usage de la monnaie dont il aurait le bénéfice interdit à ce gouvernement d’avoir des marges de manœuvre qu’il aurait s’il avait le bénéfice de la création monétaire et ce pourrait être pour le plus grand bien commun. Évidemment, il faut des contre-feux et des règles pour éviter le clientélisme et les abus, mais est-ce si difficile à faire ? On a institutionnalisé cette interdiction au sein de la construction européenne dans les traités qui sont difficiles à faire bouger. L’un des enjeux clefs, c’est de faire bouger ces lignes.
LVSL – Par ailleurs, la BCE pratique des taux très bas censés favoriser l’investissement au détriment de l’épargne. Pourtant, on observe que plutôt d’investir dans l’économie réelle, les banques utilisent cet argent « peu cher » pour réaliser des opérations plus risquées et donc compenser le fait que les taux soient bas. Selon vous, sans réforme du secteur bancaire, peut-il y avoir une politique monétaire efficace pour financer la transition écologique ?
N.D – La réforme du système bancaire est en route, mais pas dans le sens que l’on pourrait souhaiter. L’union bancaire, l’idée d’unir effectivement les marchés de capitaux et les grandes banques pour avoir des mastodontes qui seraient théoriquement plus résilients par rapport aux chocs financiers sont des principes contestables. En réalité, plus on a de mastodontes et plus le fameux adage « Too big to fail » va devenir une réalité. Cela rend la monnaie, qui est un bien commun pour tous, dépendante de la bonne fortune des banques privées. On a donc une manière de faire qui consiste à associer l’intérêt général de la société sur le plan monétaire à l’intérêt privé des grandes banques.
Maintenant, est-ce qu’on peut développer des mécanismes de financement qui ne dépendent pas directement d’une réforme des banques privées ? La réponse est oui même s’il est préférable d’agir sur les deux volets. Il faudrait en effet renforcer les fonds propres des banques et les exigences de fonds propres pour toutes leurs activités de marché, afin qu’elles prennent moins de risques. Il serait même souhaitable, à terme, de séparer les activités de crédit des activités de marché. Mais même si on ne fait pas cela, on a des leviers pour agir directement, car la politique monétaire ne se résume pas uniquement à la réglementation prudentielle ou aux actions de la banque centrale. On peut, par exemple, augmenter les dotations et les capacités à investir des banques publiques d’investissement, de BPIFrance au niveau national, de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Europe. La France semble d’ailleurs plaider pour une augmentation du capital de la BEI même si, au vu de ses statuts, elle pourrait d’ores et déjà investir près de 150 milliards d’euros supplémentaires et immédiatement par rapport à ce qu’elle fait actuellement. Si l’on met en œuvre la solution que nous recommandons dans le livre qui est de créer un mécanisme de création monétaire ciblé qui partirait de la BCE pour abonder des fonds particuliers ou la BEI, c’est-à-dire un mécanisme qui est totalement indépendant de la réforme des banques privées, on pourrait donc avoir des marges de manœuvre gigantesques ! Mais cela nécessite d’assumer une action de l’État, une action des banques centrales. Or, dans le contexte d’indépendance de ces dernières, c’est plus difficile à faire.
LVSL – La décarbonation du PIB fait débat chez les économistes. Le rapport Canfin-Grandjean dit qu’il faut réduire d’un facteur dix l’intensité carbone du PIB pour rester dans les cordes de l’Accord de Paris ; et vous expliquez qu’en 1980, il fallait 122 tonnes équivalent pétrole d’énergie pour un million d’euros de PIB produit et qu’en 2012, il n’en fallait plus que 85 soit une amélioration de 30 %. On est loin du compte, mais vous parlez du taux d’émission de gaz à effet de serre par million d’euros produit et non pas par point de PIB. Or, on produit aujourd’hui beaucoup plus de millions par point de PIB qu’avant puisqu’entre-temps, on a eu de la croissance. N’est-ce pas là une sorte d’effet rebond qui invalide vos dires sur la décarbonation du PIB ?
A.G – C’est le débat sur ce qu’on appelle le découplage. On a besoin d’une baisse en absolu des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial (car l’atmosphère ne réagit qu’à ces émissions et pas au PIB !). Une partie des analystes disent qu’on n’y arrivera pas sans une baisse du PIB parce que celui-ci est grosso modo approximé par la quantité d’énergie consommée, elle-même proportionnelle à la « matérialité » de notre économie. Comme l’énergie est à 80 % d’origine fossile, il est clair, selon ce point de vue, que, si on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre, il faut baisser cette « matérialité ».
C’est un point de vue que je ne partage pas complètement, même si je suis d’accord sur la vision suivante : nous ne sommes pas du tout sur la route qui nous permettrait d’avoir le découplage absolu, c’est-à-dire la baisse des émissions de gaz à effet de serre avec un PIB croissant. Mais cela ne veut pas dire que ce soit si évident que cela qu’on ne puisse pas y arriver dans les décennies qui viennent. De fait, je suis un petit peu plus optimiste que la vision « décroissantiste ». Ce qui m’intéresse, ce n’est pas le PIB, c’est la satisfaction des uns et des autres ; et je ne suis pas très sûr que, dans les pays développés, nous soyons plus heureux parce qu’on a quinze pulls plutôt que quatorze. À un moment donné, le monde sera sur un mode décroissant matériellement, ce qui ne veut pas nécessairement dire un PIB décroissant. Par ailleurs, le PIB n’est en aucun cas un bon indicateur sur l’idée qu’il faudrait être matériellement plus riche pour être plus heureux.
Le premier vrai débat est celui des inégalités sociales et la question de savoir si on peut les réduire sans que cela se traduise par une augmentation totale de la consommation matérielle, car il y a des gens très pauvres, même dans notre pays, qui ont faim et qui ont froid. Le deuxième vrai débat, c’est le contenu en carbone et en énergie des services et des biens qui sont vendus. Je ne vois pas pourquoi ce serait une fatalité absolue que leur contenu en carbone et en énergie ne baisse pas rapidement. Du point de vue d’un industriel dans notre système économique, si l’énergie et le carbone ne coûtent rien, il ne va pas faire d’effort pour en réduire l’usage. Sauf si l’on est dans un plan Marshall, dans un Green Deal et que des dispositions publiques sont prises concrètement, telles que des interdictions programmées ou une fiscalité très incitative comme, par exemple, l’interdiction de fabriquer des voitures à moteur thermique dans quelques années, de faire des chaudières et ainsi de suite. Contrairement à ce que l’on croit souvent, l’innovation est toujours fille de la contrainte.
Faire des raisonnements prospectifs, par rapport à l’analyse historique qui, elle-même, s’appuie sur une histoire dans laquelle c’était « la fête » et où on pouvait se gaver d’énergie sans que cela ne coûte rien, est erroné. C’est une induction qui est fausse sur le plan logique et théorique. Pour passer d’un monde dans lequel l’énergie, les contraintes d’environnement, l’aspect poubelle, l’aspect pollution ne sont pas des problèmes à un monde dans lequel ce sont des problèmes, il faut que les signaux élémentaires, les signaux-prix, soient beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui. On peut donc décarboner l’économie, on peut la rendre beaucoup plus propre si nos machines deviennent plus propres et cessent de se gaver d’énergies fossiles. Mais tout cela est quand même une révolution industrielle et économique assez forte.
N.D – L’I4CE a montré qu’on avait 73 milliards d’euros par an d’investissement dans les activités polluantes au sens large en France. Si nous recommandons quelque chose de l’ordre – il n’y a pas de chiffre absolu en la matière – de 100 milliards d’euros, on voit bien que même d’un strict point de vue comptable, si on enlève l’investissement par rapport au désinvestissement qui est nécessaire, cela peut être positif. Nous ne croyons pas à cette idée que l’on fera plus d’écologie dans un appauvrissement généralisé où les ménages n’auront pas les moyens de changer leur voiture pour une voiture plus propre, de se loger dans des appartements ou maisons mieux isolés, et dans lequel l’État n’aura pas assez investi dans des transports en commun. Cela ne veut pas dire, évidemment, qu’il n’y a pas d’autres activités comme le transport aérien et le routier qui doivent décroître en parallèle.
LVSL – Pour vous, le PIB est un outil qui in fine est utilisé comme boussole : vous évoquez les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et les 98 indicateurs qui servent à les évaluer en France. Pourrait-on, selon vous, imaginer que les ODD deviennent une nouvelle boussole ? Comment fait-on pour faire basculer sur autre chose que le PIB ? L’indicateur n’est-il pas finalement – comme la monnaie – une construction sociale qui n’a de valeur que dans la confiance qu’on lui confère ?
A.G – Sur la question des indicateurs, ceux des ODD sont trop nombreux : on ne dirige pas avec des centaines d’indicateurs. Il y a la loi Eva Sas en France qui a produit une dizaine d’indicateurs de synthèse qui sont documentés chaque année par un rapport du gouvernement. Ce n’est pas si mal, mais cela ne sert à rien aujourd’hui, non pas que les indicateurs soient mauvais ou que cette loi soit mauvaise, c’est juste que ce n’est pas incarné politiquement. Par conséquent, la priorité est que le gouvernement rende compte de son action avec ces indicateurs qui sont de l’ordre de ceux qui concernent les inégalités, la pauvreté et la précarité, de ceux qui concernent l’écologie, le taux d’emploi puis la manière dont les entreprises réussissent à se débrouiller dans le monde. Je ne crois pas du tout qu’il faille un consensus international pour arriver à faire cela – des pays ont décidé de travailler avec d’autres indicateurs, à l’instar de la Nouvelle-Zélande. Il y a donc besoin qu’on soit élu sur un programme matérialisé par des objectifs. Le PIB sert à quelque chose, il a une fonctionnalité instrumentale, l’INSEE fait son travail de manière convenable, on a besoin de statisticiens. Mais le PIB n’est pas un indicateur de progrès social, ni même d’emplois.
N.D – Il est vrai que le PIB ne mesure pas toute une série de choses, il ne mesure pas le capital naturel, les dommages faits à l’environnement, le progrès social, l’espérance de vie, etc. Robert Kennedy disait que « le PIB mesure tout sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue ». Mais le PIB est une mesure monétaire ; et on constate qu’il y a une corrélation étroite de tout temps et en tout lieu entre l’évolution de la masse monétaire et l’évolution du PIB. Cela est tout à fait normal parce que la quantité de monnaie qui est disponible dans une société permet la réalisation des plus-values et des échanges. C’est pour cela que les économistes suivent très étroitement l’évolution du crédit : si le crédit s’effondre, cela veut dire qu’il y a moins de création monétaire et que la récession n’est pas loin. Il faut donc garder le PIB juste pour cet aspect-là. Néanmoins, cela ne suffit absolument pas et il faut le croiser avec d’autres indicateurs, surtout dans une optique de développement durable.

LVSL – Vous plaidez pour que l’État se finance par la création monétaire plutôt que la dette, du moins en grande partie. Si nous avions fait cela, notre dette aurait été de seulement 30 % et non pas de plus de 90 % du PIB comme c’est la cas aujourd’hui. Vous montrez également que notre taux d’endettement explose alors que la croissance stagne. Est-ce là, selon vous, un syndrome de la baisse tendancielle du taux de profit pour cause de surproduction comme le théorisait Marx ?
A.G. – Je ne crois pas. Je l’avais déjà dit dans un livre écrit avec Gabriel Galand en 1997, il y a deux grands mécanismes de création monétaire : ce que nous avions appelé à l’époque « la monnaie d’endettement », celle massivement créée en contrepartie de l’endettement et dont l’augmentation de l’endettement est une conséquence mécanique de cette logique-là. La deuxième grande méthode pour créer de la monnaie, c’est ce qu’on a appelé « la monnaie libre » : elle peut être créée directement et sans contrepartie d’endettement. Le raisonnement qui permet de démontrer que la dette publique pourrait être à 30 % du PIB au lieu de 90 % résulte du fait que, si l’on avait créé de la monnaie sans intérêt, il n’y aurait pas eu à payer des intérêts. Or, comme les taux d’intérêt font boule de neige, à la fin de l’histoire, la dette s’accroît. L’effet boule de neige fait que le stock de dettes et les intérêts augmentent en permanence quand le taux d’intérêt est supérieur au taux d’inflation et de croissance. Dans cette situation, le besoin financier « réel » s’accroît sans arrêt. Pour ma part, je crois beaucoup plus à cette théorie qu’à la théorie de Karl Marx, car elle explique de manière extrêmement simple l’augmentation de l’endettement. Précisons que nous ne sommes pas en train de parler des dettes et créances entre particuliers ou entre une institution financière non bancaire et une entreprise. Nous parlons des mécanismes de création monétaire qui sont une partie de l’endettement qui pourrait être résorbée de cette manière-là. Cela explique extrêmement bien la problématique de l’endettement dans lequel on est.
N.D – On a déjà des cas de monnaie libre, c’est-à-dire sans endettement associé, par exemple lorsqu’une entreprise ou un ménage fait faillite, cela signifie qu’ils ne remboursent pas leurs dettes et que la monnaie qui a été créée au moment du crédit n’est pas remboursée. Elle continue alors de circuler dans la sphère économique. La création monétaire est prise entre deux flux : un flux de création, lors du crédit, que vient annuler un flux de destruction, lors du remboursement, et c’est cela qui nous pose problème. Dans toutes les explications sur le niveau des dettes publiques, on parle des diminutions d’impôts des plus riches, on parle du financement des services publics, on parle de toute une série de choses, mais on ne parle pas du mécanisme premier qui est la création monétaire qui entraîne la dette. C’est donc pour cela que nous proposons cette idée de la monnaie libre. Cela dit, si on tient vraiment à respecter les formes actuelles, à savoir le fait qu’une création monétaire entraîne une dette, il y a un moyen de faire qui est tout à fait indolore : permettre à la banque centrale d’accorder des crédits sur des durées tellement longues et à des taux tellement bas que cela s’apparenterait quasiment à un don d’argent. Dans ce cas-là, on ne recourt pas techniquement à de la création monétaire libre, mais bien à un prêt « préférentiel ». Or, ce type de prêts est malheureusement impossible pour l’instant parce que la BCE ou les banques publiques d’investissement doivent intervenir à des « conditions de marché ». Toutefois, le marché ne voit pas au-delà d’une certaine durée : il est aveugle à nos besoins et investissements de long terme. Ainsi, ce que nous proposons de faire, c’est de créer des mécanismes qui remédient radicalement à la fois à cette augmentation tendancielle de la dette et à la myopie du marché sur les enjeux de long terme, au premier rang desquels on retrouve la reconstruction écologique. Non seulement il y a une incertitude radicale sur le long terme, mais il y a, en outre, un besoin de financer un grand nombre de choses qui ne sont pas directement rentables et pour lesquelles le marché ne peut pas faire efficacement le job sans soutien public. Ensuite, il existe plusieurs techniques pour le faire.
LVSL – Pour les partisans de la Modern Monetary Theory que vous êtes, un État ne peut jamais faire faillite tant qu’il dispose de sa planche à billets : il peut toujours se financer par création monétaire. Vous dites néanmoins qu’il existe une limite à cette réflexion : avoir une partie de sa dette dans une monnaie étrangère. Mais en Europe, avec l’euro, la question ne se pose pas, la plupart de nos dettes sont en euros et, pour le reste, on peut très bien imaginer que l’on rachète des titres de dette en dollars avec nos euros… Comment vous appréhendez ce problème ? Est-ce que ça peut être en deux temps, c’est-à-dire d’abord une monétisation ou un effacement des titres de dette en euros puis une politique monétaire expansionniste ?
A.G – Je n’ai jamais dit, à titre personnel, que j’étais à 100 % d’accord avec la MMT. Il y a une partie de la question de la MMT avec laquelle on est assez à l’aise et une partie dont on n’a pas envie de discuter. C’est un point de doctrine notamment sur la garantie de l’emploi et sur l’histoire qu’un État ne peut pas faire faillite, c’est aussi un débat (le Liban fait faillite aujourd’hui). En tout cas, ce qui est essentiel, c’est qu’il ne faut pas confondre deux situations dans lesquelles la « planche à billets » a des possibilités très différentes. Par exemple, l’Europe est une zone assez autonome. Ce n’est pas la même histoire quand vous êtes dans un pays qui a une très forte dépendance extérieure, où vous faites les achats en devises, vous ne les faites pas avec votre monnaie (sauf si celle-ci est acceptée de manière inconditionnelle par le tiers, mais il n’y a que le dollar qui a cette position). Il y a une contrainte extérieure qui existe, qui est réelle et qui tempère le pouvoir de l’arme monétaire dans un pays qui dépend fortement de l’extérieur. Ce lien très fort entre la réduction des consommations d’énergies fossiles, le Green Deal et la politique monétaire est vraiment important à souligner parce que, si on réduit fortement la consommation d’énergies fossiles, on réduit fortement nos importations. Ces importations sont faites de plusieurs acteurs, mais la part énergétique dans la balance commerciale (européenne, mais aussi française) est extrêmement importante.
LVSL – Quarante milliards de déficits commerciaux liés au pétrole.
A.G – En France. Mais en Europe, le montant est beaucoup plus élevé. On souligne juste le point que, selon le degré d’ouverture et de contrainte au sens très strict du terme, l’outil monétaire ne fonctionne pas de la même manière ; et pour nuancer la question de l’inflation, je ne crois pas à l’idée selon laquelle on va pouvoir à tour de bras acheter des biens et des services hors zone euro. Je suis beaucoup plus à l’aise avec l’idée – très naïve – que l’Europe est une très grande zone économique qui laisse son marché s’ouvrir aux quatre vents des intérêts et des appétits des compétiteurs. On ferait bien de réindustrialiser la zone euro et, sans vouloir être autarciques à 100 %, devenir beaucoup plus indépendants de notre destin. Dans ce cas-là, si on associe un programme d’investissement intelligent avec une réindustrialisation « verte » et une baisse de notre dépendance aux énergies fossiles, les marges de manœuvre de l’outil monétaire sont exceptionnelles.
N.D – Il y a plusieurs dimensions dans la MMT et il est vrai que la question de la garantie de l’emploi n’est pas si simple, on préfère ne pas en parler dans le livre. Sur l’aspect monétaire, il y a des choses plus intéressantes et dans lesquelles on se retrouve plus, notamment l’idée de base de la MMT qui est d’affirmer que ce que va dépenser le secteur public – entendu au sens large (État et Banque Centrale) –, c’est ce qui crée, par un jeu de vase communicant, une partie substantielle des excédents du secteur privé. C’est mécanique. La MMT ne fait que rappeler cette évidence-là que beaucoup de gens contestent : d’où l’échec hier, aujourd’hui et demain de toutes les politiques d’austérité qui conduisent à comprimer toujours plus la part de dépenses du secteur public et qui réduisent donc les excédents du secteur privé dans un cercle vicieux infernal. C’est la première chose. La deuxième, c’est qu’il est clair que, pour des pays qui ont une monnaie très internationalisée et puissante comme les États-Unis, il n’y a pas vraiment de contrainte extérieure, mais pour des pays comme le Liban, le Venezuela, l’Algérie, etc. qui sont très endettés en devises étrangères, en dollars ou en euros, la contrainte n’est pas la même. S’ils se mettent à faire tourner la planche à billets excessivement, ils risquent des attaques spéculatives sur leur monnaie. En outre, ils risquent une inflation importée massive, car si la valeur de leur monnaie s’effondre, cela veut dire que tout ce qu’ils vont acheter à l’extérieur va leur coûter beaucoup plus cher. Une des réponses monétaires qu’on peut avoir est de mettre en œuvre des mécanismes de création monétaire ciblés pour diminuer notre dépendance aux importations. L’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran, avec qui on partage un même constat sur la nécessité de créer de la monnaie libre, a récemment proposé dans une note de l’Institut Veblen d’installer un « drone monétaire » qui distribuerait de la monnaie aux citoyens. Une des limites de cette idée est justement que cela pourrait nous conduire à importer encore plus et que ça ne contribuerait pas à modifier les formes de l’activité économique. D’où notre insistance sur des mécanismes de création monétaire qui soient ciblés pour la réindustrialisation verte, pour diminuer la dépendance aux exportations et pour financer ce qui n’est pas délocalisable.
A.G – J’ai toujours poussé le « Green QE » plutôt que le « QE for people » parce que, quand ce dernier considère qu’on doit financer un revenu universel payé par la Banque Centrale, je trouve cela dangereux pour les raisons que vient d’exposer Nicolas. Mais on peut proposer des solutions mixtes si les montants sont raisonnables et que cela permette de donner aux citoyens un coussin de sécurité, sous réserve qu’on arrive à régler les problèmes d’intendance (chacun d’entre nous n’a pas son compte à la Banque Centrale). Mais s’il s’agissait de montants importants et réguliers, je suis persuadé que cela ne marchera pas pour toutes les raisons que nous vous avons expliquées.
LVSL – Vous dites que la création monétaire n’est pas forcément inflationniste quand elle est canalisée dans des secteurs précis. Par ailleurs, vous citez Gaël Giraud qui dit : « si la planche à billets était toujours et partout inflationniste, il faudrait fermer toutes les banques privées du monde demain matin. ». De fait, les banques privées créent indirectement de la monnaie lorsqu’elles prêtent des sommes qu’elles n’ont pas en dépôt et qu’elles récupèrent dessus un intérêt. Pouvez-vous nous expliquer une bonne fois pour toutes qu’il n’y a pas forcément de lien entre inflation et relance économique et monétaire ?
A.G – Les banques créent de la monnaie directement. C’est très précis : au moment où l’un de nous va à la banque pour bénéficier d’un prêt, la banque crée de l’argent ex nihilo et, quand on le rembourse, elle le détruit. Elle le fait aussi quand elle achète des actifs et quand elle paye ses propres salariés. Ce n’est donc pas de l’ordre de l’idéologie, c’est factuel, empirique. En revanche, l’idée reçue selon laquelle il n’y aurait de l’inflation que par augmentation de la masse monétaire n’est pas empirique. Elle ne repose sur rien sauf qu’elle a été plaidée par des économistes reconnus. Mais en dehors de cela, il n’y a pas de preuve de ce lien-là. Au contraire, les banques privées n’ont cessé de créer de la monnaie, sans limitation réelle, mais on a une période extrêmement longue d’une inflation très basse depuis vingt ans. La cause principale de la hausse des prix à partir de 1973, c’était l’inflation importée par l’augmentation du prix du pétrole, c’est très simple. Ce n’est en rien un phénomène monétaire.
N.D – Il faut d’abord dire que l’inflation a des définitions et des paramètres variables, ce qui ne facilite pas les choses, qu’a priori le prix des actifs financiers n’est pas inclus dans l’inflation et les prix de l’immobilier y sont en partie, mais pas totalement. Ensuite, tout dépend de la destination de la masse monétaire, et il est extrêmement important de le comprendre. On peut avoir, et c’est ce qu’on a eu ces dernières années, une très forte création monétaire qui est orientée sur les marchés financiers et, dans ce cas-là, on aura une explosion du prix des actifs financiers, mais aucune inflation dans le reste de l’économie. En revanche, si l’on établit, comme on le recommande, un mécanisme de création monétaire ciblé pour financer la transition écologique, on peut très bien obtenir à l’inverse des baisses de prix. Un afflux de monnaie dans un secteur précis peut entraîner des baisses considérables de prix contrairement à ce que la théorie de l’offre et de la demande nous dit : c’est ce qui s’est passé dans le domaine des nouvelles technologies. Plus l’argent a afflué dans le secteur des nouvelles technologies à partir des années 2000 – et même à partir de la bulle et bien que celle-ci ait explosé –, plus il y a eu d’argent investi dans ce domaine, plus les process de fabrication étaient efficaces et plus les prix de l’informatique ou de la téléphonie se sont effondrés. En réalité, le lien entre augmentation de la masse monétaire et des prix est extrêmement complexe : il ne dépend pas que du volume mais aussi et surtout de l’allocation de la monnaie créée.
Il y a aussi un autre point sur lequel la MMT nous dit quelque chose d’intéressant, à savoir que la fiscalité peut de toute façon nous permettre de réguler l’inflation. La politique monétaire et la politique budgétaire doivent être pensées ensemble, mais aussi avec la politique fiscale. En effet, si l’on créait trop de monnaie, l’État aurait toujours la capacité de le retirer du système économique à travers la fiscalité. C’est une autre conception de la fiscalité qui est de dire qu’elle ne sert pas prioritairement comme moyen de financement de l’État, mais aussi comme un moyen de régulation de la masse monétaire dans l’économie. Aujourd’hui, toutes les Banques Centrales ont fondé leur doctrine de lutte contre l’inflation, notamment sur la fameuse courbe de Phillips qui nous oblige à faire le choix entre le développement de l’activité économique et de l’emploi et l’inflation. De fait, nous refusons ce choix et nous disons qu’il n’est ni raisonnable ni pertinent. On peut fort bien développer des moyens de stimuler l’emploi, la production et le développement de l’industrialisation verte et en même temps contenir l’inflation par toute une série de dispositifs budgétaires, fiscaux ou tout simplement de régulation des prix.
A.G – Je rajoute qu’il y a une caricature de l’usage de la création monétaire qui est toujours la même : regardez le Zimbabwe, regardez l’Allemagne des années 20, le Venezuela, etc. Nous n’avons donc jamais évidemment recommandé de faire tout et n’importe quoi. Nous plaidons cet usage pour des pays bien organisés et structurés. Quand on parle de parlement, ce n’est pas pour rien, c’est pour insister sur le fait que les mécanismes doivent être transparents, discutés, contrôlés. Concernant la crise majeure de Weimar, la réparation de guerre était impayable, la République était toute jeune et s’est retrouvée dans une situation économiquement impossible. Dans un pays qui est structuré et démocratique avec un droit de vote établi, les citoyens n’ont aucune envie d’une hyperinflation. Ce n’est pas du tout un souhait démocratique ; ce qui est l’est, c’est peut-être avoir 3 ou 4 % d’inflation, et ce ne serait certainement pas un problème. On pourrait même le faire voter. Mais dès qu’on commencerait à avoir une inflation plus élevée, les épargnants se mettraient à considérer que l’on est en train de détruire leur épargne et, immanquablement, les rapports de force s’installeraient.
LVSL – Vous pointez dans votre ouvrage ce moment mal connu de l’histoire allemande où le pays résorbe ses dettes de la Seconde Guerre mondiale, en quelques années seulement (cinq ans), grâce à l’inflation. La dette passe alors de 200 % à 30 % du PIB. Un comble puisque aujourd’hui l’Allemagne est un facteur majeur de blocage quant au projet d’une politique d’expansion monétaire européenne. On le voit d’ailleurs actuellement dans la gestion de la crise du coronavirus où la CDU, la CSU, mais aussi le SPD bloquent systématiquement toute proposition de relance économique ambitieuse. Les tenants des retraites par capitalisation ont peur de voir leur valeur chuter et, par ailleurs, le régime allemand est bâti sur un système de coalition stable qui ne semble pas près de changer. Comment est-ce que vous appréhendez ce problème majeur ?
A.G – L’histoire de l’Allemagne est compliquée avec des périodes très différentes les unes des autres. Il y a la période Weimar, période hyperinflationniste qui est résolue par le changement de monnaie organisé par Hjalmar Schacht. Il y a un épisode monétaire particulier qui est le début des années 30, après la période de récession – au départ issue de la crise de 1929 née aux États-Unis, mais aggravée en Allemagne par la politique de rigueur d’Heinrich Brüning. Après la prise de pouvoir par Hitler, le même Hjalmar Schacht crée une monnaie complémentaire, le MEFO, qui permet précisément à l’Allemagne de se passer d’un financement extérieur. Pour Schacht, le reichsmark n’était pas une monnaie très forte, très demandée et il aurait échoué à financer le programme de reconstruction qui avait été lancé. C’est avec des Mefos, monnaie quasi fiscale, que les entrepreneurs sont payés quand ils répondent à une commande publique. Ça, c’est le deuxième épisode. Le troisième épisode est celui de l’après-guerre avec le plan Marshall. Il a alors été décidé de solder une partie de la dette de guerre allemande pour faciliter la reconstruction allemande et pour apurer le passé et sortir de cette période atroce. Quelques années plus tard, il y a la naissance du Deutsche Mark et ses nouvelles bases sont fondées sur cette histoire très complexe. Les Allemands ont vécu un excès de concentration du pouvoir monétaire avec la période nazie, ils ont aussi connu aussi la période de Weimar (les brouettes de billets) qui n’est en rien à l’origine de la dépression et de l’arrivée au pouvoir d’Hitler, laquelle est vraiment due à la crise de 1929 et à la cure d’austérité profondément stupide de Brüning. Rationnellement, ce sont des épisodes distincts, mais dans l’inconscient et la mémoire allemande tout se mélange et cela rend ce peuple très attaché à la séparation du pouvoir politique et du pouvoir monétaire.
C’est pour cela qu’ils ont souhaité institutionnaliser l’indépendance entre les États et la Banque centrale. Dans les locaux de la Bundesbank est écrit en grand un extrait de l’acte II de Faust ! L’ordolibéralisme allemand s’appuie sur cette doctrine monétaire, et pense que des règles peuvent permettre d’organiser une vie économique et efficace. Cela marche bien pour l’Allemagne quand elle est puissante, mais depuis quelques années, cela marche moins bien. C’est pourquoi je ne suis pas d’accord avec l’idée selon laquelle l’Allemagne est bloquée définitivement sur son programme idéologique. Dans les années qui viennent, la récession avec les difficultés de l’industrie automobile, la sortie du charbon, cela ne va pas être si facile que ça. Cette forme d’arrogance qui consisterait à dire, « vous voyez, on a tout réussi, notre économie marche et vous devriez suivre notre modèle », ne va pas durer éternellement. Ensuite, comme on l’a dit, il y a des actions que l’État français peut faire tout seul notamment sur ses banques publiques, on a parlé de la BPI mais on peut également parler des banques publiques, la Banque Postale étant une banque publique jusqu’à preuve du contraire. L’État a donc une certaine marge de manœuvre. Enfin, on a bien vu que la BCE, quand Mario Draghi était à la manœuvre, n’a pas obéi à la thèse du banquier central allemand. Dans le rapport de force au sein du gouvernement du groupe des gouverneurs de la banque centrale, c’est plus compliqué. Il y a des marges de manœuvre qui peuvent se discuter.
N.D – Il y a deux choses sur l’Allemagne qui me semblent importantes. La première, c’est qu’après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a bénéficié d’un haircut, c’est-à-dire d’une annulation pure et simple de près de 60 % de son immense dette. Ce qu’ils refusent donc de faire pour la Grèce, et pour tous les pays endettés actuellement, c’est ce qui leur a permis, après la guerre, de rebâtir une puissance industrielle de premier plan. Le deuxième point est qu’ils ont aussi bénéficié de ce contre quoi ils luttent aujourd’hui : l’inflation. C’est grâce à l’inflation qu’ils se sont débarrassés d’un montant de dette publique astronomique, bien plus élevé en pourcentage de la richesse nationale que ce que l’on connaît aujourd’hui. Les monétaristes ne comprennent pas et ne prennent jamais en compte que l’inflation a toujours un effet positif sur les dettes publiques en raison d’un mécanisme tout simple : les prix augmentent donc les taxes proportionnelles à ces prix augmentent alors que la valeur nominale des dettes, elle, reste stable. Ainsi, l’inflation est toujours positive pour les dettes publiques parce qu’elle s’accompagne d’une augmentation du revenu public. Ça peut aussi être positif pour les agents privés, notamment dans certaines situations où ceux-ci sont, par exemple, très endettés. Il ne faut pas oublier qu’à la fin des années 20, la période de Weimar a coïncidé avec une période où les grands groupes allemands pouvaient emprunter de l’argent et le rembourser deux mois après dans une monnaie complètement dévaluée pour financer leurs investissements. L’inflation a permis aux entreprises allemandes des années 20 de s’endetter quasiment gratuitement et donc de financer leurs investissements plus facilement. Cela a en revanche été évidemment désastreux pour les fonctionnaires, les retraités, pour les petits épargnants qui eux, n’avaient pas des revenus qui évoluaient avec les prix.
C’est pour cette raison qu’il faut trouver un mix, un niveau d’inflation qui soit acceptable pour tout le monde, mais il ne faut surtout pas garder en tête que l’inflation est toujours un phénomène désastreux. C’est un phénomène qui peut être extrêmement positif sur le niveau des dettes privées et publiques et dont l’impact doit être équitablement réparti entre les citoyens. En ce qui concerne l’Allemagne contemporaine, toute l’économie allemande a été basée sur la modération salariale et sur l’export. Ces deux modèles-là sont aujourd’hui battus en brèche de plein fouet. L’export s’effondre encore plus actuellement avec la crise du coronavirus et, puisque les autres pays ne pouvaient plus augmenter leurs salaires et donc continuer à importer, sans compter ce qui annulait une partie des gains de compétitivité allemande, la modération salariale ne marchait déjà plus avant.
Le modèle allemand n’est donc pas durable et il est très vulnérable aux chocs mondiaux et externes. C’est un modèle qui va être mis en échec par les soubresauts de la mondialisation. Ainsi, il n’y a pas d’autre solution pour l’Allemagne que de redévelopper de l’investissement public, de remettre des gens à l’emploi, de diversifier son industrie pour retrouver un peu plus de compétitivité sur d’autres domaines que l’automobile, les machines-outils et la chimie. On ne comprend pas pourquoi l’Allemagne ne décide pas d’investir aujourd’hui dans un contexte où les taux d’intérêt sont inférieurs aux taux de croissance, ce qui signifie mécaniquement un endettement gratuit. Il faut attendre le coronavirus pour voir qu’Angela Merkel est prête à renoncer à un certain nombre de dogmes, notamment au dogme zéro déficit, et lancer un grand plan de relance.

LVSL – Pour les élections municipales, il a été beaucoup question de mise en place de monnaies locales. Pourtant, il y a très peu d’exemples probants. Selon vous, est-ce une bonne piste ?
N.D – Il faut comprendre comment les monnaies locales fonctionnent car beaucoup de gens se trompent sur ce sujet. Les monnaies locales ne sont pas une autre forme de monnaie puisque, comme cela a été confirmé par la loi consommation de 2014 dite « loi Hamon », il est écrit dans la loi qu’une unité de monnaie locale ne peut être obtenue qu’en échange d’une unité de monnaie officielle, c’est-à-dire l’euro. Donc, si à Toulouse, on veut obtenir cent unités de la monnaie locale, le Sol Violette, il faut avant tout déposer cent euros dans le compte bancaire de la collectivité ou de l’association qui propose cette monnaie locale. Quels sont les avantages ? Premièrement, un point très important qui est que, quand on obtient cent unités de monnaie locale, cela veut dire qu’on retire cent unités en euros de la circulation monétaire immédiate même si, par la suite, cette somme peut être investie dans un fonds qui, par exemple, investit dans des entreprises locales. L’autre avantage, c’est d’avoir une sphère de circulation locale qu’on maîtrise, qui permet de faire des achats dans un certain périmètre territorial et, ce faisant, tout cela accélère théoriquement la circulation monétaire. Cela veut dire qu’une unité monétaire va être utilisée plus de fois sur le territoire en question ; et une unité monétaire qui circule plus vite, c’est comme si on avait plus d’unités monétaires et qu’on augmentait la masse monétaire temporairement sur un territoire donné. Cela permet de stimuler l’activité d’une manière qui peut être écologique et responsable, parce qu’on peut aussi cibler les emplois, les entreprises ou les commerces qui peuvent recevoir cette monnaie. On peut, par exemple, interdire que cette monnaie serve à financer des énergies fossiles, à financer de l’agriculture intensive non respectueuse de l’environnement et donc cela peut avoir un sens citoyen. Pour toutes ces raisons, les monnaies locales peuvent avoir un grand intérêt : elles peuvent accélérer la circulation monétaire sur un territoire et redonner du sens à l’utilisation collective de la monnaie. Mais il ne faut surtout pas se tromper et attendre d’elles ce qu’elles ne peuvent pas donner comme un grand plan de relance économique, un plan de réindustrialisation vert ou de décarbonation. Pour ce type-là de grands projets de reconstruction écologique, il faut faire intervenir des mécanismes nationaux et internationaux de création monétaire et d’investissement. Les monnaies locales ne peuvent pas faire augmenter la masse monétaire, et encore moins sans endettement. Or c’est cela que nous prônons pour la reconstruction écologique.
LVSL – Le coronavirus est une sorte de catalyseur pour le fameux moment Minsky où on se rend compte que les dettes des acteurs privés ne sont pas solvables, car la situation économique est atone. Les PME, les auto-entrepreneurs, les grandes entreprises sont en difficulté. Le virus a déclenché une crise financière et il précipite plusieurs pays européens dans la récession. On imagine la suite : les États sont contraints de faire de la relance budgétaire et de s’endetter, et il en découlera une cure de rigueur qui provoquera potentiellement une autre crise, à moins que des changements politiques institutionnels aient entretemps eu lieu. Êtes-vous d’accord avec ce constat et pensez-vous qu’il s’ensuivra un moment propice pour le thème de la création monétaire et pourquoi ?
N.D – D’une manière ou d’une autre, aujourd’hui ou demain, et le plus tôt sera le mieux, ma conviction personnelle est qu’on en viendra à un moment où des mécanismes de création monétaire libre et d’injections monétaires directement dans l’économie deviendront absolument incontournables. Ce sera le seul moyen de surmonter le piège intrinsèque au système monétaire actuel qui associe la création monétaire à la dette privée ou publique. À un moment, il faudra rompre ce cercle vicieux parce que les niveaux de dette seront trop importants et que cela étouffera l’économie. On se retrouve d’ores et déjà dans cette situation avec le Covid-19 où les chaînes de création de valeurs internationales se brisent, ce qui va entraîner des difficultés d’approvisionnement, des hausses de coût, et de nombreuses restructurations d’entreprises. On est aussi dans une séquence où il y a moins de fréquentations des lieux commerciaux, des lieux publics et des commerces ce qui va restreindre la marge financière d’un grand nombre d’entreprises ; et tout cela intervient dans une situation où la dette des entreprises au niveau mondial n’a jamais été aussi élevée, soit plus de 70 000 milliards de dollars de dette des entreprises privées uniquement (hors secteur financier).
Quand on fait intervenir un grave choc d’offre et de demande dans un tel contexte, cela entraînera inévitablement un grand nombre de faillites, des licenciements et donc des baisses de revenu. Est-ce qu’on va se diriger vers le chaos décrit dans votre question ? Je ne l’espère pas. Les États se montrent prêts à venir en aide aux entreprises et aux salariés. L’Italie a mis en place un dispositif pour suspendre temporairement le remboursement des dettes privées et notamment des crédits immobiliers. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a beaucoup de choses à faire pour éviter la catastrophe. Au niveau budgétaire, au niveau monétaire, il y a des réponses possibles : des baisses d’impôt, des crédits d’impôt, des mécanismes de soutien aux entreprises, des mécanismes d’extension, de chômage partiel qui consistent à dire qu’au lieu de licencier les gens, la collectivité subventionne pendant un temps la baisse de la durée travaillée en échange du maintien du salaire et donc du maintien de la consommation et de l’emploi. On a aussi ce type de dispositifs en France, mais ils ne sont pas assez développés par rapport à l’Allemagne. Plusieurs économistes ont alerté sur ce point depuis des années. Ainsi, ce qu’on peut souhaiter, c’est que les États mettront en place l’ensemble de ces m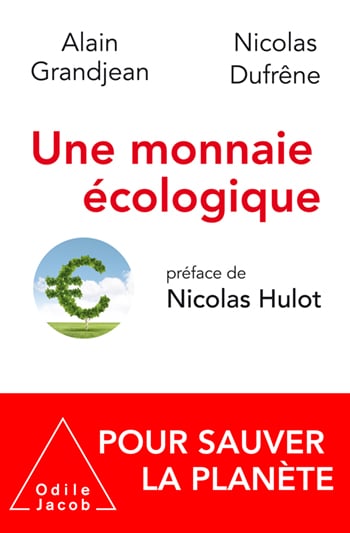 écanismes sans regarder à la dépense. Peut-être même que, si on en arrive à ce type de mesures exceptionnelles pour lutter contre le coronavirus à une grande échelle, on acceptera ensuite de conserver des outils similaires pour financer la transition écologique et pour tout simplement développer un nouveau paradigme de politique économique, écologique et sociale, sur les plans budgétaire et monétaire notamment. En particulier, on devrait saisir l’opportunité des investissements nécessaires à faire pour la lutte contre le coronavirus, et pour la relance écologique de l’économie qui devrait ensuite intervenir pour annuler les dettes publiques détenues par les banques centrales de l’eurosystème, au moins à même hauteur que ces investissements.
écanismes sans regarder à la dépense. Peut-être même que, si on en arrive à ce type de mesures exceptionnelles pour lutter contre le coronavirus à une grande échelle, on acceptera ensuite de conserver des outils similaires pour financer la transition écologique et pour tout simplement développer un nouveau paradigme de politique économique, écologique et sociale, sur les plans budgétaire et monétaire notamment. En particulier, on devrait saisir l’opportunité des investissements nécessaires à faire pour la lutte contre le coronavirus, et pour la relance écologique de l’économie qui devrait ensuite intervenir pour annuler les dettes publiques détenues par les banques centrales de l’eurosystème, au moins à même hauteur que ces investissements.










