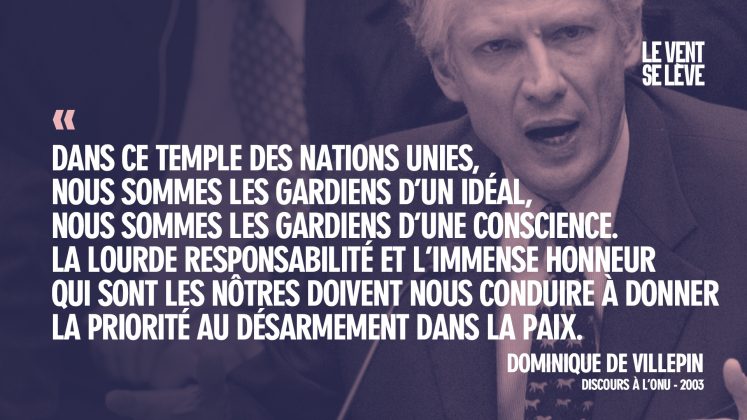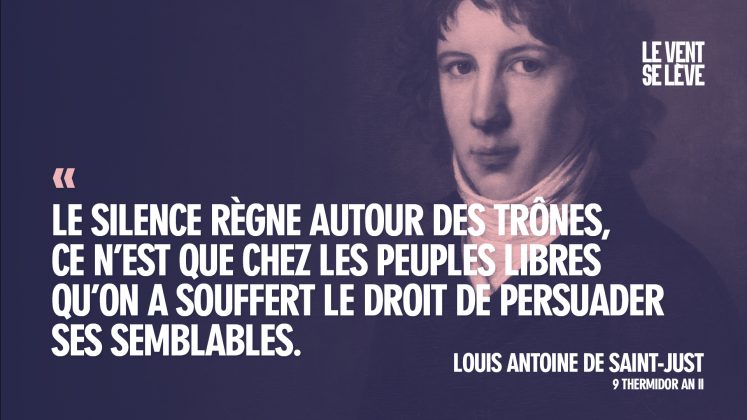Le 17 février 1894, Jean Jaurès prononce à la Chambre des députés un discours passé à la postérité sous le nom « Pour un socialisme douanier ». Tandis que la France est confrontée à une importante crise agricole, la question du relèvement des droits de douane sur les importations de blé est soumise au débat. S’il dénonce le point de vue libre-échangiste, Jaurès combat également le protectionnisme de façade qui aura – selon lui – pour principale conséquence l’enrichissement des spéculateurs français. À ces deux conceptions, il oppose la vision d’un protectionnisme abouti, laissant toute sa place à un État régulateur capable d’organiser l’économie, l’acheminement des denrées et leur distribution. Parce qu’il aborde les questions du libre-échange, des travailleurs étrangers, des frontières et du rôle de l’État dans la planification de l’économie, ce discours, que nous reproduisons dans notre série « Les grands textes », conserve une brûlante actualité. Retranscription : Guillemette Magnin et Leo Rosell.
M. JAURÈS. – Je ne puis pas, à mon grand regret et à ma grande confusion, promettre à la Chambre d’être très bref ; j’ai besoin de lui demander toute sa patience. (Parlez !)
Je crois en effet que c’est la première fois qu’une solution socialiste est proposée dans une question douanière ; c’est en tous cas la première fois qu’à cette tribune on demande dans la discussion sur le commerce extérieur des céréales de donner le monopole de l’importation des blés à l’État. Il n’a été fait sur cette question aucun rapport par la commission des douanes ; il n’y a eu, quoique notre projet ait été déposé depuis plusieurs semaines, ni discussion dans les bureaux – cela va de soi – ni discussion devant la commission des douanes. Je suis donc obligé tout à la fois de justifier le principe et d’expliquer le mécanisme de notre proposition.
Je constate tout d’abord, pour la bien préciser, qu’elle est strictement limitée à l’objet actuel de vos délibérations, c’est-à-dire au commerce extérieur des blés, ou pour parler avec plus d’exactitude, au commerce d’importation des blés. Nous ne touchons par notre proposition ni au commerce d’exportation des blés, ni au commerce extérieur des céréales, et j’essayerai de montrer que nous ne touchons en rien ni à l’intérêt des ports ni à l’intérêt des industries qui manipulent les céréales. Il s’agit tout simplement de substituer l’État, pour l’importation des blés étrangers et des farines étrangères, aux grands intermédiaires qui font à l’heure actuelle la loi sur le marché. […] Il s’agit de décider que, pour le commerce d’importation des blés, c’est la nation qui sera à elle-même son propre intermédiaire. Nous voulons par-là l’affranchir d’abord de la domination de ces spéculateurs dont il a été beaucoup parlé à cette tribune, et lui donner en même temps le moyen de régler par des prix normaux les cours intérieurs du blé au profit des cultivateurs. (Très bien ! Très bien ! à l’extrême gauche.)
D’où est née notre proposition ? Elle n’est pas sortie de préoccupations doctrinales ou théoriques. Certes, elle s’inspire de l’idée socialiste, et c’est l’honneur de notre parti que toutes les solutions partielles, que toutes les propositions particulières que nous apportons à cette tribune soient inspirées du même esprit et portent pour ainsi dire la même marque. Mais notre proposition procède avant tout des nécessités pratiques et positives. Elle procède de la crise agricole prolongée, des souffrances toujours plus aiguës des cultivateurs, auxquelles vous n’avez pas pu porter remède ; elle procède de l’impuissance constatée de la politique douanière et des mesures protectionnistes ; elle procède enfin des abus et des excès de cette spéculation contre laquelle tous les partis successivement viennent s’indigner à cette tribune avec une sorte de conviction mélodramatique, mais que le parti socialiste est seul à frapper vigoureusement d’un coup décisif. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)
Je n’ai pas, en ce moment du débat, à intervenir dans la querelle entre protectionnistes et libre-échangistes, entre l’honorable M. Méline et l’honorable M. Labat, d’abord parce que, après le passage à la discussion des articles, vous n’êtes plus à discuter des principes, mais à discuter des moyens d’application et de réalisation ; ensuite et surtout parce que nous, socialistes, nous sommes, je ne me permettrai pas de dire au-dessus, mais en dehors de la protection et du libre-échange. La protection et le libre-échange sont liés également à un ordre social qui à nos yeux est provisoire, et que nous voulons éliminer. Ce qui caractérise le régime capitaliste, c’est l’appropriation individuelle des grands moyens de production et d’échange ; la propriété capitaliste, ainsi définie et constituée, a pour conséquence nécessaire et normale la concurrence universelle de producteur à producteur, la lutte économique d’homme à homme. Tous, que vous soyez libre-échangistes ou protectionnistes, vous admettez et le principe, et la conséquence ; quand vous n’êtes pas socialistes, vous admettez et la propriété capitaliste, et la concurrence universelle qui en résulte nécessairement. […]
L’honorable M. Méline lui-même déclarait l’autre jour qu’en proposant des tarifs de douanes, il n’entendait pas contester le principe de la concurrence internationale, qu’il entendait seulement en atténuer, en modérer les effets. À ce point de vue, entre libre-échangistes et protectionnistes, il n’y a qu’une différence, à nos yeux secondaire. Les libre-échangistes veulent respecter le jeu absolument libre de la concurrence internationale ; ils veulent laisser toute son ampleur au marché universel. Ils sont patriotes, mais ils estiment que ce groupement historique qui s’appelle la patrie, qui a d’autres et de très nobles objets, ne doit pas intervenir plus que dans les échanges de peuple à peuple. Les protectionnistes, au contraire, sans contester le principe même de la concurrence entre les nations, estiment que la patrie n’est pas seulement une unité historique et une personne morale, mais qu’elle a le droit, dans une certaine mesure, de réagir sur le marché universel. Il y a entre vous cette communauté, c’est que vous acceptez tous que, dans l’ordre de la production, la loi même de la vie, c’est l’universelle bataille. Seulement, pour les libre-échangistes, c’est la planète tout entière qui est le champ de la bataille et les protectionnistes veulent, par des barrières douanières plus ou moins élevées, tracer dans ce champ de bataille universel autant de champs de bataille distincts qu’il y a de nations distinctes.
Mais pour nous qui voulons supprimer le combat lui-même, pour nous qui voulons, en supprimant l’appropriation individuelle des moyens de production et d’échange, supprimer toute concurrence aussi bien intérieure qu’extérieure, vous entendez bien, sans que j’aie besoin d’insister davantage, que la protection et le libre-échange sont des phénomènes relatifs et provisoires, comme la société elle-même dont nous préparons la disparition. (Exclamations au centre. Applaudissements à l’extrême gauche). […] Nous ne sommes donc liés par nos principes ni à la protection ni au libre-échange, et j’ajoute que nous sommes également servis par l’un et l’autre. Lorsque l’un et l’autre ont produit leurs conséquences naturelles et extrêmes, lorsque la concurrence universelle exaspérée, que respecte le libre-échange, a créé ou aggravé l’inégalité des fortunes, lorsqu’elle a accumulé dans un pays ou dans une partie de la production de ce pays les mécontentements et les ruines, et lorsqu’à son tour le protectionnisme est discrédité ou usé par l’impuissance, par l’inefficacité de ses demi-mesures, qui sont le plus souvent des contradictions sans être des remèdes, alors apparaît naturellement, nécessairement la solution socialiste. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)
C’est ainsi que les paysans, ruinés par la formidable poussée de la concurrence étrangère, écrasés par la spéculation cosmopolite, détachés du protectionnisme qui les a peut-être empêchés de mourir mais qui ne les a pas aidés à vivre, c’est ainsi que les paysans commencent à se rallier et se rallieront de plus en plus, à mesure que nous continuerez l’expérience de mesures contradictoires et inefficaces, au seul projet net, efficace et décisif, qui est en cette question le monopole de l’importation assuré à l’État. […]
Toutes les fois que nous apportons une solution qui résulte de la nature des choses et de l’état des sociétés contemporaines, on cherche entre les propositions des socialistes et certaines institutions du passé je ne sais quelle vague analogie extérieure, pour nous reprocher à bon marché d’être des rétrogrades ou, comme dit M. Yves Guyot dans ses jours de verre, des régressifs. Toutes les fois, par exemple, que nous venons demander que l’on transfère à la nation organisée cette souveraineté économique qui appartient à l’heure actuelle à des oligarchies privilégiées, on nous dit que nous voulons ramener l’humanité au communisme des tribus primitives, c’est-à-dire qu’on nous reproche, à nous qui voulons organiser économiquement la nation comme elle l’est déjà au point de vue politique, de vouloir ramener l’humanité à des temps où la nation elle-même n’existait pas.
[…] Eh bien, s’il est vrai qu’alors nous revenions à l’ancienne Égypte, vous, lorsque vous organisez la République et le suffrage universel, ne revenez-vous pas aussi à ces institutions barbares dans lesquelles chacun des soldats donnait son avis ? Si nous revenons à l’ancienne Égypte, il y a longtemps que vous, organisateurs du suffrage universel, vous siégez dans les forêts de la Germanie !
Le père Mirabeau – s’il m’est permis à moi aussi d’essayer une courte revue des ancêtres – remarque ingénieusement que, par le régime des banques, l’or, de nouveau enfoui et immobile, revient à sa condition première et rentre en quelque sorte sous terre. Voilà donc, au compte des économistes, que les grands banquiers et les grandes institutions de banque font rétrograder la civilisation humaine bien en deçà de l’époque où les Phéniciens creusaient les premiers puits de mine. Non ! Notre proposition, bien loin d’être anarchique, est la seule actuelle, parce qu’elle est la seule qui puisse, dans cette question des blés, donner à la fois toute sa réalité au libre-échange et toute son efficacité à la protection.
Quelques-uns d’entre vous parlent beaucoup ici du libre-échange. Vous imaginez-vous qu’il suffirait de supprimer les droits de douane pour qu’il y eût le libre-échange dans ce pays pour les blés ? Repoussez tout à l’heure la proposition de monopole de l’État que nous apportons, et par surcroît, au lieu d’élever les droits de douane sur les blés, supprimez-les entièrement ; y aura-t-il pour cela dans cette question des blés échange libre entre la nation et le marché extérieur ? Pas le moins du monde ! Car entre la nation et le marché extérieur, il s’est interposé une corporation d’intermédiaires qui font la loi sur le marché national. (Applaudissement à l’extrême gauche.)
À mesure que le commerce international se fait par plus grande masse et par plus grands capitaux, à mesure aussi que la petite meunerie disparaît, absorbée par la grande, et que celle-ci pour ses grandes affaires touche à la spéculation, c’est bien en effet une corporation de dix ou douze intermédiaires qui est maîtresse du marché français, des relations de la France avec le marché extérieur. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs. Interruptions à gauche et au centre.) […]
C’est une chose singulière qu’ici les représentants de tous les partis aient pu sans soulever le moindre murmure – et je puis même dire aux applaudissements unanimes de cette Assemblée – dénoncer l’influence toute-puissante, néfaste de la spéculation, et lorsqu’à mon tour je viens tenir le même langage, je ne rencontre qu’opposition et rumeurs. Quelle différence faites-vous donc entre nous ? Et si vous murmurez maintenant, n’est-ce pas parce qu’au bout de ce qui n’était jusqu’ici que déclamations il y a des sanctions efficaces ? (Applaudissements à l’extrême gauche.) […]
Ici, j’ai le droit d’invoquer le témoignage et l’autorité des ministres mêmes qui se sont succédé sur ces bancs. Vous m’entendez bien, il n’y a pas eu depuis dix ans un seul ministre de l’Agriculture parlant avec son autorité ministérielle, sous sa responsabilité, au nom du gouvernement, qui ne soit venu à cette tribune dénoncer la spéculation. […]
M. ROUVIER – La spéculation que, dites-vous, chacun flétrit à son tour, je la considère comme nécessaire à la prospérité du pays (Exclamations à l’extrême gauche) et j’estime que c’est elle, par sa vigilance, son activité que rien n’interrompt, qui met le genre humain à l’abri des grandes variations de prix que nous n’avons pas revues depuis de longues années. Flétrissez-la tant que vous voudrez ! Ce n’en est pas moins elle qui vous garantit de la famine et qui concourt à la richesse du pays ! (Très bien ! Très bien ! sur divers bancs. Mouvements divers.)
M. JAURÈS – Je me félicite d’avoir provoqué ces explications de l’honorable M. Rouvier, et je m’empresse de lui rendre ce témoignage que ce qu’il dit à cette heure, il l’a toujours dit hautement et courageusement ; aussi n’est-ce pas ses paroles que j’ai en ce moment à recueillir et à utiliser ; ce n’est pas à lui que je m’adresse ; je serais peut-être même, en un autre sens, d’accord avec lui.
Je ne crois pas qu’il soit aussi facile que certains protectionnistes le disent de faire le départ entre ce qu’ils appellent la spéculation illicite et le grand commerce. Nous croyons précisément, nous autres, qu’il est difficile de marquer dans notre société les nuances de l’honnête et du malhonnête… […]
Je reviens à l’historique très rapide que je faisais des déclarations gouvernementales. Je me rappelle que l’honorable M. Develle qui dans la Chambre de 1885 à 1889 a eu à s’expliquer sur la question des blés, a flétri avec une vigueur indignée les manœuvres de la spéculation. Je me rappelle, et je vais rappeler que deux ans plus tard, le 15 novembre 1888, M. Viette, dont on saluait tout à l’heure la mémoire avec une douloureuse sympathie – et toute la Chambre s’est associée à ce sentiment – disait – pesez la gravité de ses paroles – : « L’alimentation publique n’est pas menacée ; je me trompe : elle est menacée par un syndicat. Elle n’est nullement menacée par l’insuffisance des récoltes, mais par des manœuvres de Bourse. Le marché des grains est en ce moment en butte aux tentatives d’une bande d’écumeurs, réunis dans cette complicité occulte qu’ils ont l’effronterie d’appeler un syndicat, et qui se sont rencontrés en Autriche, à Vienne, au mois d’août dernier. Là, sans recherche aucun des éléments de la question, alors que les pays producteurs de blé n’avaient pas encore pu, même approximativement, apprécier la richesse de la récolte, on a décidé qu’on jouerait à la hausse sur la vie humaine. Alors on a calculé de parti pris. On a soigneusement établi toutes les conditions de la hausse et on a réparti à chaque pays le déficit et la dose de détresse nécessaires pour enrichir les affameurs. Voilà ce qui s’est passé. »
J’ajoute : voilà ce qui s’est dit à la tribune ; voilà ce qui, à cette époque, était la vérité. M. le ministre de l’Agriculture, l’honorable M. Viger, avant-hier, sous une forme plus atténuée, n’est-il pas venu nous dire que les spéculateurs exerçaient en effet, dans ce baccara des blés, une influence qui pouvait être contraire aux intérêts du pays ? N’a-t-il pas dit que la panique déchaînée en 1891 à la première apparence d’une mauvaise récolte, panique qui n’était justifiée en rien, comme l’événement l’a montré, par l’état général du marché des grains, avait été provoquée par des manœuvres de spéculation, qui brusquement, quand le paysan s’était dessaisi de sa récolte, avaient fait en trois mois, sans raison aucune, hausser de plus de 5 francs le prix du blé dans les derniers mois de 1891 ? N’avez-vous pas dit cela, monsieur le ministre de l’Agriculture ?
M. VIGER, MINISTRE DE L’AGRICULTURE. – C’est parfaitement exact. J’ai l’habitude de dire ma façon de penser, au risque de fournir des arguments à mes adversaires, et je le ferai toujours. (Applaudissements.)
M. JAURÈS. – Ce n’est pas seulement dans le passé mais dans un avenir prochain, que vous pourrez affirmer cette influence de la spéculation en matière de grains. Vous discutez depuis deux mois ; vous n’avez pas pu prendre une décision rapide, et il est entré, il entre dans ce moment-ci des quantités considérables de grains. Pendant un an, la baisse va continuer sur le blé ; les grands commerçants de blé maintiendront les prix au cours le plus bas, grâce aux quantités qu’ils ont accumulées ; le paysan se sera dessaisi de sa récolte à des prix très bas et, trois mois après, les mêmes hommes, les mêmes négociants déclareront tout à coup qu’il n’y a plus de grains, que le droit de 7 ou 8 francs est écrasant, qu’on est à la veille de la famine; ils déchaîneront une nouvelle panique et ils infligeront au consommateur pauvre des prix élevés, alors qu’ils auront infligé au paysan des prix très bas. (Applaudissements sur divers bancs.) Et c’est devant cette puissance que vous voulez rester désarmés ; c’est devant cette puissance que les libre-échangistes s’inclinent, et les protectionnistes inconséquents, par des mesures incomplètes et par conséquent maladroites, viennent leur fournir des armes nouvelles !
Messieurs, ce n’est pas seulement au point de vue de l’alimentation publique qu’il est bon que la nation reprenne la maitrise de ses relations avec le marché extérieur, c’est encore au point de vue de la défense nationale elle-même. Vous savez bien qu’une des causes pour lesquelles, en 1870, Paris n’a pas pu suffisamment tenir, c’est qu’il n’y avait plus d’approvisionnements ; et vous savez bien qu’en 1890, le même phénomène menaçait de se produire. Vous vous rappelez que le conseil municipal de Paris, en 1890, fut obligé de s’émouvoir parce qu’à raison de certaines combinaisons, de certaines manœuvres de la spéculation internationale, il ne restait devant Paris, pour la consommation urgente, que quatre jours de vivres en blé ou en farine, et que par conséquent, grâce à certaines combinaisons du marché cosmopolite, qui en France même est pour une bonne part réglé par des étrangers – je me permets encore de vous indiquer ce détail – vous pouviez être pour l’approvisionnement de vos grandes places fortes à la merci d’un incident international. Le ministre de la Guerre vous a demandé, il y a quelques années, de constituer l’approvisionnement des places fortes. Qu’a-t-on fait pour cela ? Tout ce qu’on fera ne sera rien tant que l’État, en même temps qu’il sera l’importateur de blé, n’aura pas pu constituer certaines réserves qui pourront faire face, à un moment donné, à certaines complications internationales.
Voilà pourquoi – c’est une des premières raisons – nous demandons que l’État soit le seul importateur des blés étrangers. Et quel autre usage fera-t-il de ce monopole ? Dans ma pensée – je n’hésite pas à le déclarer très haut – il devra s’en servir pour assurer aux produits agricoles une rémunération équitable et normale. […]
Nous n’avons pas indiqué dans notre projet les prix auxquels l’État vendrait sur le marché français son blé, parce que nous voulons d’abord que la Chambre se prononce, indépendamment de toute question de détail, sur le principe et sur le mécanisme même de notre proposition. Mais si le projet est adopté, je demanderai personnellement tout de suite que le prix auquel l’État sera tenu de vendre le blé étranger acheté et emmagasiné par lui soit le prix que l’on a déclaré ici être le prix normal, le prix de 25 francs. Car nous avons eu, nous autres, la satisfaction d’entendre beaucoup parler, ces jours-ci, de prix normal et de juste salaire. (Mouvements divers.)
J’entends bien, ce prix de 25 francs, qui est supérieur au prix habituel des blés sur le marché français, et plus encore au prix du blé sur les marchés étrangers, ce prix de 25 francs contient dans une très large mesure un élément de protection.
Et ici je me trouve en face d’une des difficultés les plus graves qui puissent se présenter aux hommes de notre parti. Je vous demande la permission, sous ma responsabilité, propre et en mon nom personnel, de m’en expliquer très rapidement. Cette difficulté tient pour nous, comme pour tous les démocrates sincères, à la complexité même du monde rural. S’il n’y avait, pour bénéficier d’une rémunération suffisante des prix, que des propriétaires oisifs et des rentiers du sol, j’imagine que la question ne ferait de doute pour personne. Mais la crise des prix qui diminue les revenus du grand propriétaire oisif achève en même temps la ruine du petit propriétaire qui cultive lui-même son domaine ; elle achève la ruine du fermier qui a contracté des baux à un cours de beaucoup supérieur au cours actuel des blés ; elle achève la ruine du métayer qui est payé en nature, et qui, lui, n’est salarié que par la rémunération de ses produits.
Voilà ce qui fait la complexité et la difficulté de la question, et c’est pourquoi nous nous appliquons, par un ensemble de mesures, à protéger le travail agricole tout en cherchant à concentrer en effet, par des mesures complémentaires, sur les travailleurs ruraux tout le bénéfice de cette protection. Oui, nous devons protection au petit propriétaire cultivateur, au métayer obéré, au fermier dans la peine. Et voici pourquoi, au point de vue socialiste, je ne me sens pas gêné de leur accorder une protection. C’est parce que pour ceux-là, comme je le disais tout à l’heure, la forme même du salaire, c’est le prix du produit, et quand nous leur assurons, à ces ouvriers de la démocratie rurale, le minimum de salaire que nous réclamons pour la démocratie ouvrière.
Et de même nous protestons contre l’invasion des ouvriers étrangers qui viennent travailler au rabais. Et ici il ne faut pas qu’il y ait de méprise : nous n’entendons nullement, nous qui sommes internationalistes (Rumeurs et interruptions sur divers bancs) […] Vous entendez bien que ce n’est pas nous qui voulons éveiller entre les travailleurs manuels des différents pays les animosités d’un chauvinisme jaloux ; non, mais ce que nous ne voulons pas, c’est que le capital international aille chercher la main-d’œuvre sur les marchés où elle est le plus avilie, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français, et pour amener partout dans le monde les salaires au niveau des pays où ils sont le plus bas. (Applaudissements) C’est en ce sens, et en ce sens seulement, que nous voulons protéger la main-d’œuvre française contre la main-d’œuvre étrangère, non pas, je le répète, par un exclusivisme d’esprit chauvin, mais pour substituer l’internationale du bien-être à l’internationale de la misère. (Applaudissements à l’extrême gauche. Mouvements divers.)
Mais alors, Messieurs, quand j’examine la démocratie rurale, sous quelle forme les travailleurs du dehors viennent-ils faire concurrence, à des prix dépréciés, aux petits propriétaires, aux petits cultivateurs, aux métayers, aux fermiers ? C’est sous la forme même des produits agricoles, lorsque dans l’Inde, par exemple, un hectolitre de blé a été produit par des salariés qui ne touchent que des salaires de 20 à 25 centimes par jour.
Je dis que lorsqu’on vient acheter sur le marché français des produits agricoles, du blé, par exemple, qui ont été obtenus par des travailleurs réduits à un salaire dérisoire, c’est exactement comme si on jetait dans les campagnes de France, pour faire concurrence à nos paysans, les ouvriers qui au dehors travaillent à des salaires dépréciés. Et voilà pourquoi, pour ma part, je ne me refuse nullement à protéger l’ensemble de la production agricole ; mais j’ajoute : à condition – et vous vous y êtes engagés vous-même – que par des mesures complémentaires vous assuriez à la démocratie rurale, à ceux qui travaillent véritablement, le bénéfice exclusif de cette mesure. Voilà pourquoi, lorsque vous aurez voté les surtaxes que vous préparez, nous viendrons vous demander d’en assurer le bénéfice aux travailleurs des champs.
Vous nous dites qu’ils en bénéficieront indirectement ; eh bien ! nous ne voulons pas nous occuper d’eux d’une façon indirecte, par des ricochets toujours problématiques et incertains. Puisque vous prenez dans l’intérêt de la propriété rurale des mesures directes, nous vous demanderons de prendre des mesures directes dans l’intérêt des travailleurs ruraux ; nous vous demanderons de leur assurer un salaire minimum.
Vous avez pu calculer le prix de revient du blé dans toute la France, vous pouvez bien savoir aussi ce que coûte une famille. Les statistiques ne s’appliquent pas spécialement aux végétaux, elles s’appliquent aussi aux hommes. Vous pouvez savoir ce qu’il en coûte pour élever une famille paysanne ; vous pouvez savoir que les travailleurs agricoles concurrencés par les ouvriers belges, appelés par ceux qui nous reprochent notre internationalisme, travaillent à des prix dérisoires. Vous ne pouvez vraiment pas nous donner cette assurance hautaine qu’une fois la surtaxe votée, le bénéfice en ira certainement, par des répercussions que vous ne pouvez pas prévoir, aux travailleurs agricoles ; nous vous demanderons d’assurer aux métayers et aux fermiers sortants le bénéfice de la plus-value incorporée par eux au sol.
M. TERRIER – Cela se fait en Angleterre.
M. JAURÈS – Nous vous demanderons, comme M. Gladstone l’a demandé et obtenu pour d’autres, que vous soumettiez à des révisions arbitrales les baux de vos fermiers, pour que les propriétaires ne puissent pas les élever à raison du surcroît de rentes que vous leur assurerez par votre protection. Voilà, messieurs, ce que nous vous demanderons, et vous serez obligés de voter avec nous.
L’honorable M. Labat prononçait l’autre jour cette parole très forte : « Lorsque par des mesures douanières vous aurez élevé le blé à 25 francs, vous aurez incorporé dans ce prix de 25 francs une part de richesse qui sera le résultat immédiat de l’action, de l’intervention sociale. » Eh bien ! nous disons, nous, que dans toute propriété individuelle il y a intervention de la société, mais le plus souvent cette intervention sociale occulte et profonde est dissimulée, à la surface au moins, par une certaine activité individuelle. Ici, ce ne sera plus le cas ; ce ne sera plus l’activité individuelle qui aura créé ce surcroît de rentes, elle n’y figurera même plus du tout ; il y aura un surcroît de rentes agricoles qui sera exclusivement le résultat de l’intervention sociale ; ce sera donc une richesse sociale et sur laquelle la société aura un droit absolu. (Applaudissements à l’extrême gauche) […] Nous aurons donc le droit, puisque cette richesse est d’origine et de nature sociales, de demander que la société intervienne pour en assurer la répartition de la façon qui convient dans une démocratie, c’est-à-dire au profit de ceux qui travaillent. Et c’est vous-mêmes qui ouvrez à la société l’accès des fortunes individuelles, c’est vous qui ajoutez aujourd’hui à votre maison un étage aux frais du public ; vous donnez donc par là même à la société le droit d’entrer chez vous, le droit d’occuper cet étage.
J’espère que dans cette œuvre nous aurons l’appui, quoi qu’il en ait dit, de l’honorable M. Méline et de la commission des douanes (Rires), […] [car] tous les matins on lui présente le protectionnisme comme un miroir et on lui dit : « Regardez-vous donc, c’est la figure d’un socialiste ! » (On rit.) […]
Je crois qu’on exagère, monsieur le président de la commission des douanes, mais vous me permettrez cependant d’ajouter à toutes les polémiques innocentes dont vous êtes l’objet une citation, celle du grand Cavour, qui a été amené à la tribune de Turin en 1851, à propos d’une discussion ouverte sur le socialisme, à traiter exactement la question que je traite en ce moment. Il disait : « Dans l’ordre économique, comme dans l’ordre politique, comme dans l’ordre religieux, les idées seules peuvent lutter efficacement contre les idées. » Ce premier paragraphe est pour M. le ministre de l’Intérieur. (Nouveaux rires.)
« Or, je dis que l’allié le plus puissant du socialisme, dans l’ordre intellectuel bien entendu, c’est la doctrine protectionniste. Elle part absolument du même principe : réduite à la plus simple expression, elle affirme le droit et le devoir du gouvernement d’intervenir dans la distribution, dans l’emploi des capitaux ; elle affirme que le gouvernement a pour mission, pour fonction de substituer sa volonté qu’il tient pour la plus éclairée, à la volonté libre des individus. Si ces affirmations venaient à passer à l’état de vérités reçues et incontestées, je ne vois pas ce qu’on pourrait répondre aux classes ouvrières, à ceux qui se font leurs avocats, quand ils viendraient dire aux gouvernements : “Vous croyez qu’il est de votre droit et de votre devoir d’intervenir dans la distribution de capital et d’en réglementer l’action, pourquoi donc ne vous mêlez-vous pas de l’autre élément de la production, le salaire ? Pourquoi n’organisez-vous pas le travail ?” » (Très bien ! Très bien ! à l’extrême gauche.)
Eh bien ! je ne crois pas, malgré l’autorité de paroles, qu’il faille confondre le protectionnisme et socialisme, et nous n’y tenons pas plus que ne paraît y tenir l’honorable M. Méline lui-même. Mais c’est précisément parce que les protectionnistes ne sont pas des socialistes qu’ils nous donnent une plus grande force. Comment ! Ils reconnaissent les principes essentiels de la société actuelle. Ils reconnaissent qu’elle a pour principe l’initiative individuelle, la propriété individuelle et la libre concurrence des producteurs contre les producteurs, et ils sont obligés cependant, pour empêcher cette société d’aboutir à des cataclysmes et à des désastres, de suspendre eux-mêmes, de contrarier eux-mêmes l’effet des lois qu’ils reconnaissent d’ailleurs comme excellentes et nécessaires. C’est la condamnation de la société actuelle prononcée non pas par ceux qui pensent comme nous, mais, chose plus importante, par ceux qui parlent contre nous (Applaudissements à l’extrême gauche) […]
M. Méline a recouru à une singulière analogie. Il a dit : « Lorsque l’État crée des tarifs de douanes, il n’intervient nullement dans les conditions respectives des citoyens à intérieur du pays ; il se borne à défendre la fortune nationale en bloc contre la concurrence étrangère, de même que l’État protège l’intégrité du territoire national par les armées. »
Messieurs, il y a là une confusion singulière. Ce qui fait précisément la force et l’unité de la patrie, ce qui fait que l’État peut défendre l’intégrité du sol et la liberté de la patrie contre l’ennemi extérieur, sans intervenir en rien dans les relations d’intérêt des citoyens et des particuliers, c’est précisément que l’idée de patrie est constituée au-dessus des divisions, des intérêts particuliers. (Très bien ! Très bien !) Il y a quelque part un groupement historique, il y a quelque part, sur cette planète que des révolutions que l’on ne peut calculer entraînent à des destinées inconnues, il y a un groupement historique qui s’appelle la France, qui a été constitué par des siècles de souffrances communes, d’espérances communes. Les lentes formations monarchiques en ont peu à peu juxtaposé et soudé les morceaux, et les ardentes épreuves de la Révolution l’ont fondu en un seul métal. C’est la patrie française. (Très bien ! Très bien !)
Oui, la patrie existe, indépendamment des luttes qui peuvent se produire dans son intérieur, de particulier à particulier. Oui, il y a des luttes, des haines entre les citoyens, des rivalités entre les familles, des rivalités passionnées entre les partis ; il y a aussi, nous le croyons, nous, et nous le disons parce que nous disons toujours ce que nous croyons être la réalité, il y a des antagonismes profonds de classes. Mais quelles que soient ces luttes politiques, ces divisions économiques, ces antagonismes sociaux, ils ne peuvent porter atteinte à l’idée même de la patrie, à l’unité de la patrie, telle qu’elle a été constituée. (Applaudissements sur divers bancs.) […]
Vous voyez donc, par l’expérience même de cette séance, qu’il n’appartient pas à l’intolérance ou à la haine des partis de couper la patrie en morceaux puisque malgré toutes les interruptions, toutes les persécutions, elle restera une, et qu’on ne parviendra pas à nous séparer d’elle.
M. Méline peut-il dire qu’il en est ainsi dans l’ordre économique ? A-t-il réalisé à l’heure actuelle, dans l’ordre des intérêts, cette homogénéité morale que la patrie a réalisée dans un autre ordre ?
Vous mettez des droits à la frontière et vous déclarez que c’est seulement contre l’ennemi. Prenez garde ! De pareilles mesures ont à l’intérieur des répercussions variées. Vous accordez ainsi une rente plus élevée à ceux qui possèdent davantage, vous intervenez dans les contrats, vous prenez parti entre les intérêts qui ne sont pas essentiellement les mêmes, et alors vous n’avez pas le droit de dire que c’est une fonction analogue à la défense de la patrie. Vous l’avez si bien senti que vous avez cherché à justifier cette rente que vous attribuez aux propriétaires.
Savez-vous, messieurs, quelles sont les deux catégories économiques que l’honorable M. Méline a découvertes dans le pays ? Il a découvert, d’un côté, les travailleurs et, de l’autre, les producteurs. Il paraît que ce ne sont pas les travailleurs qui sont les producteurs ; le producteur, c’est le grand propriétaire, qui ne réside jamais dans ses terres […] et qui dépense à Paris le produit de ses fermages. (Bruit à droite.)
La logique même des principes invoqués par vous vous obligera à aller jusqu’au bout et à protéger la démocratie rurale par des sanctions efficaces que nous proposerons, et que sans doute vous repousserez. Que faites-vous pour les cultivateurs ? Il existe un droit de 5 francs : vous voulez le porter à 7 francs ou à 8 francs. On a beaucoup discuté sur les effets de ce droit ; toutefois, il est certain que, si le droit de 5 francs a empêché une baisse plus grande du prix du blé, il n’a pas produit à son institution un relèvement quelconque des prix. Quelles sont les causes de cette situation ? Je n’ai pas à les rechercher. Les uns assurent que c’est le change ; d’autres accusent l’exagération des récoltes extérieures ; d’autres encore, comme M. Labat, prétendent que c’est la nécessité pour les pays producteurs vers lesquels sont allés nos capitaux, de nous servir les intérêts de ces emprunts, et pour cela de jeter sur notre marché leurs produits agricoles à des prix qui avilissent les prix de nos denrées.
Il importe peu pour notre thèse que nous choisissions telle ou telle de ces explications et que la vérité soit avec les uns ou avec les autres. Le résultat est le suivant : le droit de 5 francs n’a pas relevé le prix des denrées agricoles au niveau que vous vouliez atteindre ; quelles raisons avez-vous d’espérer que le droit de 7 francs, c’est-à-dire un nouveau surcroît de 2 francs, sera plus efficace ? Avec le droit de 5 francs, vous avez échoué : pourquoi réussiriez-vous avec une nouvelle taxe de 2 francs ? Les causes qui ont paralysé l’action du droit de 5 francs ne vont-elles pas persister, et peut-être même s’aggraver ? Est-ce que la production ne va pas continuer à se développer dans le monde ? […] Est-ce que les phénomènes du change ne peuvent pas encore s’aggraver à votre détriment ? Est-ce que les pays qui vous ont emprunté et qui n’ont pas encore remboursé le capital emprunté par eux ne seront pas dans la nécessité, pour s’acquitter des intérêts de leur dette, de vous vendre leurs produits à des prix plus bas encore ?
Il s’agit de savoir si depuis dix ans que vous prononcez de belles paroles, des paroles émues sur la condition des paysans, vous allez, après un droit de 60 centimes qui a été un leurre, après un droit de 3 francs qui n’a pas changé la face des choses, après un droit de 5 francs qui n’a été qu’une déception nouvelle, vous allez, dis-je, vous exposer encore à infliger à nos malheureux paysans une quatrième déception, qui ne sera pas la dernière. Il s’agit de savoir si vous voulez leur donner des espérances ou des réalités. Voilà pourquoi la société des agriculteurs de France avait songé à proposer une échelle mobile qui aurait amené le cours du blé au niveau de 25 francs. Pourquoi la commission des douanes n’a-t-elle pas adopté cette proposition ? Je ne le comprends pas. Elle a imaginé une échelle d’un nouveau genre, par laquelle on peut descendre, mais non monter. (On rit.)
Il n’y a que le système que nous vous proposons qui puisse permettre vraiment le fonctionnement de l’échelle mobile, du droit gradué. Si l’État vend le blé qu’il a apporté sur le marché au prix normal, régulateur, de 25 francs le quintal métrique, il est évident que le droit gradué est représenté là par l’écart entre le prix constant et le prix régulateur auquel il le vend sur le marché français, et ce droit gradué fonctionne automatiquement, avec une délicatesse infinie, sans que vous soyez obligés de consulter les statistiques incertaines du marché intérieur, et d’une façon bien plus rationnelle.
Quel est le vice du droit gradué ou de l’échelle mobile ? C’est que le droit de douane est réglé par des cours extérieurs sur lesquels le droit de douane lui-même. Ainsi, le droit de douane détermine en partie les cours du marché intérieur, et ce sont à leur tour les cours du marché intérieur qui viennent déterminer le droit gradué. Il y a là par conséquent une instabilité essentielle, et le droit gradué est atteint d’une sorte de tic tremblotant perpétuel. Mais nous, par le monopole d’importation, nous ne réglons pas le droit gradué sur le cours du marché intérieur, nous le réglons, comme c’est logique, sur les cours des marchés extérieurs, c’est-à-dire qu’à mesure que le prix du blé étranger baisse sur le marché extérieur, l’écart entre ce prix et le prix auquel l’État vend le blé sur le marché va croissant. Par conséquent, le droit gradué fonctionne sous la forme de monopole d’une façon automatique et rationnelle puisqu’il fonctionne en raison du prix même de la marchandise extérieure. Voilà donc, messieurs, que vous ne faites rien d’efficace pour le cultivateur, et en même temps, vous vous exposez à des hausses qui peuvent affamer l’ouvrier. Qu’avez-vous prévu ?
L’honorable M. Méline comprend bien le péril, puisqu’il propose, lorsque le blé dépassera 25 francs, d’appliquer un droit descendant. Mais le ministre de l’Agriculture est venu constater à cette tribune l’impossibilité à peu près absolue de faire fonctionner dans la pratique ce système. Je crois, monsieur le ministre de l’Agriculture, que vous avez triomphé facilement de la commission des douanes, en exposant devant la Chambre ces difficultés ; mais vous, à votre tour, quelle est votre solution pour l’autre difficulté très grave qui va se dresser devant vous et qui a préoccupé la commission des douanes ?
Quand il n’y avait qu’un droit de 5 francs, on a pu tout à coup provoquer une panique, amener la hausse des cours qui a amené la hausse du prix du pain, qui a inquiété toutes les populations. Ce péril qui s’est produit lorsque vous aviez le droit de 5 francs, comment ne se produirait-il pas, plus intense encore, lorsque vous aurez le droit de 7 francs ? En sorte que votre mécanisme, impuissant à protéger le paysan dans les périodes normales, devient une cause de famine pour l’ouvrier dans les périodes de crise.
Au contraire, messieurs, par l’organisation que nous vous proposons, lorsque l’État vendra le blé étranger sur le marché à ce prix normal et constant de 25 francs, le blé français aura une tendance à se relever jusqu’à ce niveau ; mais il ne pourra jamais le dépasser, puisqu’on sera sûr de pouvoir acheter au prix de 25 francs. Si vous me dites que cela peut à certains moments constituer une perte pour l’État, j’en conviens ; mais je vous ferai observer qu’il aura, dans les années où le prix était bien inférieur à ce prix de 25 francs, réalisé de très larges bénéfices. Et tandis que les systèmes imaginés par vous sont à la fois inefficaces en ce qui concerne le paysan, et peuvent être dangereux en ce qui touche l’alimentation publique, le système que nous vous proposons est absolument efficace et pour relever les cours, et pour empêcher ce relèvement d’atteindre des proportions inquiétantes.
Voilà les raisons décisives pour lesquelles nous vous le proposons. La vie économique du pays n’en sera en rien troublée. Que ce soit le syndicat de M. Ephrussi, le syndicat de M. Drevfus ou d’autres qui achètent les blés étrangers, ou que ce soit l’État, les mêmes quantités de blé arrivent dans nos grands ports, et l’État pourra même s’occuper de la condition des ouvriers des ports, qui traversent en ce moment-ci une crise redoutable. Et la meunerie pourra aussi bien s’approvisionner auprès de l’État qu’auprès des grands importateurs. Pour la réexpédition des farines travaillées, un système absolument identique à celui des admissions temporaires pourra fonctionner : on remboursera au meunier la différence entre le prix auquel l’État aura vendu le blé et le cours du même blé à la même date sur le grand marché extérieur ; en sorte qu’aucun trouble ne sera apporté dans la vie économique de ce pays, et que vous aurez rendu à la nation la possession de ses relations avec le marché extérieur en ce qui touche l’alimentation publique, sans compromettre en quoi que ce soit la liberté de la vie économique au dedans.
J’entends bien qu’on nous fait une objection, et je crois qu’on ne peut nous en faire qu’une. On ne peut pas nous parler de difficultés pratiques. J’imagine qu’il ne sera difficile à l’État ni d’acheter des blés à des cours publics sur les marchés du dehors, ni de les emmagasiner jusqu’à concurrence de la quantité suffisante, soit dans ses entrepôts, soit dans des magasins qui seront distribués à l’intérieur du territoire pour être à la portée des besoins. (Interruptions.) […]
Non, ce ne sont pas là les difficultés pratiques qu’on nous peut opposer. On ne nous en oppose qu’une essentielle, c’est qu’il ne convient pas, c’est qu’il peut être dangereux de faire intervenir l’État. L’autre jour, lorsque l’honorable M. Brice nous déclarait à cette tribune qu’il ne fallait pas adopter de demi-mesures, je me suis permis, par voie d’interruption, de lui dire : « Mais votez donc alors le monopole de l’État ! » […] Vous m’avez répondu : « Non, je suis trop partisan des initiatives individuelles. »
Ah ! Vous avez une singulière façon d’être partisan de ces initiatives individuelles ! Comment ! Vous venez demander à cette tribune qu’on assure au cultivateur une rémunération suffisante, non pas même au prix d’un droit de 7 francs ni d’un droit de 8 francs, mais d’un droit de 10 francs par quintal métrique ! Vous demandez une sorte de prohibition, vous demandez une réglementation des entrepôts ; puis, quand vous avez demandé tout cela à l’État, quand vous vous êtes installé chez lui et que vous y avez bien dîné, vous lui dites des choses désagréables. (On rit.) Vous renversez, mon cher collègue, le mot de Molière : pour vous, le plus détestable amphitryon est celui chez qui l’on a dîné ! (Nouveaux rires.) C’est la maxime d’un très grand nombre de protectionnistes qui sollicitent l’intervention de l’État, et puis qui disent après tout le mal possible de l’État, lorsqu’apparaît la conclusion socialiste.
Oh ! Je sais bien qu’on nous dit : « C’est un monopole. » Mais il y a autre chose que le monopole apparent qui appartient à la nation et aux communautés, il y a le monopole de fait qui appartient à quelques capitalistes privilégiés.
Et puis on nous dit : « Vous allez créer encore des fonctionnaires ! » C’est avec cet argument que l’on s’oppose depuis quelques années à toutes les mesures qui sont la défense nécessaire du domaine public. Lorsqu’il s’est agi, par exemple – et l’on peut s’en souvenir, cela remonte à quelques années à peine –, de racheter à la société des téléphones la concession qu’on lui avait faite pour rattacher les téléphones à l’exploitation de l’État, on a dit : « Vous allez créer de nouveaux fonctionnaires. » Mais est-ce que le régime capitaliste n’a pas, lui aussi, ses fonctionnaires ? Quelle différence faites-vous, au point de vue de la sécurité et au point de vue de l’indépendance, entre les agents des compagnies des chemins de fer et les salariés, les employés de l’État ? Ce régime capitaliste, avec ses grandes administrations et ses monopoles de fait, crée, lui aussi, des catégories de fonctionnaires. Seulement ce sont des fonctionnaires de l’intérêt privé, et l’on peut bien sans scandale, leur substituer les fonctionnaires l’intérêt public.
On nous dit encore : « L’État spéculera. » Regardons-y de près, messieurs. Comment donc l’État pourra-t-il spéculer ? Il achètera ouvertement sur les marchés extérieurs, avec des adjudications s’il le faut, les blés étrangers, et il les revendra. Est-ce que vous vous imaginez qu’aujourd’hui vous supprimez la spéculation et que vous l’empêchez de pénétrer jusque dans l’État même en ne constituant pas à l’État un pouvoir apparent ? Mais l’État, messieurs, est perpétuellement en proie dans notre société à toutes sortes de tentations, même quand il n’exerce pas une autorité ouverte, surtout alors. […]
L’État ne pourra-t-il pas spéculer avec vos droits de douane ? M. le ministre ne me l’a pas dit ; mais je suis bien sûr qu’un de ses arguments contre le droit gradué, c’est la facilité qu’il donnerait à l’État de spéculer. Il est bien évident que lorsque le ministre de l’Agriculture serait renseigné – et il le serait le premier – sur l’état de tous les marchés disséminés sur la France, et qu’il serait seul, à un moment, à posséder le secret d’où va dépendre une variation du droit, il est bien certain qu’il pourrait spéculer (Mouvements divers.) […]
Au contraire, le mécanisme que nous instituons fonctionne évidemment à ciel ouvert et d’une manière pour ainsi dire mathématique ; il ne donne prise à aucune spéculation. Tandis qu’il nous est possible de préciser les spéculations auxquelles donnent lieu tous vos systèmes de douane, il serait impossible de préciser les spéculations dangereuses auxquelles donnerait lieu le monopole de l’État. En tout cas, voilà un étrange argument ! Parce que l’État est faillible, parce qu’il peut être induit en certaines tentations, vous allez laisser le champ libre à la spéculation privée, au détriment de l’intérêt public, et vous allez enlever à l’État une de ses attributions nécessaires !
Il s’agit de savoir – et c’est par là que je demande à la Chambre la permission de terminer ces trop longues observations – il s’agit de savoir si vous voulez faire œuvre efficace ou œuvre vaine, œuvre durable ou œuvre éphémère.
Vous avez promis aux cultivateurs le relèvement des cours. Or, il est démontré par la discussion non par la mienne, vous entendez bien, mais par la discussion qui s’est poursuivie à cette tribune – que vous n’êtes nullement assurés de l’obtenir et que vous ménagez très probablement aux populations rurales une déception nouvelle. Vous voulez relever les cours du blé sans vous exposer à affamer l’ouvrier, et vous ne pouvez pas nous affirmer que d’ici dix à douze mois, lorsque le stock qu’on emmagasine actuellement sera écoulé, à l’entrée de l’hiver prochain, il ne se produira pas une hausse excessive contre laquelle vous serez absolument désarmé. C’est la crainte de l’honorable M. Méline et de la commission des douanes.
Si vous vous débarrassez du péril du droit gradué, vous vous retranchez aussi la faculté, que ce droit vous donnait, de combattre une hausse dangereuse pour les consommateurs. Au contraire, avec le monopole d’importation des blés qui permet à l’État d’établir pour les blés étrangers un cours régulateur, vous donnez aux paysans une satisfaction effective, vous donnez aux consommateurs une garantie réelle. Quoi que vous en pensiez, c’est encore le seul moyen de mettre un terme à la spéculation, et d’arracher à tous les périls qui ont été dénoncés par tous les ministres de l’Agriculture à cette tribune l’alimentation publique elle-même. (Applaudissements à l’extrême gauche et sur divers bancs à gauche.)