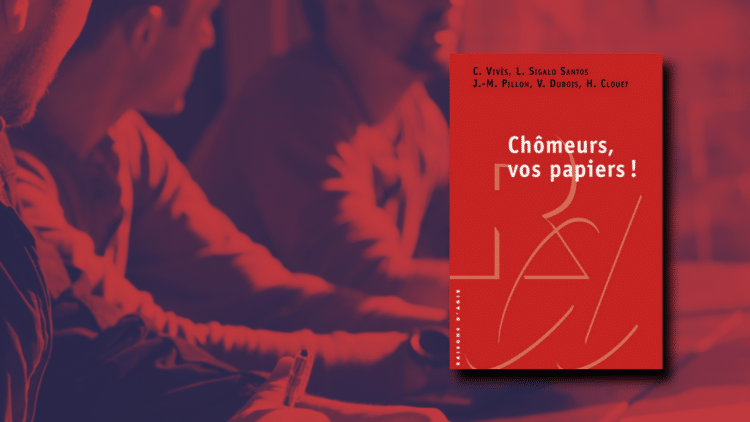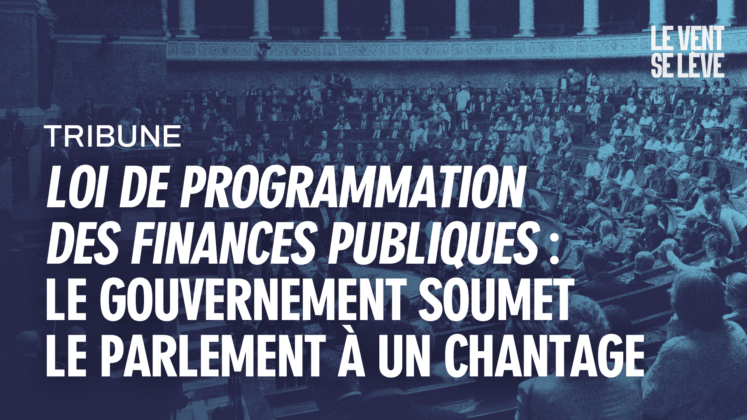La nécessité de lutter contre le recours abusif aux indemnités chômage et au RSA est un un lieu commun du néolibéralisme dont le président Emmanuel Macron et le gouvernement sont emparés : le retour au plein-emploi ne pourrait s’opérer qu’à la condition du renforcement de dispositifs de contrôle traquant des oisifs bénéficiant de prestations sociales sans véritablement chercher un emploi. Plus les chômeurs sont nombreux, plus ces discours fleurissent et avec eux, la suspicion qu’ils sont seuls responsables de leur situation. Dans Chômeurs, vos papiers ! Contrôler les chômeurs pour réduire le chômage (Raisons d’Agir, 2023), Claire Vivès, Luc Sigalo Santos, Jean-Marie Pillon, Vincent Dubois et Hadrien Clouet démontrent que l’idée selon laquelle le contrôle améliorerait le retour à l’emploi n’est pas un fait vérifié, mais une croyance, qui a légitimé le développement de dispositifs pénalisant toujours plus les travailleurs, jusqu’à créer un climat coercitif autour du chômage. Extraits.
Présent quasiment tout au long de l’histoire du traitement public du chômage, le contrôle n’a jamais occupé une place aussi centrale. Mais finalement, pourquoi au juste contrôle-t-on les chômeur·ses aujourd’hui ? Pour rééquilibrer les comptes de l’assurance-chômage ? C’est sans doute une préoccupation partagée par le gouvernement et les organisations patronales, mais l’impact financier des contrôles et sanctions apparaît bien modeste comparé à celui des changements à la baisse de la durée et du montant de l’indemnisation. Est-il si vrai que le contrôle aiguillonne les chômeurs et les chômeuses vers des démarches de recherche d’emploi plus nombreuses et plus efficaces ? Rien ne le prouve vraiment, en tout cas aucune statistique fiable. Nous montrons ensuite, à partir d’enquêtes qualitatives aux guichets du chômage [ndlr : voir le chapitre 3 de l’ouvrage] que, davantage qu’ils ne conduisent au retour à l’emploi, les dispositifs de contrôle visent à ajuster les chômeur·ses aux prescriptions institutionnelles afin d’assurer leur docilité. Nous verrons enfin que contrôles et sanctions s’inscrivent dans tout un arsenal de mesures contraignantes pour les chômeur·ses qui visent un objectif de fluidité et de flexibilité du marché du travail. C’est ce que montre notamment la rhétorique désormais omniprésente des « emplois non pourvus », qui prétend apporter une « preuve » supplémentaire que trop de chômeur·ses ne voudraient pas (assez) travailler.
Favoriser le retour à l’emploi ? L’absence de données publiques
Pôle emploi communique peu sur les résultats du contrôle de la recherche d’emploi, mais en interne, les effets du contrôle sont évalués. Comment comprendre que cette institution, qui n’est pourtant pas avare en publications statistiques, communiqués de presse et autres documents présentant son action, ne publicise pas ou seulement de façon très marginale, des données sur le contrôle de la recherche d’emploi ? Cette discrétion ne résulte pas de difficultés techniques particulières, ni d’un manque d’intérêt pour la question. Elle n’est au demeurant pas la norme parmi les différents services publics de l’emploi étrangers, comme le rappelle l’OCDE qui, publiant le taux annuel de sanction des demandeur·ses d’emploi indemnisé·es dans plusieurs pays, précise qu’elle ne dispose pas de données fiables pour la France.
La quasi-confidentialité des chiffres sur l’efficacité du contrôle n’est pas fortuite. Tout porte à croire qu’elle procède d’une stratégie désormais fréquente de la direction de Pôle emploi, qui consiste à ajuster sa communication pour limiter les critiques à son égard. Les directions des institutions de contrôle se comportent comme si l’évidence était de leur côté. Munies de lunettes néoclassiques, qui appréhendent le travail sous l’angle de la désutilité et réduisent l’emploi à une source de revenus, elles imaginent un chômeur maximisateur susceptible d’être aiguillonné à coups de bonus/malus. En témoignent les réformes successives de l’assurance chômage depuis les années 1980. L’essentiel des chiffres publicisés sur le comportement des demandeur·ses d’emploi sont produits dans le cadre d’études économétriques qui ne discutent jamais le postulat du/de la chômeur·se cherchant à maximiser son intérêt. Si les chiffres disponibles sur le contrôle et ses effets sont rarement rendus publics, c’est qu’ils battent en brèche ce cadrage et la pression exercée sur les chômeur·ses qui en découle. Ils démontrent en effet que, dans leur écrasante majorité, ils et elles cherchent bien activement du travail.
Le fait que les données ne soient pas collectées de manière systématique et l’absence de séries statistiques qui en découle limitent la possibilité de remettre en cause ou au moins de discuter, chiffres à l’appui, l’argument de la « remobilisation ». Si on s’en tient aux résultats obtenus depuis la généralisation des plateformes de contrôle de la recherche d’emploi en 2015, il n’y a pas eu de publications régulières et les chiffres ne sont pas comparables sur le temps long. De plus, il s’agit de chiffres descriptifs de l’activité de contrôle et non d’une étude des effets du contrôle.
Objectiver les effets du contrôle n’est donc pas chose aisée. D’abord du fait du déficit de chiffres. Mais aussi parce que la définition même des « effets » ne fait pas consensus. En effet, si la littérature économétrique met bien en évidence les effets bénéfiques des « incitations négatives », c’est-à-dire des sanctions, sur la reprise d’emploi, ces résultats sont le plus souvent constatés à de très petites échelles et souffrent de biais majeurs lorsqu’ils sont généralisés. La pression sur les chômeur·ses peut conduire des individus à retourner au travail, mais elle ne crée pas d’emploi. Lorsque c’est le cas, ils et elles « prennent » donc l’emploi potentiel d’autres chômeur·ses. Mais cette pression les conduit surtout à basculer vers d’autres statuts (maladie, formation, inactivité).
Les travaux de sociologie et de science politique sur le sujet, principalement américains, montrent la faiblesse des effets du contrôle au niveau macroéconomique, et surtout ses retombées néfastes sur les individus ciblés. Les contrôles et les sanctions précarisent les chômeur·ses, qui sont enjoint·es de reprendre des emplois sous-payés, pour éviter de se retrouver privé·es temporairement voire durablement de leurs allocations en cas de refus. Les contrôles conduisent également à des reprises d’emploi plus rapides mais moins stables du fait d’effets de mismatch, de désajustements entre les qualifications des travailleur·ses et les postes qu’ils et elles occupent. En découlent alors des risques accrus de turnover dans les entreprises, qui peut même fragiliser leur productivité, voire celle de l’économie des secteurs d’activités concernés. Du reste, celles et ceux-là mêmes qui conçoivent et mettent en œuvre ce type de politiques ne sont pas dupes des limites de leur efficacité. Ainsi, un cadre de la direction générale de Pôle emploi proche du dossier en interne nous confie : « la sanction n’a jamais été un levier de motivation chez le demandeur d’emploi » (entretien du 18 mai 2021).
De manière éloquente, le rapport de préfiguration du nouvel opérateur public de traitement du chômage, publié en avril 2023, pointe l’absence de données sur les effets du contrôle et donne comme « ambition [à] France Travail d’évaluer l’impact [des sanctions] sur le retour à l’emploi ». Mais encore une fois, cette absence tient sans doute au fait que les chiffres sont têtus, et ne vont guère dans le sens des politiques de contrôle. Ainsi, lorsque pour saisir l’influence des contrôles sur les chances de retour à l’emploi, Pôle emploi compare les personnes contrôlées et celles qui ne l’ont pas été, les différences (et donc l’impact des contrôles) apparaissent minimes, surtout s’agissant des emplois durables. Les taux de retour à l’emploi des contrôlées ne sont supérieurs que d’un à trois points de pourcentage. Un si maigre résultat interpelle quant à la mobilisation de 600 emplois à temps plein.
Pôle emploi, gardien de « l’employabilité »
Dans ce cadre de plus en plus contraignant, les contrôleur·ses de Pôle emploi opèrent quotidiennement des « jugements d’employabilité » pour tenter d’objectiver la probabilité de retour à l’emploi des chômeur·ses. L’enjeu est alors, pour les contrôleur·ses, de faire la part des choses entre ce qui relève du comportement du ou de la demandeur·se d’emploi et ce qui n’en dépend pas. Ces agent·es se fondent pour cela sur leur connaissance du segment de marché visé par l’individu contrôlé, plus ou moins étayée par les données disponibles, mais aussi sur leurs propres représentations de l’état de ce même segment de marché. Ils s’efforcent d’identifier les raisons, contextuelles ou plus personnelles, qui permettent de rendre compte de la situation de chômage et de l’éventuelle responsabilité personnelle du ou de la chômeur·se dans cette situation.
Mais sur quoi se fondent ces jugements ? Sous l’influence majeure des travaux d’économie néoclassique notamment, la norme d’« employabilité » qui prévaut depuis le milieu des années 1980 dans les politiques sociales et d’emploi fait largement primer les déterminants individuels du chômage sur ses causes globales. Autrement dit, c’est d’abord et avant tout dans le comportement (inadapté, inefficace, voire fainéant) de chaque individu que la cause du chômage est recherchée.
Il en découle que ce sont d’abord des solutions individuelles qui sont prescrites. Elles concernent des façons spécifiques de chercher un emploi qui soient tangibles pour les contrôleurs·ses. En pratique, il s’agit ainsi davantage de s’assurer que les chômeur·ses satisfont aux exigences institutionnelles que d’organiser leur retour effectif à l’emploi. Cette approche conduit en effet à prescrire des manières de chercher du travail qui cadrent avec le fonctionnement bureaucratique, alors même qu’elles sont loin d’être toujours efficaces. Pour les moins qualifié·es, l’incitation à produire des preuves de leur recherche d’emploi tend à déporter leurs démarches des réseaux interpersonnels vers les canaux formels. Or, ces canaux formels sont connus pour être moins efficaces pour ce type d’emploi. Ceci peut conduire à limiter le retour à l’emploi des femmes, des jeunes et des moins diplômé·es – majoritairement issu·es des classes populaires. Dans ces conditions, le contrôle peut produire des effets contraires aux objectifs officiellement affichés.
Le contrôle s’avère ainsi symptomatique des relations entre Pôle emploi et ses usager·res. Cet organisme n’est pas organisé comme un service public : c’est une institution qui instaure des relations marquées par la crainte et la contrainte (y compris du côté de ses agent·es, souvent réticent·es à nous répondre de peur de sanctions par leur hiérarchie). Pour ce qui les concerne, les chômeur·ses jugent le plus souvent l’accompagnement défaillant ou insuffisant (rareté des entretiens, convocations à suivre des ateliers externalisés jugés inadaptés, offres d’emploi reçues qui ne correspondent pas à l’emploi recherché, etc.), sans compter que les conditions d’éligibilité à la prise en charge d’une formation sont très restrictives. L’indemnisation concerne de moins en moins de demandeur·ses d’emploi, tandis que son montant et sa durée diminuent (cf. infra). Autant d’éléments qui contribuent à ce que les demandeur·ses d’emploi ne perçoivent pas cette institution comme un appui pour rechercher un emploi, et particulièrement pour se reconvertir. La montée en puissance des objectifs de « retour rapide à l’emploi » et de pourvoi des « pénuries de main-d’œuvre » accentue cette dimension coercitive.
Réformer l’assurance-chômage, renforcer les contraintes
Le contrôle n’est que l’un des outils mobilisés par le service public de l’emploi pour remettre au travail les demandeur·ses d’emploi. Il s’inscrit dans un ensemble de dispositions qui, mises bout à bout, participent à faire augmenter la pression sur les chômeur·ses. Parmi ces initiatives figurent les réformes successives qui ont réduit les droits à l’indemnisation chômage, mais aussi des programmes de lutte contre les difficultés de recrutement sur les « métiers en tension », différents plans de lutte contre le chômage de longue durée ainsi que les réécritures successives du Code du travail.
La réduction des ressources des chômeur·ses, et particulièrement la réduction des droits à l’assurance chômage, a été l’un des principaux leviers mobilisés depuis 2017 pour mettre au travail les demandeur·ses d’emploi. D’une manière générale, les prestations sociales (dont le RSA et l’ASS) sont revalorisées chaque année en avril en fonction de l’inflation constatée. Si une revalorisation de 4 % a été exceptionnellement accordée en juillet 2022, les associations regroupées au sein du collectif Alerte dénoncent le caractère insuffisant des revalorisations actuelles, qui entraînent un appauvrissement des bénéficiaires de ces prestations sociales. Concernant l’ARE, une revalorisation de 2,9 % est intervenue au 1 er juillet 2022 avant une revalorisation exceptionnelle de 1,9 % au 1 er avril 2023. Si des mesures spécifiques sont prises pour faire face à la crise provoquée par l’inflation, les montants de revalorisation sont très inférieurs à la hausse des prix mesurée par l’Insee. Cette dégradation de la situation financière des demandeur·ses d’emploi intervient alors même que les inscrit·es à Pôle emploi sont davantage touché·es par la pauvreté monétaire que le reste de la population. Ainsi, en 2019, 38,9 % des chômeur·ses se trouvent en situation de pauvreté monétaire, alors que 6,8 % des salarié·es sont dans une telle situation.
Plus spécifiquement, l’assurance chômage a, depuis 2017, fait l’objet de réformes quasi continues qui ont profondément modifié son fonctionnement institutionnel ainsi que les droits des allocataires. Sur le plan institutionnel, la période a été marquée par une reprise en main par l’État de cette institution paritaire. Cette « étatisation » a consisté, d’une part, à remplacer une partie des cotisations (la part dite « salariale ») par un impôt (la contribution sociale généralisée, CSG) et, d’autre part, à réduire les prérogatives des organisations syndicales et patronales en matière de négociation des règles d’assurance chômage. Le financement du chômage partiel lors de la crise du Covid-19 est symptomatique du rapport que l’exécutif entretient avec cette institution paritaire : le gouvernement a imposé à l’Unédic de financer un tiers des dépenses d’activité partielle sans laisser de place aux organisations syndicales et patronales dans les décisions prises. Les réformes de 2017 et 2019-2021 ont également eu pour effet de réduire les droits des salarié·es à l’emploi discontinu. En 2017, cela est passé par une modification de la comptabilisation des jours travaillés pénalisante pour les salarié·es en contrats courts. Outre le durcissement des conditions d’éligibilité, la réforme de 2019-2021 a modifié en profondeur le calcul du salaire de référence et donc de l’allocation. En intégrant les jours non travaillés au calcul du désormais mal nommé « salaire de référence », ce nouveau règlement pénalise chaque salarié·e qui cumule des jours non travaillés au cours de la période prise en compte dans le calcul. Ce nouveau mode de calcul réduit en moyenne le montant de l’allocation de 16 %, cette réduction pouvant aller jusqu’à 50 % pour certain·es allocataires. Cette réforme a été justifiée par la volonté affichée de mettre fin aux prétendus comportements d’optimisation des travailleur·ses en contrats courts qui « choisiraient » la précarité plutôt que du CDI pour « profiter » de leurs indemnités chômage.
Une nouvelle réforme entrée en vigueur en février 2023 s’attaque désormais à la durée de l’allocation : elle réduit de 25 % la durée de l’allocation pour l’ensemble des allocataires. Ainsi, un·e allocataire qui disposait avant la réforme de 12 mois d’indemnisation ne sera plus indemnisé·e que 9 mois. Cette réforme a pour effet de diminuer encore la part des indemnisé·es parmi les inscrit·es à Pôle emploi, sachant qu’elle atteint déjà cette année un taux historiquement faible de 38 % (source : Pôle emploi). Sur le papier, cette réduction de la durée d’indemnisation serait supprimée (avec un retour à la durée antérieure) en cas de dégradation de la conjoncture économique. Là encore, l’existence de tensions de recrutement a été l’argument avancé pour justifier une réduction de la durée d’indemnisation afin d’accélérer le retour à l’emploi. Depuis le milieu des années 2010, les justifications politiques du renforcement des contrôles (qu’il s’agisse d’augmenter leur nombre ou leur sévérité) reposent sur un argumentaire pour partie renouvelé : puisque coexistent un nombre important de demandes d’emploi et d’offres d’emploi non pourvues, et puisque les employeur·ses se plaignent de difficultés de recrutement, c’est bien la preuve que des demandeur·ses d’emploi choisissent de ne pas travailler. Il faudrait donc les « inciter », y compris en les menaçant de sanctions, à occuper les emplois (théoriquement) vacants plutôt qu’à rester (« confortablement ») au chômage.
Parmi les autres outils mobilisés dans la dernière période pour mettre au travail les demandeur·ses d’emploi, un nouveau plan de remobilisation des chômeur·ses de longue durée a été déployé à partir de fin 2021. Si, en soi, accompagner les demandeur·ses d’emploi de longue durée ne peut être tenu pour une mesure de mise au travail, il s’avère, dans ce cas précis, que cela s’est traduit par des pratiques coercitives de convocation et de radiation en cas d’absence. Ces différents outils de mise au travail des demandeur·ses d’emploi servent quatre objectifs principaux. Premièrement, l’objectif est d’accélérer le retour à l’emploi aussi bien pour réduire les dépenses d’indemnisation que pour diminuer les tensions de recrutement. Deuxièmement, il s’agit de conduire les demandeur·ses d’emploi à ne pas s’inscrire à Pôle emploi ou à se désinscrire afin de faire baisser les chiffres du chômage et l’ensemble des dépenses (indemnisation, accompagnement) associées à leur inscription. Un rapport de la Dares estime qu’entre novembre 2018 et novembre 2019 le taux de non-recours à l’assurance chômage se situe entre 25 et 42 % des privé·es d’emploi éligibles à une indemnisation. Troisièmement, durcir la situation des chômeur·ses est l’un des nombreux leviers existants pour inciter les actif·ves en général, et les inscrit·es à Pôle emploi en particulier, à préférer la création d’entreprise et notamment l’auto-entreprenariat plutôt que la recherche d’un emploi salarié. Quatrièmement, dégrader la situation des demandeur·ses d’emploi a pour conséquence de faire pression sur les salarié·es en poste. Cette pression s’exerce de différentes manières. D’une part parce que la situation des chômeur·ses fait figure de repoussoir eu égard à la stigmatisation dont ils font l’objet. Si la perspective pour les salarié·es en cas de chômage est d’être non ou mal indemnisé·es et de subir un accompagnement coercitif au retour à l’emploi, cela incite, dans la mesure du possible, à rester en poste ou du moins à être au chômage le moins longtemps possible. À la peur de « tomber » au chômage s’ajoute ainsi celle de devoir traiter avec une institution aux pratiques de plus en plus coercitives. D’autre part, la pression sur les salarié·es vient de ce qu’au regard de leur situation, les chômeur·ses sont contraint·es d’accepter des emplois aux conditions de travail difficiles. Alors que les tensions sur le recrutement pourraient donner lieu à la création d’un rapport de force favorable aux salarié·es pour obtenir des augmentations de salaire et l’amélioration des conditions de travail, la pression exercée sur les demandeur·ses d’emploi contribue à affaiblir les actif·ves en exerçant une pression à la baisse sur les salaires.

Alors que les tensions sur le recrutement pourraient donner lieu à la création d’un rapport de force favorable aux salarié·es pour obtenir des augmentations de salaire et l’amélioration des conditions de travail, la pression exercée sur les demandeur·ses d’emploi contribue à affaiblir les actif·ves en exerçant une pression à la baisse sur les salaires. Le lien entre conditions des chômeur·ses et niveau de salaire a déjà été démontré dans le cas de l’Allemagne, par exemple. Ainsi, les salaires des 15 % des salarié·es les moins bien rémunéré·es ont baissé de plus de 9 % sur la période 2003-2008 et le pouvoir d’achat du salarié médian a baissé, alors que l’Allemagne a dans le même temps connu une période de croissance économique et de baisse du chômage.
Chômeurs, vos papiers ! Contrôler les chômeurs pour réduire le chômage, Claire Vivès, Luc Sigalo Santos, Jean-Marie Pillon, Vincent Dubois et Hadrien Clouet, éditions Raison d’Agir, 13,00 €