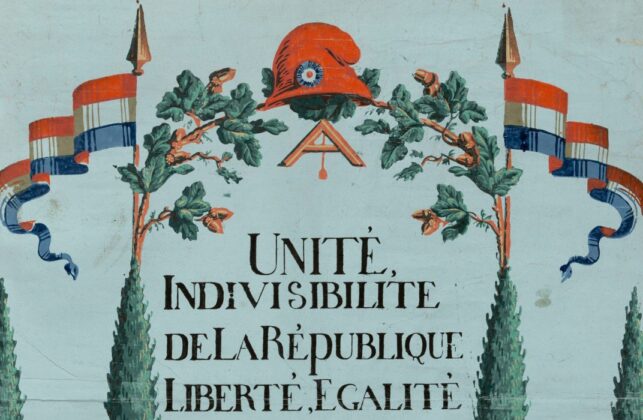Cette période de scandales autour des EHPAD, de débats relatifs aux retraites ou à la préservation des personnes âgées en temps de Covid, a soulevé des interrogations concernant les politiques publiques à l’égard des retraités. Dans son ouvrage Vieillir à Cuba (IHEAL, 2022), la sociologue Blandine Destremau nous immerge dans le système cubain de traitement de la vieillesse. À travers de riches entretiens, récits et analyses, elle fait des personnes âgées les témoins de la Révolution cubaine et des transformations sociales du pays ces soixante dernières années. En miroir – et sans manichéisme aucun – elle conduit à réfléchir à la condition des retraités dans les pays occidentaux. Avec une question fondamentale : « Quelle combinaison d’amour, de nécessité et de faille des politiques publiques » requiert ce sujet ? Entretien par Maïlys Khider, autrice du livre Médecins cubains : Les armées de la paix (LGM éditions, 2021).
LVSL – Pourquoi vous êtes-vous intéressée à la question de la vieillesse à Cuba ?
Blandine Destremau – Le sujet de la vieillesse a surgi dans mes recherches. Je travaillais sur la protection sociale et la famille, avec pour interrogation : « qu’est-ce qu’une politique sociale socialiste ? ». Je me suis rendue compte que la présence des personnes âgées dans les familles absorbait beaucoup d’énergie. J’ai alors commencé à me pencher davantage sur les politiques publiques liées à l’accompagnement de la vieillesse par les familles. C’est une entrée fascinante sur Cuba. Il y a une classe d’âge entière dont le vécu dit de nombreuses choses sur l’accès aux biens, aux services, sur l’organisation de la famille. Certains ont vécu soixante ans de révolution et portent sa mémoire. Ils ont conscience de ce qui a changé, en mieux ou en pire. Cela donne une profondeur de champ sur l’histoire de la révolution et sur des trajectoires personnelles.
La vieillesse est un prisme important pour regarder Cuba. Et Cuba est un prisme important pour considérer la vieillesse. Mes déplacements d’un terrain à l’autre m’ont permis de remettre en cause des évidences. Les Cubains m’ont parfois formulé des réflexions telles que : « vous mettez tout le monde en EHPAD chez vous ! ». En France, nous n’étudions pas assez la contribution de la famille à la prise en charge des personnes âgées – ce que l’exemple cubain permet de penser. À l’inverse, si l’on ne veut pas d’institutions de type EHPAD, on sacrifie forcément un membre plus jeune de la famille. Réfléchir à partir de deux lieux met notre système en perspective.
LVSL – La population cubaine est vieillissante. Pourquoi ? Et en quoi cela témoigne-t-il d’évolutions sociales et médicales à Cuba ?
BD – La baisse de la fécondité est le premier facteur de vieillissement. Après un petit boom de naissances dans les années 1970, les femmes ont fait beaucoup moins d’enfants. C’est dû à leur émancipation, elles qui ont eu le choix d’avoir un autre destin que celui d’être mère, et à un accès aux contraceptifs et à l’avortement depuis 1965. Les difficultés de logement et à se projeter dans l’avenir, la pauvreté, ont aussi pu dissuader de faire des enfants.
Le « care », l’attention non médicale, n’a pas réellement été pensée. Pourquoi ? Parce qu’elle est principalement prise en charge dans le cadre familial et surtout par les femmes
Le deuxième facteur de vieillissement est la longévité, en lien direct avec les progrès d’un système de santé fortement égalitaire. Tout le monde a accès aux services de soins. Au sein de toutes les classes sociales, la durée de vie s’est accrue. Troisième facteur : la migration. Ceux qui s’en vont sont principalement des jeunes en âge de travailler et de procréer. Et la migration s’intensifie depuis un ou deux ans. Elle affecte notamment les zones où la culture sucrière est en recul depuis la fin des années 1990. C’est d’abord de ces endroits-là que les gens partent (vers les grandes villes cubaines et d’autres pays).
LVSL – Cuba est un pays de cohabitation entre les générations. Beaucoup d’adultes (parents pour certains), vivent avec leurs ascendants. Cette cohabitation est-elle culturelle, due à un manque de moyens, ou à un mélange des deux facteurs ?
BD – A Cuba, il n’est pas automatique de quitter le logement de ses parents en devenant adulte et en ayant soi-même des descendants. Les parents ne mettent pas leurs enfants dehors. Ils aident beaucoup les générations d’en-dessous. Et vice-versa. Cela structure la prise en charge du vieil âge à Cuba. La famille doit s’occuper de ses parents âgés, quel que soit le prix en termes de carrière – surtout celles des femmes.
En plus de cela, les filles pensent avoir besoin de leur mère pour élever leurs propres enfants. Cette solidarité intergénérationnelle entre femmes est culturelle. Mais elle est aussi économique. De nombreux adultes ne peuvent pas déménager à Cuba car il n’y a pas suffisamment de logements disponibles. Par ailleurs, la vie quotidienne est tellement compliquée par les problèmes d’approvisionnement qu’une mère avec ses enfants seule, même avec un conjoint, peut difficilement s’organiser pour tout gérer. Les conditions matérielles à Cuba ne permettent pas réellement la conciliation entre travail et organisation du foyer. Cohabiter permet une économie de temps.
La cohabitation est une solution à l’impossibilité de vivre seul(e), avec une pension de retraite ou un salaire insuffisant. Les personnes âgées ont des difficultés car ils encaissent la crise plus que d’autres : les pensions ne sont pas indexées sur la dévaluation monétaire et l’inflation. D’un autre côté, en termes de services, ils ont un accès prioritaire à la santé. La gérontologie a été assez précoce et est toujours là. Mais la crise affecte le système de santé, pour eux comme pour les autres. Les pénuries de médicaments les touchent. La désorganisation du système de transport aussi, d’autant plus parce qu’ils sont moins en capacité de marcher.
LVSL – En 2011, une réforme de la propriété immobilière est intervenue. A-t-elle favorisé le déménagement de jeunes et une nouvelle organisation de cette cohabitation ?
BD – La propriété des logements n’a pas été abolie par la Révolution, contrairement à la propriété privée des moyens de production. Fidel Castro en avait fait le choix. Une propriété pouvait être échangée. Quelqu’un qui avait un appartement de deux pièces en centre-ville et voulait avoir des enfants pouvait l’échanger à une autre famille contre une maison avec jardin en banlieue. Cela s’appelle une permuta (échange, opération de troc).
En 2011, le marché immobilier a été ouvert. La possibilité d’acheter et de vendre a été introduite. Cela a permis davantage de mobilité, d’accumulation, d’investissement d’argent extérieur notamment dans des locations de tourisme. Des Cubains ont pu vendre leur maison pour partir aux États-Unis. En termes d’organisation familiale, cela a permis que la génération de jeunes adultes quitte parfois le microscopique logement partagé avec les parents et achète un appartement. De nouvelles mobilités se sont développées pour les gens qui en avaient les moyens. Des parents ont vendu des biens dont ils avaient hérité, ont donné l’argent à leur enfant pour qu’il déménage. Depuis, il existe un peu plus de souplesse dans les stratégies patrimoniales et résidentielles.
LVSL – Dans de nombreux pays, le recours à des aides à domicile est fréquent pour s’occuper des personnes âgées. Cette aide à domicile est-elle un angle mort de la médecine cubaine ? Le recours à des aides privées est-il devenu facteur d’inégalités ?
BD – Ce n’est pas un angle mort de la médecine. C’est un angle mort de la société. Il existe à Cuba des établissements que l’on appelle hogares de ancianos (établissements résidentiels pour personnes âgées). Mais ils sont essentiellement destinés aux gens qui n’ont pas de famille pour s’occuper d’eux (ils peuvent accueillir également d’autres personnes).
Sur l’île, les services publics se sont développés, donnant accès au cure (soin). Mais le care, l’attention non médicale, l’aide, n’a pas réellement été pensée. Pourquoi ? Parce qu’elle est principalement prise en charge dans le cadre familial et surtout par les femmes. De nombreuses Cubaines cessent de travailler à 45 ou 50 ans pour s’occuper de leurs parents. Aujourd’hui, cette question est de plus en plus politisée. Elle commence à être posée comme un enjeu féministe. Puisqu’il faut trouver des solutions, le ministère de la Santé commence à dire qu’il faut s’en occuper. J’étais à une convention de santé en octobre à Cuba. Ils sont en train d’en faire un objet partagé entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Santé.
De plus en plus d’aides à domicile privées (une branche spécialisée des métiers d’auto-entrepreneurs autorisés), notamment des infirmiers et des infirmières, démissionnent et font de l’aide à domicile puisqu’ils gagnent plus d’argent. Il y a aussi des gens qui font du ménage, et qui, en plus de nettoyer, s’occupent des grands-parents. À Cuba, il existe un dispositif pour rémunérer les aidants familiaux d’enfants handicapés qui ne peuvent plus travailler. Mais la paie est très basse. Petit à petit, cela s’étend à la situation d’aidants familiaux de personnes âgées. À nouveau, c’est un emploi mal rémunéré – et qui concerne peu de Cubains. Ce qui s’est développé (mais de façon insuffisante), ce sont les aides à domicile pour les personnes âgées qui vivent seules. Mais les salaires sont bas, et en concurrence avec l’activité privée. Donc seules les personnes qui ont des revenus de l’étranger ou des revenus du « marché » ont accès au luxe d’une aide à domicile privée…
Les Cubains qui ont choisi de ne pas quitter leur pays ont dû payer un certains prix, notamment en termes de confort. L’homme nouveau, après tout, accepte un certain degré de sacrifice pour la promesse d’un nouveau modèle.
LVSL – Cette cohabitation est un laboratoire intéressant pour mesurer le fossé générationnel entre ceux qui sont nés avant ou au début de la Révolution et des jeunes qui rêvent parfois d’autre chose. Quelles différences de vision entre jeunes et vieux avez-vous pu constater ?
BD – Beaucoup de Cubains sont restés dans leur pays par conviction révolutionnaire. Alma, que je cite dans mon livre, a grandi avec une mère communiste qui a souhaité rester alors que son mari travaillait pour une entreprise étasunienne, possédait une voiture, bref, appartenait à la bourgeoisie. La famille a adhéré à la Révolution. Alma a trouvé fantastique le développement de la culture, des bibliothèques, du cinéma, du théâtre. Une autre interviewée devait aller étudier dans une grande université étasunienne, mais elle est restée. Ce fut aussi le cas d’Eduardo, médecin qui a refusé de quitter l’île pour s’occuper de ses parents âgés alors que son père, cardiologue, lui disait de s’en aller.
Pour ne pas laisser leur pays, ils et elles ont payé un certain prix. Notamment en termes de confort. Dire à 70 ou 80 ans « j’ai fait cela, j’ai cru à cela » est une manière de justifier ses choix de vie. L’homme nouveau [1], après tout, accepte un certain degré de sacrifices pour une promesse – une promesse pour soi, une promesse éthique, et la promesse d’un nouveau modèle. Alma me disait : « on a vécu une grande aventure. Quand j’ai commencé l’université, j’avais deux robes mais c’était fantastique. Sans cela, nous aurions été des petits bourgeois ».
Les plus jeunes n’ont pas participé à cette aventure fantastique. Ils ont hérité de choses et de services dont ils ne réalisent pas toujours la valeur. Car ils ne comparent pas les conditions de vie à celles du Guatemala ou de pays très pauvres d’Amérique latine, mais avec les États-Unis. Même si la santé ou l’éducation se dégradent, il est difficile pour eux de mesurer le progrès que ce système a amené. Lorsqu’on est pauvre, on a besoin de sécurité. La sécurité permet la liberté. Et on ne peut pas faire grand chose de la liberté sans sécurité.
La jeune génération a une relative sécurité même si celle-ci est incertaine (chaque jour, impossible de savoir si elle va trouver de la viande ou pas, les queues s’enchaînent, c’est une galère quotidienne). Mais ils ont un pays relativement stable, sans guerre civile, avec du logement, de la nourriture, des soins de santé, une école qui fonctionne. Avec la crise du système, cependant, il apparaît moins aujourd’hui comme la promesse d’un avenir plus juste et plus éthique.
LVSL – Quelles aspirations les jeunes vous ont-ils exprimé ?
BD – Je pense qu’une bonne partie des jeunes ont envie de consommation, de liberté d’échange, de communication, sans nécessairement se poser des questions sur le sens de tout cela. La question du sens à Cuba a été accaparée par la Révolution. Tout le monde était enjoint de n’avoir d’autre sens à sa vie que la Révolution.
Les jeunes en général veulent surtout avoir une sécurité matérielle sans devenir de gros consommateurs. Dans les familles que je vois, les enfants possèdent parfois de nombreuses choses inutiles mais qui font partie d’un confort et d’une sorte de dignité de classe moyenne. Bien sûr, certains jeunes que j’ai rencontrés sont très impliqués politiquement. À l’instar de Mario, membre d’un projet communautaire. Ils ont installé une espèce de squat dans un quartier assez pauvre. Ce sont des idéalistes. Ils veulent maintenir un projet social et socialiste. Mario est pauvre. Mais il se met au service de cela.
LVSL – Chez les personnes âgées, avez-vous constaté des volontés de transformation ? Des aspirations des plus jeunes que vous avez retrouvées chez eux ?
BD – Bien sûr. Il y a tout un mouvement autour de la revue Temas tenue par des gens qui ont vécu la Révolution, sont politiquement très engagés, et luttent pour réformer le socialisme, lui rendre son âme, son élan, sa force, son enthousiasme, et pour le décentraliser, le débureaucratiser. Pour trouver des solutions matérielles à la vie des gens. L’idée de socialisme se noie dans la vie quotidienne. C’est comme un couple qui s’aime beaucoup et rompt car il n’a pas décidé qui ferait la vaisselle. Il y a un décalage d’amplitude. Plusieurs générations s’impliquent pour que le seul avenir ne soit pas celui d’un capitalisme périphérique, avec de fortes inégalités, une grande pauvreté, de la prostitution. Et que les jeunes aient d’autres espérances que celle de migrer. C’est encore plus triste pour les Cubains puisque cet ailleurs, ce sont souvent les États-Unis, qui ont contribué aux échecs de la Révolution cubaine.
LVSL – Jeunes et vieux vivent-ils les crises de la société cubaine de la même manière, selon ce qu’ils vous ont raconté ?
BD – Ce qui est difficile, ce sont les pénuries. Pour les personnes âgées, cela peut représenter un épisode de plus dans l’histoire de la Révolution cubaine, ponctuée par les crises. Il y a eu l’âge d’or des années 1980, mais les années 1970 et 1990 ont été très difficiles. Les plus âgés ont l’habitude de ces crises. Les vieux ont aussi une forte conscience du poids de l’embargo. Les jeunes en ont ras-le-bol que l’on mette tout sur le dos de l’embargo, quand ils voient bien que le système productif s’écroule, que l’agriculture est en déshérence, que la distribution ne fonctionne pas bien. Ceux-là n’acceptent pas que ces pénuries-là aillent de paire avec le système socialiste.
Autre point, de la part de personnes âgées, j’ai entendu plusieurs fois qu’il était difficile d’accepter l’humiliation que représente la vieillesse pauvre et éventuellement dans la solitude. J’ai récolté plusieurs témoignages en ce sens : « ma mère est très engagée, elle a soutenu la Révolution, accompagné les crises, et regarde comment elle vieillit ! ». Les vieux le disent eux-mêmes. La promesse, c’était aussi un système de retraite. Que la société puisse répondre à des besoins qui se développent avec l’âge. À Cuba, les gens meurent âgés. L’espérance de vie y est supérieure à celle des Etats-Unis. Mais justement, que faire quand on a 80 ans et qu’on est à Cuba ? On ne peut pas être que vivant.
Notes :
[1] ”L’homme nouveau” est un terme utilisé par Ernesto Guevara pour décrire l’homme modelé par le socialisme, éduqué, émancipé, capable de défaire la domination capitaliste et façonnant des rapports nouveaux entre les hommes.